Introduction par Rémi Beau et Virginie Maris
La récente disparition de Raphaël Larrère est une triste nouvelle. La pensée écologique perd un précieux compagnon de route qui n’a cessé d’aiguillonner ses développements par ses activités de chercheur, d’auteur et d’éditeur. Des études rurales à l’histoire de la protection de la nature, en passant par les éthiques environnementales et animales, Raphaël Larrère a arpenté une grande diversité de territoires géographiques et conceptuels, dessinant une trajectoire libre et singulière dans le monde de la recherche. De ce dernier, il a observé, souvent d’un œil critique, les profondes transformations depuis son entrée à l’INRA dans le milieu des années 1960. Faisant peu de cas des frontières disciplinaires – il aimait à rappeler avoir été recruté en tant qu’assistant en économie sans posséder le moindre diplôme de cette discipline –, il fit de la sociologie en agronome, de l’éthique en sociologue, de l’écologie en ruraliste et de la philosophie en écologue.
Quatre grandes thématiques de recherche l’ont plus particulièrement occupé. La dynamique des systèmes agraires fut, en premier lieu, au cœur de ses travaux des années 1970, qui donnèrent lieu à plusieurs monographies régionales (le plateau de Millevaches, la Margeride, l’Aigoual). Dans les années 1980 vint le temps des études forestières, incluant l’analyse de la place des forêts dans les systèmes agraires et l’histoire de la foresterie. Au début des années 1990 s’est ouverte la période consacrée à la question environnementale qui ne l’a plus quitté. Elle l’a conduit à étudier de près, aux côtés de Catherine Larrère, la littérature anglo-saxonne des éthiques environnementales, tout en se donnant des points d’observation sur les pratiques qu’offraient notamment le Comité national de la protection de la nature, les conseils scientifiques de parcs nationaux, ou encore différents comités d’éthique. La participation aux travaux du Comité d’éthique et de précaution de l’INRA fut précisément pour lui l’occasion d’enquêter plus spécifiquement sur une quatrième thématique : l’expérimentation animale et, plus tard, la question de la conscience animale.
S’il a ainsi multiplié les terrains, les méthodes et les objets d’enquête, quelques invariants caractérisent cependant sa posture de recherche : une certaine défiance à l’égard des généralisations théoriques, le respect des connaissances scientifiques et le refus du scientisme, l’attention à la diversité des regards portés sur un milieu ou sur une question, la juste distance, enfin, permettant d’établir une proximité critique avec les différentes communautés de recherche avec lesquelles il dialoguait.
En hommage, nous republions ici un texte de la « première période », celle de Clermont-Ferrand et du Laboratoire d’économie de l’élevage de Theix (1971-1977). Il s’agit de la première monographie régionale menée par Raphaël Larrère sur le plateau de Millevaches. On y découvre son style de recherche et d’écriture, mais aussi une ligne directrice qui orientera la plupart de ses investigations en direction de nœuds de sciences, de politique et de rapports sociaux. Celle-ci consiste à mettre à l’épreuve de l’enquête des discours sur les milieux ou sur la société qui se parent d’une autorité scientifique. Dans le cas de Millevaches, le point de départ est un sérieux doute sur la valeur scientifique d’une « théorie » en vigueur décrivant des « seuils de sociabilité » en-dessous desquels un territoire serait condamné à la désertification. Associant enquête qualitative et analyse quantitative, Raphaël Larrère s’applique, contre tout déterminisme économique, social ou environnemental, à rendre compte de la complexité des logiques d’acteurs qui s’affrontent pour le contrôle de l’espace. Il s’emploie à montrer comment la rhétorique de la désertification des campagnes dramatise à dessein les transformations de l’espace rural pour mieux justifier la nécessité d’y déployer de nouveaux modes de mise en valeur. Derrière les promesses de rationalisation de l’aménagement du territoire, le texte révèle peu à peu les incertitudes économiques, agronomiques et écologiques à travers lesquelles certains acteurs puissants s’orientent, avec pour seule boussole la satisfaction de leurs intérêts de court-terme.
Si ce texte publié en 1978 peut sembler un peu daté tant il est attaché à la période de « déprise agricole » qui suivit les grandes lois d’orientation agricole du début des années 1960, certaines problématiques qui y sont introduites restent d’une actualité frappante et résonnent à de nombreux égards avec des considérations qui sont au cœur des réflexions menées au sein de la revue Terrestres.
D’abord et sous forme de clin d’œil, nous confessons un attachement de longue date à cette région qui, dans les histoires politiques et personnelles qui tissent la revue Terrestres, n’a cessé de jouer un rôle important d’inspiration, de refuge et de camaraderie. Que certains députés d’extrême-droite y voient aujourd’hui un haut lieu du « wokisme » ou une base arrière de l’ultra-gauche1 ne peut qu’ajouter à l’affection que nous portons à ce territoire.
Ensuite et de façon moins anecdotique, cet article publié en 1978 aborde une série de questions dont l’examen politique demeure absolument nécessaire aujourd’hui. Dans l’entremêlement des questions écologiques, agronomiques et sociales de cette mutation du territoire se dessinent plusieurs thèmes : le foncier, la paysannerie, la foresterie, le sauvage.

L’évidence avec laquelle l’auteur met la question du foncier au cœur de son analyse fait écho à un tournant récent de l’écologie politique, qui, à travers des collectifs comme « Reprises de terre2 » ou dans les stratégies de lutte déployées par des mouvements comme les Soulèvements de la terre, centralise la question de l’accaparement des terres. L’introduction historique de cette monographie décrit avec finesse le passage d’une gestion collective des parcours communaux à une privatisation qui mène à l’exploitation capitaliste de l’espace. Alors que nous sommes nombreux à souhaiter revitaliser « la forme commune3 », il semble opportun de comprendre ce qui a été détruit pour tenter de le réactiver. De même, l’attention portée aux enjeux de transmission des terres, l’enchevêtrement des ressors familiaux, psychologiques, politiques et économiques qui s’y trament n’est pas sans rappeler les questions que se posent aujourd’hui des structures comme Terre de liens et plus généralement celles et ceux qui tentent de soutenir l’installation paysanne face à l’agrandissement des grandes exploitations voisines ou l’accaparement des terres par des multinationales de l’agro-industrie4 et des nouvelles énergies.
Par ailleurs, cette enquête qui donne à voir la diversité des points de vue et des intérêts autour d’un même territoire témoigne de l’attention et du respect que l’auteur accorde à la paysannerie. Évitant les écueils de l’idéalisation comme de la condescendance, il rend compte de la complexité de la situation paysanne dans cette période de grandes mutations agricoles. En pleine semaine d’élections syndicales pour le monde agricole, la justesse de ce regard est inspirante. Elle permet de rappeler ce double rôle de la paysannerie, localement dans l’entretien écologique des milieux et la vitalisation sociale des territoires, à l’échelle nationale comme acteur d’une économie soucieuse de qualité et de durabilité face à la mise en concurrence mondialisée.
L’autre pôle d’action majeur de cette lutte pour le contrôle de l’espace est la foresterie. L’opposition symbolique de l’arbre et du champ se concrétise sur le plateau de Millevaches, comme, historiquement, dans de nombreux territoires de déprise agricole, sous la forme d’un rapport de force entre la puissance étatique et une société paysanne. Sur ce point, tout un pan des travaux de Raphaël Larrère s’est orienté de façon précoce vers l’analyse critique des discours forestiers, afin de débusquer derrière l’ « emphase forestière5 » l’expression utilitariste de la rationalité administrative. Si l’article rend compte de la complexité des logiques d’acteurs, une ligne d’interprétation se dégage nettement : après avoir précipité la « fin des paysans » par ses lois de modernisation agricole, l’État a appuyé le reboisement (et avant toute chose l’enrésinement) comme seule voie pérenne et rentable, pour assurer la continuité du contrôle de l’espace face à la menace qu’auraient incarné l’embroussaillement et la progression de l’inculte. La dramatisation du discours sur la désertification servait ainsi une stratégie d’annexion forestière. L’arbre ou le désert, voici l’alternative que suggéraient les politiques incitatives de reboisement et contre laquelle se positionnait l’article en déconstruisant la prétendue « assise scientifique » de ce déterminisme économique. Quelque cinquante ans plus tard, la lutte contre l’extractivisme forestier se poursuit et s’intensifie face aux poussées nouvelles de l’industrialisation de la filière bois6.
Un autre intérêt contemporain pour cet article peut venir, paradoxalement, de ce dont il ne parle pas ou qu’il peine à nommer dans le contexte intellectuel des années 70. Alors que Raphaël Larrère dédiera une grande partie de sa vie à penser et à défendre la nature, le monde sauvage n’est encore désigné dans ce texte que de façon négative, sans que l’on puisse déceler avec clarté quelle relation l’auteur lui-même entretient avec ces formes spontanées de réensauvagement. D’un côté, l’enfrichement est clairement associé à une dégradation des milieux, il est question de terres « incultes », et les propos de la DDA qui parle « d’une nature sauvage franchement hostile » sont cités sans prise de distance particulière. Il est partout question de « mise en valeur » des milieux et l’alternative elle-même portée par le titre de l’article entre désertification et annexion de l’espace rural semble captive d’une vision strictement anthropocentrée de la valeur des espaces. Et pourtant, pour qui chercherait les prémisses des engagements à venir de Raphaël Larrère, l’attention qu’il porte à l’écologie des milieux et la distance qu’il prend par rapport aux discours catastrophistes de la désertification témoignent tout à la fois de sa connaissance fine de la nature et de sa confiance dans la possibilité d’en faire « bon usage7 ». Il faudra quelques décennies encore, dans la carrière du chercheur et plus largement dans la société, pour que pointe l’idée que l’on puisse éventuellement passer d’un « bon usage » au « non-usage ». Les engagements de Raphaël Larrère dans le groupe de travail « Wilderness et nature férale » de l’UICN ou son inlassable dévouement auprès des parcs nationaux témoignent amplement de cette trajectoire. Finalement, la confiance de l’auteur dans la réversibilité des cycles d’usages paysans et de déprises des terres pointe vers une conclusion qui reste d’actualité : sur le plateau de Millevaches comme ailleurs, ce n’est pas plus le monde sauvage que la paysannerie qui menacent les conditions d’habitabilité, écologiques et sociales, de nos milieux de vie. C’est l’appropriation capitaliste des terres et son instrumentalisation radicale de la nature.
Nous espérons qu’en partageant avec vous ce texte un peu long mais ô combien inspirant, nous contribueront à faire connaître et vivre la pensée de cet inlassable arpenteur des espaces ruraux, des milieux naturels et champs intellectuels qui, par son amitié et son exigence scientifique, n’a cessé de nous inspirer et nous inspirera longtemps encore.
Rémi Beau et Virginie Maris – Jeudi 16 janvier 2025

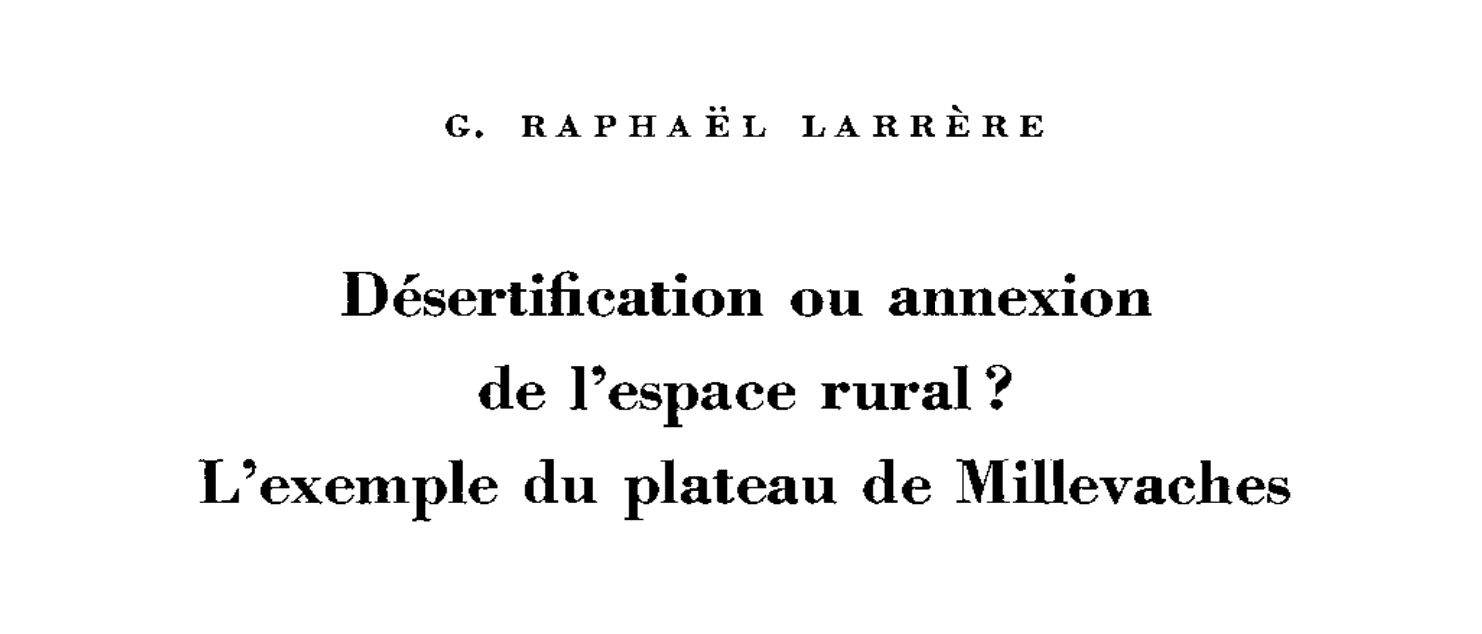
De la fin du Moyen Âge au début de notre siècle, les paysans de Millevaches associèrent une céréaliculture de maigre subsistance à l’utilisation pastorale de vastes landes communales. Pauvre pays que ce plateau, dont l’histoire fut jalonnée de disettes. Pauvres ces habitants qui devaient émigrer chaque été et s’employer comme maçons.
Justement, à la fin du XIXe siècle, le marché du travail se transforme. L’émigration saisonnière décline. L’exode la remplace. Le statut communal des parcours est remis en cause par la nécessité, pour ceux qui restent au pays, de développer la production marchande. Alors, les communaux sont divisés entre les ayants droit. Les prés et les pâtures gagnent sur les terres et les landes, et les parcelles marginales sont boisées. Ainsi, les paysans réorganisent leur espace, tirant parti des aptitudes herbagères et ligneuses de la région.
Mais, depuis une quinzaine d’années, se manifeste un repli généralisé de cette mise en valeur agricole. Les paysans perdent le contrôle d’un sol où progressent les friches et plus encore les plantations d’épicéas qu’effectuent des propriétaires — pour la plupart citadins. À cette mutation correspond un dépeuplement prononcé. Les habitants parlent de leur région comme d’un pays qui se meurt…
Le plateau de Millevaches va-t-il donc devenir, à plus ou moins brève échéance, un « désert » agricole, couvert de broussailles et de forêts ; un territoire abandonné, ou mal entretenu par des propriétaires absentéistes ? Sommes-nous à la fin d’une histoire ?
Il s’avère que nous sommes plutôt à une croisée des chemins. Ce territoire, que les paysans ne parviennent plus à contrôler, est un espace convoité. D’autres catégories sociales y inscrivent le mode de mise en valeur qui correspond à leurs objectifs économiques. Les transformations contemporaines ouvrent la voie à de nouvelles formes de production, à une nouvelle organisation de l’espace, tendant à faire du plateau une des principales réserves ligneuses de l’industrie.
Les transformations du système agraire sur le plateau de Millevaches
Le système agropastoral
Au XIXe siècle, le plateau de Millevaches est un pays granitique de vastes landes, avec des oasis de verdure aux abords des hameaux. Dans cette contrée isolée, juste effleurée par le chemin de fer (à partir de 1850), les habitants doivent d’abord pourvoir au pain, et sur les terroirs les plus accessibles, ils pratiquent une céréaliculture d’auto-subsistance. Le seigle revient tous les deux ou trois ans, alternant avec sarrasin, avoine, tubercules et jachères. Vers 1880, la sole labourable ne représente guère que 15 à 20 % du territoire [V. Brenac 1882]. Une superficie équivalente de prés de fauche et de pâtures assure l’entretien des animaux de trait et l’alimentation hivernale des brebis.
Subordonné à la production des céréales, l’élevage bovin est avant tout cheptel de trait. Point de production marchande régulière en ce qui le concerne : tel vend quelques veaux au boucher, tel autre à un engraisseur, certains gardent quelques bœufs gras, d’autres les dressent et les vendent comme bêtes de somme. Avec ce cheptel réduit aux nécessités du labour, le recyclage des éléments fertilisants par le fumier est insuffisant. La terre, déjà pauvre, en paraît encore plus ingrate. Sur un noyau cultivé peu étendu, peu fertilisé, sur ces sols acides et froids, sous ce climat pluvieux, la production céréalière est faible, aléatoire. Mais chaque finage cultivé est entouré de vastes landes de callunes. Elles couvrent 60 à 70 % de la superficie totale des villages. Ce sont les communaux8. En vertu de droits d’usage acquis au cours du Moyen Âge, les habitants de chaque hameau y conduisent leurs troupeaux de moutons. Cet élevage ovin, producteur de laine et d’agneau « gris » vendus pour l’embouche dans les foires périphériques, constitue la principale production marchande des paysans de Millevaches.
Le communal est vaste. Point n’est besoin ici de berger de village ni de règlement strict pour répartir le nombre de moutons que peut tenir chaque ayant droit9. Chacun conduit donc sur la lande autant de brebis qu’il est capable d’en nourrir l’hiver. Ayant prés, pacages et bâtiments, les grandes métairies et les laboureurs peuvent élever d’importants troupeaux. Du bien commun, ils se taillent ainsi la part du maître. Mais les petits paysans aussi, même les paysans sans terre, parviennent à en tirer parti. Ils ont presque toujours quelques brebis. Ils peuvent, en outre, pratiquer une culture temporaire de seigle, par écobuage, sur certains tènements. Ainsi, le communal « prolonge les inégalités sociales tout en les atténuant » [A. Fel 1962]. Qui songerait alors à contester le statut de ces vastes parcours, se trouverait bien isolé dans le village.
Une céréaliculture pauvre, une utilisation très extensive de vastes étendues de landes…, voilà qui ne permet guère aux habitants de subvenir à leurs besoins. Aussi, depuis longtemps, beaucoup d’entre eux pratiquent-ils l’émigration saisonnière. La plupart vont chaque été s’employer dans les villes. Ce sont les maçons limousins. Avec les Creusois de la Marche, ils ont construit Versailles. Lorsque vient le Second Empire et l’essor considérable du capitalisme industriel, les villes s’étendent et sont remaniées. Le baron Haussmann couvre Paris de ses travaux. La Montagne limousine est alors à même de fournir à l’industrie du bâtiment une main-d’œuvre expérimentée, sachant vivre à la dure et, finalement, bon marché. L’ampleur du « limousinage » est telle10 que la vie économique du plateau en vient alors à dépendre de l’émigration saisonnière et des revenus qu’elle procure.

La crise du système agraire et son dénouement
Ayant acquis pour fonction principale d’assurer la subsistance hivernale d’un prolétariat saisonnier, le système agropastoral est bloqué… et fragile. Tant que l’industrie a besoin de cette force de travail, tant que les revenus du limousinage parviennent à compenser les faiblesses de la production, il n’est pas d’amélioration possible de la mise en valeur.
À la fin du XIXe siècle décroît l’ampleur des grands travaux d’infrastructure urbaine. Le bâtiment met en œuvre des chantiers permanents et, pour l’embauche saisonnière dont elles ont encore besoin, les entreprises préfèrent désormais importer des maçons italiens. Le rapide déclin de l’émigration saisonnière condamne le système agropastoral du plateau.
Si les revenus saisonniers diminuent, il n’y a d’autre solution que d’émigrer ou de développer une petite production marchande en étendant et en intensifiant le noyau cultivé. Cette seconde voie devient possible dès que les hommes valides ne partent plus à la saison des gros travaux. Mais elle n’est pas ouverte à tous. Les plus pauvres, ceux qui n’ont que leurs bras, quelques brebis sur le communal et un lopin de terre, doivent partir définitivement pour la ville. Pour la plupart des autres, l’intensification se heurte à l’absence de capitaux et l’extension du noyau cultivé au statut communal des parcours.
Au cours de ces mêmes années, concurrencé par l’élevage intensif des plaines, le mouton maigre du plateau se vend moins bien. S’amorce ainsi le déclin de l’élevage ovin, renforcé par l’exode des pauvres parmi lesquels se recrutaient les bergers. La régression s’amplifie lors de la Première Guerre mondiale. Le pacage est de plus en plus extensif. La callunaie devient alors très dense, éliminant les graminées de la lande11. Où les troupeaux ne passent plus, s’installent des formations arbustives spontanées. Le consensus social sur le statut communal des parcours éclate alors. Des dernières années du XIXe siècle à 1920, leur sort devient un enjeu : comment seront-ils mis en valeur et au bénéfice de qui ?

Trois points de vue s’affrontent. Certains paysans riches, certains propriétaires de domaines veulent profiter de la crise pour obtenir un partage censitaire du communal, ou une simple location des tènements aux plus offrants.
Petits paysans et journaliers s’opposent à ces projets. S’ils furent, jadis, les défenseurs les plus résolus du communal, ils optent désormais, ayant besoin de terres, pour une division égalitaire par foyer. Sur les lots qu’ils pourraient acquérir de la sorte ils pensent défricher les meilleures parcelles, élever plus de vaches, produire plus pour le marché.
Mais, déjà, interviennent les forestiers. Où ne subsistent que landes, ils ont « découvert » des vestiges d’antiques forêts. Dans le déclin du pacage extensif, dans la colonisation naturelle des bruyères, abandonnées par des essences arbustives, ils voient un retour spontané à l’équilibre naturel de la région. C’est d’avoir trop détruit la « forêt primitive » que se meurt, selon eux, le système agropastoral. Si le climat est rigoureux, les rivières irrégulières, les fonds marécageux, c’est que la forêt n’est plus là. La reconstitution d’un massif, malencontreusement détruit par des paysans trop préoccupés de leur subsistance, doit améliorer les conditions de la production agricole. Il convient ainsi de renouer avec la vocation originelle du pays. Il faut boiser les communaux ! Malheureusement nous savons aujourd’hui que l’existence d’une forêt primitive ne peut être prouvée avec rigueur que sur les contreforts du plateau. Quant aux influences bénéfiques de la forêt sur le climat, elles n’ont toujours pas été démontrées de façon convaincante…
Les forestiers croient-ils vraiment à cette argumentation historique et écologique ? Sans aucun doute. Mais ils ont aussi d’autres projets, quoique moins explicites. Pour rétablir l’équilibre naturel, il pourrait suffire de mettre en défens certaines landes, de favoriser leur colonisation par le pin sylvestre et le bouleau, puis, sous leur ombre, l’installation du hêtre et du sapin. Il suffirait de planter quelques versants abrupts. Mais ce que proposent les forestiers, c’est la plantation de pins sylvestres et le développement de la sylviculture ; c’est la constitution d’un massif forestier productif et utile à l’économie nationale. Les houillères sont alors en pleine expansion. Elles ont besoin d’étais de mine. Pourquoi n’installe-t-on pas sur ces communaux sous-utilisés une forêt de pins sylvestres dont les produits trouveraient débouché auprès des proches mines de l’Auvergne ? Ce que proposent les forestiers, ce n’est donc point la reconstitution d’un équilibre naturel synonyme de paradis perdu, mais une nouvelle forme d’artificialisation du milieu dont la possibilité (faillite du système agropastoral) comme la nécessité (développement de l’industrie extractive) sont conjoncturelles.
Mais le discours historico-écologique des forestiers institue cette forêt nouvelle comme héritière légitime du système agraire décadent. À ceux qui douteraient de la sylviculture sur des landes où, de mémoire humaine, aucun arbre — sinon rabougri — n’a poussé, la découverte du massif primitif donne une raison d’espérer que le bois ne fera pas défaut. Aux paysans qui veulent partager les communaux et défricher les landes, les considérations sur les bienfaits écologiques de la forêt suggèrent que leurs efforts seront vains s’ils ne laissent pas de place aux plantations résineuses.
Ce que proposent les forestiers, c’est la constitution d’un massif productif et utile à l’économie nationale. Les houillères sont alors en pleine expansion et elles ont besoin d’étais de mine.
De 1900 à 1914, les petits paysans parviennent, ici ou là, à diviser le communal selon leurs vues. Rien n’est encore joué cependant, car ils se heurtent tant aux pouvoirs publics (acquis aux aspirations forestières) qu’aux notables de la région. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Vazeilles, garde général des Eaux et Forêts, chargé à ce titre de promouvoir le reboisement du plateau, soumet le point de vue strictement forestier à celui des petits paysans.
Dirigeant local du parti socialiste (puis, après le Congrès de Tours, du parti communiste), Vazeilles a pour objectif politique de soustraire les petits et moyens paysans à l’influence des notables et, la rupture opérée, d’en faire les alliés du mouvement ouvrier. Dans ce but, il s’appuie sur la contradiction qui se fait jour entre la masse des paysans et les gros producteurs quant au statut des communaux. Il se propose de défendre les intérêts économiques des petits et moyens paysans. Il soutient donc leur point de vue sur le mode de partage des pacages communs.
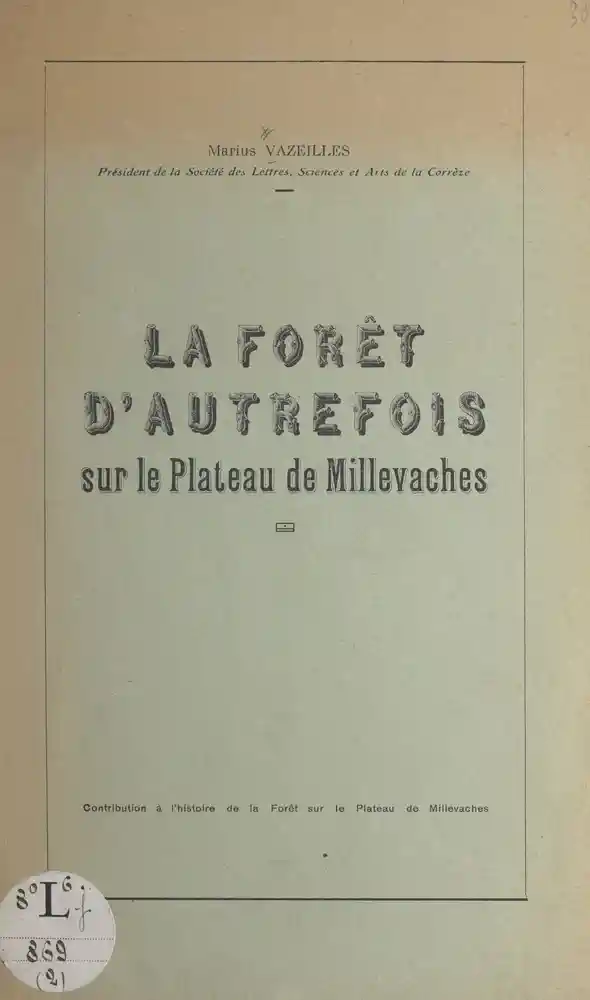
Mais Vazeilles n’en est pas moins forestier. Il se révèle même particulièrement soucieux d’étayer la vocation ligneuse de la région. Il va concilier ces deux points de vue par la recherche d’un équilibre agrosylvopastoral dont le but final est « d’apporter un peu plus de bien-être dans la région » [M. Vazeilles 1917]. Pour qu’il en soit ainsi, la forêt ne doit en aucune façon empiéter sur le domaine dont les paysans ont besoin pour vivre. Ses revenus, lorsqu’ils viendront, devront permettre d’intensifier la production et d’améliorer l’habitat. À cette fin, la forêt doit être plantée par les paysans et leur appartenir. Dans son livre largement diffusé, Vazeilles préconise une intensification progressive des lots de communaux acquis. Il invite les paysans à reboiser, à temps perdu, les parcelles les moins accessibles ou les plus pauvres. Il adjure les pouvoirs publics de subventionner ces petites plantations. Il persuade les premiers que la forêt peut être utile s’ils la contrôlent. Il convainc les seconds que le reboisement paysan est plus facile à réaliser, moins coûteux, moins risqué et finalement plus efficace qu’une expropriation de communaux en vue de leur plantation directe par l’État.
Renforcés par ce projet cohérent (et par le soutien qu’il obtient des pouvoirs publics), organisés en un syndicat des « travailleurs de la terre » dont Vazeilles est l’artisan (il en deviendra le dirigeant lorsqu’il démissionnera de ses fonctions administratives), les petits paysans parviennent à imposer leur point de vue12. Les communaux sont partagés. Le système agropastoral détruit, l’intensification de la production et le reboisement sont à la portée de tous.
Le développement de la petite production marchande et le reboisement paysan
La petite production marchande intensive en Millevaches et la forêt paysanne
Ainsi, par une sorte de réforme agraire, peut se développer en Millevaches une petite production marchande intensive. Le noyau cultivé s’étend au détriment des landes. Amélioration progressive, comptant plus, suivant les conseils de Vazeilles, sur le savoir-faire des paysans et l’investissement de leur travail que sur des capitaux que la plupart ne sauraient avancer. Les bruyères les plus accessibles, les parcelles les mieux exposées sont défrichées (après une ou deux cultures de sarrasin, on y installe une pâture, ou mieux, un pré de fauche). Sur les autres sont parqués les animaux (des ovins lorsqu’il en reste, mais surtout des bovins). Le piétinement et la fumure feront régresser la callune au profit de l’herbage. Sur ce noyau cultivé qui s’étend (et que l’exode répartit entre un nombre plus faible de paysans), l’importance relative de la sole céréalière décroît. Sur ce qui reste de terres labourables, l’introduction de prairies temporaires et de plantes sarclées fourragères (betteraves, topinambours) assure une rotation continue. Augmentent ainsi les disponibilités fourragères et, par là, l’aptitude à conduire du bétail. Chacun peut alors compléter son attelage par un cheptel bovin élevé uniquement pour le rapport. De ce fait, la charge des parcours et des landes à callunes augmente et le pacage s’en trouve amélioré. Avec plus de bétail, le recyclage des éléments fertilisants est aussi plus intense. Fumure et rotation continue tendent à relever les rendements céréaliers. Cela permet à nouveau d’étendre les herbages au détriment des terres labourables. Ainsi, l’ager s’agrandit et s’organise pour assurer le développement d’une production bovine intensive : ce sont les veaux blancs, tels qu’on les produit depuis longtemps dans d’autres régions limousines, tels qu’on en faisait un peu jadis sur le plateau, avec un tour de main artisanal et des soins continus.

Par ce patient effort d’intensification, chacun se trouve cependant avec des lots de landes inutiles. L’amélioration des pacages permet de négliger les parcelles les plus éloignées, les plus inaccessibles. Au lieu d’abandonner ces terres inemployées, les paysans plantent des pins sylvestres.
Chaque famille, en deux semaines automnales, peut enrésiner un hectare. L’État fournit gratuitement les plants. La plantation ne coûte donc au paysan que ce temps de travail qu’il dépense habituellement sans compter. Autant dire qu’elle ne lui coûte rien. Puisqu’il la possède, puisqu’il l’a installée où elle ne le gêne pas, le paysan peut espérer que sa forêt, plus tard, lui sera profitable.
L’effort forestier est donc intense. En 1914, le taux de boisement se situe entre 5,5 et 7 %. Un forestier constate en 1928 que « chaque partage [de communaux] amène en foule des demandes de subventions » [F. Boubal 1928]. Deux ans plus tard, la forêt recouvre déjà 14 à 17 % du territoire… Elle atteindra 23 à 25 % en 1946. Compte tenu de son temps libre et des subventions qu’il obtient, le paysan plante au coup par coup les parcelles dont il n’a plus l’utilité. Le reboisement paysan n’établit pas ainsi un massif forestier mais un « état boisé » [ibid.], une forêt « en timbre poste », mosaïque de parcelles d’âges différents, réparties entre une multitude de petits propriétaires.
L’intensification progressive de l’agriculture, qui fait de cet ancien pays du seigle et du mouton une région d’herbages, le reboisement paysan, qui étend, sur un paysage de landes, son manteau d’arlequin, s’articulent ainsi en un patient effort de mise en valeur du plateau.
La décomposition de la petite production marchande : exode et concentration
Bien qu’elle perfectionne son système de production, bien qu’elle tire un meilleur parti de l’espace qu’elle organise, la petite production marchande n’enraye pas l’exode, loin de là. Sur le marché, dont dépendent désormais leurs conditions de vie, les paysans du plateau sont, dans l’ensemble, défavorisés par la pauvreté de leur sol, l’âpreté du climat, l’éloignement des grands centres urbains et la modicité des avances de capital qu’ils sont en mesure de faire. Cependant ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Le partage du communal n’a fait qu’atténuer l’inégale répartition du sol. Avec plus de moyens, les anciens laboureurs ont pu tirer meilleur parti des lots de communaux, intensifier plus vite que les autres. De nombreuses causes de différenciation viennent se combiner à cette stratification préexistante : les mariages et le nombre d’enfants qu’il en naît, les héritages, l’émigration des collatéraux, l’occasion de récupérer les terres d’un voisin ou, à l’inverse, des adversités imprévues (brucellose, maladie, la parcelle convoitée qui revient à un autre, etc.). À chaque moment il est ainsi des paysans pauvres qui ne parviennent guère à reproduire leurs conditions de production, d’autres « s’en tirent à peu près », d’autres enfin (ayant pu, ou su, profiter des chances que leur offrait leur situation) qui dégagent de leur activité productive un surplus capitalisable.

Deux processus concourent alors à transformer cette différenciation de l’aisance en décomposition de la paysannerie. D’abord, la détérioration des termes de l’échange entre l’agriculture et les secteurs périphériques oblige les paysans à produire de plus en plus pour assurer leur subsistance. Ensuite, l’ouverture aux échanges matériels et sociaux, la transformation (induite par les multiples vecteurs de l’idéologie dominante) du système de valeurs et des comportements paysans conduisent à une évolution des besoins. Ce qui est socialement admis, dans les campagnes, comme l’indispensable niveau de subsistance requiert l’acquisition d’une quantité croissante de biens et de services. Par conséquent, si la valeur relative de la force de travail augmente tendanciellement, si la valeur relative des denrées produites diminue, les exploitants doivent étendre leur superficie, améliorer la productivité de leur travail. Dans les familles les plus pauvres, les enfants sont contraints d’émigrer. N’ayant pas eu les moyens de se développer, le « domaine » disparaît avec le vieux couple d’exploitants. À l’inverse, ceux qui disposent d’une certaine capacité de financement (ou l’acquièrent au prix de privations) peuvent récupérer les terres libérées de la sorte. Ils élargissent ainsi la base de leur production marchande, afin de maintenir, voire d’améliorer, leurs conditions de vie.
On assiste donc à l’élimination des formes productives les moins adaptées aux conditions économiques contemporaines et, dans le même temps, à la transformation, à la croissance des formes les plus efficaces (dont certaines peuvent être éliminées à un stade ultérieur). Au sein de cette petite production marchande en continuelle décomposition, la redistribution du foncier est de règle. Or, dans les conditions concrètes du plateau, cette redistribution est insuffisante. L’exode est massif, mais ceux qui restent ne parviennent pas à récupérer l’ensemble des terres libérées.
La petite production intensive, en Millevaches, ne permet pas aux paysans de contrôler l’ensemble de leur territoire
La production de veau blanc limousin met en œuvre un procès de travail artisanal extrêmement peu productif. Chaque veau est l’objet de soins individuels très attentifs. Pour obtenir une croissance rapide, tout en conservant la blancheur de la chair, le veau, calfeutré dans une étable sombre dont il ne sortira que pour la foire, doit ingurgiter une quantité considérable de lait. L’éleveur fait allaiter ses veaux au pis, deux ou trois fois par jour. Il doit donc, chaque fois, rentrer les vaches des pacages. Les limousines sont médiocres laitières ; et dès le second mois, le lait maternel ne suffit plus à l’alimentation du veau. Aussi l’éleveur étale-t-il les vêlages tout au long de l’année : de la sorte, il dispose à tout moment de vaches en lactation dont le veau est déjà vendu et qui peuvent servir de nourrices aux descendants gloutons des mères déficientes. Chaque veau doit ainsi téter successivement plusieurs vaches et chaque vache nourrit à son tour plusieurs veaux.
Tout cela exige beaucoup de temps, d’attention et de savoir-faire. Dans un tel système productif, les économies d’échelle sont rapidement saturées. Ayant étudié, trois ans durant, une vingtaine d’élevages corréziens, G. Liénard et G. Baud mettent ce fait en évidence :
« On peut constater sur les trois campagnes (dont la conjoncture a été fort différente) qu’en Corrèze le revenu par travailleur n’est pas plus élevé dans les élevages de veau de boucherie de taille moyenne (de 30 à 50 ha de saut avec une moyenne de 39,6 ha) que dans les petites exploitations (moins de 30 ha de SAU [surface agricole utile] avec 22,3 ha en moyenne) […] Parfaitement adapté aux petites exploitations qui ont là un moyen d’intensification ne réclamant pas beaucoup d’input ni d’investissement, ce système ne l’est plus lorsque la surface augmente. L’éleveur […] ne peut plus faire face au travail exigé par les veaux et par le système de production fourragère […] le chargement devient insuffisant […] la qualité des veaux diminue. »
[G. Liénard et G. Baud, 1978]
Au-delà de 25 à 30 ha de superficie, les éleveurs de veau limousin parviennent donc difficilement à maîtriser leur procès de travail. C’est la raison pour laquelle les paysans de Millevaches n’ont récupéré les terres libérées qu’avec prudence, même lorsqu’ils disposaient d’une base d’accumulation. Si les anciennes terres labourables, les prés de fauche, les pacages bien desservis se sont redistribués au sein de la paysannerie, les landes improductives et même les pacages extensifs sont souvent restés sur les bras de leurs héritiers citadins. Si bien que la spécialisation des exploitations dans la production de veau de boucherie participe à la constitution d’une propriété foncière non paysanne. Dans le cadre de la petite production marchande intensive, avant que les reboiseurs n’interviennent pour perturber à leur profit la redistribution du foncier, les paysans perdent ainsi le contrôle d’une partie de leur espace.
Mais il s’agit surtout, dans ce premier temps, de terres marginales, de landes… et de forêts. Car la forêt ne reste pas paysanne, du moins pas intégralement. L’exode et les modalités de la redistribution du foncier opèrent une dissociation entre l’agriculture et la forêt. D’abord, la forêt paysanne tend à changer de mains, passant aux parents émigrés. Il en est ainsi chaque fois qu’une exploitation disparaît sans reprise. Il en est de même, très souvent, lorsque le vieux paysan a un successeur : la plantation revient aux cohéritiers partis en ville. Ce partage permet de diminuer (voire d’annuler) les soultes.
Certes, les paysans conservent encore près du tiers du massif, et les revenus forestiers ont permis à certains d’entre eux de mécaniser leur exploitation et d’agrandir leurs bâtiments. Mais, avec l’exode, la forêt paysanne devient un fait minoritaire. D’autant plus que la tradition forestière incite les héritiers citadins à planter pour leur propre compte. Ils le font, dans un premier temps, à la façon des paysans, au coup par coup, selon les aides qu’ils obtiennent et les économies qu’ils ont pu faire. Ils le font aussi sur des espaces peu utiles à l’agriculture : ceux dont personne n’a voulu.
Ainsi les transformations de la mise en valeur entre les deux guerres ont confirmé la pertinence des conceptions de Vazeilles. Mais la forêt paysanne n’a pas apporté aux habitants suffisamment de bien-être pour enrayer l’exode. À l’harmonie attendue d’un agencement, contrôlé par les paysans, de prés, de terres et de bois s’est substitué un timbre-poste envahissant, anarchique, de plus en plus dissocié de l’agriculture.
Une agriculture qui ne maîtrise plus son espace et des reboiseurs qui se l’approprient
Depuis le début des années 60, la mise en valeur du plateau se modifie profondément. Nous assistons à un repli généralisé de l’agriculture. En 1970, les paysans ne contrôlaient plus que 55 % du territoire (et moins de la moitié dans le tiers des communes), la superficie agricole utilisée diminuait au rythme de 3,8 % l’an. Les deux tiers des terres libérées — estime-t-on (DDA et CERU) — échappent à l’agriculture faute d’acquéreurs, et il ne s’agit plus, comme par le passé, des parcelles « marginales ». À l’inverse progressent les friches, les terres incultes et, plus encore, la forêt. Aux reboisements de petites parcelles qu’effectuaient les paysans et leurs descendants, se substituent les plantations de vastes domaines que réalisent des propriétaires urbains relativement aisés.
L’agriculture ne parvient plus à contrôler son territoire
La crise du veau blanc limousin
Les transformations de l’agriculture des grands bassins laitiers ont profondément modifié les conditions de production du veau de boucherie. La spécialisation laitière et l’intensification, la diffusion des techniques d’allaitement artificiel ont considérablement développé la production de veau du cheptel laitier. Celui-ci représente plus des trois quarts de la production nationale [J. Craney et P. Rio 1974]. De l’éleveur qui alimente à la poudre de lait les veaux de son troupeau au producteur spécialisé, disposant d’un atelier hors-sol sous contrat, toutes les variantes (et elles sont nombreuses) de l’élevage « moderne » de veau de souche laitière assurent une productivité du travail largement supérieure à celle de la technique limousine. Dans de telles conditions, l’éleveur du plateau ne peut subsister que si le veau limousin allaité au pis de la mère bénéficie d’une rente de qualité.
Or, avec la concentration des circuits de transformation et de distribution de la viande, la grande qualité gastronomique du veau blanc limousin le protège de moins en moins de la concurrence des sous-produits plus intensifs de l’élevage laitier. Les structures modernes de transformation et de distribution s’intéressent plus, en effet, à la régularité, à l’homogénéité de la production qu’aux qualités organoleptiques des denrées produites. Certes, le veau limousin est toujours mieux payé, et plus lourd, que le veau de souche laitière, mais la différence tend à s’amenuiser. L’absence d’économie d’échelle au-delà de 20 à 25 vaches ne permet pas aux paysans de Millevaches de compenser, par la croissance, la régression de leur rente de qualité. Le système de production ne parvient donc plus à rémunérer l’importante force de travail qu’il mobilise.

L’élevage extensif : voie ouverte, mais porte étroite
Une reconversion est à l’ordre du jour. Depuis une dizaine d’années, un nombre croissant d’éleveurs s’orientent ainsi vers un élevage extensif. Le troupeau est alors conduit en plein air intégral. Les vêlages sont regroupés entre février et avril pour que les mères et leur suite bénéficient de la pousse printanière. Les jeunes veaux tètent leur mère au pâturage, broutent eux-mêmes et reçoivent un complément d’aliment concentré. Ils sont vendus comme « broutards » entre 7 et 9 mois pour être engraissés en Italie ou dans des régions d’embouche13. Ce type d’élevage exige ainsi bien moins de soins attentifs et de temps que la production de veau blanc. La plus forte productivité du travail, comme l’absence de bâtiment, lui confèrent une grande souplesse, lui permettant de valoriser des surfaces plus étendues que l’élevage traditionnel. G. Liénard et G. Baud ont ainsi constaté que les revenus des exploitations « extensives14 » de 30 à 50 ha sont notablement supérieurs à ceux des exploitations traditionnelles de taille équivalente. Ils ont aussi mis en évidence que les économies d’échelle ne sont pas encore saturées au-delà de 80 hectares [G. Liénard et G. Baud, 1978].
Ainsi la grande superficie, qui n’était guère un atout décisif dans le système du veau de boucherie, devient, en élevage extensif, la condition même du développement. La reconversion extensive suppose donc — et permet — la constitution d’une « grande culture » de paysans aisés, capables de dégager un surplus, de le transformer en capital pour concentrer les terres et les mettre en valeur. Facilitant et rentabilisant la croissance dimensionnelle, l’élevage extensif devient partie prenante dans la mise en valeur de l’espace.
Toutefois, cette nécessaire transition à l’élevage de broutards se heurte à d’étroites limites. La reconversion est moins aisée qu’elle ne pourrait paraître. Certes, l’éleveur conserve le même cheptel, n’a pas besoin de bâtiments nouveaux pour l’abriter. Certes, les animaux sont toujours nourris au lait maternel (avec, ô combien, moins de soins !) et l’alimentation n’exige guère d’être plus intensive. Mais il faut passer d’une pratique de vêlages étalés tout au long de l’année à un regroupement des mises bas. Cela requiert plusieurs années (et les échecs ne sont pas rares). Il faut aussi ce améliorer la qualité du troupeau pour l’adapter à la production d’animaux plus âgés » [G. Liénard et G. Baud, 1978]. De même, l’éleveur doit augmenter ses disponibilités fourragères pour nourrir un cheptel plus important. Pour cela il lui faut défricher les landes jusqu’alors laissées pour compte, mais aussi, s’il ne dispose pas déjà d’un vaste domaine, acquérir des parcelles nouvelles. Il faut enfin, pour tirer parti de l’augmentation de productivité, constituer des unités de pâturage relativement vastes. Le développement de l’élevage extensif est alors limité par le système foncier dont il hérite. Obstacle physique au remembrement des parcelles, le massif forestier en timbre-poste impose — et pour longtemps encore — un espace morcelé ; la petite production intensive parvenait à y trouver place, mais il s’oppose à la constitution d’unités compactes d’exploitation. La lenteur de la transition, ses difficultés techniques, les investissements qu’elle exige, les obstacles fonciers qu’elle rencontre, font que la voie de l’extensif n’est à la portée que d’une minorité d’exploitants disposant déjà de domaines étendus et/ou dont l’avenir paraît suffisamment assuré pour tenter l’aventure. Les exploitants susceptibles de se reconvertir à l’élevage extensif sont donc très peu nombreux. En 1970, ils n’étaient que 300 en Corrèze (selon les estimations du CERU), soit environ 1 sur 10. Dans de telles conditions, il n’est guère étonnant que l’agriculture ne soit pas en mesure de contrôler la majeure partie des terres libérées.
Quelques remarques au sujet d’autres raisons de la « déprise paysanne »
Si la grande culture en puissance est aussi faible en Millevaches, cela ne tient pas uniquement aux conditions de production, à la décomposition (puis à la crise) de la petite production intensive. Comment expliquer sinon que 35 % des exploitations de plus de 50 ha aient été en voie de disparaître lors même que s’ouvraient à elles les possibilités de l’extensif ? La crise du système n’est pas uniquement économique… elle est aussi idéologique.
Dans l’ancien système agropastoral, chaque village constituait une petite société. Le communal nécessitait, justifiait et symbolisait la cohésion de ses habitants. Chaque village avait un ensemble de lieux collectifs : la forge, le four à pain, le lavoir, l’échoppe du sabotier. Là, comme au cours des veillées, se débattaient les affaires communes, s’échangeaient les informations et les expériences. Cette organisation de la vie sociale suscitait, dans l’univers restreint du village, une « façon de vivre et de concevoir la vie » originale. Elle supportait donc une idéologie spécifique (susceptible de variations locales et, l’influence du socialisme en fait foi, nullement imperméable à l’extérieur) permettant à chacun de concevoir son statut, l’obligeant à se conformer au regard collectif du groupe, lui donnant les moyens de vivre et de lutter dans cet espace.
Dans l’ancien système agropastoral, chaque village constituait une petite société. Le communal nécessitait, justifiait et symbolisait la cohésion de ses habitants. Chaque village avait un ensemble de lieux collectifs.
Les transformations de la mise en valeur vont désagréger l’univers du village. Lors du partage des communaux, vole en éclats le consensus social : la lutte de classe divise le village, mais elle permet de recomposer les solidarités à l’intérieur de chaque camp. Par la suite, l’économie domestique décline avec l’expansion des échanges. Se développe en même temps un système de production astreignant. Les occasions de veillées s’espacent au point de disparaître. Le déclin de ces moments collectifs conduit au repli des familles sur elles-mêmes. Désormais « chacun reste chez soi, chacun œuvre pour soi ». Cette situation se combine aux nouvelles conditions de travail pour éliminer peu à peu les pratiques d’entraide.
Ainsi s’appauvrissent les relations sociales du village. Elles s’estompent d’autant plus que l’exode des jeunes porte un coup fatal aux coutumes, aux traditions, aux festivités dont ils avaient la maîtrise. Enfin, la diminution de population provoque la disparition des artisans et des commerçants, parfois la fermeture de l’école. Alors s’évanouissent les derniers lieux et biens collectifs du village. (Reste parfois seulement le café et, symbole de victoire de l’univers marchand, la foire la plus proche.) Le vide créé suscite l’apparition de nouvelles aspirations et de nouveaux besoins. La destruction des anciennes pratiques sociales, de l’idéologie qu’elles impliquaient, l’automatisation progressive des familles favorisent l’importation d’un système d’idées et de comportements nouveaux. Véhiculée par les médias, par les techniciens du secteur para-agricole, par les organisations professionnelles, par les émigrés, par l’école même, une idéologie, étrangère à ce que fut la société rurale, impose ainsi progressivement ses normes et ses modèles. Même si cette idéologie dominante est susceptible d’interprétation locale, c’est par rapport à elle que les habitants, désormais, comprennent leur statut social et règlent leur pratique.
Jusque vers le début des années 60, ces transformations de l’idéologie paysanne n’ont guère d’incidence directe sur l’exode. Comme la politique agricole contemporaine, le discours dominant vise explicitement à renforcer la petite production marchande, à perpétuer l’agriculture familiale. Le parti communiste lui-même, fortement implanté dans la région depuis Vazeilles et, plus encore, après la Résistance, invite les paysans à lutter pour rester à la terre. De part et d’autre, l’exode rural est déploré. Les paysans conservent des raisons de s’accrocher — du moins quand ils le peuvent — et d’espérer une promotion « interne » de leur situation sociale soit en collaborant aux transformations préconisées par les pouvoirs publics, soit en luttant contre elles.

Lorsqu’il s’avère nécessaire, pour l’ensemble de l’économie, de moderniser le secteur agricole, l’idéologie agrarienne valorisant la tradition rurale, louant l’ « ordre éternel des champs » n’est plus de mise. Dès lors « la bourgeoisie, employant tous les moyens de communication sociale à son service, fait savoir que l’agriculture française est archaïque, dépassée, inefficace… les paysans […] qui luttent pour survivre deviennent donc des attachés ou des réactionnaires opposés au progrès » [Frères du Monde 1969]. Jadis tant décrié, l’exode est désormais qualifié de mutation professionnelle… Il devient nécessaire, seul susceptible d’assurer les « réformes de structures » indispensables au développement d’une agriculture digne de ce nom.
Si le paysan traditionnel est disqualifié, une nouvelle image positive est alors proposée aux agriculteurs : celle du petit entrepreneur dynamique, soucieux de se moderniser, gérant bien son affaire, participant à la croissance économique générale et en bénéficiant. Cette adaptation rurale de l’image que la bourgeoisie se fait d’elle-même ne transforme pas uniquement le rapport au travail, elle modifie aussi l’univers des besoins. « Le paysan chef d’entreprise ne “modernise” pas seulement son appareil productif, il “modernise” son foyer et reproduit, dans un confort légitime, les conditions de vie urbaine. » [G. R. Larrère 1976a.] Les organisations professionnelles ayant adopté rapidement ce discours moderniste, le MODEF leur ayant emboîté le pas après quelques hésitations, ces conceptions se sont imposées à tous.
Or, par leur situation économique, par l’élevage artisanal qu’ils pratiquaient, les paysans de Millevaches n’ont pu, dans leur ensemble, se conformer au modèle du paysan moderne et dynamique. Ils n’ont eu d’autre issue que de jouer le rôle — désormais fort ingrat — du paysan traditionnel. Ils n’ont donc su, pour beaucoup, concevoir de réussite sociale qu’en quittant ce pays où l’agriculture ne « pouvait avoir d’avenir ». L’émigration sanctionnait jadis la pauvreté de l’exploitant, l’impossibilité pour lui de développer son domaine et d’améliorer ses conditions de vie. Bref elle signifiait l’échec social de celui qui partait. Les discours de l’idéologie dominante ont, à l’inverse, conféré à toute émigration le cachet d’une promotion sociale.
Cela implique en retour une dévalorisation de ceux qui restent. Cette crise idéologique a encouragé ceux qui l’ont pu à quitter la région, auraient-ils eu les moyens d’accumuler du capital. Elle décourage encore aujourd’hui d’entreprendre les investissements et les transformations nécessaires au développement de l’élevage extensif.
Ainsi ont été élagués les rangs de ceux qui pourraient encore être partie prenante dans l’appropriation du sol.
Par une crise économique qu’amplifient les transformations idéologiques récentes de la paysannerie, par les incidences démographiques d’un exode ayant excédé les strictes nécessités de l’économie (célibat, solde naturel en déficit croissant15 ). Bref, par l’affaiblissement de son potentiel humain, la société rurale ne parvient plus à maîtriser son territoire. La terre échappe au contrôle des paysans… Et ce d’autant plus que les reboiseurs interviennent, limitant la transition à l’extensif, précipitant la crise et en tirant parti.

Les reboiseurs : une partie prenante dans le partage du sol
Jusque vers 1950-1955, la forêt s’insérait dans le processus d’intensification de la mise en valeur paysanne ou s’installait dans les lacunes du système agraire. Elle occupait l’espace que les paysans jugeaient inutile ou les terroirs qu’ils ne pouvaient guère s’approprier de manière intensive. Une transformation profonde s’est opérée depuis. Les paysans reboisent de moins en moins, sinon en prenant leur retraite (pour le compte de leurs enfants). Les héritiers citadins ne se contentent plus de reboiser, à l’occasion, les parcelles que l’agriculture leur abandonne. Porteurs d’un projet de mise en valeur par la forêt, ils prennent le contrôle de tout ce dont ils héritent et même de ce qu’ils ont l’occasion d’acquérir. Ils sont rejoints par différents agents économiques qui achètent des propriétés et les boisent, dans l’unique but de placer leur argent. Détournant à leur avantage la redistribution du foncier, profitant des faiblesses de l’agriculture, ces reboiseurs se constituent partie prenante.
La concentration des industries du bois incite à réaliser de vastes propriétés privées
Lorsque s’installait la forêt paysanne, les conditions économiques qui présidaient à la mobilisation du bois et à son traitement permettaient d’envisager l’exploitation de petites parcelles. Mais le temps de la sylviculture est un temps bien plus lent que celui de l’industrie. Pendant que le timbre-poste poussait — à son rythme — , l’appareil productif des industries d’aval se renouvelait et se perfectionnait. Aux petites scieries, aux ateliers de fabrication d’étais de mine, se sont substituées des entreprises plus importantes — en particulier le Comptoir des bois de Brive qui alimente les papeteries des groupes Ausseydat-Rey et La Cellulose du pin16.
La concentration industrielle suppose aujourd’hui un approvisionnement régulier en lots de rondins homogènes. La dispersion des propriétés, l’absentéisme d’une importante fraction des propriétaires obligent les exploitants à consentir un lourd et coûteux travail de prospection des coupes. Sur de petites parcelles imbriquées, sans voie d’accès pour la plupart, les frais d’exploitation sont élevés. Les coupes se vendent mal. Aussi les reboiseurs tendent-ils à réaliser des unités de production sylvicoles mieux adaptées (par leurs caractéristiques dimensionnelles et par l’infrastructure des chemins de desserte) aux conditions contemporaines d’exploitation du bois. Il ne suffit donc plus à l’héritier citadin (ou au propriétaire) d’enrésiner les quelques parcelles dont les voisins n’ont pas voulu. S’il veut tirer parti de la forêt future, il lui faut dorénavant planter la totalité de son patrimoine.
La récupération bourgeoise de la tradition forestière
La création de vastes plantations sur des propriétés retenues, ou acquises, à cette fin suppose que les propriétaires disposent de capacités financières supérieures à celles des paysans et des émigrés de jadis. Justement, la base sociale des reboiseurs se transforme. Une enquête effectuée en 1969 par la DDA de Corrèze permet de ventiler la superficie des forêts résineuses selon l’âge de la plantation et la catégorie socioprofessionnelle du propriétaire. Les résultats consignés au Tableau 1 doivent être interprétés avec circonspection17. En effet, pour les forêts anciennes, la catégorie sociale du propriétaire actuel ne renseigne guère sur le statut du planteur. Avec l’exode, la forêt paysanne a largement changé de main, les paysans ont donc incontestablement planté plus de résineux qu’ils n’en possèdent encore. Le Tableau 1 donne ainsi une image déformée de ce que furent les reboiseurs, au détriment des agriculteurs et au bénéfice des autres catégories (retraités notamment). Il est cependant certain, à la lecture de ces résultats, que les paysans furent, jusque vers 1950, les principaux artisans de l’effort forestier. Dix ans plus tard, les « cadres, industriels et professions libérales » les ont largement supplantés.
Nous assistons à un phénomène d’embourgeoisement des héritiers du sol. D’abord des émigrés de seconde génération ont eu l’occasion d’assurer, en ville, leur promotion sociale. En outre, de nombreux paysans aisés ont détourné leurs revenus d’un investissement agricole pour favoriser les études de leurs enfants. Certains domaines, enfin, parmi les plus vastes, sont depuis le milieu du XIXe siècle entre les mains de notables locaux (qui les font exploiter en fermage) : une fois libérés d’un bail, ils reboisent d’autant plus volontiers que le statut du fermage limite la progression des rentes et qu’ils éprouvent quelques difficultés à trouver de nouveaux preneurs.
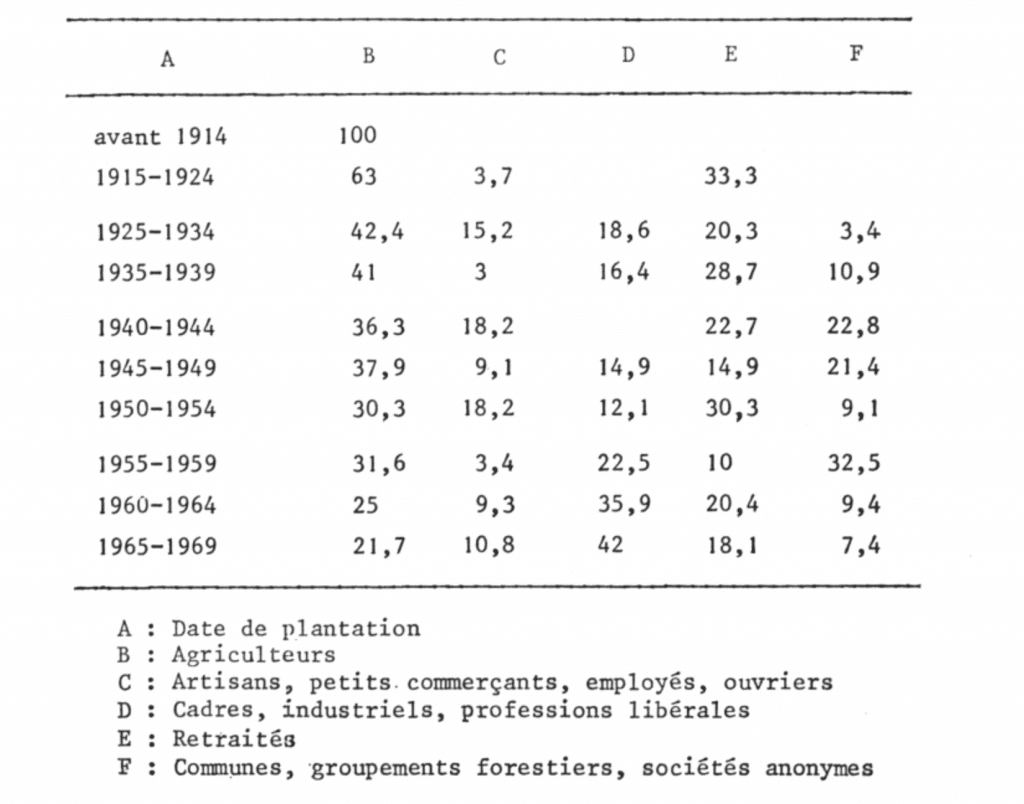
Par ailleurs, divers agents économiques acquièrent des terres pour les planter. Il s’agit de sociétés d’assurances, parfois même de sociétés immobilières, d’entreprises, de collectivités diverses. Mais il s’agit — et plus encore — de cadres supérieurs, de médecins, de notaires, de marchands de bois. La plupart n’ont guère d’attache au pays, et n’investissent en Millevaches que parce que la terre n’y est pas trop chère et que les paysans en perdent le contrôle. Pour ces « nouveaux reboiseurs », la forêt est un placement financier. Ils la conçoivent donc de façon à ce qu’elle corresponde aux besoins d’approvisionnement de l’industrie18.
Ainsi s’établit en Millevaches, à côté de l’ancienne forêt paysanne, sur les terres que l’agriculture abandonne (ou qui lui sont soustraites), un nouveau massif forestier. Il est constitué de plus vastes propriétés, de parcelles plus homogènes, bien desservies. Il n’est plus planté de pins sylvestres — ce bois qui se vend mal depuis le déclin des houillères — mais d’épicéas (et de Douglas) pour les scieries et, plus encore, pour les usines de pâte à papier.
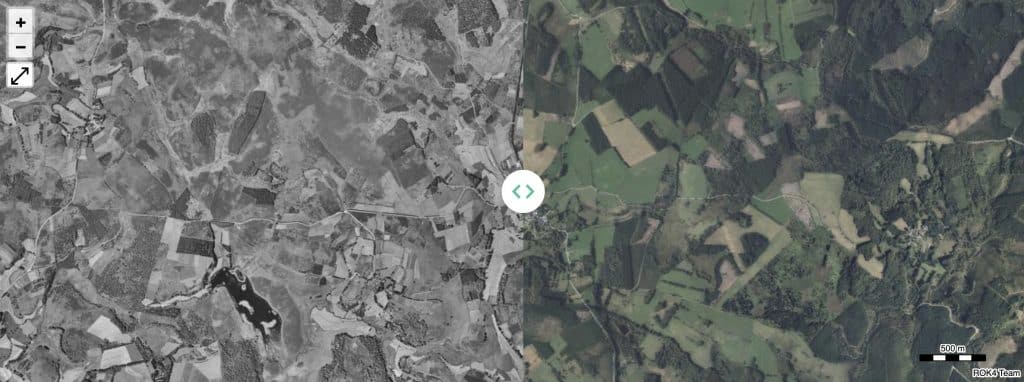
La définition d’une nouvelle politique forestière consacre et renforce cette évolution des reboisements
Dans l’entre-deux-guerres, les services forestiers distribuèrent sans parcimonie leurs subventions aux petits reboiseurs. Avec de plus amples moyens financiers, le Fonds forestier national (FFN) a maintenu longtemps cette politique, accordant la majeure partie de ses crédits aux « petites subventions ». Cependant, dès 1960, les aides sous forme de prêts et de contrats sont plus fréquentes. Elles permettent de répondre à une demande croissante de reboisements étendus.
Les responsables du FFN portent alors un regard critique sur leur action passée. Mal gérée, mal entretenue, trop morcelée, la forêt en timbre-poste ne correspond plus, selon eux, aux conditions contemporaines de mobilisation du bois. « On a subventionné un reboisement en timbre-poste qui rend l’exploitation du bois coûteuse, l’implantation d’équipements routiers et de défense contre l’incendie difficile et la restructuration impossible. » [R. Roustide 1970.] Aménager le massif existant est donc hors de propos. Selon les forestiers, le nombre de propriétaires est tel, et l’anarchie des peuplements si grande, que l’entreprise serait compromise avant d’être tentée. Il ne s’agit donc pas de remédier aux « erreurs » du passé, mais de ne point les reproduire. Pour cela, il faut favoriser en priorité, et contrôler, la création d’un massif « structuré » (se juxtaposant au timbre-poste) sur les terres que la forêt conquiert au détriment de l’agriculture. À partir de 1967 la subvention n’est presque plus utilisée et la plupart des moyens financiers du FFN sont mobilisés pour favoriser les plantations de grande surface (cf. Tabl. 2).
Induite par l’évolution des reboisements en Millevaches, cette nouvelle politique forestière la renforce et la justifie.
Les aides financières (particulièrement avantageuses19 ) que propose le FFN ont ainsi pour effet d’inciter les catégories sociales susceptibles d’investir en forêt à planter ce qu’elles contrôlent de territoire, et même à contrôler l’espace qui leur échappe encore.
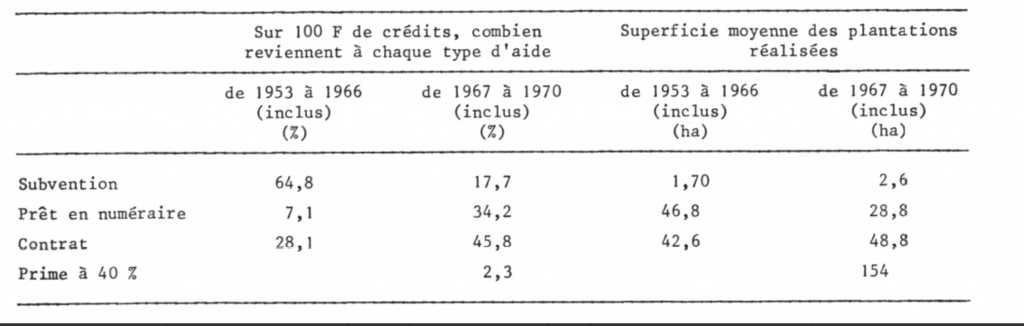
Le souci d’améliorer les conditions d’approvisionnement des industries du bois contribue par conséquent à renforcer une partie prenante forestière, sur les terres que libère massivement une agriculture en déclin.
Par l’élimination massive des producteurs traditionnels, un volume important de terres libérées transite chaque année. Les conditions sont ainsi réunies pour que les lois de l’héritage assurent la maîtrise du sol à un nombre croissant de citadins, « Dans la majorité des cas les non-résidents et les résidents non-agriculteurs gèlent le foncier, empêchent son exploitation rationnelle par ceux qui voudraient le louer ou l’acheter. » [Y. Calloc’h 1969.] Telle est par exemple la situation que décrit un exploitant dans le nord du plateau :
« Beaucoup d’exploitations ont disparu depuis 10 ans. Un exploitant de V. a repris les terres de deux d’entre elles, parce que les vieux avaient pris I’IVD et qu’il était de la famille. Moi, j’ai récupéré quelques prés. Surtout des prés de fond un peu humides, où le bois pousse mal. Les voisins aussi, un peu moins peut-être. Le reste, impossible de le louer ou de l’acheter. Certains héritiers ont boisé tout de suite. Les autres laissent en friche en attendant d’avoir de quoi planter et les crédits des Eaux et Forêts. On ne trouve pas de terre ici aujourd’hui. »
Le marché foncier est relativement restreint et dominé par les promoteurs de la forêt. Par leurs surenchères, notaires, pharmaciens et autres médecins parviennent à emporter la majeure partie des ventes. En 1972 les acquisitions d’agriculteurs n’ont représenté que 15 % des transactions notifiées à la SAFER. Ils ont acheté globalement 181 ha au prix moyen de 2 879 F/ha. Dans le même exercice, les acquéreurs non-paysans enlevaient 777 ha au prix moyen de 3 509 F. Les interventions de la SAFER sont modestes, le droit de préemption n’étant utilisé qu’exceptionnellement. Peut-être craint-elle de ne point trouver, par la suite, d’exploitant à qui rétrocéder les terres ? Sans doute a-t-elle aussi opté pour un avenir forestier (c’est du moins ce qu’elle explicite dans son étude du canton de Bugeat).

Les promoteurs de la forêt organisent ainsi à leur profit la redistribution du foncier. Leur intervention limite les possibilités de concentration des exploitations, entrave la constitution de domaines compacts. Elle induit une hausse des valeurs foncières…, et l’on sait que le prix de la terre affecte considérablement la rentabilité de tout système de production extensif — en particulier, comme G. Liénard l’a mis en évidence, la production de broutards élevés au pis de la mère [G. Liénard 1973].
Accentuant les difficultés de la transition à l’élevage extensif, la partie prenante forestière reproduit les conditions de développement de son emprise.
La forêt en tant que mode d’annexion de l’espace
Lorsqu’une société rurale perd le contrôle de son espace, d’autres catégories sociales peuvent le prendre en charge. Si les friches abandonnées par un système agraire décadent peuvent être source de profits, divers agents, qu’ils soient propriétaires ou susceptibles d’en acquérir les droits, tentent de promouvoir le mode d’occupation du sol qui correspond à leurs intérêts et à leur pratique sociale. Les parties prenantes qui se constituent alors dépendent de la situation régionale. Il s’agit ici des reboiseurs. Ailleurs il s’agira des vacanciers, des promoteurs de l’industrie touristique, ou de l’armée. La crise d’un système agraire favorise ainsi une substitution de modes d’occupation du sol sous le contrôle de nouveaux propriétaires fonciers. Mais en même temps, la libération massive des terres permet d’envisager le développement de nouvelles formes productives agricoles, susceptibles d’occuper le territoire et d’en tirer parti. Que l’espace devienne un enjeu dans un pays où l’agriculture ne parvient plus à maîtriser son territoire ne saurait donc nous surprendre.
Un espace à l’encan ?
La confrontation des parties prenantes
La crise de la mise en valeur agricole tend à diminuer la rente foncière. Les propriétaires non-exploitants sont donc prêts à promouvoir tout mode d’utilisation du sol susceptible de valoriser leur patrimoine. Lorsque l’espace est convoité (par des reboiseurs, par le tourisme, par I’EDF ou par l’année), se développe une contradiction entre l’exploitation du sol et la propriété foncière. S’affrontent les intérêts de ceux pour qui la terre est un moyen de production, un outil de travail, et les objectifs de ceux qui la considèrent comme un objet de spéculation ou de placement financier. Cette contradiction oppose donc producteurs et propriétaires (soit ici, dans une certaine mesure, les paysans aux émigrés de leur parentèle). Mais elle divise aussi profondément la paysannerie. Dans leur grande majorité, les paysans sont à la fois producteurs agricoles et propriétaires du sol (ils possèdent ici les trois quarts de la SAU — le reste étant en location). Ils peuvent donc, selon les circonstances, mettre en avant un point de vue d’exploitant, ou rejoindre le camp de la propriété foncière. Ils peuvent tenter d’étendre leur emprise, de cantonner la forêt aux périphéries du finage, de s’entendre pour remembrer le parcellaire. Ils peuvent à l’inverse, chacun pour son propre compte, jouer la carte forestière. Leur position dépend de leur situation économique et familiale, des relations qu’ils entretiennent avec leurs voisins, voire même de la façon dont ils se représentent leur statut comme de la façon dont ils conçoivent l’avenir de l’agriculture dans la région.
Dans la situation actuelle, logiquement, le fer de lance de la partie prenante agricole (le point de vue du producteur) est constitué par les éleveurs extensifs et ceux qui peuvent envisager de se reconvertir ou d’adjoindre à leur élevage de veaux de boucherie un troupeau de moutons. En pratique, il s’agit d’exploitants « d’avenir » : ceux qui sont encore jeunes (mariés si possible) ou assurés d’une reprise. Il s’agit donc d’un faible nombre, qui, pour être les privilégiés de la société paysanne en Millevaches, n’ont guère les moyens de résister aux surenchères des acquéreurs de biens fonciers. S’y adjoignent de petits exploitants, sans avenir à long terme, ou sans « domaine » leur permettant d’envisager l’élevage extensif, mais qui peuvent encore tirer parti d’une augmentation de superficie dans le système de production traditionnel.

Cependant ces paysans sont en concurrence pour récupérer les terres libérées. Ils le sont d’autant plus que la plupart d’entre elles (les deux tiers) sont retenues par leurs propriétaires ou détournées par des acheteurs de bien-fonds. Plus ou moins vive selon la situation locale, cette concurrence est source de conflits qui, souvent, interdisent aux paysans de présenter un front uni face aux agents de l’emprise forestière. Compte tenu des faiblesses de cette partie prenante agricole, l’avenir de l’agriculture en Millevaches dépend donc dans une large mesure de l’attitude des paysans pauvres, des éleveurs âgés et sans reprise. Or, tout porte à penser qu’ils sont très divisés sur la question, une majorité optant même pour la solution forestière. Sur 100 paysans âgés de plus de 60 ans en 1967, 23 seulement ont pris I’IVD au cours des 3 années suivantes, dans les exploitations de moins de 20 ha (contre 47 dans les exploitations de 20 à 50 ha et 63 dans les domaines de plus de 50 ha). Les enquêtes que nous avons pu mener confirment cet indice : seule une minorité de petits paysans cherchent à favoriser le transfert de leurs terres au bénéfice d’autres exploitants. Les enjeux du passé (souvenons-nous de l’affrontement entre les paysans et les laboureurs sur le partage des communaux), le travail politique de Vazeilles et de la Confédération générale des paysans travailleurs (CGPT) ont contribué à tracer des camps. Petits et moyens paysans, en ce pays, s’opposent depuis longtemps aux notables, aux paysans riches, aux gros. Opposition instituée par une division syndicale et politique, renforcée par le souvenir de l’attitude de certains notables sous le régime de Vichy20, avivée par la concurrence sur le foncier, puis par la sélectivité des aides.
L’avenir de l’agriculture en Millevaches dépend de l’attitude des paysans pauvres, des éleveurs âgés et sans reprise. Or, une majorité opte pour la solution forestière ; seule une minorité cherche à favoriser le transfert de leurs terres au bénéfice d’autres exploitants.
Il semble cependant que, pour certains petits paysans, cet antagonisme s’estompe quelque peu. Plus exactement, il cède le pas à un autre. Certes, il est regrettable d’abandonner sa terre au profit du « gros du coin »…, mais il faut bien avouer qu’il n’est guère plus séduisant, la vendrait-on à meilleur compte, de l’aliéner à un notaire, un médecin ou un avocat. Un vieil exploitant, parmi d’autres, nous a justifié ce point de vue de la sorte : « II vaut mieux que la terre ne change pas de camp… elle ne doit pas aller à un capitaliste ni même être boisée pour engraisser les marchands de bois. » (Aussi a-t-il décidé de prendre l’IVD au bénéfice d’un vague neveu, laissant quelques parcelles enclavées aux voisins, la maison, le jardin et les plantations à ses enfants.) Mais pour une majorité de paysans âgés, le désir de « ne pas voir la terre changer de camp » signifie, au contraire, qu’elle ne doit pas bénéficier aux paysans aisés. Mieux vaut la reboiser où la transmettre aux descendants : « Le plus important pour les paysans qui reboisent en prenant la retraite, c’est qu’ils retardent le passage de leurs terres dans les mains de la bourgeoisie ou des gros. » [Groupe pour la fondation de I’UCFML 1976.] Enfin, si l’on est obligé de vendre, mieux vaut le faire au plus offrant.
Lors de la crise du système agropastoral, les paysans pauvres et moyens du plateau étaient porteurs d’un projet de « réforme agraire » et de mise en valeur. Aujourd’hui ils sont moins nombreux, et leurs enfants sont partis pour la ville. Marginalisés par une politique agricole moderniste (et par le discours productiviste qui la soutient), négligés par les syndicats (le MODEF, de ce point de vue, diffère profondément de la CGPT dont il a pris la relève21 ), ces paysans n’ont plus de projet de mise en valeur qui leur soit propre. Bien plus, il n’y a pas de place pour eux, même à court terme, dans le projet d’élevage extensif que les exploitants d’avenir tentent de mettre en avant. Pour ces producteurs modernes, ne vaudrait-il pas mieux d’ailleurs que les paysans traditionnels fassent rapidement place nette ? Il ne reste aujourd’hui aux paysans pauvres d’autre moyen que de résister jusqu’au bout, de boiser en prenant la retraite, ou de laisser à leurs enfants le soin de s’acquitter de cette tâche. Ce faisant, avec des objectifs particuliers, ils participent au développement de l’emprise forestière.

La partie prenante agricole ne présente ainsi qu’incertitudes et faiblesses. Bien que ses rangs soient renforcés par l’installation de quelques immigrants, la grande culture à vocation extensive est représentée par un nombre trop faible d’exploitants pour être en mesure de contrôler l’espace encore agricole du plateau. Une importante fraction des petits paysans refuse en outre de jouer la carte de cette partie prenante agricole qui les domine et sur qui se concentrent les aides de l’État. À l’inverse, bénéficiant de capitaux, de l’appui du FFN et des divisions de la paysannerie, les promoteurs de la forêt ont les moyens d’étendre leur emprise, d’organiser l’espace à leur profit.
De la nécessité d’un compromis
La question paraît donc entendue. A terme, la partie prenante forestière est en mesure d’imposer son point de vue. Mais cela ne signifie nullement que les plantations résineuses couvriront la totalité de ce territoire. Certes, les élus locaux, les aménageurs, les « forestiers », tous ceux qui aujourd’hui portent un jugement sur le plateau, sont persuadés de sa vocation forestière. Comment ne le seraient-ils point quand les plantations « autres que le pin sylvestre » produisent en moyenne 9m3 de bois par hectare et par an (Inventaire forestier national) ? Quand on remarque sur des parcelles bien conduites d’épicéas et de Douglas des accroissements annuels de 18 à 21m3 à l’hectare ?
Témoins des difficultés de l’agriculture, comment n’accorderaient-ils pas priorité à l’emprise de la forêt ? Tous, cependant, sont convaincus de la nécessité de préserver les chances de l’élevage. Tous estiment indispensable de favoriser la reconversion extensive d’un certain nombre d’éleveurs, de répartir l’espace entre quelques terroirs agricoles protégés et des zones à destination forestière.
Si, pour la SAFER, « la forêt est l’aménagement prioritaire » du secteur de Bugeat, il ne faut pas négliger pour autant l’avenir de l’agriculture : une « élite » de quelque vingt-cinq éleveurs doit avoir les moyens de se développer. De même, le Ceru propose de financer la transformation de quelque trois cents paysans sur la partie corrézienne du Mille vaches. La DDA enfin n’hésite pas à affirmer que son objectif second (après la constitution d’une forêt rentable) est de réaliser la « vocation à l’élevage extensif » du pays. N’y aurait-il là que bonnes paroles pour faire accepter aux agents les plus actifs de la partie prenante agricole la victoire finale de l’option forestière ? Nous ne le pensons pas.
Puisque l’agriculture existe, résiste tant soit peu à son évincement, puisque nous ne sommes ni dans l’Angleterre du XVIe siècle, ni dans les Highlands écossais du XVIIIe siècle, ni aux États-Unis pendant la conquête de l’Ouest, puisqu’un clearing of estates22 est ainsi impossible…, autant ménager les transitions, autant permettre aux paysans de mieux utiliser leur territoire (en attendant les futures conquêtes de la forêt). Si « l’aide forestière doit être massive », la SAFER estime nécessaire, concurremment, de protéger et de subventionner l’agriculture résiduelle. Mais, nuance, « l’aide agricole doit être sélective », seuls conservant le droit de contrôler une part de l’espace les paysans susceptibles « de se moderniser ». La concession n’est donc pas uniquement tactique. Si l’on convient de limiter le champ d’action des reboiseurs, rien ne permet de supposer que c’est en pure perte. Une agriculture résiduelle peut être rentable et même utile à l’économie nationale. La DDA estime ainsi, sur la base de ses travaux et de ceux du CERU, que le plateau est « une des rares régions de France aptes à produire les jeunes bovins maigres qui deviendront indispensables à une production moderne de viande ». Il semble même que la Montagne limousine bénéficie, pour ce type de production, d’une rente de situation23. Pourquoi, dans de telles conditions, n’y aurait-il point place, même à long terme, pour une telle activité ? Pourvu qu’elle ne gêne pas outre mesure la réalisation du massif forestier dont les industries du bois ont besoin…
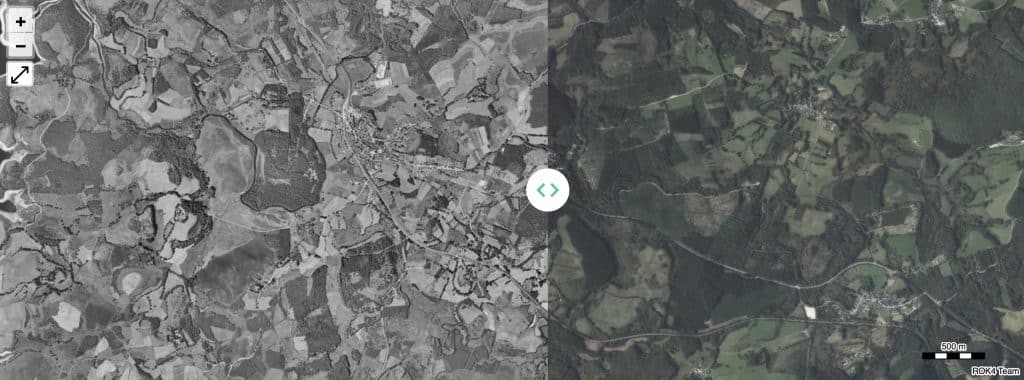
Remarquons par ailleurs qu’une utilisation forestière rationnelle du territoire suppose que l’agriculture ne décline pas trop vite et, plus encore, qu’elle ne disparaisse pas intégralement. La situation actuelle se présente ainsi : l’agriculture abandonne chaque année de vastes étendues. Le reboisement est intense, mais (portant en partie sur des friches anciennes et des taillis) insuffisant pour récupérer immédiatement les terres libérées. Il se constitue donc, en permanence, un stock de friches dont il faut différer la plantation. Plus s’amplifie la crise de l’agriculture, plus s’accroît le domaine foncier en attente de reboisement. Plus longue sera donc l’absence de mise en valeur.
Or ce terrain perdu fait planer sur les plantations résineuses la menace permanente des incendies : les feux de broussailles ne sont pas rares et l’imbrication des parcelles (comme l’absence d’équipements appropriés sur l’ancienne forêt en timbre-poste) ne permet pas de les circonscrire aisément. Par ailleurs, la plantation d’une forêt est d’autant plus intéressante que le temps de latence depuis l’abandon de la mise en valeur agricole est moins long. Sur un sol entretenu l’année précédente, la forêt se plante aisément et bénéficie de la fertilisation que lui lègue l’agriculture. Sur une friche de cinq ou six ans d’âge, dans les conditions écologiques du plateau (la végétation buissonnante y est vigoureuse), il faut, pour planter, défricher une broussaille inutile qui, seule, a profité des amendements de la mise en valeur agricole.
Si l’on parvenait à limiter le déclin de l’agriculture, à résorber le stock de landes inutiles, cela permettrait à la forêt de s’installer à moindre coût. Cela signifierait aussi que l’agriculture (si du moins elle parvenait à imposer l’élevage extensif et un remembrement des parcelles dans des secteurs protégés) réaliserait une restructuration foncière dont les reboiseurs n’auraient pas à supporter les inconvénients et les frais.
Un repli modéré de l’agriculture est donc susceptible d’assurer de meilleures conditions à l’emprise de la forêt qu’une débâcle générale. Bien plus, à long terme le bon entretien du massif suppose le maintien d’une population agricole disséminée. Les services forestiers estiment en effet que la protection la plus efficace contre les incendies réside dans la présence de clairières agricoles suffisamment vastes pour limiter la progression du feu. L’expérience a prouvé, par contre, qu’« au-delà d’un certain taux de boisement, les moyens de défense contre l’incendie, perdent leur efficacité » [F. Mouton 1957]. Notons enfin qu’il faut une population locale pour surveiller la forêt, signaler les chablis, les incendies, ou les coupes sauvages que pourraient effectuer des exploitants peu scrupuleux. Une population qui paie des impôts locaux, finance l’entretien des chemins vicinaux (puisque l’exonération trentenaire de l’impôt foncier sur les plantations fait que les reboiseurs ne participent guère à la réfection des chemins abîmés par le gel et par le débardage des grumes et des rondins…).
Enfin le tourisme, dont il nous faut dire quelques mots (bien qu’il soit hors du champ immédiat de l’étude), impose une limite à l’extension de la forêt comme au déclin de l’agriculture. De nombreux émigrés reviennent passer les vacances au pays. Les résidences qu’ils aménagent (ou qu’ils bâtissent) représentent 30 à 40 % du chiffre d’affaires des artisans ruraux. Doublant, parfois même triplant la population des communes, la présence de ces estivants en juillet et en août assure le maintien de commerces et de services. En tant qu’émigrés, ces touristes sont souvent des agents de l’emprise forestière. Mais ils ne sont pas promoteurs d’une utilisation touristique des sites. Ils se contentent d’occuper l’ancien cadre bâti et d’élever quelques pavillons sur des parcelles aisément viabilisables.

Localement cependant, des installations touristiques, conçues en fonction de cette clientèle et de vacanciers sans attache directe au pays, s’approprient des secteurs relativement étendus. Il s’agit encore d’espaces limités où le vent peut pousser les voiliers sur l’indispensable plan d’eau. La création du complexe nautique de Vassivières au nord creusois du plateau est le premier exemple — et le plus important à ce jour — de cette emprise touristique. Certes, la pluviosité est trop abondante et trop fréquente pour permettre un ample déploiement de la consommation d’espace à des fins de loisirs. Pourtant quelques projets sont à l’étude, ou en cours de réalisation24. La SAFER estime ainsi que l’ « agriculture doit pouvoir laisser une large place à une autre destination pour les sols susceptibles d’être inondés et voués alors à des activités piscicoles touristiques ou autres » [SAFER 1969]. Pour leur part, les responsables du plan d’aménagement rural songent sérieusement à inscrire dans l’espace du plateau une mise en valeur des pratiques ludiques des vacanciers :
« Le développement du tourisme […] devra faire l’objet d’une recherche des formes originales d’activités et de loisirs adaptées aux conditions du milieu naturel et à l’exploitation de l’espace, des sites, du potentiel halieutique des cours d’eau. L’utilisation des plans d’eau naturels ou artificiels, le tourisme équestre, le tourisme ‘à la ferme’, les activités de détente : pêche, randonnée en forêt […] devront faire l’objet d’études de clientèle précises […] débouchant sur un plan-programme de tourisme établi en étroite collaboration avec la somival. »
[DDA 1971a.]
Pratique coutumière des émigrés, mais aussi moyen de « rentabiliser l’espace », « d’exploiter le milieu naturel en répondant au besoin d’évasion » [DDA 1973] des citadins, le tourisme intervient donc à son tour, et en seconde ligne, comme partie prenante. Simple figurant aujourd’hui, il peut, à l’occasion, envisager de jouer les premiers rôles. Sans doute son emprise est-elle de nature à accentuer les difficultés de l’agriculture, mais, en même temps, le tourisme suppose le maintien à long terme d’une population paysanne. Où trouver autrement la main-d’œuvre pour assurer les services indispensables, pour entretenir les chemins et les routes ? Le touriste a besoin d’espace…, mais d’un espace humanisé, entretenu. Seuls les cueilleurs de champignons errent dans les pessières de Millevaches (où ils concurrencent efficacement les paysans qui trouvent dans cette activité de cueillette d’appréciables revenus complémentaires). Les promeneurs, les vacanciers, les cavaliers vont le long des prés et des landes, aux abords des ruisseaux. Ils évitent tout autant les broussailles chaotiques que l’armée noire et serrée des plantations d’épicéas. Pour les résidents secondaires (propriétaires, ou non, d’espaces forestiers), pour les touristes, il faut une paysannerie résiduelle pour « composer le paysage », pour entretenir les clairières, les chemins. Dans l’optique d’une mise en valeur touristique, le paysan doit subsister en tant que « jardinier de la nature ». L’agriculture doit être soumise à la consommation de l’espace. Elle doit être présente, non tant pour produire que pour favoriser la reproduction des loisirs citadins.
La substitution d’une mise en valeur touristico-forestière à l’utilisation agricole du sol suppose donc que soit préservé à long terme un espace agricole. « II faut des hommes dynamiques en nombre suffisant pour être les gardiens du milieu naturel. » [DDA 1971a.] Il faut des paysans pour protéger la forêt des incendies, les résidents secondaires et les touristes d’un environnement sauvage, impénétrable et inquiétant. Si l’espace est à l’encan, il convient d’éviter, dans l’intérêt même de la forêt (et du tourisme), qu’une partie prenante l’emporte sans partage. Ces raisons imposent aux aménageurs la recherche d’un compromis, sans que la vocation forestière dominante soit remise en cause.
Pour ménager les transitions, comme pour préserver l’avenir d’un espace agricole et d’une population locale, les aménageurs sont donc conduits à définir des limites à l’extension des reboisements. C’est ce qui explique l’élaboration d’un plan d’aménagement rural dont un des objectifs est de favoriser, par le développement de l’IVD (et des primes spéciales), les transferts fonciers au bénéfice d’agriculteurs et d’aider à la reconversion extensive des éleveurs. C’est ce qui explique la volonté de contrôler l’affectation du sol par des opérations de zonage. Il s’agit d’imposer, compte tenu de la situation locale, une règle du jeu à la lutte que se livrent les parties prenantes sur le sol du plateau.

Désertification ou annexion de l’espace ?
Repoussant toute idée de non-intervention dans les affaires du plateau, la DDA estime que « les conséquences d’une telle politique d’abandon sont faciles à prévoir : disparition d’ici dix ans de toute activité agricole hormis une économie de subsistance des plus âgés, régression rapide de la vie rurale, retour progressif à une nature sauvage franchement hostile : landes à fougères et à ronces, halliers et taillis impénétrables, tourbières et marécages. » [DDA 1971a.] Pour sa part, ayant présenté des propositions d’aménagement, Y. Calloc’h [1969] proclame : « Je suis certain que si l’on n’agit pas ainsi, toute vie sociale et économique aura quitté cette région dans vingt ans ! » Dans dix ans, dans vingt ans…, bref le plateau, si l’on intervient pas, s’achemine vers le « désert ».
Dire qu’une région se désertifie, c’est signifier, en même temps, la destruction totale de sa vie sociale et la dégradation définitive de sa végétation et de ses sols. Plus la population s’effrite, plus l’inculte s’installe ; plus progresseront les friches, plus la population quittera le pays. L’association du dépeuplement et du déclin de la mise en valeur confère aux transformations sociales et écologiques que l’on peut constater le cachet de l’irrémédiable. Si n’interviennent pas d’importantes mesures, le plateau est-il engagé dans la voie de cet ultime désastre ?
On ne saurait parler de détérioration des aptitudes productives
Le déclin de la mise en valeur agricole ne fait aucun doute. Implique-t-il pour autant une destruction des potentialités productives de la région ? Sur les ruines de l’agriculture, sur les coupes à blanc abandonnées par des propriétaires absentéistes, nous voyons s’installer différentes associations végétales de landes, broussailles et taillis.
La callune s’étend sur les pacages abandonnés. Elle tend à acidifier le sol. Mais il n’y a rien là d’irréversible. Bien conduite, la remise en valeur est possible et peut tirer parti de l’humus accumulé par la bruyère. Entre les deux guerres mondiales, les paysans de Millevaches parvinrent à récupérer une grande partie des ancestrales callunaies de leurs biens communaux. Le feu, le labour, une ou deux cultures de sarrasin y ont pourvu sur les parcelles les plus praticables. Ailleurs, il a suffi de parquer plusieurs années de suite le bétail. Il en est de même des landes à genêts qui s’implantent sur les anciens labours. Loin d’appauvrir le sol, la genêtière l’enrichit par le travail de ses racines et par la fixation d’azote sur les nodules de ses radicelles. La transformation d’une lande à genêt en bon pacage est possible, pour peu que l’on y puisse maintenir une charge suffisante de bétail à l’hectare.
Si l’absence d’exploitation se prolonge, ces associations de landes évoluent vers des peuplements arbustifs. S’installent en premier lieu quelques fruitiers sauvages, le bouleau et le pin sylvestre, puis, à l’ombre de ces essences, le hêtre. Un taillis embroussaillé s’établit, improductif, impénétrable. Mais là, point de non-retour. Convenablement traité, tout taillis peut repartir en souche et s’orienter vers la futaie de hêtres. La simple plantation de sapins pectines porte-graines peut, à moindre frais, enrésiner ces peuplements (avec une essence peu acidifiante et produisant des bois de grande qualité). Rien n’interdit enfin de défricher les taillis des faibles pentes et de récupérer ainsi un sol enrichi par l’humus des essences feuillues. Dans ces transformations du couvert végétal et des sols du plateau, rien ne permet de postuler une dégradation irréversible (ou difficilement réversible) des potentialités productives du milieu. Par ailleurs, la principale mutation n’est pas, en Millevaches, l’extension de l’inculte mais la plantation des épicéas. La forêt gagne sur les landes, sur les friches, sur les broussailles et les taillis autant que sur le territoire agricole. Si mal entretenue soit-elle, cette forêt est productive… et pourrait aisément l’être bien plus (en pratiquant des coupes d’éclaircies par exemple). Certes, l’épicéa (comme le pin sylvestre) acidifie le sol, le chargeant d’un humus difficilement minéralisable. La régénération naturelle paraît très faible dans ce type de plantation, et il y a tout lieu de supposer qu’il conviendra de replanter entre chaque révolution (peut-être même d’appliquer des façons culturales et des amendements, comme en ligniculture). L’ampleur du phénomène est cependant mal connue et contestée. Les dangers de podzolisation sont un argument en faveur de plantations associant à l’épicéa des essences moins acidifiantes. Mais ils ne permettent pas de conclure à une détérioration définitive du sol. On ne saurait donc parler en Millevaches, sans épurer explicitement le terme de ses résonances écologiques. Il n’y a à craindre ni latérisation, ni érosion irrémédiable, ni un tel appauvrissement du sol que toute remise en valeur soit hors de portée et de propos.

On ne saurait parler de dépopulation irréversible
Reste la conviction d’une inéluctable dépopulation. L’abandon de la mise en valeur se perpétuera car il n’y aura plus personne, à terme, pour entretenir cet espace et en tirer parti : la désertification n’est pas encore à l’œuvre sur le plateau, mais le désert attend fatalement cette proie que les hommes auront abandonnée. Telle est l’analyse que développent les études d’aménagement du plateau. Elles font référence à un seuil critique de peuplement, c’est-à-dire à un taux de densité de population en deçà duquel « l’installation humaine ne tient plus et s’effrite » [F. Mouton 1957]. S’agissant du canton de Bugeat, la SAFER est catégorique : « En dessous du seuil de vie sociale, ce secteur est condamné. » Plus nuancée, la DDA estime pour sa part que « la densité d’occupation du territoire n’atteint plus que 12,7 hab./km2 et se rapproche dangereusement du seuil à partir duquel le maintien d’une vie rurale active devient difficile à assurer ».
Nous avons, dans une publication précédente, critiqué les présupposés de cette théorie des seuils de sociabilité [G. R. Larrère 1976a]. Les conclusions de ce travail rejoignent celles de N. Mathieu et J.-C. Bontron, lorsqu’ils analysent les régions françaises à faible densité humaine : « II n’y a pas de modèle optimal de peuplement, ni de déterminisme de peuplement qui condamnerait à la désertification certaines régions. On ne peut parler d’un seuil de densité pour le maintien de la vie sociale. » (J.-C. Bontron et N. Mathieu 1976.] Reproduire ces analyses occuperait, par trop, l’espace qui nous est imparti. Supposerait-on la théorie pertinente, contentons-nous de remarquer ici que même si les communes les plus dépeuplées doivent être abandonnées, rien n’interdit des regroupements de population auprès des bourgs et la mise en valeur à distance des anciens finages (pratique envisageable pour la forêt comme pour l’élevage extensif).
La dramatisation d’un conflit social
Nous assistons en Millevaches à la destruction progressive d’une société rurale. L’affaiblissement du potentiel humain, l’impossibilité qui en dérive de maîtriser l’espace, l’intervention systématique des promoteurs de la forêt conduisent au déclin de la mise en valeur agricole. Ce processus induit le développement de systèmes écologiques improductifs (taillis et callunaies), insuffisamment productifs (timbre-poste abandonné à son morcellement), instables ou relativement dégradants (plantations d’épicéas). Or, nous l’avons vu, il n’y a rien là d’irrémédiable. Ces transformations accompagnent une mutation de la mise en valeur et le « concept » de désertification ne signifie rien qui puisse rendre compte du processus de transformation du plateau. Pourquoi donc associer, avec tant d’insistance, l’image du désert à une histoire qui n’y conduit pas ?
La nature sauvage sans appropriation humaine est désormais perçue comme élément hostile. Elle symbolise la faillite de la société et de ses efforts de mise en valeur. Elle est assimilée au désert. Et le désert c’est la mort d’un pays.
C’est que le thème de la désertification est le discours dramatisé d’une réalité plus terre à terre, celle de l’enjeu que le sol représente. Nous ne sommes plus au temps où les forestiers pouvaient voir dans la progression de l’inculte une révélation de la vocation naturelle ; où ils proposaient de se mettre à l’école de la végétation spontanée pour reconstituer l’équilibre écologique d’une région. La nature sauvage sans appropriation humaine est désormais perçue comme élément hostile. Elle symbolise la faillite de la société et de ses efforts de mise en valeur. Elle est assimilée au désert. Et le désert c’est la mort d’un pays, c’est un espace incontrôlé et inquiétant (refuge des bêtes sauvages, voire même des réprouvés, des asociaux). Compte tenu des connotations courantes du terme, parler de désertification, c’est aujourd’hui condamner sans appel — et sans autre analyse — l’évolution des choses. C’est proclamer l’inéluctable fin de la société rurale. C’est justifier l’urgence, l’impérieuse nécessité d’une nouvelle forme d’appropriation et de mise en valeur de l’espace. La crainte du désert, s’organisant au cœur même de la civilisation, renforce le pouvoir de conviction de tout projet, justifie toute intervention, discrédite le point de vue de ceux d’entre les habitants qui tenteraient de résister aux mutations économiques et sociales qui « s’imposent ». Entre l’aménagement du territoire et le néant, l’enjeu est tel qu’on ne voit plus au nom de quoi quelques paysans pauvres refuseraient de prendre l’IVD, ni de quel droit les éleveurs qui subsistent encore s’opposeraient à l’extension des plantations ou à l’installation des centres touristiques. On ne voit plus au nom de quoi les reboiseurs refuseraient de concéder quelques clairières à des agriculteurs modernes et extensifs. La notion de désertification a pour effet de renforcer le point de vue de ceux qui peuvent la manipuler, occultant l’analyse d’une crise agraire et des contradictions qu’elle recouvre.
Les termes de l’enjeu
S’agit-il de mieux gérer les ressources naturelles de la région ?
L’emprise de la forêt s’étend, se restreint celle de l’agriculture. S’il ne s’agit pas de lutter contre un processus de désertification, cela signifie-t-il que la forêt est ici en mesure d’assurer une utilisation plus productive, plus rationnelle de l’espace ? La confrontation des parties prenantes, les concessions que tentent de définir et d’imposer les responsables de l’aménagement peuvent-elles réaliser une affectation optimale du sol ? Les transformations de la mise en valeur du plateau peuvent-elles être conçues en terme de rentabilité économique ? Tout porte à penser que non. Perfectionner, sophistiquer des modèles économétriques ne servirait à rien : parler de rentabilité comparée de l’agriculture et de la forêt est dénué de sens. Il faudrait pouvoir estimer sur une longue période (au minimum trente ans) les revenus cumulés de l’agriculture et ceux, exceptionnels, de la forêt. Voulez- vous calculer le rendement financier d’une forêt que l’on projette de planter ? Il vous faut estimer le prix des différentes catégories de bois qu’elle produira dans trente ou quarante ans. Celui de la main-d’œuvre aussi à cette époque, celui de l’énergie, etc. Certes, vous pouvez toujours prolonger les courbes de prix constatées. Vous projetez dans un avenir lointain l’évolution contemporaine (et conjoncturelle) du marché. Alors, vous faites fi des mutations économiques susceptibles d’intervenir d’ici là. Trente ou quarante ans ce n’est pas demain. C’est un temps suffisant pour que vous ne soyez pas en mesure de vérifier la pertinence de vos estimations. Un temps suffisant pour que l’appareil productif des entreprises d’exploitation et des industries du bois se soit renouvelé plusieurs fois, que des innovations technologiques aient bouleversé les conditions d’exploitation et de traitement du bois. Un temps suffisant pour que les débouchés actuels soient saturés ou en déclin, pour que de nouvelles utilisations se développent…
Certains pionniers du reboisement en Millevaches tentèrent ainsi, au début de ce siècle, de prouver la rentabilité économique des plantations de pins sylvestres. À leur époque, les étais de mine se vendaient bien. L’industrie extractive était en plein essor. Il paraissait justifié de projeter dans un avenir lointain le système contemporain des prix et, actualisant le revenu futur de la forêt, d’établir sa « rentabilité » par rapport aux maigres profits du pacage extensif. Hélas, quand les plantations furent en âge d’être exploitées, la politique énergétique de la France avait changé. À l’utilisation de l’énergie fossile nationale, le système dominant avait substitué l’importation du pétrole à bas prix des pays du Tiers Monde. La « pétroprospérité » s’installant, les mines de l’Auvergne fermèrent une à une. Privé de son débouché, le pin sylvestre se révéla une essence médiocre pour la pâte à papier, fournissant, en outre, des sciages de second choix. Il se vendit donc moins, et moins bien que prévu. Sommes-nous certains aujourd’hui de mieux appréhender le marché à long terme que ne le firent les forestiers du début de ce siècle ? Tout porte à penser que non. Aucune analyse de la forêt en Millevaches, parue entre 1970 et 1973, ne faisait allusion au fait qu’un fort réajustement du coût de l’énergie pouvait intervenir et modifier considérablement les conditions du marché du bois. Il eût suffi pourtant de n’anticiper que de quelques mois pour envisager une telle éventualité…
Comment estimer, par ailleurs, l’évolution concurrente des revenus agricoles ? Il faudrait pouvoir saisir la transformation des techniques, l’évolution du prix des denrées, celle des coûts de production. Bien malin qui nous dira le prix relatif du tourteau de soja, du tracteur, du veau de boucherie ou de l’animal maigre dans cinq ans… Estimer leurs itinéraires respectifs pendant trente ou quarante ans tiendrait du prodige.
Lorsqu’il s’agit donc d’investissement forestier, la signification du calcul économique paraît fort compromise, toute notion de rentabilité lourdement teintée de subjectivisme25. A fortiori excluons-nous la définition, dans un espace régional, d’une affectation optimale du sol, car celle-ci devrait, en outre, prendre en considération des effets de masse encore mal maîtrisés. Elle devrait même tenir compte des valeurs d’usage non commercialisantes et des nuisances de la forêt, tout aussi mal connues. De la forêt et de l’agriculture, lorsque ces deux modes de mise en valeur se concurrencent sur le sol, ce n’est ni le moins désertifiant ni le plus rentable qui l’emporte, mais celui dont les promoteurs ont les moyens de contrôler l’espace et de l’organiser selon leurs vues. La répartition de la forêt et de l’agriculture entretient donc peu de rapports avec la recherche d’une bonne gestion des ressources naturelles. Elle transcrit sur le terrain le rapport de forces qui s’établit entre les parties prenantes, compte tenu de l’arbitrage des aménageurs.
Pourtant la question n’est pas uniquement de savoir qui, du paysan ou du « nouveau reboiseur », contrôlera le sol. Elle engage aussi l’avenir de la région et l’insertion de ses activités dans l’économie nationale.

La soumission de l’espace rural du plateau aux besoins de la reproduction élargie du capital
Supposons qu’une agriculture extensive, autre que marginale, parvienne à trouver place en Millevaches. La majeure partie de ses revenus serait (à l’exception des rentes foncières et des impôts) consommée, ou réinvestie, sur place (il en serait ainsi, notons-le, des revenus d’une forêt contrôlée par les habitants du plateau). En serait-il de même pour un pays couvert de plantations résineuses ?
Certes, le timbre-poste appartient encore largement aux paysans, aux retraités, aux artisans et commerçants de la région, mais il est peu productif, et, puisque les services compétents n’envisagent pas de l’aménager, il sera de moins en moins adapté aux conditions de mobilisation et d’utilisation industrielles du bois. L’avenir appartient donc à ces récentes plantations d’épicéas que les notables de la région, et plus encore les non-résidents, établissent sur de vastes parcelles. Les revenus futurs de ce massif « structuré » serviront-ils au développement des activités productives de la région, au financement de l’armature des équipements et des services ? S’agissant des non-résidents, tout permet d’en douter. Qu’ils soient ou non sentimentalement attachés au pays, ils n’y ont investi que pour placer un capital monétaire ou pour valoriser un patrimoine, profitant du faible coût du foncier, des aides du FFN et des avantages fiscaux qui leur sont accordés (exonération trentenaire de l’impôt foncier, exonération partielle des droits de succession). Mais leur univers social est ailleurs. C’est dans l’espace des cités où ils vivent, travaillent et consomment qu’ils dépenseront l’essentiel de leurs revenus forestiers. Tout au plus investiront-ils en Millevaches ce qui sera nécessaire à la reproduction de leur peuplement résineux (soit, environ le dixième du produit d’une coupe dans le système de prix actuel). Il n’est même pas certain que ce sera toujours le cas. La DDA de Corrèze estime qu’il y a déjà, chaque année, quelque 200 ha de coupes à blanc abandonnées par des propriétaires absentéistes.
Cet aspect essentiel des reboisements actuels en Millevaches est, pour l’instant, occulté. D’abord les non-résidents possèdent surtout des plantations qui ne sont pas encore en âge d’être exploitées. Ensuite, « cette catégorie, très attachée au pays, est probablement celle qui investit le plus : construction, réparation, bâtiments, achats de terre » [SAFER… 1969]. Importateurs de capitaux dans la région, les nouveaux reboiseurs apparaissent ainsi comme les principaux agents de son développement. Mais l’objet même de cet investissement est d’annexer un territoire, d’y implanter un mode de mise en valeur qui permettra, dans un second stade, une « exportation » des profits et des rentes réalisés.
Sans doute la création d’un massif forestier bien ajusté aux besoins industriels peut-elle justifier l’implantation, à proximité, d’entreprises de façonnage ou de trituration du bois. Mais il est permis de s’interroger sur l’ampleur de ce phénomène et l’importance de ses « retombées locales ». La majeure partie des sciages est exportée vers des entreprises de la région parisienne, où se concentre ainsi une large part de la valeur ajoutée du circuit de transformation. Les quelques décentralisations opérées depuis une dizaine d’années n’ont, par ailleurs, guère de quoi convaincre. Elles semblent avoir compensé les handicaps liés aux difficultés de transport, comme à l’éloignement des centres administratifs et commerciaux, en proposant à leur personnel des conditions de rémunération et de travail peu attractives. La plupart de ces entrepreneurs n’ont ainsi embauché que le contingent de main-d’œuvre locale justifiant l’obtention des primes et l’exonération de l’impôt. Ils font façonner leurs produits par des ouvriers immigrés, turcs ou portugais…, main-d’œuvre fréquemment renouvelée, soumise à de dures conditions de travail, vivant de façon très précaire…, et exportant une partie de ses faibles salaires.
L’installation d’une usine de panneaux de particules à Ussel n’a certes rien à voir avec les implantations d’entrepreneurs « chasseurs de prime ». Mais cette entreprise dépend d’un groupe industriel important qui concentre les profits de ses filiales et les redistribue en fonction d’une stratégie nationale. Rien ne permet d’avancer avec certitude que ce holding développera les activités de cette entreprise locale.
Ainsi, la progression de la forêt « structurée » correspond à la promotion d’une mise en valeur dont les fruits seront largement exportés. Bien plus, l’intérêt principal des reboisements en Millevaches ne réside pas dans une éventuelle insertion de la forêt dans l’économie régionale. Il tient à l’utilité que peut présenter ce massif pour l’économie nationale. « Le plateau de Millevaches pourrait devenir l’un des premiers réservoirs de matières ligneuses de France. » [DDA 1971a.] Tel est pour la DDA « le premier atout de la région ». Le déficit national de la balance commerciale pour les bois et produits dérivés est considérable, et en constante progression. Il s’élevait à 2 milliards de Francs en 1968, à 5,8 milliards en 1974 [J. Gadant 1976] et dépassait 7 milliards de Francs en 1976. C’est le second poste de nos importations après les produits pétroliers. Les importations de pâtes, cartons et papiers, de rondins d’épicéa (destinés à la « filière de la pâte mécanique ») et de sciages résineux constituent l’essentiel de ce déficit.
Or notre civilisation consomme (et, peut-être, gaspille) une quantité croissante d’emballages, de « non tissé », de papiers, de livres, journaux, tracts, prospectus et affiches publicitaires, électorales, etc. Support matériel des échanges, de l’information, de la promotion des ventes, matière première indispensable au bon fonctionnement de l’administration, aliment nécessaire de toute bureaucratie…, le papier, à bien des égards, peut être considéré comme une denrée stratégique (stricto sensu, pourrions-nous dire, tant on imagine mal le fonctionnement des forces armées sans papier…). Quoi de plus logique, dans un souci d’indépendance nationale, que de ne point dépendre, pour un tel produit, des importations canadiennes, Scandinaves et soviétiques ?
Par ailleurs, « le bois est un matériau renouvelable et biodégradable, qui nécessite (à poids égal) pour sa mise en œuvre vingt-cinq fois moins d’énergie que l’acier et cent fois moins que l’aluminium, tout en n’entraînant que des pollutions négligeables » [N. Decourt, 1978]. Si ces produits ont supplanté le bois à une époque d’énergie bon marché, son utilisation industrielle présente un nouvel intérêt (bien qu’elle nécessite en général plus de travail) dans une conjoncture internationale où le prix directeur de l’énergie s’oriente à la hausse. Le développement de l’industrie du bois d’œuvre et des panneaux de particules peut ainsi s’insérer dans un programme de limitation de la consommation énergétique26).
À une époque où les positions impérialistes du capitalisme français sont en déclin, les reboisements de montagne manifestent un redéploiement de son activité sur le territoire national.
Pour l’ensemble du capitalisme français, il est donc essentiel de réduire le déficit de la branche des produits du bois, important de s’engager dans le développement de la production de pâte et de sciage résineux.
Cela suppose la mobilisation des ressources qui se trouvent encore inemployées. Cela suppose aussi, en prévision du long terme, le reboisement des espaces sous-utilisés — ou abandonnés — des régions où décline la mise en valeur agricole. Cela suppose donc que, dans ces régions, l’on substitue à l’appropriation paysanne du sol une annexion du territoire, au profit de diverses catégories sociales susceptibles de reboiser. Conçus en fonction d’une exigence nationale (équilibrer la balance commerciale en sorte de favoriser la reproduction élargie du capital), tenant compte des stratégies d’approvisionnement de puissants groupes papetiers, réalisés par des citadins — pour la plupart aisés — sous le contrôle de l’État, les reboisements du plateau de Millevaches participent à une soumission de cet espace au mode de production dominant.
Lorsque la SAFER, convaincue de la vocation forestière du canton de Bugeat, souhaite une « recolonisation de résidents secondaires propriétaires d’espaces forestiers », le terme est à prendre au sérieux et, dans un certain sens, au pied de la lettre. Il s’agit d’ailleurs, nous pouvons le noter, d’une tradition des promoteurs de la forêt. Lorsqu’en 1880 J.-B. Martin proposa de reboiser les communaux au nom de l’intérêt national (et des intérêts particuliers de l’industrie extractive), il écrivit un opuscule qui s’ornait du sous-titre « Colonisons la France ! ». À une époque où les positions impérialistes du capitalisme français sont en déclin, les reboisements de montagne manifestent (comme d’autres transformations récentes de l’espace rural) un redéploiement de son activité sur le territoire national.

Conclusion
Le lieu
Un plateau monotone, jadis couvert de landes à moutons, aujourd’hui de forêts ; avec des plages cultivées, des herbages et du terrain perdu : des friches, des broussailles, des « accrus ».
Le temps
Une époque où le développement du capitalisme remet en cause l’intérêt d’une production traditionnelle de veau blanc qui exigeait beaucoup de temps, de savoir-faire et d’amour du métier.
Une époque où les pouvoirs publics entendent rentabiliser le territoire, tirer parti de ses ressources naturelles, réorganiser son espace. Où l’agriculture peut jouer ce rôle, les paysans sont incités à se moderniser. Où elle le joue mal, s’implantent la forêt, le tourisme… ou des camps militaires.
Une époque où les paysans vivent isolés les uns des autres, atomisés, sérialisés.
Une époque où ils estiment leurs conditions particulières d’existence inférieures aux normes de vie que leur impose (ou leur suggère) la classe dominante.
Une époque où l’exode n’est plus, dans la Montagne, la sanction d’un échec ou le constat d’une misère, mais la voie, tant espérée, d’une ascension sociale.
Les personnages
Quelques vieux paysans, plutôt pauvres. Leurs enfants se sont installés en ville. Pour leur pays ils n’envisagent pas un avenir radieux. Ils viennent de porter en terre deux des leurs…
Un jeune agriculteur relativement optimiste. Marié, père de deux enfants il s’en tire moins mal que les autres ; ce n’est pas la richesse à proprement parler, mais il vit mieux, il a un bon domaine, il a de l’avenir.
Des émigrés, pour la plupart fils ou petits-fils de paysans pauvres. Ce pays est un peu le leur. Ils y reviennent volontiers. Mais leur vie est ailleurs. Dans un autre univers, celui des villes, sont leurs soucis et leurs pratiques. Ils héritent ou ils vont hériter. Certains ont quelque peu réussi, ils ont de quoi économiser. Et, avec cet argent, ils boisent le patrimoine familial ou se proposent de le faire.
À leurs côtés, un chœur imprécis de notables, fascinés par la terre et le bois.
L’argument
Deux paysans sont morts. Deux autres sont un peu malades. Ils cultivaient 100 hectares tous les quatre. En tout, ils élevaient 80 vaches. Ils vivaient du jardin, de la basse-cour et de 8 000 F à 10 000 F par an chacun. Tout ceci se libère : terres, cheptel, bâtiments.
Quelques paysans récupéreraient volontiers une ou deux parcelles tout au plus. L’un a besoin d’un bon pré, l’autre de quelques pacages bien protégés du vent et des gelées tardives, tel autre d’un lopin enclavé dans ses terres. Mais ils n’ont guère les moyens d’être plus ambitieux. Pour exploiter plus de terre, il leur faudrait aménager et agrandir leurs bâtiments, il leur faudrait travailler plus encore. Ou bien il leur faudrait… abandonner le veau de boucherie pour le broutard… A quoi bon quand on a 50 ans et que les enfants sont partis pour la ville !
Le jeune paysan se détache des autres. Il parle plus fort, il a plus d’assurance et de plus amples prétentions. Il veut ces 100 hectares pour conduire à lui seul — aidé d’un vieux commis — 100 bêtes en plus des 40 qu’il élève déjà. Il emploiera des méthodes modernes. Il fera du « ranching » en quelque sorte. Les techniciens ne lui ont-ils pas dit que c’était l’avenir ? Alors, place aux jeunes ! Il est prêt à tout prendre27.
Mais voilà ! Les deux héritiers ne veulent rien savoir. Cette terre est à eux. Certes, ils n’y ont presque jamais travaillé, mais elle leur vient des parents. Ils aiment le pays et entendent y aménager la maison des vieux. Ils y installeront (enfin !) un brin de confort. Avec des crédits, ils reboiseront le reste des terres… On ne sait jamais, le bois se vend bien. C’est, dit-on, un bon placement et ça peut toujours être utile28. En attendant, parce que le jeune paysan insiste un peu, ils acceptent, éventuellement, de lui louer quelques parcelles. Mais attention ! pas de bail ! une location à l’année, à l’amiable…, juste un engagement verbal afin de garder les mains libres. Juste de quoi maintenir la terre en état avant de reboiser. Le jeune agriculteur décline l’offre : allez donc défricher dans de telles conditions ! Impossible !
Un des vieux paysans a besoin d’argent tout de suite. La retraite ça ne suffit pas pour vivre, ses 10 vaches ont eu la brucellose, il doit réparer la toiture de sa maison. Il veut vendre des terres, ne gardant pour lui qu’un petit lopin avec une ou deux bêtes… Notre jeune exploitant hésite à acheter. Le crédit, ma foi, ça se paie. Et le vieux n’est pas prêt à laisser sa terre pour rien. Un pharmacien et un notaire se détachent alors du chœur des notables. Ils font au vieux des propositions, se disputent, et le notaire part avec son titre de propriété sous le bras (ce pourrait aussi bien être le pharmacien).
Le dernier vieux est indécis. Moins pauvre que son voisin, il n’a guère besoin de vendre. Mais il ne peut plus non plus, à son âge, s’occuper de ses 15 vaches et nourrir tous les veaux. Va-t-il prendre I’IDV ou laisser ses enfants libres de disposer à leur guise du sol ? Justement, ceux-ci sont en vacances. Ils hésitent. Reboiser ? La forêt, c’est sans doute rentable, mais ils n’ont guère les moyens de planter, moins encore le temps de s’en occuper. Un contrat FFN ? Oui, mais si l’administration gère la forêt, on ne pourra pas exploiter le bois quand on aura besoin d’argent. Finalement, ayant pris conseil des uns et des autres, et le café chez le jeune exploitant, les héritiers suggèrent au père de prendre I’IVD.
Le vieux remplit quelques papiers. Le jeune agriculteur se précipite dans un bureau pour récupérer la location, puis dans un autre pour emprunter de quoi mettre en valeur les 25 hectares qu’il vient de louer.
Le rideau tombe alors que les acteurs entament un hymne à l’équilibre sylvopastoral.

Dénouement, plusieurs années plus tard
Sur les 100 hectares, 70 ont été boisés, 5 sont encore en friche. Les deux héritiers reviennent chaque été. Ils vont tremper une ligne dans l’eau et ne visitent leur forêt que pour y cueillir cèpes et girolles. Le notaire (ou le pharmacien), lui, ne vient jamais. Les quelques paysans qui se trouvaient encore au premier acte ont, eux aussi, quitté la scène. La plupart de leurs terres ont été reboisées par des émigrés, des notables ou des sociétés. Il y a même un beau domaine planté sous contrat que gèrent les services forestiers. Épicéa commun, épicéa Sitka, Douglas.
En dehors du domaine des Eaux et Forêts, les plantations poussent un peu comme ça, en sauvageonnes, avec autant de petits chênes non prévus et de hêtres que de résineux. Ce spectacle réjouit beaucoup un écologue (ou un écologiste, peu importe) qui passe par hasard sur un chemin embroussaillé.
Le jeune agriculteur a bien repris et bien mis en valeur ses 25 hectares. Il a pu en récupérer d’autres ailleurs, achetant ici, louant là, au gré des rares occasions. Il a fini — non sans mal — par élever 80 vaches. Mais le veau maigre se vend moins bien que jadis, dirait-on… Ça varie en tout cas beaucoup d’une année à l’autre. Mais il y a des traites à payer. Mais il ne reste plus personne d’autre au village. Quelques estivants, l’été, viennent lui acheter des œufs et lui parlent à l’occasion. C’est tout.
II a perdu beaucoup de son enthousiasme notre ancien paysan d’avenir. Il s’interroge : sa fille est institutrice, son fils marche bien à l’école…, s’il pouvait devenir technicien !
« Quelle idée ! », dit alors le chœur des notables et des émigrés : « L’agriculture est un si beau métier ! »
Chacun part, méditant sur un avenir de désert.
Bibliographie
Bontron, J.-C. et Mathieu, N. (1976). Les espaces de faible densité dans l’espace français. Réflexions sur l’espace rural français : approches, définitions, aménagement. Université de Paris I – École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, Laboratoire de géographie rurale, pp. 143-165.
Boubal, F. (1928). L’effort forestier. Tulle : A.D. Corrèze, 8 T (54) (Document administratif multigr.).
Brenac, V. (1882). Mise en valeur du plateau central, assainissement, irrigation, reboisement. Tulle : Compte d’auteur.
Calloc’h, Y. (1969). Diagnostic sur les possibilités de maintenir des activités et d’aménager le plateau de Millevaches. Meynac : Comité Millevaches en Limousin.
Carron, M.-A. (1965). Reboisement et reconversion dans le nord de la Montagne limousine. Acta Geographica, septembre, pp. 17-34.
CERU & Ministère de l’Agriculture. (1972). Modernisation des structures agricoles. Plateau de Millevaches corrézien. Paris : Offset.
Craney, J., & Rio, P. (1974). Le dossier de l’industrie de la viande. Monographies de firmes et de groupes. Paris : INRA, décembre, 515 p. (Sér. « Économie et sociologie rurales »).
Decourt, N. (1978). Environnement et politique forestière. Économie rurale.
Direction départementale de l’agriculture (DDA) (Corrèze). (1971a). Propositions pour une politique concertée de développement et d’aménagement du plateau de Millevaches en Corrèze. Tulle : Offset.
Direction départementale de l’agriculture (DDA) (Corrèze). (1971b). Tableaux de l’enquête réalisée en 1969 sur la propriété forestière en Corrèze. Tulle : Multigr.
Direction départementale de l’agriculture (DDA) (Corrèze). (1972). Documents sur l’état des dépenses du Fonds forestier national de 1950 à 1971. Tulle : Multigr.
Direction départementale de l’agriculture (DDA) (Corrèze). (1973). Projet de mise en valeur touristique d’un secteur du plateau de Millevaches. Tulle : Multigr.
Direction départementale de l’agriculture & Association départementale pour l’amélioration des structures des exploitations agricoles de Corrèze. (1972). Programme d’opérations concertées de développement et d’aménagement du plateau de Millevaches en Corrèze. Tulle : Offset.
Fel, A. (1962). Les hautes terres du Massif central. Tradition paysanne et économie agricole. Clermont-Ferrand : Faculté des lettres et sciences humaines.
Frères du Monde. (1969). L’oppression idéologique et culturelle subie par les paysans pauvres et moyens. Frères du Monde, 3e trim., 59, pp. 53-67.
Gadant, J. (1976). Le bois de trituration. Compte rendu de l’Académie d’Agriculture de France, 62(12), pp. 905-924.
Groupe pour la fondation de l’Union des communistes de France marxiste-léniniste (UCFML). (1976). Le livre des paysans pauvres. Paris : Maspero (Coll. « Yenan »).
Larrère, G. R. (1974). Éléments sur l’histoire de la mise en valeur du plateau de Millevaches. Clermont-Ferrand : INRA, Multigr.
Larrère, G. R. (1975). Analyse d’une politique forestière. Clermont-Ferrand : INRA, Multigr.
Larrère, G. R. (1976a). Dépeuplement et annexion de l’espace rural : le rôle de la théorie des seuils de sociabilité. Géodoc, 7, Toulouse – Le Mirail.
Larrère, G. R. (1976b). Évolution de la mise en valeur du plateau de Millevaches : une crise agraire et son enjeu. Bulletin d’Information du Département d’Économie et de Sociologie rurales, 2.
Liénard, G. (1973). L’exploitation des troupeaux de vaches allaitantes. Journées d’information du Grenier de Theix, n° spécial. Clermont-Ferrand : INRA, Offset.
Liénard, G., & Baud, G. (1978). Quel avenir pour le veau de boucherie en zone herbagère ? Son évolution en Auvergne et Limousin. Bulletin technique INRA-CRZV, dans Le veau de boucherie. Versailles : INRA-publications.
Martin, J.-B. (1896). Le Plateau de Millevaches. Colonisons la France ! Tulle : A. D. Corrèze, BR 364.
Ministère de l’Agriculture (Direction des forêts). (1970). Inventaire forestier national. Département de la Corrèze. Paris : Offset.
Mouton, F. (1957). Le problème agro-sylvo-pastoral dans une petite région agricole : la Montagne limousine. Rapport ENA, Multigr.
Puiseux, L. (1977). Le label nucléaire. Paris : Galilée, 298 p.
Roustide, R. (1970). Monographie forestière de la Corrèze. Tulle : DDA, Multigr.
Safer Marche-Limousin & Ministère de l’Agriculture (Direction des aménagements ruraux). (1969). Étude d’aménagement rural d’un secteur du plateau de Millevaches. Secteur de Bugeat. Limoges : Offset.
Société centrale d’aménagement foncier rural (SCAFR). (1973). Le marché des terres agricoles en 1972. Corrèze.
Société de mise en valeur de l’Auvergne et du Limousin (SOMIVAL) & CEREF. (1971). Calcul du rendement d’investissements forestiers sur ordinateur. Clermont-Ferrand : Offset.
Vazeilles, M. (1917). Mise en valeur du plateau de Millevaches. Ussel : Eyboulet frères, 220 p.
Image de couverture : village de Combressol, carte postale des années 1970 (correze.com).

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- « Le fantasme d’une insurrection violente et zadiste revient hanter le plateau de millevaches », Médiapart, 10 décembre 2024[↩]
- https://www.terrestres.org/reprise-de-terres/[↩]
- Kristin Ross, La forme commune – la lutte comme manière d’habiter, La Fabrique, 2023.[↩]
- Lucie Leclerc, Hold-up sur la terre, Le Seuil / Reporterre, 2022.[↩]
- Larrère Raphael, « L’emphase forestière », Recherches, n° 45, 1981, p. 113-157[↩]
- voir « Un front commun contre l’industrialisation des forêts françaises », Terrestres, 26 novembre 2024 ou « Dans le parc naturel de Millevaches, les industriels font feu de tout bois », Mediapart, 25 juillet 2024.[↩]
- Catherine et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature, Flammarion, 1997.[↩]
- Ces « communaux » ont un statut juridique de bien de section. Ils n’appartiennent pas à la commune mais à la personne morale que constitue chaque village de la commune. Les habitants de chaque hameau en sont ayants droit.[↩]
- Ce mode d’utilisation individualiste du communal est assez exceptionnel dans les régions agropastorales du Massif Central. La Margeride, les Dômes connaissent le berger de village conduisant en été sur les pacages communaux les troupeaux regroupés de tous les paysans. Dans ces régions, des règles strictes attribuent les droits et devoirs de chacun. Le troupeau collectif y est parqué, chaque nuit, sur les terres des ayants droit et la législation villageoise organise la répartition des nuits de parc. En Millevaches, seuls quelques gros éleveurs parviennent à parquer leurs terres de la sorte. Les autres rentrent leurs bêtes en bergerie ou les mettent sur une parcelle (toujours la même et surfertilisée) à proximité immédiate de la maison.[↩]
- Émigrent, sous le Second Empire et au début de la Troisième République, entre 65 et 80 % des hommes valides de chaque commune (cf. G. R. Larrère 1974).[↩]
- La callunaie est une formation végétale caractéristique des pacages soumis, sur une longue période, à une charge de bétail insuffisante. Elle s’étend d’autant plus qu’il y a moins de bêtes à l’hectare ou que ces bêtes y séjournent moins longtemps. Les chercheurs du Centre de recherches agronomiques de Clermont-Ferrand ont montré, à l’inverse, qu’une augmentation judicieuse de la charge d’animaux à l’hectare permet, avec une application limitée de fumure de fond et d’engrais azotés, de transformer en cinq ou six ans une callunaie dense en pacage couvert de graminées et de légumineuses fourragères.[↩]
- Pour une analyse critique plus approfondie du « discours » forestier de l’époque et du projet de M. Vazeilles, cf. G. R. Larrère (1974).[↩]
- Dans les exploitations extensives les plus vastes — souvent les plus anciennes — , les génisses (et même certains taurillons) sont élevées et vendues comme reproductrices.[↩]
- Ces exploitations peuvent être considérées comme extensives dans la mesure où elles mobilisent moins de travail et de capital à l’hectare que les élevages de veau de boucherie. Par contre, elles permettent (sur des domaines d’une centaine d’hectares) de maintenir une charge de bétail plus importante. De ce fait, elles utilisent plus intensivement leur superficie fourragère que les exploitations traditionnelles.[↩]
- Avec -0,4 % par an, le déficit naturel entre 1954 et 1962 représentait moins du tiers de la diminution de population des communes rurales du plateau. De 1962 à 1968, le taux annuel du déficit naturel passait à -1 %. Il était ainsi responsable de plus de la moitié de la récession démographique. Aujourd’hui, même si l’émigration devait disparaître, l’excédent des décès sur les naissances ferait encore diminuer la population au rythme de -4 % par an. Cela tient au vieillissement de la population et à un taux très élevé de célibat (ainsi 46 % des exploitants de moins de 30 ans sont célibataires et 33 % des exploitants de 30 à 40 ans).[↩]
- Le marché du bois de trituration (environ la moitié de la production ligneuse) en Corrèze est monopolisé par le Comptoir des bois de Brive. Cette société d’approvisionnement est une filiale du groupe Ausseydat-Rey qui traite 10 % du bois d’industrie utilisé en France. Une entente lie ce groupe à celui de La Cellulose du pin. Ce dernier, le plus important de France, traite près de 40 % du bois de trituration depuis qu’il contrôle (avec la Banque de Paris et des Pays-Bas) la Chapelle-Darblay. La Cellulose du pin possède des actions du groupe Ausseydat-Rey et l’une de ses filiales, la papeterie de Condat-le-Lardin en Dordogne, est approvisionnée par le Comptoir de Brive.[↩]
- Les données consignées au Tableau 1 ne sont représentatives qu’à l’échelle de l’ensemble de la forêt résineuse en Corrèze. Le plateau de Millevaches constituant le plus vaste massif de ce département, on peut lui appliquer, sans trop craindre d’erreur, des ordres de grandeur équivalents. Les remarques de différents observateurs (M.-A. Carron, A. Fel, F. Mouton, R. Roustide…), les discours convergents recueillis auprès des habitants du plateau lors de nos enquêtes corroborent les conclusions qui peuvent être extraites de la lecture du tableau. Quelques vérifications monographiques que nous fîmes — sur trois petits finages — indiqueraient même une évolution plus accusée de la base sociale des reboiseurs.[↩]
- Ainsi la superficie moyenne des plantations résineuses et feuillues en conversion est de 1,4 ha quand le propriétaire est agriculteur, 1,3 ha s’il est artisan, commerçant ou ouvrier, 2,5 ha s’il est retraité. Par contre, les cadres et industriels possèdent, en moyenne, 19,4 ha de résineux et feuillus en conversion ; et les professions libérales, 10,5 ha (toujours d’après l’enquête de 1969).[↩]
- La subvention revenait à fournir gratuitement les plants ou leur équivalent en argent. Elle était plafonnée à 1 500 F jusqu’en 1968, à 3 000 F par la suite, et jusqu’en 1972. Les aides aux reboisements « structurés » sont de trois sortes. (1) Prêt en numéraire : le FFN avance sur 80 % du devis. Le prêt sur 30 ans, non indexé, est effectué avec un intérêt de 0,25 % pour les travaux de plantation. Compte tenu de l’érosion monétaire et des taux d’intérêt en vigueur, le prêt revient à subventionner l’intérêt du capital pour des particuliers ayant au moins 10 ha à boiser et pouvant avancer 20 % des frais nécessaires. (2) Contrat ou prêt en travaux : il s’adresse principalement aux collectivités, mais peut être effectué au bénéfice de particuliers, de groupements forestiers et plus encore de sociétés ayant à reboiser d’importants espaces. Le FFN se charge de la plantation, avance tous les frais. La forêt est alors gérée sous contrat jusqu’à l’épuisement de la dette. Le FFN se rembourse de ses avances — avec un intérêt de 2,5 % — et de ses frais de gestion en commercialisant à son profit 50 % de chaque coupe. (3) Prime à l’investissement forestier : la mise en œuvre de cette prime est récente. Elle s’adresse à des propriétaires possédant de vastes surfaces et susceptibles de financer 60 % des frais de reboisement. Les 40 % restant sont alors subventionnés.[↩]
- La Montagne limousine a fourni une contribution très active à la Résistance. De nombreux paysans (en particulier les anciens de la CGPT) rejoignirent les maquis de Darius au sud et la puissante armée de Guingouin au nord. À l’inverse, certains notables, issus de l’Union federative corrézienne (syndicat rival de la CGPT), épousèrent la Corporation de Vichy. Les antagonismes de cette époque sont restés vivants. L’implantation du parti communiste et du MODEF trouve ainsi sa source, non seulement dans l’action de Vazeilles, mais aussi dans cette « tradition » de la Résistance (bien que Vazeilles ait quitté le parti communiste lors du pacte germano-soviétique et que Guingouin en ait été exclu dès la Libération — soupçonné d’avoir eu l’ambition de devenir un « Tito français » pour s’être opposé à la triple alliance gouvernementale).[↩]
- Ayant recueilli l’héritage de la CGPT, s’opposant à une implantation relativement faible de la FNSEA, le MODEF a, dans un premier temps, préconisé la lutte pour le maintien des petits paysans. Son discours a changé depuis 1965. Intégrant volontiers les conceptions « modernistes », il a largement déplacé son centre d’intérêt de la défense des paysans pauvres à la recherche d’une politique favorable au développement du maximum de « paysans d’avenir ».[↩]
- Procédé par lequel la bourgeoisie anglaise, du XVIe au XVIIIe siècle, organise son espace rural en fonction de ses intérêts et de ceux d’une aristocratie convertie au capitalisme. Pour installer, en lieu et place de l’agriculture de subsistance, des « communautés » villageoises, les grands élevages ovins dont l’industrie textile avait besoin, les landlords exproprièrent les paysans par la force des lois et des armes. Ayant ainsi dramatiquement détruit la paysannerie et alimenté le prolétariat des grands centres urbains, ayant « épuré » les domaines, la bourgeoisie anglaise se dota de l’agriculture la plus moderne de son époque… et de la plus puissante industrie textile du monde.[↩]
- Ainsi, G. Liénard a mis en évidence que les résultats économiques des élevages de broutards, dont il suit la gestion en Limousin, sont notablement supérieurs à ceux qu’il constate dans des régions traditionnelles d’élevage extensif — Aubrac et Nivernais.[↩]
- Un projet de la DDA réaliserait, au sud du plateau, un plan d’eau de 40 ha entouré d’un « parc » de 160 ha réservé au camping sauvage et à différentes pratiques sportives (équitation). Pour sa part, la SOMIVAL (Société de mise en valeur de l’Auvergne et du Limousin) tente de promouvoir la réalisation d’un lac de 300 ha aux confins de Meymac, Chavanac et Saint-Merd-les-Oussines. Enfin, il est des notables locaux qui se portent acquéreurs de prés de fond et les convertissent en étangs. Certains de ces petits plans d’eau servent aux loisirs, et plus encore au « standing », de leur propriétaire. D’autres sont loués à des sociétés de pêche. En des lieux où les paysans ne parvenaient à récupérer que les fonds de vallée à cause des reboiseurs, cette emprise marginale les condamne à ne plus trouver à proximité la moindre parcelle disponible.[↩]
- La SOMIVAL fournit un bel exemple des limites du calcul économique en matière d’investissement forestier. Ayant mis au point un programme (écrit en Fortran) pour estimer le rendement financier d’une plantation, les auteurs de ce rapport reconnaissent qu’il est exclu de prévoir les valeurs relatives des différents postes de recettes et de dépenses. Ils sont donc conduits à formuler des « hypothèses » avec « une dose raisonnable d’optimisme et de pessimisme ».[↩]
- Bien plus, la forêt peut elle-même, par sa production de biomasse, devenir source d’énergie. « De nombreuses études parues récemment s’attachent à montrer le potentiel énergétique des forêts, des déchets végétaux, des plantations terrestres ou aquatiques spécialement conçues pour produire du carburant […] La bioconversion de l’énergie solaire pourrait alors couvrir une partie non négligeable de nos besoins en énergie. » (Y. Sachs, cité par L. Puiseux 1977 : 199.[↩]
- Encouragé, dans les coulisses, par quelques représentants d’organisations professionnelles agricoles.[↩]
- Dans l’assistance un forestier se met à battre des mains.[↩]






