Un succès phénoménal
Ses livres ont été traduits dans des dizaines de langues et vendus à des millions d’exemplaires ; il a été encensé par Barack Obama, Bill Gates ou Mark Zuckerberg ; il s’est entretenu avec Christine Lagarde, présidente du FMI, Angela Merkel et Emmanuel Macron ; il a fait la couverture des magazines du monde entier ; en France, l’hebdomadaire Le Point l’a présenté comme « Le penseur le plus important du monde »1 tandis que Le Figaro s’interrogeait : « Homo Sapiens et Homo Deus : la nouvelle Bible de l’humanité ? »2.
Le succès populaire et médiatique de l’historien israélien Yuval Noah Harari, depuis la parution de Sapiens. Une brève histoire de l’humanité (2011, traduit chez Albin Michel en 2015), suivi d’Homo Deus. Une brève histoire de l’avenir (2015, Albin Michel 2017), enfin de 21 leçons pour le XXIe siècle (2018, Albin Michel 2018) est un véritable phénomène. Car il n’est pas ordinaire que des livres de sciences humaines, fussent-ils des ouvrages de vulgarisation, suscitent un tel engouement. Comment l’expliquer ? La première phrase de 21 leçons pour le XXIe siècle pourrait fournir un indice : « Dans un monde inondé d’informations sans pertinence, le pouvoir appartient à la clarté ».
La « clarté » en question renvoie cependant moins à l’idée claire et distincte, critère de vérité selon Descartes, qu’à l’art de la synthèse. C’est du reste le point de départ de sa fulgurante ascension : professeur d’histoire des technologies militaires à l’Université Hébraïque de Jérusalem, Harari accepta, à la demande des étudiants, de se charger d’une tâche difficile : offrir une vision synthétique de l’histoire de l’humanité depuis l’émergence de l’homo sapiens jusqu’à nos jours. Le succès rencontré auprès des étudiants incita ensuite le professeur à écrire un livre, qui d’abord ne trouva pas d’éditeur, l’anonymat de l’auteur et l’audace du projet rendant hypothétique sa valeur commerciale. Et pourtant, il s’agissait de Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, dont le site du Figaro, le 21 juillet 2018, rapporte qu’il a déjà été traduit dans 42 langues, vendu à 8 millions d’exemplaires et qu’il va être bientôt adapté au cinéma par Ridley Scott et Asif Kapadia. Le même journal, dans un article précédent, avait rendu compte du succès de Sapiens en ces termes :
Ce raz de marée mondial s’explique par l’ambition globalisante de l’auteur. À notre époque de prolifération et d’éclatement des savoirs où plus que jamais l’homme se demande d’où il vient, qui il est et où il va, cette somme de 500 pages qui prétend faire une synthèse de l’histoire de l’humanité depuis les origines en s’appuyant sur des savoirs objectifs a tout pour séduire.2
Aujourd’hui, il est aisé d’observer que Sapiens « a tout pour séduire », mais le fait est qu’il ne trouva d’abord pas d’éditeur. C’est donc après coup qu’on s’explique le phénomène : « le pouvoir appartient à la clarté ». Mais peut-être faudrait-il distinguer entre les raisons d’un succès populaire d’une part, celles d’un succès médiatique et institutionnel d’autre part. La « clarté » pourrait en effet ne pas être de même nature dans l’un et l’autre cas, de même que le « pouvoir ». Médias et institutions politiques ou économiques ont emboîté le pas d’un phénomène dont ils ne maîtrisaient pas les ressorts, et dont le point de départ avait été étudiant. Le succès de Sapiens est donc, en premier lieu, le succès d’un savoir.
Une synthèse portée par une vision
Sapiens est une admirable synthèse de l’histoire de l’humanité, et sans conteste l’œuvre d’un vrai savant, capable de collecter des connaissances étendues et précises et de les ordonner avec clarté. Le livre est composé de quatre parties : I. La révolution cognitive. II. La révolution agricole. III. L’unification de l’humanité. IV. La révolution scientifique.
I. « La révolution cognitive » décrit l’ascension, il y a environ 70 000 ans, d’une espèce animale qui, du fait d’une évolution biologique et sociale singulière, allait devenir maître de la planète : homo sapiens. Or, quelle est la singularité de cette espèce dans le règne animal ? Harari répond que c’est sa capacité de créer des systèmes de communication, de représentation et de symbolisation qui peuvent réunir des individus qui ne se connaissent pas. Les accointances sociales entre deux singes s’expliquent par une expérience sensible, instruite par la génétique et l’instinct ; à l’inverse, les accointances sociales entre deux hommes peuvent procéder d’une expérience inconnue jusqu’alors dans le monde animal : la médiation d’un système cognitif, capable de réunir et d’organiser une masse toujours plus grande d’individus. Et une fois apparue cette part cognitive, le processus ne cessera de croître et de gagner en puissance, processus dit « sapiens ». La « révolution cognitive », c’est donc une forme d’affranchissement par rapport aux limites du corps organique. Et c’est le fil directeur que déroule Harari dans Sapiens, puis dans un second livre, Homo deus. Une brève histoire de l’avenir, de manière cette fois non plus rétrospective mais prospective. Mais restons-en d’abord à ce premier livre.
II. « La révolution agricole », dite aussi néolithique, décrit le passage, il y a environ 10 000 ans, des populations de chasseurs-cueilleurs aux populations d’agriculteurs et d’éleveurs sédentaires, bientôt réunis en de vastes cités urbaines dont l’organisation est toujours plus complexe et hiérarchisée, jusqu’à devenir de véritables empires. S’appuyant notamment sur les travaux de Marshall Sahlins et de Jared Diamond, Harari souligne que si cette nouvelle configuration sociale de l’espèce sapiens favorise le développement des systèmes cognitifs, systèmes de communication, de représentation et de symbolisation, et conséquemment la coopération de masses toujours plus grandes d’individus, l’autre versant de la révolution néolithique est un surcroît de travail, une exposition aux épidémies, un régime alimentaire appauvri et finalement un bonheur de vivre vraisemblablement amoindri3. Durkheim, interrogeant plus largement les causes et les effets de la division du travail social, l’avait d’ores et déjà observé : « Mais, en fait, est-il vrai que le bonheur de l’individu s’accroisse à mesure que l’homme progresse ? Rien n’est moins sûr »4. Avec le processus enclenché par la révolution cognitive apparaît donc un écart croissant, sinon exponentiel, entre la puissance d’agir, de produire et de connaître de l’espèce sapiens et le bonheur sensible de la majorité de ses membres, observation qui aboutira à la conclusion que le bonheur de l’individu sapiens risque de compter de moins en moins à mesure que le système cognitif s’affranchit de sa condition organique.
III. « L’unification de l’humanité » décrit le processus par lequel, en quelques millénaires, l’humanité est passée d’une pluralité de sociétés ou de civilisations distantes tant géographiquement que culturellement à une civilisation unifiée, capable de communier autour de rites mondialisés, comme par exemple les jeux olympiques ou la coupe du monde de football. Ce processus a dépendu principalement de trois institutions : la monnaie, l’empire et la religion. C’est par le biais de ces systèmes de communication, de représentation et de symbolisation que des masses de sapiens toujours plus nombreuses ont pu coopérer et se mouvoir sur la base de schèmes communs, jusqu’à l’unification que nous connaissons aujourd’hui. Reste toutefois un chaînon, celui qui permet de passer de la coexistence de schèmes impériaux ou théologico-politiques à la mondialisation technoscientifique et capitaliste.
IV. « La révolution scientifique » désigne l’avènement de la science moderne autour du XVIe et XVIIe siècle. Elle est apparue dans le sillage de la découverte de l’Amérique (1492) et de ce qu’on a décrit comme la première mondialisation5, et elle fut suivie d’une révolution industrielle. Mais cette révolution technoscientifique est aussi en corrélation avec l’émergence d’un nouveau « credo » – le capitalisme – destructeur de l’ancien monde. De l’idéologie capitaliste, Harari propose dans ses livres une vision mesurément critique, voire paradoxale, soulignant pour une part qu’à l’image de la révolution néolithique, la révolution capitaliste soumet la société à un impératif productiviste largement indifférent au bonheur sensible des individus et écologiquement prédateur, d’autre part qu’elle a cependant permis d’éradiquer la pauvreté biologique. Il est plus résolument laudateur au sujet de la science moderne, expliquant qu’au regard des mythes fondateurs, la révolution scientifique consiste d’abord à reconnaître son « ignorance », ce qui, du même coup, ouvre le champ de l’enquête empirique, de la recherche théorique et expérimentale, de l’investigation critique et de l’invention technique.
Concluant sa « brève histoire de l’humanité » sur la toute-puissance technoscientifique acquise par l’espèce sapiens, cependant sise dans une biosphère toujours davantage fragilisée par les activités humaines, Harari interroge son lecteur : « N’y-a-t-il rien de plus dangereux que des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu’ils veulent ? » L’extraordinaire succès populaire de son livre, s’il était imprévisible, repose donc bien sur un art consommé de la synthèse, une érudition impressionnante, une vulgarisation heureuse mais aussi, et surtout, une vision, calme et mesurée, parfois vertigineuse. Car Harari se ressaisit à sa manière de l’un des fondus les plus célèbres de l’histoire du cinéma, celui du prologue de 2001 : L’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, lorsqu’un hominidé découvre l’usage possible d’un os comme outil de guerre, savoure la puissance acquise sur ses congénères puis, dans une sorte d’extase, le jette en direction du ciel, et qu’alors l’arme du primate se fond en une… navette spatiale.
Toutefois, dans la vision de Harari, pourtant historien des technologies militaires, ce n’est pas l’os transformé en outil de guerre qui sert de point de départ à l’épopée d’homo sapiens, mais l’os transformé en signe, lequel signe, élément d’un système de communication, de représentation, de symbolisation, dirigera dorénavant les conduites des individus de l’espèce et présidera à leur coopération sur une échelle sans cesse plus vaste, s’affranchissant toujours davantage des limites du corps organique. La raison de l’imprévisible succès de Sapiens, ce ne serait donc pas que « le pouvoir appartient à la clarté », mais plutôt que la « clarté » est un objet populaire de désir. Car il y a fort à parier que les millions de lecteurs de cette histoire de l’humanité ne sont pas « des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu’ils veulent », mais des homo sapiens qui savent qu’ils ne savent pas, et aspirent à apprendre.
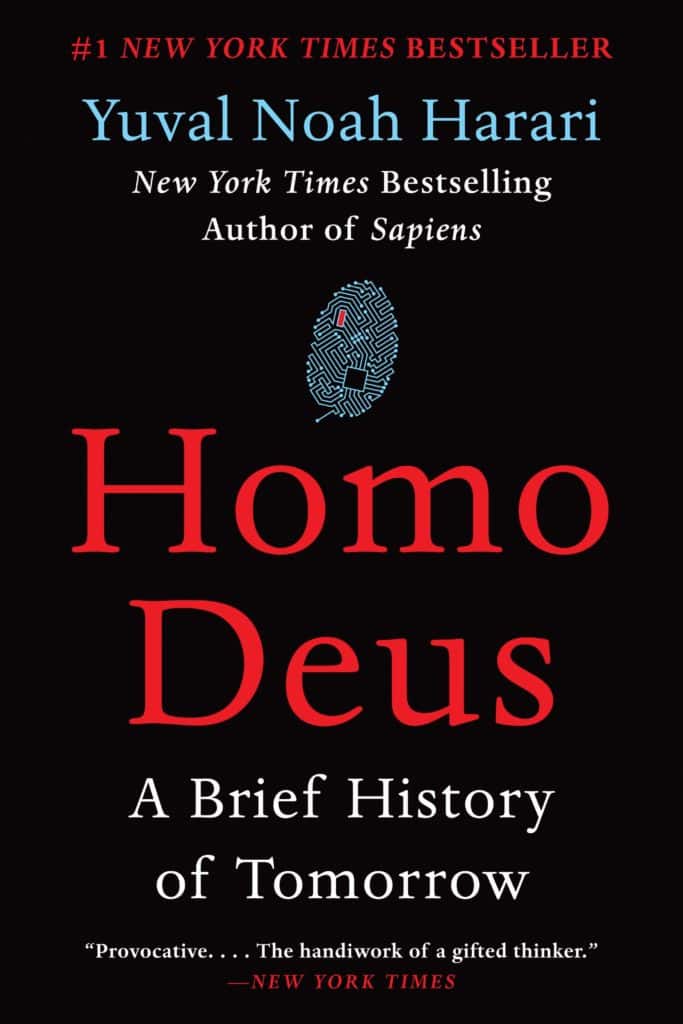
« Une brève histoire de l’avenir »
Quatre ans après l’édition de Sapiens et un succès commercial hors du commun, une suite paraît : Homo Deus. Une brève histoire de l’avenir (2015). Tirant les leçons de ce qu’a été l’histoire de l’humanité, il s’agit à présent d’anticiper l’avenir, de bâtir une vision prospective. L’exercice est convenu. Jacques Attali, par exemple, s’y est essayé en 2006 dans un livre quasiment homonyme : Une brève histoire de l’avenir (Fayard). Mais son argument était plus concentré, plus résolu aussi : l’idéal démocratique, libéral et rationaliste surmontera l’aliénation capitaliste. On y voit cependant déjà apparaître le motif principal du livre quasiment homonyme de Harari : l’homme devenu inutile. Attali, dès la seconde page de son essai de politique fiction, écrit en effet :
Devenu la loi unique du monde, le marché formera ce que je nommerai l’hyperempire, insaisissable et planétaire, créateur de richesses marchandes et d’aliénations nouvelles, de fortunes et de misères extrêmes ; la nature y sera mise en coupe réglée ; tout sera privé, y compris l’armée, la police et la justice. L’être humain sera alors harnaché de prothèses, avant de devenir lui-même un artefact, vendu en série à des consommateurs devenant eux-mêmes artefacts. Puis, l’homme, désormais inutile à ses propres créations, disparaîtra.6
Ce n’est toutefois pas le mot de la fin, la spéculation d’Attali étant portée par un optimisme messianique qui promet une alternative à « l’hyperempire », alternative que l’auteur voit émerger autour de 2060, composée de « nouvelles forces, altruistes et universalistes » qui « prendront le pouvoir mondialement, sous l’empire d’une nécessité écologique, éthique, économique, culturelle et politique », qui « se rebelleront contre les exigences de la surveillance, du narcissisme et des normes », puis « conduiront progressivement à un nouvel équilibre, cette fois planétaire, entre le marché et la démocratie : l’hyperdémocratie ». Alors une « nouvelle économie, dite relationnelle, produisant des services sans chercher à en tirer profit, se développera en concurrence avec le marché avant d’y mettre fin, tout comme le marché mit un terme, il y a quelques siècles, au féodalisme ».7
Au regard des prophéties d’Attali, Harari est plus circonspect et sinon pessimiste, détaché. Son second livre est bâti en trois parties : I. « Homo sapiens conquiert le monde ». II. « Homo sapiens donne sens au monde ». III. « Homo sapiens perd le contrôle ». La « révolution cognitive » est d’abord un gain de puissance, qui permet à l’espèce sapiens de conquérir le monde (I) ; mais elle est aussi ce qui donne sens, notamment au moyen de « fictions », parce que c’est principalement en produisant du sens que la coopération à grande échelle fonctionne (II) ; le problème est que le système cognitif qui produit du sens et organise l’activité de sapiens, l’intéressé pourrait en perdre le contrôle (III).
De nouveau, Harari scrute dans Homo deus la dualité de l’espèce sapiens, animal pour une part, pour une autre siège d’une révolution cognitive s’affranchissant des limites du corps organique. Et cet affranchissement, prévient-il, risque de prendre la forme d’une scission de l’humanité, avec d’une part une classe de surhommes s’étant, grâce aux biotechnologies et à l’intelligence artificielle, quasi affranchis de la condition animale, et d’autre part une espèce sapiens pour l’essentiel devenue inutile au bon fonctionnement du système de communication, de représentation et de symbolisation, et à son expansion possible hors des limites de la biosphère. Est-ce une version savante d’un scénario convenu de science-fiction ? Harari s’en défend :
Le pire des péchés de la science-fiction moderne, je l’ai dit, est sa propension à confondre intelligence et conscience. Ainsi se soucie-t-elle outre mesure d’une guerre potentielle entre robots et humains quand, en réalité, nous devrions plutôt craindre un conflit opposant une petite élite de surhommes servis par des algorithmes et un immense sous-prolétariat d’Homo sapiens démunis. Quand on songe à l’avenir de l’IA [Intelligence Artificielle], Karl Marx reste un meilleur guide que Steven Spielberg.8
D’autres fois, plutôt que la lutte de classes, c’est la notion marxiste de « fétichisme », ou ce que la Wertkritik appellerait le « sujet automate »9 que l’historien semble prendre pour modèle lorsqu’il analyse les dangers du post-humanisme à venir :
Les fictions nous permettent de mieux coopérer, mais le prix à payer est que ces mêmes fictions déterminent aussi les objectifs de notre coopération. Nous pouvons donc avoir des systèmes de coopération très élaborés, au service de buts et d’intérêts fictifs. En conséquence, un système peut sembler bien marcher, mais seulement selon les critères du système en question.10
Avec la « révolution humaniste » apparue autour du XVIe siècle, explique Harari dans Homo deus, l’homme a été placé au centre, à la source de toutes les valeurs. Mais le grand récit humaniste touche à sa fin, les hautes technologies, biotech et IA, ayant à présent la puissance de remodeler le corps humain, et peut-être de s’en affranchir ; d’où la possibilité de voir émerger un système cognitif s’autonomisant tant et si bien que l’humain n’en soit plus du tout un « critère ». Il serait toutefois surprenant que la leçon de Harari dans Homo sapiens, puis Homo deus, enfin 21 leçons pour le XXIe siècle, soit calquée sur celle de Marx, et que curieuse d’en savoir plus, Christine Lagarde, présidente du FMI, ait invité l’auteur à s’entretenir avec elle.11
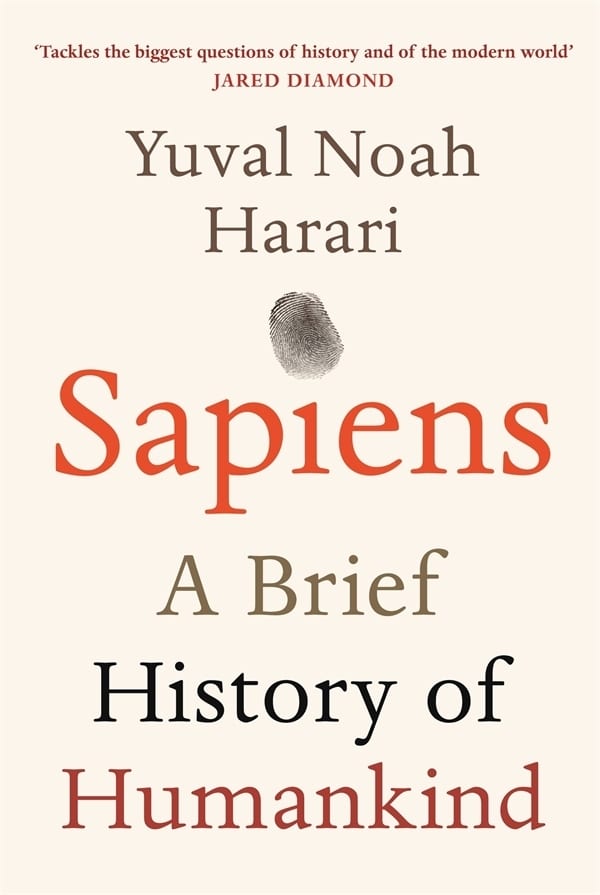
Des leçons pour les dieux
Il semble plutôt que, une fois enrôlé, ou assujetti aux critères de la réussite médiatique et institutionnelle, Harari ne s’efforce plus tant de satisfaire un désir de savoir des gens que de conseiller les princes. Et le glissement tend à se prononcer dans son troisième livre, puisqu’il s’agit presque, en caricaturant un peu, de 21 fiches de synthèse à l’usage des gouvernants, ceux du FMI, de Google ou de Microsoft. Bill Gates a du reste assuré la recension de l’ouvrage pour le New York Times dans un article intitulé : « What Are the Biggest Problems Facing Us in the 21st Century ? » Le « nous » dont il est question est-il celui des millions de gens qui ont rendu célèbre Harari, ou est-il celui des hommes et femmes de pouvoir ? Bill Gates étant l’un d’eux, voyons ce qu’il a retenu du dernier livre de l’historien. À vrai dire, pas grand-chose, sinon que l’humanité s’est unifiée, que la méditation pourrait être un exercice pertinent et qu’il convient, en toute chose, d’être mesuré, leçon qui sonne vraie aux oreilles de Bill :
Dans un monde de plus en plus complexe, qui pourrait posséder suffisamment d’informations pour prendre les décisions pertinentes ? Il est alors tentant de se tourner vers les experts, mais comment être sûr qu’ils ne suivent pas le courant? « Le problème de la pensée de groupe et de l’ignorance individuelle ne concerne pas seulement les électeurs et les consommateurs », écrit Harari, « mais également les présidents et les PDG ». Je l’ai vérifié dans le cadre de mes activités à la fois à Microsoft et à la Fondation Gates. Je dois faire attention à ne pas me méprendre en pensant que les choses sont meilleures – ou pires – qu’elles ne sont vraiment.12
Plus haut, Bill Gates a listé les problèmes abordés dans 21 leçons pour le XXIe siècle : « On y trouve des chapitres sur le travail, la guerre, le nationalisme, la religion, l’immigration, l’éducation et 15 autres sujets d’importance ». Mais ce qu’il a principalement retenu, en tant qu’ancien dirigeant d’une entreprise de haute technologie d’envergure mondiale, c’est donc qu’il doit « prendre garde de ne pas se méprendre en jugeant les choses meilleures – ou pires – qu’elles ne sont vraiment ». Sachant qu’un des problèmes que soulève Harari dans son dernier livre est l’inutilité à venir d’une masse de gens employés aujourd’hui dans les services, dernier refuge de l’emploi après la mécanisation de l’agriculture et de l’industrie, mais refuge en passe d’être automatisé du fait des développements de l’IA, et sachant que Bill Gates, président de Microsoft, doit avoir lui-même une vision claire du problème, il est singulier que le lecteur du New York Times n’ait rien d’autre à se mettre sous la dent qu’un appel à relativiser (les choses ne sont bien souvent ni aussi bonnes, ni aussi mauvaises qu’on ne le croit). Harari, pourtant, anticipant les effets à venir de l’IA sur l’emploi, prévient : « Beaucoup pourraient connaître le sort non pas des cochers du XIXe siècle reconvertis en taxis, mais des chevaux, qui ont été de plus en plus chassés du marché du travail ».13 Et à lire ce que dit Bernard Stiegler de l’automatisation en cours des services, cela aussi aurait dû sonner vrai aux oreilles de Bill :
Au début de l’année 2014, dans une convention réunissant à Washington quelques-uns des plus grands patrons des États-Unis, Bill Gates a déclaré que dans les vingt ans, d’ici à ce que l’automatisation de nos sociétés prenne toute son ampleur, l’emploi sera devenu marginal. Randall Collins, dans Le capitalisme a-t-il un avenir ?, cosigné avec Immanuel Wallerstein, affirme que la réduction des emplois atteindra 70% aux États-Unis dans les trente prochaines années.14
De fait, quiconque s’intéresse à l’IA ne manque pas de soulever le problème :
Comme le résume bien Erik Brynjolfsson, un spécialiste de la transition numérique qui enseigne au MIT, « la première révolution industrielle était fondée sur l’automatisation des muscles humains et animaux. Aujourd’hui, il s’agit des cerveaux ». Et cela change tout, comme le souligne également l’essayiste américain Martin Ford, auteur de L’Avènement des machines (FYP Editions), selon lequel « les machines deviennent elles-mêmes des travailleurs ». Pour ces « technologues », le travail humain, inexorablement remplacé demain par les robots dans les usines et les algorithmes dans les bureaux, ne s’en remettra pas.15
Abordant ce problème, Blaise Agüera y Arcas, chercheur au Google Brain, appelle à une « redistribution des bénéfices » :
Les tâches pour lesquelles on construit des IA sont pour la plupart confiées aujourd’hui à des humains, et au fur et à mesure qu’on automatise ces tâches, tout un pan du travail humain devient superflu. Ça devrait être une bonne nouvelle pour l’humanité – nous ne le ferions pas sinon -, mais si ce n’est pas mis en place avec une redistribution des bénéfices, ça conduira à un chômage de masse.16
Harari, dans sa leçon sur l’emploi, en tire les conséquences en appelant à l’institution d’un revenu universel : « Il s’agit de taxer les milliardaires et les sociétés qui contrôlent les algorithmes et robots, et de se servir de cet argent pour distribuer à chacun une généreuse allocation lui permettant de couvrir ses besoins fondamentaux ». Rendant compte dans le New York Times du livre de Harari qui prévoit en effet un chômage de masse et réfléchit aux mesures susceptibles d’y répondre, Bill Gates préfère toutefois ne pas en parler, rester mesuré et conclure sur les bienfaits de la méditation. Cela signale et le peu d’entrain du chef d’entreprise à redistribuer « généreusement » ses bénéfices, et le caractère inoffensif des leçons prodiguées par Harari – lequel, en effet, en conclusion de sa quatrième leçon, celle portant sur l’« égalité » et sous-titrée « Le futur appartient à qui possède les data », en appelle au dirigeant de Facebook, qu’il s’imagine guidant le peuple des nuages vers un communisme des data :
Dès lors, comment avancer et affronter les immenses défis que représente la révolution de la biotech et de l’infotech ? Peut-être les mêmes hommes de science et entrepreneurs qui ont commencé par perturber le monde pourraient-ils trouver une solution technique ? Par exemple, des algorithmes de réseaux pourraient-ils former l’échafaudage permettant à la communauté humaine mondiale de posséder collectivement les data et de surveiller le développement futur de la vie ? Avec la montée de l’inégalité et l’accroissement des tensions sociales à travers le monde, Mark Zuckerberg pourrait-il appeler ses deux milliards d’amis à unir leurs forces et à faire quelque chose ensemble ?17
S’entretenant avec Christine Lagarde, présidente du FMI, Harari peut donc lui expliquer que si, par le passé, les masses étaient exploitées, le risque, demain, c’est qu’elles soient économiquement inutiles ; son interlocutrice esquisse un sourire gêné, mais ne s’émeut pas outre-mesure puisque Harari, en guise d’axiome égalitaire, s’en remet aux « entrepreneurs », se contentant de leur écrire des fiches. En regard, Rutger Bregman, auteur d’Utopies réalistes (2016, traduit au Seuil en 2017), quel que soit le succès populaire de son livre (diffusé dans 23 pays), ne pouvait espérer bénéficier des mêmes relais médiatiques et institutionnels, et par exemple s’entretenir avec Lagarde, Macron ou Merkel. Il n’est qu’à lire les slogans qui habillent la couverture de l’édition française : « Un monde sans frontières ». « En finir avec la pauvreté ». « La semaine de travail de 15 heures ».
Pourtant, sa démonstration au sujet de la lutte contre la pauvreté est plutôt rondement menée, et sa leçon d’une simplicité biblique : la meilleure manière de combattre la pauvreté, en termes d’économie de moyens et de réalisation des objectifs, c’est de donner l’argent directement aux pauvres sans aucune contrepartie, plutôt que de le dépenser en encadrement social, policier, juridique, carcéral, etc. L’expérience prouve en effet qu’une fois rendus autonomes par l’attribution d’un revenu minimum, les pauvres, les déclassés, les SDF, reconstruisent leur existence sociale, économique, affective et intellectuelle plutôt qu’ils ne dissipent leur argent et leur vie dans l’alcool ou la paresse. S’opposant frontalement au préjugé capitaliste selon lequel tout salaire (se) mérite (par le) travail, et démontrant la pertinence économique et sociale d’un principe antagonique, en vertu duquel un revenu sans contrepartie est la condition d’un travail véritablement créateur de richesses (plutôt que de profits), on comprend que le traitement médiatique et institutionnel du livre de Bregman n’ait pas été de même nature que celui de Harari.
Ainsi l’hebdomadaire L’express, accueillant Harari dans ses colonnes en octobre 2018, annonce en caractères gras : « Selon l’auteur du best-seller Sapiens, l’ordre libéral « offre toujours la promesse la plus valable de coopération » ».18 Dans le cas du livre de Bregman, l’approche du même hebdomadaire est plus résolument critique : « Intéressant et même enthousiasmant dans certains de ses passages, le livre souffre de deux travers : une certaine naïveté et un manque de cohérence ».19 C’est également l’antienne du Magazine littéraire qui dans un même numéro propose d’une part un entretien avec Harari, dont le magazine salue « l’originalité de [la] démarche », d’autre part un compte-rendu critique du bestseller de Bregman, expliquant cette fois que ces « utopies réalistes », « ancrées dans le seul ciel des bonnes intentions rationnelles », « n’ont en réalité aucune chance de voir le jour » et qu’elles sont « aux changements véritables ce que la camomille du soir est au thé ou au café fort du matin ».20
C’est qu’en effet, pour ce qui est de combattre la pauvreté, Bregman ne pense pas que l’ordre des choses qui gouverne aujourd’hui « offre la promesse la plus valable ». Et en guise de redistribution des bénéfices, il a quelques idées, bel et bien rationnelles. Et ses démonstrations ont donc intéressé des millions de gens qui, peut-être, savent qu’ils ne savent pas et aspirent à apprendre. Emmanuel Macron, en revanche, sait qu’il sait et à défaut de s’entretenir avec Bregman, il a concocté en 2018 un nouveau plan de lutte contre la pauvreté qui devrait voir le jour en 2020 : le « revenu universel d’activité », lequel « revenu » sera encadré par « des droits et des devoirs supplémentaires » a prévenu le chef de l’Etat, précisant son credo en la matière : « je n’ai jamais cru à un revenu universel sans condition ».21 À bon entendeur, salut.
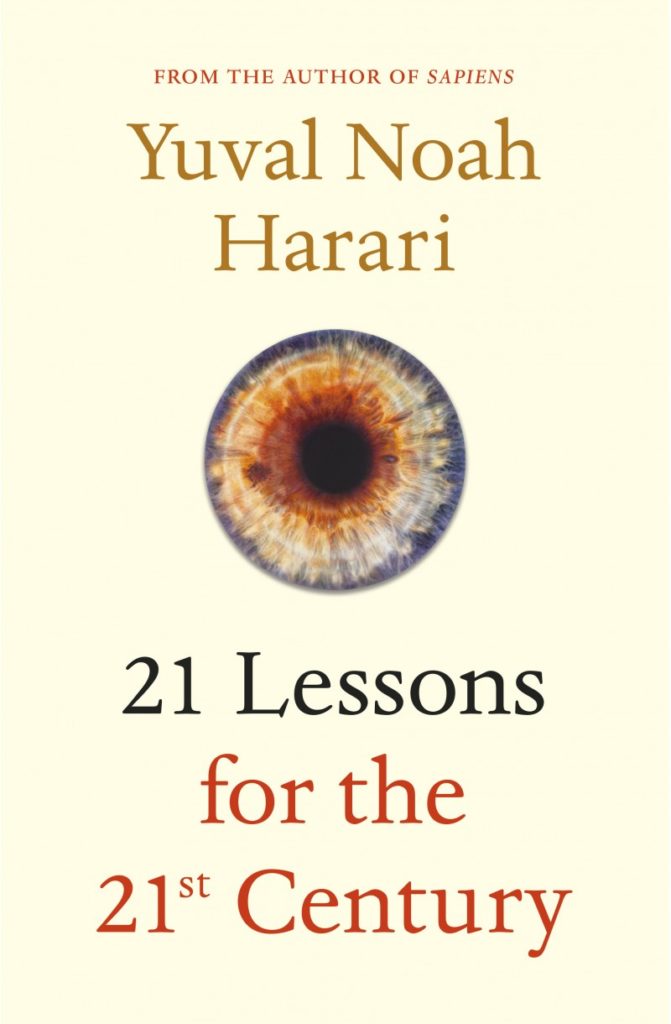
Le péril post-humaniste et la question sociale
Revenons à Homo deus. Le livre débute par un heureux constat : les trois principaux fléaux qu’a connu l’homo sapiens depuis son émergence il y a 70 000 ans, la famine, la maladie et la guerre, ont été endiguées. Chiffres à l’appui, l’historien montre que la pauvreté biologique, les épidémies et la guerre sont devenus des phénomènes mineurs dans le monde d’aujourd’hui. Le problème auquel va devoir faire face l’homo sapiens, dès lors, ce n’est plus le combat animal contre la faim, la maladie et la violence, mais l’avènement de nouvelles technologies qui rendront bientôt possible une inégalité entre les hommes non plus seulement sociale mais biologique, ou plus exactement biotechnologique : « La plus grande menace pour l’humanité vient probablement de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie. Nous devons les réguler, et l’État-nation n’est pas le bon cadre ».22 La possible transformation d’un homo sapiens en un artefact biotechnologique ou « cyborg » et la démesure d’un système économique s’automatisant toujours davantage non seulement en termes de moyens mais de fins, voilà des motifs bien connus d’inquiétude : la domination exponentielle d’un « sujet automate », laissant présager l’avènement d’un « hyperempire ». Depuis Herbert Marcuse jusqu’aux divinations d’Attali en passant par la Wertkritik, il existe de multiples versions de cet enfer possible, sinon déjà palpable.
En 1931 paraissait Brave New World, le roman d’anticipation d’Aldous Huxley. En 1969, David Rorvik, un journaliste scientifique, écrit Brave new baby. Promise and Peril of the Biological Revolution, un essai où la manipulation génétique, le désir d’éternité et la biotechnologie tracent d’ores et déjà les contours d’un post-humanisme, sorte d’ombre portée d’une révolution scientifique surgie en 1953 : la description par Watson et Crick de la structure en double hélice de l’ADN. En quelques années, la découverte de l’information génétique révolutionne la biologie, si bien que haute technologie mathématique et corps vivant procèdent désormais d’une même matrice, autorisant les rêves – et les cauchemars – les plus fous. Depuis 1960 et l’invention par Manfred Clynes du concept de « cyborg » (cybernetic organism) jusqu’à Homo deus, le thème est durablement florissant. La haute technologie rend en effet toujours plus concret le dépassement des conditions organiques de la vie déjà envisagé par Clynes il y a plus d’un demi-siècle :
Partageant en ceci l’opinion d’un nombre croissant de spécialistes des ordinateurs, Clynes ne voit pas pourquoi notre intelligence devrait être confinée dans les molécules d’ADN. « Plus que de matériau, je crois que la vie est affaire de relations et d’organisation », dit-il. Sa conception d’un ordinateur doué d’intelligence et de conscience correspond au stade ultime que pourraient atteindre les cyborgs. La race entière des hommes se serait alors dépouillée de son ADN. jusqu’à la dernière molécule. Quels que soient nos nouveaux composants, ajoute encore Clynes, nous garderons notre qualité d’êtres humains, pour autant qu’ait pu être préservée notre identité psychique profonde et que nous puissions l’extérioriser par quelque moyen.23
Les philosophes de l’antiquité observaient que le bateau de Thésée, dont on remplace progressivement tous les éléments, reste pourtant le même bateau de Thésée ; les matériaux qui le composent ont tous été remplacés, mais sa forme est demeurée identique à elle-même. C’est l’idée que Clynes applique au corps organique, et qui inspira un roman de Houellebecq dans les années 2000 (La possibilité d’une île). La vie humaine étant de plus en plus à l’étroite sur la Terre à mesure que ses activités dégradent la biosphère, s’ensuit que, si la dégénérescence avait jusqu’à présent pour sens de garantir l’existence d’une nouvelle génération d’homo sapiens, et ainsi de la régénérer, autrement dit de passer le relai en laissant la place libre pour de nouvelles générations, demain les choses pourraient changer ; une autre base matérielle de la vie intelligente pourrait voir le jour, refondée sur la possible nécessité de conquérir les espaces intergalactiques. Et alors l’éternité rêvée ne serait plus contradictoire avec l’existence transgénérationnelle, l’univers étoilé, ou plus exactement le « multivers » étant devenu l’horizon d’une existence non seulement biotechnologique mais extra-terrestre. Heiner Müller, l’auteur de Hamlet-machine, expliquait dans un entretien paru en 1988 :
On peut imaginer un avenir dans lequel l’homme, tel qu’il est aujourd’hui organiquement construit, ne sera plus capable de vivre. Avec les changements de l’atmosphère et de l’écosystème qui se désertifie, peut-être que seul un hybride homme-machine sera encore capable de vivre. Ce serait pour ainsi dire déjà une voie technologique vers l’éternité, peut-être la seule. Le développement des voyages dans l’espace amènera des transformations de cette sorte. Car aucun organisme humain ou terrestre ne pourra supporter certaines distances ou espace-temps. Il faudra donc développer une combinaison d’homme et de machine, les parties fragiles ou facilement putrescibles seront remplacés par des installations techniques. L’être humain doit être constamment redéfini. Personne ne dénierait son humanité à une personne équipée d’un stimulateur cardiaque bien que dans la conception traditionnelle de l’homme, ce n’est déjà plus tout à fait un être humain mais en partie déjà une machine.24
L’homme-machine pourra-t-il coloniser un nouvel espace-temps, une fois affranchi de sa condition organique ? Spinoza soutient que la mort est une rencontre fortuite, rendue nécessaire du fait que l’homme est une partie de la nature, mais cependant extrinsèque à la forme du corps qui, elle, ne connaît d’autre loi que celle de persévérer dans son être. Quant à la science contemporaine, en matière de vieillissement des corps, elle présente pour l’heure un ensemble de théories hétéroclites :
Cela vient du fait qu’il n’existe pas encore de vue d’ensemble, de théorie détaillée capable d’« expliquer » le vieillissement de l’organisme – et des populations – à tous les niveaux d’études. Les découvertes (paradigmes) d’un niveau d’organisation donné ne permettent pas de tout comprendre des autres niveaux.25
Alertant ses millions de lecteurs sur l’avènement possible d’une inégalité non plus ethnique et/ou sociale mais biotechnologique, et en appelant pour finir à Facebook, le FMI ou une autre instance supranationale, Harari prophétise un avenir menaçant, tout en souhaitant que les dirigeants de ce monde sachent le déjouer. Mais entre les lignes, il y a la question que pose, en tant que telle, l’aspiration biotechnologique à s’affranchir du corps organique : exprime-t-elle un désir de vivre éternellement et qu’il conviendrait de démocratiser, ou une haine féroce de la vie, sorte de refoulement méthodique des corps qui caractériserait, sinon depuis la révolution néolithique, du moins depuis l’émergence du capitalisme, la classe dominante ? Scapin rouant de coups le représentant de l’ordre, n’est-ce pas la revanche du corps populaire joyeux sur l’avarice morbide du maître, lequel craint l’altérité des corps comme la peste ? C’est du moins ce que paraît penser Heiner Müller, dramaturge est-allemand peu enclin, dès 1990, à prêter une quelconque puissance d’émancipation aux deux milliards d’amis à venir de Mark Zuckerberg :
Le vrai problème de ce siècle de la technologie est la déréalisation de la réalité : la fuite de la réalité dans l’imagination. Les choses ne sont pas comme elles restent. Tout est de plus en plus figuré. C’est la tendance. L’intérêt des gens les uns pour les autres, et même la notion d’adversaire, n’en finit pas de dépérir. Le règlement de conflits réels est de plus en plus remplacé par la théâtralisation des conflits. Ballard, l’auteur anglais de science-fiction, décrit dans une de ses histoires un monde dans lequel il n’y a plus de contact physique entre les hommes. Le personnage principal, un médecin, a fait un mariage heureux et a deux enfants. Sa famille, il ne la connaît que sur écran. Finalement il arrange une rencontre avec sa femme. Pour la première fois, l’un comme l’autre, se trouve dans une même pièce avec un autre être humain. Une monstrueuse agressivité s’empare subitement d’eux, car aucun n’avait auparavant senti l’odeur d’un autre être humain. Juste avant qu’ils ne s’entredéchirent, le médecin parvient à rebrancher les machines entre lui et sa femme. Mais l’idée d’avoir un contact physique avec sa famille ne lui sort pas de la tête et il pense que la présence des enfants pourrait avoir un effet d’harmonisation. Et de fait il organise cette rencontre avec femme et enfants : le résultat est un effroyable massacre. L’histoire de Ballard montre clairement ou conduit la technicité croissante du monde – à la destruction des contacts et même du besoin de contact.26
C’est un diagnostic du même ordre qu’émettait Lévi-Strauss dans les années 1950. Expliquant que les sociétés dites « primitives » sont « fondées sur des relations personnelles, sur des rapports concrets entre individus », il observait qu’à l’inverse, dans la société moderne, « nos relations avec autrui ne sont plus, que de façon occasionnelle et fragmentaire, fondées sur cette expérience globale, cette appréhension concrète d’un sujet par un autre ».27 À la lumière des analyses de Müller et de Lévi-Strauss, une autre vision se dessine, et une autre leçon ; car ce que ne verrait pas Harari lorsqu’il interpelle son lecteur, écrivant que demain, « peut-être, dans certaines parties du monde, enseignerez-vous à vos gosses à écrire des codes informatiques, alors qu’en d’autres mieux vaudra leur apprendre à tirer et à viser juste »28, c’est que ce tableau n’anticipe pas le risque de scission d’une espèce humaine autrefois unifiée, mais bien l’avènement présent de son unification fantasmée, ou spectaculaire : une humanité enfin affranchie de l’altérité des corps, planant quelque part entre la théorie du bloom29 et celle du drone. Plutôt que d’en appeler aux amis de Facebook, et s’émouvoir du désir d’éternité des pharaons de ce monde, mieux vaudrait donc en appeler aux amis de Rimbaud, et s’émouvoir de leur Matinée d’ivresse : « Nous savons donner notre vie tout entière tous les jours ».
Notes
- 20 septembre 2018, n° 2403[↩]
- http://www.lefigaro.fr/livres/2017/09/08/03005-20170908ARTFIG00004–homo-sapiens-et-homo-deus-la-nouvelle-bible-de-l-humanite.php[↩][↩]
- Quant aux causes de la révolution néolithique, elles ne cessent d’être discutées par les chercheurs, les uns privilégiant une causalité matérielle (évolution démographique ou climatique rendant nécessaire une croissance des ressources), les autres une causalité symbolique. Et Harari, à l’évidence, privilégie la seconde orientation : « Il est fort possible que les fourrageurs soient passés de la cueillette de blé sauvage à la culture intensive du blé non pas pour accroître leur approvisionnement normal, mais pour soutenir la construction et l’activité d’un temple » (Sapiens, op. cit., p. 116-117).[↩]
- De la division du travail social, Puf, 1930, rééd. 1991, p. 220.[↩]
- Voir Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, éditions de La Martinière, 2004.[↩]
- Une brève histoire de l’avenir, Fayard, 2006, p. 10.[↩]
- Ibid., p. 22-23.[↩]
- 21 leçons pour le XXIe siècle, op. cit., p. 265-266.[↩]
- Voir Anselm Jappe, Les aventures de la marchandise (La Découverte, 2003). La Wertkritik, “critique de la valeur”, est un courant du marxisme qui place au centre du système capitaliste et de sa critique non pas l’exploitation de la force de travail et la lutte des classes mais le processus de valorisation marchande, lequel opère à la manière d’un “sujet automate”.[↩]
- Homo deus, op. cit., p. 193.[↩]
- Voir la vidéo de leur entretien sur Youtube.[↩]
- https://www.nytimes.com/2018/09/04/books/review/21-lessons-for-the-21st-century-yuval-noah-harari.html[↩]
- 21 Leçons pour le XXIe siècle, op. cit., p. 48.[↩]
- Bernard Stiegler. L’emploi est mort, vive le travail ! Entretien avec Ariel Kyrou, Mille et Une Nuits, 2015, p. 51.[↩]
- Intelligence artificielle. Enquête sur ces technologies qui changent nos vies, ouvrage collectif, Libération/Radio France/Flammarion, 2018, p.66[↩]
- Ibid., p. 23. Pour une approche plus économique de la question, voir Pierre-Noël Giraud, L’homme inutile. Une économie politique du populisme, Odile Jacob, 2015.[↩]
- 21 leçons pour le XXIe siècle, op. cit., p. 98-99.[↩]
- https://www.lexpress.fr/culture/yuval-noah-harari-le-liberalisme-peut-se-reinventer_2037694.html[↩]
- https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/utopies-realistes-la-dystopie-est-proche_1949821.html[↩]
- Magazine littéraire, novembre-décembre 2017, n°585-586, p.26 et p. 63.[↩]
- Voir l’article paru site du Nouvel Observateur le 13 septembre 2018 : https://www.nouvelobs.com/societe/20180913.OBS2310/ce-que-l-on-sait-du-revenu-universel-d-activite-propose-par-macron.html[↩]
- Entretien à l’hebdomadaire Le Point, op. cit. p. 62.[↩]
- David Rorvik, Brave new baby. Promesses et dangers de la révolution biologique, Albin Michel, 1972, p. 193. Rorvik est principalement préoccupé par la croissance démographique et un nécessaire contrôle des naissances, citant à ce sujet Crick, l’un des découvreurs de l’ADN. : « Le fait d’avoir des enfants devrait préoccuper l’opinion au moins autant que celui de conduire une automobile » ; d’où Rorvik tire une leçon : « Il y a belle lurette que le permis de conduire est obligatoire. Alors ? » (Brave new baby, op. cit., p. 221). La politique eugéniste de stérilisation forcée n’est pas loin…[↩]
- Fautes d’impression. Textes et entretien, L’arche, 1991, p. 111, 112.[↩]
- Ladislas Robert, Le vieillissement. Faits et théories, Flammarion, 1995, p. 56-57[↩]
- Heiner Müller, Fautes d’impression. Textes et entretiens, op. cit., p. 185-186[↩]
- Anthropologie structurale, Plon, 1958, 1974, p. 425.[↩]
- 21 leçons pour le XXIe siècle, op ; cit., p. 95.[↩]
- http://bloom0101.org/wp-content/uploads/2014/10/Theorie-du-bloom.pdf[↩]






