
Alors que les vents contraires soufflent de plus en plus fort sur l’écologie politique, aidez-nous à faire vivre cet espace éditorial et politique unique, où s’imaginent et s’organisent les écologies radicales.
Merci ! On compte sur vous !
Temps de lecture : 22 minutes
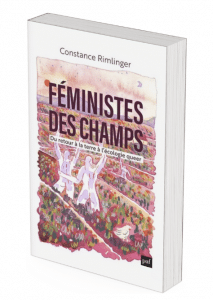
À propos de Féministes des champs. Du retour à la terre à l’écologie queer, de Constance Rimlinger, Presses universitaires de France, 2024.
Depuis les années 1970 dans plusieurs pays occidentaux, des femmes et des minorités de genre opèrent un « retour à la terre1 », qui s’inscrit plus largement dans les vagues d’installations en collectif rural observées par exemple en France après Mai 68. Ces personnes quittent leurs logements et leurs modes de vie urbains pour co-fonder ou rejoindre des lieux de vie à la campagne.
Dans son livre Féministes des champs, qui porte sur ces mobilités résidentielles politisées, la sociologue Constance Rimlinger explique qu’il s’agit de se réapproprier l’espace rural « en vue de valoriser un milieu vivant et d’opérer une (re)connexion à la terre, aussi bien d’ordre sensible et/ou spirituelle que matérielle2 ». Ces personnes présentent tout de même des spécificités : en quittant les villes, elles souhaitent autant « s’émanciper de l’hétéropatriarcat » qu’« élaborer un autre rapport à l’environnement3 » en se reconnectant à la « nature » et aux activités de subsistance.
Si les démarches de ces « féministes des champs » peuvent à première vue sembler homogènes, les motivations, modalités organisationnelles et positions respectives sont en réalité diverses au sein de la « nébuleuse écoféministe4 » identifiée par Constance Rimlinger dans son ouvrage.
Entre 2015 et 2021, Constance Rimlinger s’est attachée à explorer un « angle mort de la recherche sur le retour à la terre5 » qui a, jusque-là en France, laissé de côté les alternatives rurales portées par des personnes féministes et non hétérosexuelles. En effet, au croisement de la sociologie rurale, de la sociologie des mouvements sociaux et de la sociologie du genre et des sexualités, cette enquête ouvre les travaux français portant sur les alternatives rurales depuis les années 19806 à leurs marges lesbiennes et queers. L’originalité et la force de la démarche de Constance Rimlinger résident dans ses choix théoriques et méthodologiques.

Les sept terrains choisis par la sociologue se situent sur les trois continents qui ont accueilli un retour à la terre lesbien séparatiste depuis les années 1970 : les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la France.
Les Women’s Land états-uniens voient le jour à cette époque dans un contexte de guerre froide, de peur d’une apocalypse nucléaire, de considérations écologiques émergentes et de remise en cause du capitalisme7. Des lesbiennes cherchent alors à opérer un retour à la terre (back-to-the-land-movement) de manière séparatiste, c’est-à-dire sans homme cisgenre8, en s’inspirant de la pensée féministe radicale et du lesbianisme politique alors en plein essor, selon lesquels le meilleur moyen de lutter contre le système patriarcal est de s’organiser entre femmes. Il ne s’agit pas uniquement de fuir le patriarcat, mais également de se réfugier dans un lieu protecteur – identifié comme rural, car en connexion avec la terre associée à la figure de la mère – et d’inventer une culture lesbienne9.
Ces initiatives s’étendent progressivement en Europe – particulièrement, pour la France, en Ariège et en Ardèche – et en Nouvelle-Zélande, au gré des voyages des un·e·s et des autres, et de la circulation de leurs idées à partir de créations artistiques et de publications littéraires. Or, après une période culminante au début des années 1990 au cours de laquelle Constance Rimlinger dénombre une centaine de lieux (dont 80 aux États-Unis), beaucoup de ces initiatives disparaissent. L’importance du travail de la chercheuse réside ainsi dans la redécouverte de ces initiatives tombées en désuétude, à travers l’identification de leurs points communs et de leurs singularités. Elle rappelle qu’ont existé et perdurent toujours des initiatives écoféministes en France, malgré une « réception manquée10 » dans les années 1970 par rapport aux pays anglo-saxons.
Constance Rimlinger dresse un panorama de l’écoféminisme contemporain dont la principale caractéristique est d’être en évolution constante.
Le terme d’« écoféminisme », qui connaît un regain d’intérêt en France depuis 201511, apparaît pour la première fois sous la plume de Françoise d’Eaubonne en 1972. Il désigne la « tentative de synthèse entre deux combats qu’on avait jusqu’alors envisagés comme séparés, celui du féminisme et celui de l’écologie », que celle-ci observe dans les pays des Suds (dénonciation du néo-colonialisme et de l’extractivisme, défense des pratiques de subsistance), comme du Nord (lutte anti-nucléaire dans laquelle elle s’engage)12.
Lire aussi sur Terrestres : Myriam Bahaffou, « Gouines des champs : expérimenter l’éco-féminisme par la non-mixité », octobre 2022.
Aujourd’hui, deux approches de l’écoféminisme existent en parallèle dans le monde académique : certains travaux de philosophie en proposent des approches théoriques et plutôt abstraites, quand d’autres, anthropologiques et sociologiques, s’appuient sur des enquêtes de terrain et des données empiriques.
Quoi qu’il en soit, l’écoféminisme académique tel qu’il se déploie dans les cercles intellectuels se distancie de l’écoféminisme tel qu’il s’éprouve et s’expérimente dans des groupes militants ou dans des manières concrètes de vivre. Face à ces tensions, Constance Rimlinger parvient à dresser un panorama très convainquant de l’écoféminisme contemporain dont la principale caractéristique est d’être en évolution constante. Sa démarche empirique est d’autant plus bienvenue qu’elle adhère au point de vue selon lequel les luttes écoféministes ne sont pas « hors sol », mais « s’inscrivent dans des territoires, dans un rapport matériel, affectif, parfois spirituel à la terre, à des terres13 ».
Les initiatives écoféministes recensées par Constance Rimlinger ne s’en tiennent pas à la non-mixité et à la construction d’une culture de femmes, comme dans le cas des terres de femmes séparatistes des années 1970, mais intègrent davantage les questions d’intersectionnalité et de genre, tout en prenant en compte les autres qu’humains. Elles se répartissent sur un continuum : la chercheuse propose d’étudier les différences et similarités entre trois configurations écoféministes.
Cette élaboration théorique se fonde sur une enquête multi-située et comparative, qui repose elle-même sur une diversité d’initiatives que Constance Rimlinger qualifie d’écoféministes, malgré le fait que leurs actrices ne s’en revendiquent pas forcément.
Cerner les contours de la nébuleuse écoféministe rurale
D’une terre de femmes aux États-Unis à un sanctuaire végan en Nouvelle-Zélande, en passant par une ferme en permaculture en Bretagne : si l’exploration des parcours et expériences de vie rurales à distance de l’hétéronormativité est vaste, ces initiatives ont des traits communs. Au quotidien, elles articulent « un projet féministe et un projet écologiste14 » et partagent une même visée politique : s’émanciper des normes dominantes en matière de genre et de sexualité, de travail, de consommation, et de rapport à la « nature » et aux autres qu’humains. Leurs habitant·e·s ont également un profil social homogène en étant originaires des classes moyennes-supérieures, blanc·he·s et diplômé·e·s du supérieur.
Dans les années 1970 apparaissent des terres de femmes, lieux de vie non-mixtes pour se reconstruire suite à la violence patriarcale et se connecter spirituellement à la terre.
Cependant, ces initiatives écoféministes présentent des différences. À ce titre, Constance Rimlinger identifie trois configurations, la première étant légèrement antérieure aux deux suivantes. Celles-ci sont traversées par des lignes de clivage, comme l’intégration ou l’exclusion des personnes trans, le rapport au véganisme, ainsi que leurs visions féministes de la « nature ». Si les deux premières configurations ont pour priorité d’offrir un accès à la terre à distance des hommes cisgenres hétérosexuels et de sensibiliser des personnes féministes, lesbiennes ou queers à l’écologie, la troisième est surtout fondée sur un projet de vie écologiste et décroissant.
La chercheuse nous met tout de même en garde : ces configurations visent moins à « réifier en des catégories statistiques des agencements ponctuels et mouvants15 », qu’à rendre compte de « la pluralité des manières d’être écoféministe et d’articuler au quotidien plusieurs engagements16 ».

La première configuration est définie comme « séparatiste différentialiste ». Dans les années 1970 aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, des lesbiennes décident de créer des terres de femmes. Ce sont des lieux de vie non mixtes marqués par l’amour libre, des célébrations et des pratiques artistiques, qui leur permettent de se reconstruire autour d’une culture sororale suite à la violence patriarcale causée à leur égard par des hommes de leur entourage, et de se connecter spirituellement à la terre.
Deux de ces terres de femmes sont concernées dans l’ouvrage : We’Moon Land dans l’Oregon et la communauté Earthspirit en Nouvelle-Zélande. Dans la première, on trouve par exemple Suzie, âgée d’une soixantaine d’années, qui y vit depuis 4 ans, ou encore Marie et Sky, deux jeunes trentenaires en couple. Dans la seconde, on rencontre Arafelle, née en 1944, ergothérapeute de profession. Elle décide de fonder une terre de femmes dans les années 1970 après avoir rencontré Nut, avec laquelle elle entame une relation amoureuse. Après plusieurs mois de recherche, elles acquièrent un terrain au cours d’une enchère publique, où se trouve une maison, entouré de forêts et traversé par un ruisseau. Les visiteuses – qui pour certaines s’installent rapidement – affluent après quelques annonces placées dans des revues lesbiennes et la visite d’Allemandes depuis lesquelles se déploie un bouche-à-oreille. Cependant, au cours des dernières années, le flot de visiteuses s’est considérablement réduit.
Ensuite, la sociologue définit la « configuration queer intersectionnelle ». De manière plus récente, en France et en Nouvelle-Zélande, des personnes queers s’installent à la campagne à proximité de grandes villes et organisent leurs modes de vie à partir d’une approche féministe intersectionnelle qui se nourrit d’une sensibilité anarchiste, anticapitaliste, antiraciste, antipsychiatrique et d’une critique du système policier.
Il ne s’agit pas ici d’adopter une stricte optique séparatiste, car les catégories de genre binaires sont questionnées, de même que les femmes et les hommes trans sont acceptés. C’est le cas de la Ferme des Paresseuses, en Saône-et-Loire, et du sanctuaire végane Black Sheep, en Nouvelle-Zélande, construit autour d’une association de protection des animaux. Sezig et Maya habitent la première. En 2012, la mère de Sezig ne veut plus vivre dans le vieux corps de ferme chargé de souvenirs de son compagnon décédé, et donne les clés à sa fille de 36 ans. Celle-ci débute une formation en maraîchage et décide d’en faire un lieu collectif, pour son réseau amical lyonnais, mais les visites sont ponctuelles.
Toutes les initiatives explorées se rejoignent sur le souhait de vivre en collectif féministe sans homme cisgenre en milieu rural.
À la même période, Maya arrive dans le coin pour rejoindre l’éco-lieu de son frère en construction. Les deux lesbiennes finissent par se rencontrer, et la seconde emménage chez la première. Chacune possède son espace personnel : Maya dort dans la grange, et Sezig dans un mobile-home. Elles vendent quelques légumes et un peu de pain, mais elles subsistent surtout grâce au RSA de Sezik et au petit héritage que Maya a reçu suite au décès de sa mère.
Enfin, Constance Rimlinger construit la « configuration holistique intégrationniste ». En France, des lesbiennes et queers valorisent moins leur appartenance identitaire et féministe que la dimension écologiste de leur mode de vie, proche de la terre et déployé dans des collectifs mixtes, caractérisé par une alimentation saine cultivée chez soi, la médecine alternative et l’exploration de la parentalité positive.
C’est le cas de la Ferme des Roches, en Charente, qui met en œuvre plusieurs activités de permaculture, et des Jardins de Colette à la lisière de l’Indre et de la Creuse. Ces derniers sont tenus par Margaret, qui a quitté l’Angleterre il y a trente ans pour s’installer dans ce hameau. Durant ses études, elle réalise qu’elle ne veut pas d’un emploi salarié et qu’elle souhaite travailler au grand air. Son diplôme en poche, elle part voyager avec sa compagne de l’époque. Son père, ingénieur civil, accepte de lui prêter de l’argent et, célibataire, elle se lance seule dans la recherche d’une terre : elle se rend en Creuse, le foncier y étant peu cher et les terres supposément peu polluées. Elle s’installe et fonde les Jardins de Colette en 1990, en référence à l’écrivaine qu’elle estime. Elle tire ses revenus de l’accueil de stages artistiques et de bien-être, et de la vente de sirops, tisanes et autres produits qu’elle produit à partir de ses plantations en permaculture.
Par contraste, la ferme des Roches est un projet de couple : celui de Vanessa et Charlie, deux trentenaires ayant acheté une vielle ferme charentaise à rénover en 2015. Iels y développent maintenant des activités mêlant permaculture, thérapie et écoconstruction.
Vivre et vieillir en féministe rurale
Toutes les initiatives explorées se rejoignent sur le souhait de vivre en collectif féministe sans homme cisgenre en milieu rural. En effet, les lieux de vie créés constituent un « refuge » et un « espace de mise à l’abri » pour ces « personnes affectées par le système patriarcal, que ce soit en tant que femme ou en tant que personnes ayant une identité minoritaire17 ».
La « configuration différentialiste séparatiste » met particulièrement l’accent sur cette hospitalité à l’égard de celles qui sont menacées, psychologiquement et/ou physiquement, par les oppressions de genre et de sexualité. C’est par exemple le cas de plusieurs femmes des communautés We’Mon Land et Earthspirit, qui s’y sont réfugiées pour quitter des conjoints violents ou des pères incestueux.

Par ailleurs, ces écoféministes prennent la clé des champs en s’émancipant du couple hétérosexuel monogame et de la famille nucléaire, qui constituent les principales armes du patriarcat pour les féministes matérialistes18, et du capitalisme pour les féministes de la subsistance19. Il s’agit donc de repenser les liens amoureux, en laissant libre cours à des expériences polyamoureuses et en essayant de maintenir des relations saines, voire amicales, avec des anciennes amantes.
Les écoféministes des campagnes cherchent également à « échapper à la vision masculine » en s’offrant « un espace de vie et d’expérimentation préservé de regards qui jaugent, évaluent, sexualisent et, in fine, dépossèdent20 ». Pour cela, ces personnes renversent les normes de genre et la dichotomie entre le féminin et le masculin, par des transgressions vestimentaires et corporelles – ne pas s’épiler, ne pas porter de soutien-gorge tout en étant assignée au genre féminin –, et subvertissent la division sexuée du travail. Iels apprennent à manier des outils, en faisant les travaux par elleux-mêmes ou en organisant des chantiers collectifs sans homme cisgenre.
Faire ensemble permet d’expérimenter de nouvelles manières de travailler, de s’aimer, d’éduquer des enfants, tout en incarnant des sources d’inspiration pour celleux encore inséré·e·s dans la société dominante.
À la ferme des Paresseuses, Constance Rimlinger assiste à un chantier en non-mixité « meufs trans gouines » ayant pour ambition de pailler le potager et de préparer des semis. Joyce, l’un·e des participant·e·s, lui explique que le fait qu’il n’y ait pas d’hommes cisgenres qui, sinon, « essaient de porter toutes les choses lourdes ou de faire toutes les tâches physiques », lui offre « l’opportunité d’essayer ces choses et d’apprendre21 ».
Margaret, des Jardins de Colette, raconte également à la chercheuse la manière dont elle a enseigné à une visiteuse à se servir d’une tronçonneuse, alors que son conjoint n’adoptait aucune posture pédagogue, ce qui lui a permis de sortir momentanément du rôle et des activités associés à son genre.
Ce « climat propice à l’apprentissage22 » favorise ainsi l’acquisition de nouvelles compétences et la confiance en soi, dans le bricolage comme aux champs. L’accent est mis sur le faire : faire ensemble permet de confronter ses peurs et d’expérimenter de nouvelles manières de travailler, de s’aimer, d’éduquer des enfants, tout en incarnant des sources d’inspiration pour celleux encore inséré·e·s dans la société dominante. Il s’agit en effet de faire essaimer ces initiatives parmi celleux qui seraient susceptibles de pouvoir les rejoindre, par des œuvres artistiques, ou bien par le biais de sociabilités urbaines qui restent importantes pour les membres de la « configuration queer intersectionnelle ».
Lire aussi sur Terrestres : Geneviève Azam, « Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écoféministe », mai 2023.
Les modes de vie écoféministes ruraux sont orientés vers la subsistance, soit la réponse à ses propres besoins et à ceux du collectif par des activités productives, sans recourir à la sphère marchande et sans chercher le profit économique. Chez Maya et Sezik de la ferme des Paresseuses, par exemple, les productions de fruits, de légumes et de pain « sont avant tout destiné[es] à l’autoconsommation par les habitantes et les visiteuses », et permettent – en second lieu – « de dégager quelques revenus23 ».
Les écoféministes plantent et récoltent, élèvent des animaux (non pour les consommer mais pour leur aide au travail des champs), cuisinent, font leur bois, récupèrent des denrées alimentaires et des matériaux, construisent et rénovent leurs lieux de vie. Ces espaces domestiques, élargis aux terrains, jardins, champs et forêts alentours, octroient une sécurité matérielle aux féministes des champs, qui sont propriétaires de leurs lieux de vie. Cette sécurité peut même s’étendre à d’autres collectifs féministes, lorsqu’il s’agit par exemple de stocker le matériel encombrant de militant·e·s urbain·e·s.
Ce travail de subsistance s’adosse à la remise en question de la place prépondérante du travail rémunéré – souvent salarié – dans les quotidiens. Si Constance Rimlinger ne documente pas précisément les revenus qui permettent à ces écoféministes de subvenir à leurs besoins – d’autant plus que leurs projets professionnels ne sont pas élaborés pour être rentables –, on comprend qu’elles vivent avec le peu d’argent que procurent les minimas sociaux et/ou la vente d’une partie de leur production.
Les féministes des champs sont mu·e·s par le souhait de « minimiser leur part dans le désastre écologique et de montrer qu’un autre quotidien est possible ».
Les lieux étant généralement hérités ou achetés en collectif sans recours au crédit, diminuer leur consommation leur permet de réduire leur temps de travail contre rémunération. La recherche d’émancipation et la réappropriation de son travail – rejet de la subordination, polyactivité – et de son temps, ralenti et calqué sur les rythmes naturels à l’image de la ferme des « Paresseuses » présentée dans l’ouvrage, s’appuient sur des expérimentations incessantes. Le quotidien de Vanessa, 31 ans, habitante de la ferme des Roches, s’articule ainsi entre activités rémunératrices liées à un travail indépendant (consultations ayurvédiques), activités de subsistance, et activités à la frontière entre les deux – plantation d’arbres ou élaboration de confitures et de conserves pour l’auto-consommation et la vente commerciale.
La permaculture et la biodynamie, particulièrement mises en œuvre dans les lieux appartenant à la configuration « holistique intégrationniste », reflètent les tentatives et recommencements au cœur des modes de vie écoféministes. À la ferme des Roches ou à Moulin Coz, un calendrier lunaire est consulté afin de déterminer le programme au jardin des jours à venir. Dans les Jardins de Colette, Margaret se décrit comme une personne qui « crée et dessine des jardins » : on y trouve un potager en forme d’étoile, ou encore un labyrinthe de pierres qui symbolise « la vie où l’on avance, malgré les détours24 ».
Ce sont en effet dans les trois initiatives françaises qui composent cette configuration – le Moulin Coz, les Jardins de Colette et la ferme des Roches – que s’expérimente de la manière la plus aboutie un mode de vie écologique décroissant « où les logiques du salariat et de la consommation sont déconstruites25 ». De la construction des habitats en terre-paille à l’alimentation locale végétarienne voire végétalienne, en passant par la mise en place de toilettes sèches, la récupération de nourriture, d’eau et d’objets, le bricolage, et la présence d’une éolienne : les féministes des champs sont mu·e·s par le souhait de « minimiser leur part dans le désastre écologique et de montrer qu’un autre quotidien est possible26 ».
À Moulin Coz, par exemple, l’ensemble du bâti est constitué d’habitats légers – caravanes, cabanes, roulottes. Le seul bâtiment en dur est une yourte construite grâce à une ossature en bois, isolée avec un mélange terre-paille et chauffée grâce à un poêle à bois, et on y trouve des toilettes sèches. Six panneaux solaires et une éolienne fournissent une grande partie de l’énergie domestique, et de grandes cuves accueillent l’eau de pluie. La récupération et le bricolage sont privilégiés.
Les positionnements des écoféministes font écho aux éthiques du care : elles cherchent à « maintenir », « perpétuer » et « réparer ».
En outre, ces engagements féministes et écologistes ruraux sont uniformément caractérisés par le soin à l’égard de l’environnement – de la terre, des animaux, des plantes. Vivre sur un lieu rural à soi, c’est le protéger de l’exploitation agricole intensive en limitant les pressions productives qui y sont exercées. C’est également préserver les semences que l’on récupère d’une année à l’autre et qui assurent le renouvellement, voire l’enrichissement, de la biodiversité. C’est enfin « vivre avec les animaux27 » qui, avec les plantes, constituent des « espèces compagnes28 » avec lesquelles ces écoféministes cohabitent, et qui nécessitent de l’attention.
À Moulin Coz, Simone valorise beaucoup la « nature » et la « diversité » des fruits et légumes qui existent – « petites », « gros », « tordus », « de toutes les couleurs29 ». A We’Moon Land, Vicki, 70 ans, dispose des coupelles d’eau destinées aux insectes et aux petits animaux lors des périodes de fortes chaleurs. L’herbe y est fauchée de manière irrégulière afin de laisser des abris et des couloirs aux animaux. À Moulin Coz, Morgane s’attarde sur le comportement de chacune des truies, qu’elle nomme – Séraphine et Philomène – et admire leur intelligence.

Bien que ces écoféministes ne s’en réclament pas, leurs positionnements font écho aux éthiques du care : elles cherchent à « maintenir », « perpétuer » et « réparer30 » leur monde. C’est ainsi un engagement politique discret et quotidien du « moindre geste31 » qu’expérimentent ces féministes rurales, à distance des « formes les plus instituées de l’engagement32 », a fortiori urbaines, et que seule l’immersion ethnographique au sein des alternatives rurales mise en œuvre dans cette enquête est en mesure de saisir.
Lutter contre une pluralité de rapports de pouvoir ?
Les féministes des champs cherchent à lutter contre les rapports de pouvoir, essentiellement de genre et à l’égard de l’environnement, mais aussi contre le racisme, le colonialisme, le validisme et la transphobie pour celleux qui appartiennent à la configuration « queer intersectionnelle » et reconnaissent l’intersection des discriminations systémiques. Ces positionnements peuvent cependant dissimuler la reproduction de rapports de pouvoir à l’intérieur, comme à l’extérieur, de ces lieux de vie.
D’une part, comme le souligne Constance Rimlinger, ces collectifs sont principalement composés de femmes et minorités de genre blanches, issues des classes moyennes-supérieures et diplômées. Si des pistes sont ouvertes au sein de certains lieux, comme la possibilité d’instituer une propriété collective ou de mettre en commun les ressources, les femmes et queers racisé·e·s, souvent précaires au vu de l’entrelacement des enjeux de race et de classe, ont moins de chance de venir s’installer dans ces lieux. Ces rapports de pouvoir sont relativement impensés à l’échelle de ces initiatives, essentiellement centrées sur le rejet de l’hétéropatriarcat.
Lire aussi sur Terrestres : Héloïse Prévost, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.
De même, les initiatives relevant de la « configuration différentialiste séparatiste » reposent sur l’exclusion des personnes trans, et donc sur une transphobie en acte, questionnée par les habitantes, mais toujours à l’œuvre au moment de l’enquête. Par ailleurs, plusieurs de ces collectifs sont fondés sur l’accueil de volontaires (wwoofers), ce qui soulève la question du travail gratuit et d’une certaine forme de domination économique lorsque les hôtes doivent travailler pour participer à construire et améliorer un lieu qu’iels ne possèdent pas et sur lequel iels ne sont pas amené·e·s à vivre sur le long terme.
Se retrouver entre personnes minorisées peut cependant entraîner le rejet de celles et ceux qui n’auraient pas les codes symboliques ou les ressources matérielles adéquats pour rejoindre ces expériences.
D’autre, part, ces lieux de vie à l’abri de la domination patriarcale peuvent se transformer en « entre-soi33 ». C’est particulièrement le cas des initiatives appartenant aux configurations « différentialiste séparatiste » et « queer intersectionnelle » qui n’investissent pas, ou peu, les relations avec leur voisinage, et sont peu ancrées localement. À partir de ces constats posés par la chercheuse, on peut alors se demander si ces initiatives, si attentives à l’abolition des rapports de pouvoir en leur sein, ne participent pas à reproduire des rapports de classe dans leur espace social localisé34.
En effet, le souhait, légitime, de se retrouver entre personnes minorisées peut entraîner le rejet, involontaire ou par souci de distinction, de celles et ceux qui n’auraient pas les codes symboliques ou les ressources matérielles adéquats pour rejoindre ces expériences, même lorsqu’elles sont géographiquement très proches.
Constance Rimlinger souligne bien la tension inhérente à certaines initiatives, entre la volonté de faire essaimer ses idées et sa démarche en assumant une présence locale, et celle de cultiver un entre-soi féministe et protecteur. Les contacts réduits avec la population locale, appartenant souvent aux classes populaires, se fondent davantage sur des préjugés que sur des actes concrets, car il est bien stipulé qu’aucune des personnes rencontrées n’a jamais « subi d’acte d’intimidation, de menace ou de violence35 » de la part du voisinage.
En contraste avec les deux premières, la configuration « holistique intégrationniste » se fonde sur un fort ancrage local. Celui-ci s’incarne dans une multitude d’échanges non marchands – trocs, prêts, dons – entre personnes ouvertement engagées dans la cause écologiste – néo-paysan·ne·s, associations permacoles, AMAP, réseau d’agriculteurs et agricultrices bio –, davantage qu’avec les gens du coin. C’est le cas de Margaret des Jardins de Colette : arrivée sans connaître personne sur place il y a plus de trente ans, elle est désormais fortement ancrée localement dans un petit groupe informel d’entraide composé d « néoruraux ». C’est également le cas de Vanessa et Charlie de la ferme des Roches, qui, doté·e·s d’un capital culturel élevé et d’un capital militant constitué en milieu urbain, ont cherché à s’intégrer localement, en nouant notamment des liens amicaux avec des jeunes « néoruraux » du coin.
Ces modes de vie sont doublement marginalisés : parce qu’en milieu rural et parce que portés par des femmes et des minorités de genre.
On retrouve alors une tendance déjà mise en exergue par des travaux de sociologie rurale : l’engagement écologiste de personnes économiquement et/ou culturellement bien dotées peut participer à l’entretien d’un entre-soi petit-bourgeois36, a fortiori quand il se mêle à un engagement féministe d’origine urbaine adossé à une culture politique.
Visibiliser les alternatives écologiques et féministes rurales sans les idéaliser
Ce n’est ni un portrait romantisé, ni une analyse idéalisée de ces initiatives que propose Constance Rimlinger. Le propos est plus fin, car s’il présente leur potentiel émancipateur et politique en plein cœur d’une crise écologique et sociale sans précédent, il ne néglige pas leurs ornières. À ce titre, l’ouvrage pose avec brio toutes les questions qui ont traversé et traversent toujours les écoféminismes ruraux, et qui sont plus largement celles des personnes qui cherchent à s’extirper de la société capitaliste, bourgeoise, écocidaire, (post)coloniale, raciste, sexiste et validiste. Or, si les personnes qui portent ces initiatives cherchent à abolir une pluralité de rapports de pouvoir, elles semblent toutefois ne pas toujours faire preuve d’une réflexivité suffisante quant à l’homogénéité sociale de leurs collectifs.
À la différence de certains mouvements politiques et milieux militants féministes ou écologistes, qui privilégient la lutte contre le patriarcat d’un côté, et la lutte contre la destruction de l’environnement de l’autre, ces écoféministes tentent de faire converger les luttes, considérées comme profondément interconnectées, même si leurs privilèges sociaux peuvent parfois les aveugler.

La force de l’ouvrage de Constance Rimlinger est d’étudier conjointement des modes de vie écoféministes ruraux répartis sur trois continents, qui sont doublement marginalisés, parce qu’en milieu rural et parce que portés par des femmes et des minorités de genre. En partant de ces marges féministes et écologistes rurales – « la minorité au sein de la minorité37 » –, l’autrice explore le potentiel politique transformateur du quotidien en train de se faire. Ainsi, la portée de l’ouvrage est tout autant scientifique que politique. C’est à partir de l’« espace de la cause38 » écoféministe élaboré en son sein que l’on peut plus largement se demander comment construire des mondes ruraux féministes et écologistes totalement inclusifs, à partir de leurs marges queer. La typologie proposée éclaire dès lors des questions politiques centrales, particulièrement incarnées dans deux points abordés dans l’ouvrage, qui mériteraient d’être explorés plus encore.
D’une part, face à la visibilisation médiatique accrue des personnes trans ces dernières années, qui s’accompagne d’une très forte transphobie, en quoi ces collectifs permettent-ils précisément de lutter contre cette oppression systémique ou, au contraire, en quoi participent-ils à la renforcer ? Les écoféministes rurales de la configuration « différentialiste séparatiste », qui refusaient la présence de personnes trans en leur sein au cours de l’enquête de Constance Rimlinger, ont-elles depuis modifié leur position – ou non –, et sur quels arguments ?
D’autre part, il s’agirait de creuser la question des sociabilités locales entre les néo-habitantes que constituent les personnes rencontrées par la chercheuse, et les gens du coin. En effet, la comparaison entre les configurations « queer intersectionnelle » et « holistique intégrationniste », met en exergue l’entre-soi qui peut prévaloir dans certaines communautés. Or, on peut se demander comment les classes populaires et intermédiaires sans le sou installées en milieu rural depuis des dizaines d’années, dont les modes de vie sont écologiquement sobres sans néanmoins être mis en discours, pourraient être source d’inspiration, voire de ressources matérielles, pour ces écoféministes.
Parallèlement, l’implantation progressive des idéologies d’extrême-droite en milieu rural peut participer à fragiliser ces collectifs, ce qu’une enquête ultérieure serait invitée à investiguer. Par ailleurs, si l’on comprend au fil de l’ouvrage la manière dont l’installation en collectif rural queer permet d’assumer son orientation sexuelle – voire son appartenance de genre – avec confiance, on aimerait en savoir plus sur l’influence de la résidence rurale sur les rapports aux enjeux environnementaux de ces écoféministes. Des éléments seraient en effet bienvenus sur la manière dont ces lieux les socialisent en retour à la crise écologique – par le constat de la diminution de la biodiversité, de l’épandage de produits phytosanitaires et des déchets sur les bords des routes, ou encore l’apparition de maladies –, voire renforcent leur engagement écologiste, en les incitant par exemple à militer contre un projet local jugé écocidaire.
Ainsi, la typologie des trois configurations, de même que les nombreux thèmes qui sont abordés dans l’ouvrage – comme le rapport au travail rémunéré, à la spiritualité, à la « nature » et à l’agriculture, à la sexualité et au genre –, mêlés à la rigueur de l’enquête ethnographique de Constance Rimlinger, ouvrent de nouveaux questionnements, qui invitent d’autant plus à documenter les expériences collectives féministes et écologistes rurales que les mondes ruraux font l’objet d’enjeux politiques cruciaux dans des sociétés fortement inégalitaires.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Catherine Rouvière, Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960, Presses Universitaires de Rennes (Rennes, 2015).[↩]
- Féministes des champs, p.14.[↩]
- Ibid., p.257.[↩]
- Jeanne Burgart Goutal, « Un nouveau printemps pour l’écoféminisme ? », Multitudes, n°67 (2017), p.17‑28.[↩]
- Féministes des champs, p.12.[↩]
- Danièle Hervieu-Léger et Bertrand Hervieu, Le retour à la nature : au fond de la forêt… l’État, Seuil (Paris, 1979); Bernard Lacroix, L’utopie communautaire. Histoire sociale d’une révolte, PUF (Paris, 1981); Anaïs Malié et Frédéric Nicolas, « Des loisirs productifs aux “alternatives”. Le rapport ambivalent des classes populaires aux pratiques agricoles et alimentaires en milieu rural », Savoir/Agir, n°38 (2016), p.37‑43; Madlyne Samak, « Le prix du “retour” chez les agriculteurs “néo-ruraux” », Travail et emploi, n°150 (2017), p.53‑78; Geneviève Pruvost, La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte, La Découverte (Paris, 2024).[↩]
- Françoise Flamant, Women’s lands. Construction d’une utopie. Oregon, USA, 1970-2010 : l’épopée des pionnières de l’écoféminisme, Editions iXe (Donnemarie-Dontilly, 2023 [2015]).[↩]
- Homme dont le genre assigné à la naissance correspond à l’identité de genre.[↩]
- Constance Rimlinger, « Travailler la terre et déconstruire l’hétérosexisme : expérimentations écoféministes », Travail, genre et sociétés, n°42 (2019), p.89‑107.[↩]
- Marlène Benquet et Geneviève Pruvost, « Pratiques écoféministes : corps, savoirs et mobilisations », Travail, genre et sociétés, n°42 (2019), p.23‑28.[↩]
- Cette date correspond à la tenue de la 21ᵉ conférence de Paris (COP21) en France qui s’est accompagnée d’actions militantes écologistes et féministes, aux premières mises en place de festivals qualifiés « écoféministes », et aux prémisses d’un cycle de publications écoféministes en France. Voir Sandra Laugier, Jules Falquet, et Pascale Molinier, « Genre et inégalités environnementales : nouvelles menaces, nouvelles analyses, nouveaux féminismes. Introduction », Cahiers du Genre, n°59 (2015), p.5‑20; Émilie Hache, Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Cambourakis (Paris, 2016).[↩]
- Françoise d’Eaubonne, Le Féminisme ou la Mort, Le Passager Clandestin (Lorient, 2020 [1974]), p.276.[↩]
- Féministes des champs, p.26.[↩]
- Ibid., p.23.[↩]
- Ibid., p.258.[↩]
- Ibid., p.22.[↩]
- Ibid., p.213-214.[↩]
- Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe (Paris, Éditions iXe, 2013 [1991]); Christine Delphy, L’Ennemi principal : économie politique du patriarcat, Syllepse (Paris, 2013 [1998]); Monique Wittig, La pensée straight, Éditions Amsterdam (Paris, 2018 [1992]).[↩]
- Geneviève Pruvost, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, La Découverte (Paris, 2021); Veronika Bennholdt et Maria Mies, La subsistance. Une perspective écoféministe, La Lenteur (St-Michel de Vax, 2022).[↩]
- Féministes des champs, p.199-200.[↩]
- Ibid., p.120.[↩]
- Ibid., p.207.[↩]
- Ibid., p.126.[↩]
- Ibid., p.144.[↩]
- Ibid., p.134.[↩]
- Ibid., p.217.[↩]
- Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIᵉ siècle, La Découverte (Paris, 2014).[↩]
- Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes. Chiens, humains et autres partenaires, Flammarion (Paris, 2019).[↩]
- Féministes des champs, p.182.[↩]
- Joan C. Tronto, « Du care », Revue du MAUSS, n°32 (2008), p.243‑265.[↩]
- Geneviève Pruvost, « Chantiers participatifs, autogérés, collectifs : la politisation du moindre geste », Sociologie du travail, vol.57, n°1 (2015), p.81‑103.[↩]
- Féministes des champs, p.45.[↩]
- Ibid., p.103.[↩]
- Gilles Laferté, « Des études rurales à l’analyse des espaces sociaux localisés », Sociologie, vol.5, n°4 (2014), p.423‑439.[↩]
- Féministes des champs, p.128.[↩]
- Jean-Baptiste Paranthoën, « Processus de distinction d’une petite-bourgeoisie rurale », Agone, n°51 (2013), p.117‑130; Anaïs Malié, « « “C’est local, c’est ce qui nous intéresse”. Étude des constructions et usages du ‘local’ à travers les pratiques alimentaires », dans Les territoires de l’autochtonie, PUR (Rennes, 2016), p.97‑110.[↩]
- Féministes des champs, p.257.[↩]
- Laure Bereni, « Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause des femmes » dans Les féministes de la deuxième vague, PUR (Rennes, 2012), p.27‑41.[↩]






