Alors que la pensée écologique questionne aujourd’hui de façon croissante la création artistique dans toutes ses dimensions — des matériaux employés aux histoires racontées, en passant par les dispositifs de médiation et jusqu’à la finalité même de l’œuvre d’art —, suscitant un important renouvellement des formes et des pratiques, on ne cesse de redécouvrir des précurseurs, artistes ayant intégré à leurs œuvres des problématiques écologiques bien avant l’époque actuelle. Il en est ainsi de la rencontre entre la pensée écologique et le théâtre : si, « au cours de ces dernières années le nombre de spectacles, publications, colloques et autres rencontres professionnelles consacrés aux problématiques écologiques s’est considérablement accru1 », il est simultanément frappant de voir que certaines troupes théâtrales abordaient frontalement ces questions dès les années 1970. Tel est le cas de la troupe du Reinhabitory Theater, active à cette époque en Californie, et que cet article entend présenter pour la première fois au lectorat francophone. Son caractère confidentiel explique qu’elle ne soit pas entrée jusqu’à présent dans l’histoire théâtrale2, y compris aux États-Unis3 ; néanmoins, elle semble mériter d’être redécouverte aujourd’hui, à la fois pour ce statut de « précoce expérience de théâtre écologique4 », et parce que certaines des zones qu’elle a défrichées peuvent être encore fécondes aujourd’hui.
De la San Francisco Mime Troupe au Reinhabitory Theater : sur la piste d’une troupe de théâtre militante
La troupe du Reinhabitory Theater fut active en Californie de 1975 à 1977 ; mais elle ne saurait être comprise sans être replacée dans son histoire longue, la plupart de ses membres ayant fait partie, au cours des années 1960, de la San Francisco Mime Troupe et/ou du groupe des Diggers5.
La San Francisco Mime Troupe
Fondée par Ron Davis, un élève du mime Étienne Decroux, en 1959, la San Francisco Mime Troupe mène dans la ville du même nom un « théâtre de protestation et de propagande6 » dans les années 1960 : elle essaie d’interpeller les spectateurs sur les enjeux politiques de l’époque — guerre du Vietnam, droits civiques, violences policières, etc. Les pièces jouées sont tantôt des réécritures de comédies du répertoire (La Farce de Maître Pathelin, Molière, Goldoni), adaptées aux enjeux américains, tantôt des créations originales : dans les deux cas, l’un des acteurs de la troupe, Peter Berg, s’affirme comme le principal dramaturge. Le style de jeu de la troupe est très marqué par le mime et la commedia dell’arte, Ron Davis étant convaincu que « c’est aux actions physiques d’exprimer les significations essentielles [car] l’action physique touche le public de manière sensible7 » ; cela se retrouvera dans le Reinhabitory Theater. Ils se servent également d’un cranky, sorte de panneau muni d’une manivelle permettant d’y faire dérouler des images de toutes sortes8. Afin d’échapper aux contraintes de programmation des théâtres en dur et d’aller à la rencontre de tous les spectateurs possibles, la troupe joue dans les parcs de San Francisco en se payant au chapeau.
En 1966, Ron Davis publie un manifeste qui fait date aux Etats-Unis, et dont le titre est trouvé par Peter Berg : « Le théâtre de guérilla9 » (en écho à La Guerre de guérilla du Che Guevara, paru aux États-Unis en 1961). Outre un certain nombre de conseils pratiques pour faire du théâtre « social » ou « radical » avec peu de moyens, on y trouve l’idée qu’une compagnie de théâtre de guérilla doit concevoir son travail sous le triptyque « enseigner ; montrer la voie du changement ; donner l’exemple du changement » : « Le comportement public ne doit pas se distinguer du comportement privé. Fais en public ce que tu fais en privé, ou alors cesse de le faire en privé10 ». Cela s’accompagne d’une injonction particulièrement insistante à l’efficacité, au risque de la répression policière :
« Soyons très clairs. Vous pouvez critiquer, débattre, donner votre avis sur certains problèmes en société, vous serez accepté aussi longtemps que vous ne serez pas efficace11 ».
Ron Davis
Cette obsession pour ce qu’on pourrait appeler la performativité de la performance, l’idée d’un impact réel de la représentation théâtrale sur le monde, fait en réalité débat au sein de la San Francisco Mime Troupe ; et ses partisans plus radicaux, Peter Berg en tête, finissent par quitter celle-ci, rompre avec Davis, accusé d’être trop attaché aux séparations entre la scène et la salle et entre le théâtre et la vie, et par s’investir dans l’aventure des Diggers.
Les Diggers
Les Diggers sont plus qu’une autre troupe de théâtre. Sous ce nom, emprunté à un groupe de paysans ayant brièvement tenté une réappropriation des terrains communaux dans l’Angleterre du xviie siècle, sont d’abord publiés des textes, les Digger Papers, écrits par des membres de la Mime Troupe, Billy Murcott et Emmett Grogan (dont l’autobiographie romancée Ringolevio allait devenir culte dans les années 197012 ). Placardés ou distribués dans les rues de San Francisco à l’automne 1966, ils brocardent l’apolitisme des hippies ou de la révolution psychédélique alors en vogue, et posent la question du renversement réel de la société qu’ils dénoncent.
Puis sont organisés, par ce collectif, qui jusqu’au bout revendique son anonymat et sa totale ouverture (« être un Digger c’est se dire soi-même Digger. […] Qui veut, peut être un Digger13 »), des « évènements » d’un genre nouveau. C’est d’abord Free Food, une distribution de repas gratuits tous les jours dans un parc de San Francisco, non pas dans un esprit de charité mais d’incarnation d’une société post–capitaliste. « Il s’agissait de faire ce dont on avait envie, pour ses propres raisons. Si on voulait vivre dans un monde où la nourriture est gratuite, alors il fallait le créer et s’y impliquer » raconte ainsi l’un des Diggers, Peter Coyote14. La distribution est mise en scène de façon que tous les automobilistes circulant le long du parc voient « ce tableau d’une distribution gratuite de repas15 », cette représentation qui est en même temps présence réelle d’un avenir rêvé. Puis c’est un jeu, Intersection Game, où des marionnettes construites par Robert La Morticello de la Mime Troupe bloquent la circulation automobile pour remettre en question « l’usage et la propriété des rues16 » ; puis des magasins, les Free Stores, où quiconque le souhaite peut passer prendre ou déposer gratuitement des marchandises… Autant d’actions réalisées en-dehors du cadre traditionnel du théâtre, mais que les Diggers conçoivent comme des life–acts, un théâtre mêlé à la vie réelle et donnant à voir « la façon dont les choses pourraient ou devraient être17 ».
Dépassé par la répression policière, mais aussi par l’afflux à San Francisco de dizaines de milliers de jeunes Américains plus venus là pour profiter de la drogue à bas prix que pour renverser le capitalisme, le collectif des Diggers s’auto–dissout après le Summer of Love de 1967. Parmi ses membres, nombreux sont ceux qui tentent alors le retour à la terre, c’est-à-dire « de vivre en-dehors de la société de consommation, d’expérimenter l’autarcie et de tenter le virage radical du consommateur au producteur en étant soi-même à la source de ses propres moyens de subsistance18 » : c’est notamment le cas de Peter Berg et de sa compagne, la danseuse Judy Goldhaft. « Avec des amis des Diggers, des Noirs proches des Black Panthers, des féministes radicales, […] ils bâtissent une commune rurale, le Black Bear Ranch19 » : c’est de cette expérience que naît chez eux une pensée politique nouvelle, le biorégionalisme.
Le biorégionalisme
Le biorégionalisme peut être défini comme une redéfinition des régions géographiques à l’aune de critères écologiques — zone d’habitat d’espèces animales ou végétales, bassin-versant d’un fleuve, etc. — et bien sûr, les interdépendances s’y étant nouées. Au moment de son émergence dans les années 1970, il s’accompagne de l’idée que les biorégions devraient être le principal échelon politique des sociétés humaines, au détriment des frontières étatiques ou administratives actuelles (un mouvement en faveur de l’indépendance de Cascadia20, une biorégion à cheval sur les États-Unis et le Canada et définie par la chaîne de montagne des Cascades, apparut ainsi à l’époque et est toujours actif aujourd’hui). Fait à souligner, il ne s’agit donc pas d’une écologie du type « parcs nationaux », séparant espaces « naturels » préservés et espaces humains urbanisés, mais d’une réorientation des principales organisations politiques humaines en fonction de critères éco–territoriaux. En France, l’idée fut d’abord récupérée par l’extrême-droite (« parce que défendre l’idée d’un territoire comme lieu de vie permet également d’en exclure ceux que l’on ne veut pas y voir21 ? »), avant d’être rendue à sa dimension structurellement « antispéciste, anticapitaliste, antinationaliste22 » par l’architecte Mathias Rollot23.
À lire aussi sur Terrestres, un entretien avec Mathias Rollot, « Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste », avril 2023.
Ce concept est indissociable de celui de « vivre–sur–place » ou « vivre–dans–un–lieu » (living–in–place), à savoir un mode d’habitation « conservant un équilibre entre les vies humaines, les autres êtres vivants, et les processus planétaires — saisons, météo, cycles de l’eau — […], aux antipodes d’une société qui se fabrique une vie (makes a living) à travers l’exploitation court-termiste et destructrice du pays et de la vie24 ». Celui-ci aurait de facto été maîtrisé par la plupart des groupes humains au cours de l’histoire (et notamment, pour ce qui concerne l’Amérique du Nord, par les populations amérindiennes) jusqu’à l’avènement de la révolution industrielle au sein des sociétés occidentales ; par conséquent, ces dernières devraient donc apprendre à « réhabiter », c’est-à-dire à habiter une biorégion dans le respect de son équilibre écologique25.
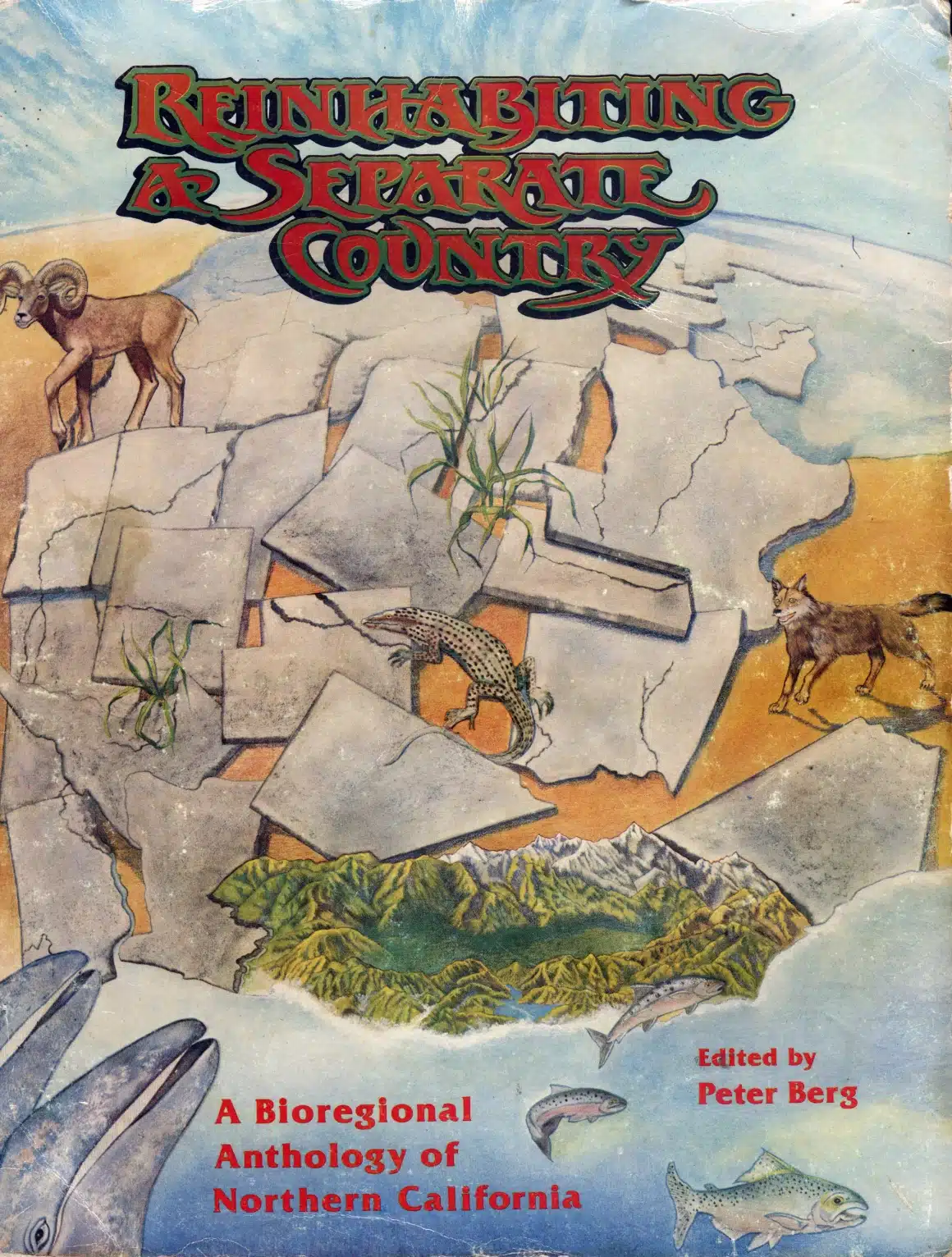
« Biorégionalisme », « vivre–dans–un–lieu », « réhabiter » : Peter Berg est généralement reconnu comme l’inventeur de ces concepts. Signalons toutefois l’influence manifeste de Gary Snyder, compagnon de route des Diggers, poète membre de la Beat Generation, auteur notamment de Turtle Island (1974) qui lui valut le prix Pulitzer l’année suivante, et qui partageait avec Berg et Goldhaft (ou leur avait inspiré ?) « l’idée d’une renaissance culturelle et écologique d’inspiration amérindienne pour toute l’Amérique du Nord26 » ; toute son œuvre, poétique comme théorique, peut se lire une promotion du biorégionalisme et de la « réhabitation27 ».
Sur Terrestres, lire aussi le texte de Gary Snyder, « Accéder au bassin-versant », septembre 2020.
Le Reinhabitory Theater
En 1973, de retour à San Francisco, Peter Berg et Judy Goldhaft fondent Planet Drum, une association dévolue à la promotion du biorégionalisme (et toujours active aujourd’hui) ; et en 1975, ils lancent le Reinhabitory Theater, une petite troupe de théâtre dont le projet pouvait se définir comme une promotion du biorégionalisme et de la reinhabitation via le théâtre28. Composée d’une quinzaine de membres impliqués de façon plus ou moins régulière (dont près de la moitié avaient été membres des Diggers), elle se consacra pendant trois ans à des workshops et à la mise en scène et à la tournée d’un spectacle, intitulé Northern California Stories29. La première représentation du spectacle eut lieu au mois d’octobre 1976 ; les autres (une quinzaine au total) eurent lieu en 197730, principalement dans des petites villes de Californie du nord — mais aussi dans des fermes, sur le campus de Berkeley, ou dans les montagnes avoisinant San Francisco.

C’est par les workshops, dirigés par Judy Goldhaft, que cette aventure a commencé : il s’agissait de cours de mime, focalisés sur les comportements animaux — principalement des mammifères et des oiseaux, tous endémiques de la Californie du Nord. Aux antipodes d’un travail de mime codifié, ils étaient nourris des études éthologiques les plus récentes, ainsi que d’observations directes, dans les zoos ou dans des environnements sauvages. L’idée sous-jacente était qu’incarner ainsi coyotes, ours ou renards argentés, comprendre le plus finement possible l’organisation de leur corps ou leur mode de déplacement, permettait de s’approcher de leur point de vue sur le monde, et donc de s’ouvrir à des perspectives multi–spécifiques.
Le spectacle Northern California Stories se construisit sur cette base. Il s’agissait d’un spectacle à géométrie variable, composé d’une vingtaine de sketchs, présentés ou pas en fonction de l’avancement de leur écriture et/ou de la disponibilité des comédiens. Judy Goldhaft en est la metteuse en scène, et les textes semblent avoir été principalement écrits par Peter Berg et Lenore Kandel (poétesse importante de la Beat Generation et ex–Digger), tout en laissant une place à l’écriture collective.
Les sketchs qu’on y trouve — jamais publiés, mais dont j’ai pu consulter les brochures des comédiens ainsi que des captations vidéos des répétitions et des représentations — sont de trois principaux types : histoires issues des mythologies amérindiennes, interventions pédagogiques sur l’écologie de la Californie, et créations originales.
Les adaptations de récits issus de mythologies amérindiennes, et plus spécifiquement de mythologies de peuples de la Côte Ouest (Pomo, Maidu, Karok et Pit River31 ), ont toutes en commun d’impliquer des animaux non–humains : du point de vue de Peter Berg, c’est là le cœur du spectacle. Leur source principale semble avoir été les ouvrages de l’anthropologue Jaime de Angulo32 (1887-1950), dont plusieurs livres avaient été réédités à San Francisco par les éditions Turtle Island33 au cours des années 1970 ; les travaux d’Alfred Kroeber ont également pu être consultés34. Le raisonnement de Berg est le suivant : si le mode de vie occidental entraîne une destruction des écosystèmes alors que les modes de vie amérindiens étaient sur ce point équilibrés, alors il serait bénéfique, dans une perspective écologique, de mieux connaître les cultures amérindiennes, notamment pour la place qu’elles font aux animaux dans leurs cosmologies. De nos jours, cela n’est pas sans soulever la question de l’appropriation culturelle, sur laquelle je reviendrai plus loin. Étaient ainsi racontées — et incarnées avec un grand souci de réalisme éthologique — les histoires de Coyote et Renard argenté, Coyote et Taupe, Coyote et Lézard, Lézard et Grizzly, etc.
Voici par exemple la première scène du spectacle, qui évoque un mythe de création du monde des Pit Rivers :
BILL. Qu’est-ce que c’est que cette chose que les Blancs appellent Dieu ? Ils en parlent tout le temps, bon dieu ci, et bon dieu ça, et nom de dieu, et dieu a créé le monde… Qui est ce dieu, Doc ? Ils disent que Coyote est le Dieu Indien, mais si je leur dis que Dieu est Coyote, ils se fâchent. Pourquoi ?
DOC. Ecoute, Bill, dis-moi… Est-ce que les Indiens pensent, vraiment, que Coyote a fait le monde ? Je veux dire, est-ce qu’ils le pensent pour de vrai ? Est-ce que toi tu le penses pour de vrai ?
BILL. Mais bien sûr… Pourquoi pas ?… En tout cas, c’est ce que les personnes âgées ont toujours dit… mais ils ne racontent pas tous la même histoire. Voilà une de celles que j’ai entendues : on aurait dit qu’il n’y avait rien nulle part qu’une sorte de brouillard. Un brouillard mêlé d’eau, dit-on, pas de terre où que ce soit, et voilà Renard Argenté…
DOC. Tu veux dire Coyote ?
BILL. Non, non, je veux dire Renard Argenté. Coyote, c’est après. Tu verras. Pour l’instant, quelque part dans ce brouillard, on dit que Renard Argenté errait et se sentait seul. (Bill se change en Renard Argenté) J’aimerais rencontrer quelqu’un ! (Doc se change en Coyote) Je pensais bien rencontrer quelqu’un ! Où voyages-tu ?
DOC. Où voyages-tu, TOI ? Pourquoi voyages-tu comme ça35 ?
On peut pointer ici un petit raccourci dans la pensée de Berg : aussi multi–spécifiques soient-ils, les mythes des Pit Rivers ne se situaient nullement dans une perspective de réalisme éthologique — Renard argenté crée le monde, Lézard donne des coups de bâton à Coyote, Taupe fume du tabac, etc. Néanmoins, on ne saurait donner tort à Berg de les trouver moins anthropocentriques que les mythologies occidentales modernes.

Les interventions pédagogiques étaient menées par Peter Berg, sous le nom ironique de « Fred-full–of–facts ». Muni d’un cranky présentant des illustrations diverses comme à l’époque de la San Francisco Mime Troupe, Berg cherchait à développer chez les spectateurs une conscience écologique du lieu où ils habitaient, à savoir le nord de la Californie — « pays à part36 » défini avant tout par l’impact climatique des montagnes de la Sierra Nevada (dans le même état d’esprit, une autre séquence consistait à énumérer collectivement les noms de plantes et d’animaux endémiques de ce bassin-versant). Cela allait de pair avec une mise en perspective de l’histoire de ce « pays », qui était l’occasion d’expliquer à la fois le tissu d’interdépendances écologiques le constituant et la lourde responsabilité de la colonisation européenne (flore européenne supplantant la flore locale, impact de l’introduction de l’élevage massif sur les sols et les eaux…) dans le bouleversement de celui-ci.
Enfin, plusieurs textes originaux — une chanson décrivant le cycle de l’eau, des poèmes évoquant les animaux et les cycles naturels — émaillaient le spectacle. L’un d’eux, généralement joué en clôture du spectacle, se détache par sa longueur et sa qualité : « Le lynx et les poulets », un sketch inspiré d’une anecdote ayant eu lieu dans le ranch de Gary Snyder (où une représentation du spectacle eut d’ailleurs lieu), le seul à avoir lieu dans un univers contemporain et non un temps mythique. Il raconte les mésaventures d’un couple de néo-ruraux, Branch et Crystal, aux prises avec un lynx dévastant leur poulailler. J’en traduis ici la première page, où les acteurs présentent aux spectateurs leurs personnages, non sans ironie envers la naïveté de ceux-ci :
OUVERTURE
LYNX. J’ai toujours vécu ici.
BRANCH. Je m’appelle Branch. Je voulais m’enraciner quelque part. Je ne supportais plus d’être enfermé en ville.
CRYSTAL. Je m’appelle Crystal. Je suis venue ici pour faire pousser des légumes. Je voulais sortir du bruit, des embouteillages et de la pollution de la ville.
POULE. Quand je suis arrivée de la ferme de Petaluma, je n’avais jamais vu la nuit. Maintenant qu’ils ont enlevé le speed de ma nourriture, je peux enfin dormir !
AUTRE POULE. Comme tant d’autres, moi aussi je suis née à Petaluma.
[…]
AUTRE POULE. Je me suis échappée du laboratoire du colonel Sanders. Je n’en finis pas de briser ma coquille.
COQ. Je viens de l’une des meilleures familles de la vallée. Cela fait deux ans que je suis avec Branch et Crystal. Je protège les poules, et je m’assure que les œufs sont fertiles.
SCÈNE I
Basse-cour. Les poules dorment… Le coq les réveille… Il les compte… Elles mangent… Alerte… Tout va bien… Alerte… Alerte rouge… Le lynx tue une poule.
SCÈNE II
CRYSTAL. Le lynx a encore tué une poule ! C’est la quatrième ! Non, ne le dis pas.
Branch mime une palissade.
CRYSTAL. Non, je ne veux pas être séparée de la forêt37.
Au cœur de problématiques écologiques concrètes, en prise directe avec des enjeux auxquels étaient confrontés les spectateurs, machine à jouer d’une grande puissance comique : cette scène peut être considérée comme la plus réussie du Reinhabitory Theater.
On l’aura compris, cette aventure ne brille pas par son volume ! Mais elle recèle au moins trois innovations intéressantes du point de vue de ce que fait au théâtre une perspective écologique : une innovation vis-à-vis des histoires racontées, une autre vis-à-vis des rôles incarnés, et une troisième vis-à-vis du lieu de la représentation.
Changer d’histoires : des récits multi-spécifiques
L’essentiel des Northern California Stories repose, on l’a dit, sur des adaptations de récits issus des mythologies amérindiennes de la Côte Ouest. De nos jours, une telle démarche aux États-Unis soulèverait immanquablement la question de l’appropriation culturelle — à la fois en amont, puisque Berg et Kandel ont écrit à partir de textes d’anthropologues blancs sans consulter les populations concernées, et en aval, puisque tous les membres de la troupe sont blancs eux aussi. Du point de vue des Karok (par exemple), on pourrait dire qu’on reste dans une configuration coloniale, où des Américains extraient une chose qui les intéresse d’une culture qui n’est pas la leur, la transplantent dans un contexte dont les Karok sont absents et lui font dire autre chose que sa signification d’origine. Signalons toutefois qu’on est ici aux antipodes des cas les plus polémiques du genre (comme les sous-vêtements à « imprimé Navajo » de la marque Urban Outfitters38 ), l’esprit de la démarche de Berg ayant bien plutôt été de réhabiliter la culture karok aux yeux des Américains, et la troupe ayant par ailleurs été loin de tirer de ces représentations le moindre profit.
Au-delà de l’avis des populations concernées, la question se pose de la capacité des spectateurs baignant dans une culture occidentale à approcher l’équilibre écologique du mode de vie amérindien par la simple connaissance de ces mythes. Comme l’écrivent Fred Bozzi et Martin Mongin dans un article récent consacré à la vogue actuelle, au sein des milieux écologistes, des ouvrages d’anthropologie (tels ceux de Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, Barbara Glowczewski, Florence Brunois, Nastassja Martin, Eduardo Kohn, etc.) :
Ces mythes tellement évocateurs pour nous sont toujours, chez ceux qui les cultivent, plus que des mythes. Ils sont inséparables d’une expérience vécue, d’une praxis, d’un rapport intégral au monde et au temps long de l’histoire collective. En ce qui nous concerne donc, les anthropologues l’indiquent, nous ne pouvons en avoir qu’une approche extérieure et spectaculaire.
Fred Bozzi et Martin Mongin, « Sorcières et sourciers : de quels mythes avons-nous besoin ? »,
Terrestres, 25 février 2022
Mais dans une certaine mesure, Berg semble conscient de ces écueils : « Des représentations par le théâtre réhabitant d’ “histoires de coyote”, indique-t-il, ne devraient pas chercher à imiter la religion karok originelle (native), mais elles devraient invoquer un esprit de création perpétuelle pour montrer la relation d’interdépendance qui unit les êtres humains aux autres espèces39 ». À bien y regarder, il s’agit donc moins de devenir Amérindien que de devenir écologiste, ce que confirment les libertés prises avec les mythes racontés. Sa perspective est plutôt localiste — puisque c’est sur la côte Ouest que nous habitons, intéressons-nous aux mythes propres à ce lieu, cela nous aidera peut-être à mieux y vivre — et surtout multispécifique — puisque développer un imaginaire multispécifique pourrait aider à avoir un rapport au monde plus équilibré. Comme le dit Berg, « présenter ces histoires implique de réaffirmer la coexistence des humains avec les autres espèces : pour rendre justice aux “histoires de coyote”, il faut affirmer d’emblée une vision multispécifique donnant crédit et égalité implicites à toutes les choses vivantes40 ».
Changer de rôles : incarner les non-humains
Adopter une perspective biorégionaliste, c’est s’intéresser aux non-humains, au premier rang desquels les animaux ; en le faisant au théâtre, la troupe du Reinhabitory Theater a choisi d’incarner ceux-ci par les acteurs. Ces derniers n’ont bien entendu pas été les premiers à jouer des animaux41 ; mais à ma connaissance, ils furent les premiers à le faire dans une perspective explicitement multispécifique. Fait significatif, tout comme « les textes ne marquaient aucune distinction entre les espèces » (on l’a vu dans « Le lynx et les poulets »), de même « il n’était pas fait usage de masques ou de costumes d’animaux, qui auraient séparé les humains des autres espèces42 ». Tout devait passer par le corps des comédiens — on reconnaît là bien sûr l’héritage de la San Francisco Mime Troupe.

D’autres choix de mise en scène sont évidemment possibles, mais celui-ci a l’intérêt de pousser les comédiens à observer les animaux, à analyser le fonctionnement de leur anatomie — encore aujourd’hui, Judy Goldhaft est ainsi capable de mimer différents oiseaux par les nuances de leurs battements d’ailes ; et ce faisant, à ouvrir des chemins d’empathie inter-espèces, dans un sens ou dans l’autre (l’enjeu initial étant bien sûr d’augmenter l’empathie humaine envers les non-humains ; mais les acteurs que j’ai rencontrés riaient encore d’une représentation où les imitations de Coyote et Renard avaient suscité une surexcitation telle chez les chiens présents parmi l’auditoire qu’ils avaient interrompu la représentation).
Changer le rapport au lieu de la représentation : un théâtre situé
Enfin, la dernière innovation significative du Reinhabitory Theater me semble être son ancrage territorial. Il s’agissait de jouer en Californie du Nord, pour les habitants de ce territoire, un spectacle destiné à les aider à mieux connaître et mieux habiter celui-ci, autrement dit à « emmener les communautés des lieux où ils allaient vers l’expérience de vivre dans une perspective biorégionale43 ». Surtout, à l’instar de Planet Drum, l’association fondée par Berg et Goldhaft, il s’agissait, par le théâtre, de faire communauté (c’est l’héritage des Diggers), d’aider le mouvement écologiste qui ne s’appelait pas encore ainsi à faire réseau, à se reconnaître lui-même ; et notamment d’apporter « une réponse directe au mouvement de retour à la terre des années [19]60 et [19]70, au cours duquel des gens des villes ont choisi de s’installer à la campagne pour devenir fermiers. Comme le dit Goldhaft, « ils étaient très peu soutenus, et ce théâtre a été conçu pour qu’ils sachent que ce qu’ils faisaient était important44 ».
Même si la troupe a joué dans différents lieux au sein de la Californie du Nord, on est donc ici dans une logique aux antipodes de celles de la « tournée » classique d’une pièce de théâtre : c’est ce qui rend le spectacle Northern California Stories inadapté à des représentations dans d’autres régions des États-Unis et a fortiori sur les scènes françaises, sauf à en faire une adaptation allant jusqu’à la réinvention intégrale.
De la Californie à la France : des pistes pour de nouveaux récits multispécifiques ?
De cette réinvention, je propose ici de défricher quelques pistes. L’idée d’un « théâtre situé » soulève des questions intéressantes : on voit que la tournée théâtrale, telle qu’elle existe aujourd’hui en France de façon structurante (subventions corrélées au nombre de dates de tournée, au fait de tourner dans plusieurs départements, etc.), apparaît peu compatible avec cette recherche d’échanges et de connexions entre le spectacle et le lieu où il prend place ; bien au contraire, son outil privilégié, la « boîte noire », conçue pour être identique partout, est le symbole le plus poussé d’une volonté de faire abstraction du contexte. À rebours, il n’est bien sûr pas étonnant que la troupe du Reinhabitory Theater ait privilégié les représentations en plein air (et le plus souvent en dehors des théâtres) ; et le renouveau que l’on constate en France depuis une dizaine d’années du côté du théâtre-paysage (Alexandre Koutchevsky, Mathilde Delahaye, Clara Hédouin) ou des festivals de théâtre « de proximité45 », qui jouent généralement en extérieur et toujours au même endroit, n’est peut-être pas sans lien avec le désir de (ré)inventer le théâtre comme un art situé, ancré dans un lieu spécifique, que cela soit articulé avec une pensée écologique consciente ou non46.
D’autre part, en ce qui concerne la question d’un imaginaire multispécifique local à (re)découvrir, plusieurs pistes peuvent être explorées. Certes, il a été dit et répété que la cosmologie chrétienne, dominante en Europe et notamment en France, accorde (aux antipodes de toute perspective multispécifique) une place essentielle à l’idée d’une Terre mise par Dieu à la disposition de l’Homme seul ; et, pour cette raison entre autres, la pensée écologique a d’ailleurs, depuis l’article fondateur de Lynn White, souvent mis le christianisme à la « racine historique de notre crise écologique47 ». Dans cette cosmologie, les animaux ne sont en général que des symboles (de Dieu, du Diable, des passions humaines, etc.), dépourvus de toute perspective propre, et par ailleurs décorrélés de la faune et de la flore présentes en France (d’où les lions sauvages ont disparu avant l’arrivée du christianisme, et où le blé et la vigne, plantes chrétiennes par excellence, n’ont été acclimatés qu’à grand-peine48 ).
Mais, comme le rappelle l’anthropologue Charles Stépanoff, cette cosmologie chrétienne n’a jamais fait disparaître des traditions populaires bien plus multispécifiques :
Nous croyons pouvoir résumer les croyances populaires au christianisme officiel, celui des théologiens, des prêtres et des gens éduqués. Or cette religion de l’écrit a été extrêmement minoritaire pendant de nombreux siècles. […] Les traditions populaires étaient porteuses d’une tout autre vision sur l’univers quotidien. Les récits paysans décrivent un temps du mythe où les animaux étaient des humains : le rossignol était une bergère qui, métamorphosée en oiseau, continue d’appeler ses bêtes ; la taupe, l’ours, les phoques ont un passé humain. […] Tous ces mythes s’emploient à tisser des liens généalogiques et analogiques entre les humains et les animaux et forment un contraste frappant par rapport à la division métaphysique rigide entre nature et culture qui définit l’ontologie moderne49.
Et Stépanoff d’orienter l’enquête (des anthropologues mais aussi, en ce qui nous concerne, des artistes en quête d’imaginaires multispécifiques locaux) « vers un monde mal connu et considéré comme défunt […], celui des traditions orales et de la religion populaire50 ».
Dans la même perspective, on peut regarder d’un œil nouveau toutes les mythologies impliquant les créatures surnaturelles. Comme le rappelle l’historien Fabrice Mouthon :
Les dames des lacs ou fées, comme les hommes sauvages, mais aussi les nains et les elfes en pays germaniques sont avant tout des génies du terroir, c’est-à-dire des créatures imaginaires personnifiant les forces de la nature. Les fées sont généralement les gardiennes des eaux, parfois des montagnes51.
L’historien Claude Lecouteux52 ou le mythologue Pierre Dubois53 ont ainsi pu démontrer que la plupart des créatures féériques étaient rattachées à un lieu spécifique, et que le mythe les concernant tournait en général autour d’enjeux de partage de territoires ou de ressources entre humains et non-humains (dryade défendant son arbre contre un bûcheron, naïade protégeant une source, etc.) — c’est-à-dire très exactement des enjeux écologiques. L’imaginaire populaire européen, et notamment français, regorge donc de porte-paroles des non-humains, dont la perspective écologique (et théâtrale) n’est qu’à redécouvrir.
Enfin, si l’on cherchait des histoires multispécifiques non pas dans les mythologies locales mais, sur le modèle de la scène « Le lynx et les poulets », dans les luttes actuelles, on pourrait s’intéresser « aux histoires des gens qui explorent des modes de vie post-industriels, comme les gens ayant fait le retour à la terre dans les Pyrénées ou les personnes vivant à Notre-Dame-des-Landes42 », m’a suggéré Judy Goldhaft. Ce dernier exemple me paraît particulièrement bien choisi, dans la mesure où la lutte contre le projet d’aéroport s’est affirmée aussi comme un choc de cosmologies, celle des opposants revendiquant explicitement son multispécisme (ce qu’un ouvrage comme La Recomposition des mondes54 d’Alessandro Pignocchi analyse en détail) ; mais d’autres choix sont bien sûr possibles.
Ainsi, en suivant la piste du lynx californien, la question de la cohabitation dans la France d’aujourd’hui entre communautés humaines et grands prédateurs — réintroduction de l’ours dans les Pyrénées, retour (timide) du loup au niveau national, voire présence croissante du renard dans les grandes villes, etc. — pourrait faire l’objet de spectacles de théâtre réhabitant qui seraient passionnants à voir, et dont l’impact politique, pour peu qu’ils parviennent à exprimer l’ensemble des points de vue en présence et qu’ils soient conçus en dialogue avec les populations concernées, ne saurait être sous-estimé.
Pour poursuivre votre lecture, retrouvez toutes les publications d’Alessandro Pignocchi dans la revue Terrestres.
Pour aller plus loin, vous pouvez également télécharger la bibliographie complète de l’article ici.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Julie Sermon, « L’écologie comme condition(s) », in Julie Sermon (dir.), Théâtre/Public n°247 : La condition écologique, avril 2023, p. 13.[↩]
- Elle n’est à ma connaissance mentionnée que dans deux études, par ailleurs plutôt consacrées au biorégionalisme (sur cette notion, voir plus bas) : Cheryll Glotfelty, « Peter Berg: living a making » in Cheryll Glotfelty et Eve Quesnel (eds), The Biosphere and the Bioregion. Essential writings of Peter Berg, Londres/New York, Routledge, 2015 ; et Yeshe Salz, « Reinhabitory Theater: A Legacy of Inspiring Bioregionalism Through Storytelling », in FoundSF, the San Francisco digital history archive,2017 (consultable en ligne sur https://www.foundsf.org/index.php?title=Reinhabitory_Theater:_A_Legacy_of_Inspiring_Bioregionalism_Through_Storytelling, dernière consultation en février 2023). Peter Berg lui-même lui a consacré un article, « Reinhabitory Theater », dans l’ouvrage qu’il a dirigé sur le biorégionalisme (Reinhabiting a Separate Country. A Bioregional Anthology of Northern California, San Francisco, Planet Drum Foundation, 1978), ouvrage où l’on trouve également « Lizard and Coyote », la seule scène du spectacle Northern California Stories à avoir été publiée jusqu’à présent.[↩]
- Elle est ainsi absente de la première somme sur le sujet, dirigée par Una Chaudhuri dans les années 1990 (« Theater and Ecology », Theater, vol. 25, n°1, Duke University Press, 1994).[↩]
- Glotfelty, art. cit., p. 22. Je traduis.[↩]
- Outre l’étude de l’époque par Franck Jotterand (Le Nouveau Théâtre Américain, Paris, Seuil, 1970), je m’appuie ici sur le livre d’Alice Gaillard, Les Diggers, révolution et contre-culture à San Francisco (1966-1968), Montreuil, l’Échappée, 2014.[↩]
- Gaillard, Op. cit., p. 39.[↩]
- Cité par Jotterand, Op. cit., p. 163.[↩]
- Jotterand (Op. cit., p. 161) considère que c’est un emprunt fait à Peter Schumann, le fondateur du Bread and Puppet Theatre[↩]
- Ron G. Davis, « Guerrilla Theatre », première publication in Tulane Drama Review, vol. 10, n°4, Été 1966 ; repris dans San Francisco Mime Troupe, Guerrilla Theatre Essays, San Francisco, SFMT, 1970. Jotterand (Op. cit., pp. 169-176) en reproduit la traduction intégrale de Diane de Rham.[↩]
- Davis, art. cit. ; cité par Jotterand, Op. cit., p. 170.[↩]
- Ibid, p. 172.[↩]
- Emmett Grogan, Ringolevio, Paris, L’Échappée, 2022.[↩]
- Gaillard, Op. cit., p. 67.[↩]
- Peter Coyote, Sleeping where I fall, p. 71 ; cité par Gaillard, Ibid.[↩]
- Gaillard, Ibid.[↩]
- Gaillard, Ibid., p. 64.[↩]
- Peter Berg, cité par Gaillard, Ibid., p. 79.[↩]
- Gaillard, Op. cit., p. 119.[↩]
- Edouard Waintrop, « Le « Hun » écolo de San Francisco », Libération, 27 décembre 2000; cité par Gaillard, Op. cit., p. 163.[↩]
- Sur cette biorégion, voir les travaux de Julie Celnik, par exemple « La biorégion de Cascadia, territoire de la décroissance » in Agnès Sinaï (dir)., Politiques de l’anthropocène, Presses de Sciences Po, 2021[↩]
- Michel Bernard, « Les différentes couleurs du biorégionalisme », in Silence, n°496 : « Le biorégionalisme, le monde d’après ? », février 2021, p. 10.[↩]
- Ibid.[↩]
- Depuis plusieurs années, Mathias Rollot s’est fait le promoteur en France du biorégionalisme, non seulement en traduisant L’Art d’habiter la Terre (Marseille, Wildproject, 2020), première somme sur le sujet par Kirkpatrick Sale (1985), mais aussi avec plusieurs publications originales : « Aux origines de la biorégion » (métropolitiques.eu, 2018) ; Les Territoires du vivant : un manifeste biorégionaliste (Paris, François Bourin, 2018 ; réédité chez Wildproject en 2023), point de départ du dossier de la revue Silence sus-cité ; et Qu’est-ce qu’une biorégion ? avec Marin Schaffner (Marseille, Wildproject, 2021).[↩]
- Peter Berg et Raymond F. Dasmann, « Reinhabiting California » in Peter Berg (éd.), Op. cit., p. 218. Ils soulignent, je traduis.[↩]
- Laura Centemeri fait justement le lien entre cette notion et le mouvement de la permaculture, conceptualisé en Australie à la même époque : cf. La Permaculture ou l’art de réhabiter, Versailles, Quae, 2019.[↩]
- Gary Snyder, « La redécouverte de l’Île Tortue » in Gary Snyder, Le Sens des lieux. Éthique, esthétique et bassins-versants, Marseille, Wildproject, 2018, p. 244.[↩]
- Cf. par exemple l’article « Réhabiter » in Snyder, Op. cit., p. 191. Son œuvre fait actuellement l’objet d’un regain d’intérêt éditorial en France ces dernières années, porté principalement par la maison Wildproject : outre l’ouvrage cité ci-dessus, cf. Kenneth White, Gary Snyder, Marseille, Wildproject, 2021 ; Jim Harrison et Gary Snyder, Aristocrates sauvages, ibid, 2022.[↩]
- cf. Salz, art. cit.[↩]
- On trouve également des occurrences sous le titre California Tales, California Stories et Northern California Mythology.[↩]
- Dans son entretien avec Yeshe Salz en 2017, Judy Goldhaft indiquait que la fin du Reinhabitory Theater eut lieu vers 1979-1980 ; mais dans les archives auxquelles j’ai eu accès en 2022, aucun document ne fait référence à une date postérieure au 16 novembre 1977 (représentation au Julian Theater de San Francisco), et Judy Goldhaft m’a finalement déclaré que cette datation était sans doute plus exacte.[↩]
- Peter Berg, « Reinhabitory Theater », in Peter Berg (dir.), Op. cit., p. 186.[↩]
- En français, on peut consulter : Indiens en bleu de travail, Genève, Héros–Limite, 2014 ; Le Lasso et autres écrits, Genève, Héros–Limite, 2018 ; Une famille de chasseurs indiens : mythes, contes et fables des Indiens de Californie, Monaco, Editions du Rocher, 2022.[↩]
- Le lien entre les éditions Turtle Island et le livre éponymede Gary Snyder n’est pas avéré, mais la coïncidence est symptomatique du regain d’intérêt à cette époque pour les mythologies amérindiennes — « l’Île Tortue » est, dans nombre d’entre elles, le nom donné au continent nord-américain. cf. Snyder, art. cit.[↩]
- Et notamment son Handbook of the Indians of California (1925), alors tout juste réédité (New York, Dover publications, 1976). Il me paraît intéressant de signaler qu’Alfred Kroeber était également le père d’Ursula K(roeber) le Guin, dont les romans de science-fiction féministe, anarchiste ou décoloniale connaissaient dans les années 1970 un important succès. La Vallée de l’éternel retour (Always Coming Home,1985) peut être lu comme une tentative de faire par le roman ce que tentait la troupe du Reinhabitory Theater par le théâtre : donner à voir les (futurs) habitants de la Californie menant une vie plus écologique, largement inspirée des cultures amérindiennes de la Côte Ouest. On retrouve également sous sa plume une réécriture d’une histoire de Coyote dans la nouvelle qui donne son nom au recueil Buffalo Gals and other Animal Presences (Santa Barbara, Capra Press, 1987, non traduit).[↩]
- Reinhabitory Theater archives, © Ocean Berg. Exception faite des didascalies et de la mise en forme en répliques théâtrales, cette scène est une reprise textuelle de leur source, Indiens en bleu de travail de Jaime de Angulo (c’est lui le « doc ») : je reprends ici la traduction française de ce texte, Op. cit., p. 74.[↩]
- Traduction possible de « separate country », formule qui donne son titre à la somme de Berg sur le sujet (Reinhabiting a Separate Country, Op. cit.) : par celle-ci, il met l’accent non sur un séparatisme politique de cette région, encore moins sur une (impossible) absence de liens écologiques entre elle et celles qui l’environnent, mais simplement sur son caractère unique et non réductible au reste des États-Unis.[↩]
- Reinhabitory Theater archives, © Ocean Berg, ma traduction.[↩]
- L’exemple est cité par Eve Tuck et K. Wayne Yang dans La Décolonisation n’est pas une métaphore, Sète, Rot-Bo-Krik, 2022, p. 15.[↩]
- Berg, art. cit., p. 190. Je traduis.[↩]
- Ibid, p. 187.[↩]
- Une synthèse sur les pratiques d’incarnation d’animaux par les humains (qui idéalement intégrerait les pratiques populaires comme le carnaval ou le cirque, voire des pratiques rituelles) reste à écrire : on trouvera des pistes dans le dossier « Bestiaire » in Théâtre/Public, n°43 (1982) ; le dossier « Animaux en scène » dirigé par Hélène Jacques in Jeu (n°130 (1), 2009) ; et plus récemment, pour la France, dans Ignacio Ramos-Gay (dir.), La Ménagerie théâtrale. Écrire, incarner, mettre en scène l’animal en France (xviiie–xxie siècles), Paris, Classiques Garnier, 2023. Pour s’en tenir au xxe siècle, l’« incorporation animale » est un exercice incontournable de l’Actors Studio et, partant, d’une bonne partie de la tradition d’actorat américaine depuis les années 1950 — mais en général seulement à titre d’exercice, et non dans la perspective d’un changement de cosmologies. cf. Ivan Magrin-Chagnolleau, « L’incorporation animale chez l’acteur », p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e, 2, p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org/?page_id=1989, dernière consultation le 21 avril 2023. En France, on la rencontre principalement dans la méthode de Jacques Lecoq — mais là encore, comme étape de travail et non comme fin en soi.[↩]
- Judy Goldhaft, communication personnelle, 15 novembre 2021. Je traduis.[↩][↩]
- Salz, art. cit.[↩]
- Ibid. Cette pratique, à la lisière du théâtre–éducation ou du théâtre–forum, a d’ailleurs survécu à la troupe du Reinhabitory Theater : au cours des années 1990, lors des « Timber Wars » qui opposèrent bûcherons et militants écologistes au Nord-Ouest des États-Unis, des habitants de Petrolia (Californie) s’en servirent dans une démarche de médiation avec les bûcherons (je remercie Paolo Stuppia pour cette information).[↩]
- cf. la jeune Fédération des Festivals de Théâtre de Proximité, federationdesfestivals-tp.com (dernière consultation en février 2023).[↩]
- Aude Astier, « Jusqu’au “bout du chemin” : poursuivre la décentralisation au prisme de l’urgence écologique », in Sermon (dir.), Op. cit, p. 50.[↩]
- Lynn T. White, Les Racines historiques de notre crise écologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2019 (1967).[↩]
- Fabrice Mouthon, Le Sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Age, Paris, La Découverte, 2017, p. 35 et suivantes.[↩]
- Charles Stépanoff, L’Animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage, Paris, La Découverte, 2021, pp. 69-70.[↩]
- Ibid, p. 63.[↩]
- Mouthon, Op. cit., p. 40.[↩]
- Claude Lecouteux, Démons et génies du terroir au Moyen Age, Paris, Imago, 1995.[↩]
- Pierre Dubois, La Grande Encyclopédie des lutins, Paris, Hoëbeke, 1992 ; La Grande Encyclopédie des fées, Ibid., 1996 ; La Grande Encyclopédie des elfes, Ibid., 2003.[↩]
- Alessandro Pignocchi, La Recomposition des mondes, Paris, Seuil, 2019. D’une manière générale, toute l’œuvre récente de Pignocchi — elle aussi non dépourvue de puissance comique — peut se lire comme une contribution à l’élaboration de cosmologies multispécistes post–modernes : cf. les trois volumes du Petit traité d’écologie sauvage, réunis en coffret chez Steinkis en 2022, ou encore, avec Philippe Descola, Ethnographies des mondes à venir (Paris, Seuil, 2022).[↩]







