Un livret numérique de cet article à imprimer soi-même est disponible ici.
Face aux désastres écologiques, l’idée de planification renaît avec la « planification écologique ». Inscrite dans le programme de la France Insoumise en 2017 et en 2022 puis dans celui de la NUPES en 2022, elle est devenue un marqueur pour une gauche opposée à « l’écologie de marché ».
Elle est aussi l’étendard d’ingénieurs, regroupés notamment dans le Shift Project, présidé par Jean-Marc Jancovici : « La crise est une occasion unique de mettre la résilience et le climat au cœur de la relance, et c’est l’objectif que se fixe le Shift par ce projet audacieux de planification de la transition »1. Telle est la vision globale du Plan de transformation du Shift Project. Relance, résilience, transition.
Enfin, Emmanuel Macron a annoncé une planification écologique pour affronter « le combat du siècle » et en faire une « politique des politiques ». Imposture diront certains. La planification n’est pourtant pas du seul registre de pensée de gauche, comme le montre son histoire.
Initiée en URSS avec le Gosplan et le premier plan quinquennal de 1929, la planification semblait enterrée sous les ruines industrielles soviétiques, dont l’ampleur, à elle seule, exprime les souffrances infligées aux humains et à la Terre. Le Plan impératif et vertical, organisant l’équilibre entre besoins et production, opposé à « l’anarchie du marché », s’était officiellement écroulé. C’étaient les années 1980. Place alors aux simplifications et à la fiction d’un Grand Marché, censé produire spontanément l’équilibre économique par le jeu du système des prix. Inspirés par le génie néolibéral de Milton Friedman et des Chicago Boys, les maîtres de la planification soviétique s’en sont emparés et ont poursuivi, sans états d’âme, une économie de rente et de prédation, cette fois en partie au grand jour et au nom de la libre entreprise.
Une autre voie, celle de la planification « indicative » qui avait vu le jour après 1945, notamment en France, pour reconstruire l’industrie et la moderniser, fut également abandonnée dans les années 1970. L’essoufflement tangible de la croissance industrielle, la primauté donnée alors au capital financier et à sa restructuration, les options néo-libérales, auxquelles se sont ralliés les courants majoritaires de la social-démocratie, ont eu raison des plans quinquennaux. La planification relevait de l’irrationnel, de la transgression des « lois » économiques.
Le retour en grâce du Plan se réalise désormais sous les habits de l’impératif écologique et des données scientifiques concernant l’état de la Terre. Cependant, et contrairement aux déclarations du Shift Project, présentant son plan pour la transition comme un outil technique, la planification écologique, dans ses différentes versions, exprime un projet politique ainsi que la nature de nos rapports à la Terre et aux mondes terrestres qu’elle abrite.
Pour démêler ces enjeux, il est instructif d’aller voir du côté des années 1930. À côté de la planification soviétique et face à la crise capitaliste et industrielle, a émergé un courant « planiste », puisant à plusieurs sources politiques et philosophiques, avec notamment un « planisme des ingénieurs ». Le plan était alors au centre des débats et controverses entre planistes d’un côté et penseurs du néolibéralisme – F. Hayek, L.Von Mises, W. Lippman – de l’autre, même si, au-delà de leurs divergences, ces deux philosophies et visions économiques, nous le verrons, s’accordaient sur les bienfaits de la société industrielle et sur la nécessité d’un pouvoir des experts pour en gérer la complexité.
Dans quelles eaux navigue donc la planification écologique ? Les catastrophes en cours ne peuvent être affrontées par simple addition de gestes individuels, aussi nécessaires soient-ils, ou par pollinisation progressive d’alternatives écologistes radicales. Dans ces conditions, quels types de coordination et de processus sont requis, d’abord pour définir collectivement et démocratiquement des caps et des directions, et ensuite pour les mettre en œuvre ?
Le retour d’une Planification « socialiste » ?
Pour mieux cerner la proposition de la gauche pour une planification écologique, accordons nous un retour sur la planification socialiste. Dès le début des années 1920 et avant que n’émerge un courant « planiste » à proprement parler dans les pays capitalistes, la planification socialiste et les calculs pour l’élaborer furent débattus à Vienne. Ce fut la célèbre controverse du « calcul socialiste », notamment entre d’un côté les économistes Otto Neurath et Karl Polanyi, proches de l’austro-marxisme, et de l’autre le libéral Ludwig Von Mises, professeur de Friedrich Hayek et l’un des fondateurs en 1947 de la Société du Mont Pèlerin.
L’opposition aux socialistes, venue de l’école néo-classique et libérale autrichienne représentée par Von Mises, a porté sur le Plan et sur les modalités du calcul préconisées. Selon ces libéraux, opposés à la planification, le Marché permet un gouvernement optimal par les prix, considérés comme moyen d’ajustement et de coordination des décisions prises par une multitude d’individus. Ainsi, la liberté de marché est la seule garantie de l’équilibre entre l’offre et la demande ainsi que de la liberté politique. À l’opposé de Von Mises, l’économiste Otto Neurath défendit l’idée socialiste du Plan, fort de son expérience d’une économie de guerre et du « plan de socialisation » qu’il avait élaboré pour l’éphémère République spartakiste des Conseils de Bavière en 1919. Selon lui, la planification devait être réalisée in natura, c’est-à-dire en quantités physiques, car la mesure en monnaie, exprimée par les prix de marché, ne permet pas d’obtenir des informations adéquates sur le bien-être matériel des consommateurs ou sur le bilan réel d’une décision donnée. L’économie de guerre, pensait-il à l’instar de nombreux marxistes, avait accéléré une socialisation du capitalisme, déjà entamée avec la constitution des trusts et des cartels, dirigés par des bureaucrates et des planificateurs. Elle était un prélude à une économie socialiste. Ainsi, l’urgence était à l’organisation des structures économiques sous une autorité centrale, afin de rationaliser l’utilisation des ressources, d’améliorer les conditions de vie des travailleurs et de sortir du cycle des crises capitalistes. Le plan serait élaboré à l’aide des informations données, non plus par le système des prix de marché, mais par les statistiques, qu’il vénérait comme composantes essentielles de l’ordre socialiste. La comptabilité in natura, fondée sur les valeurs d’usage au lieu des valeurs d’échange, lui vaut d’être considéré parfois comme un précurseur d’une planification écologique, en particulier par certains courants écosocialistes2.
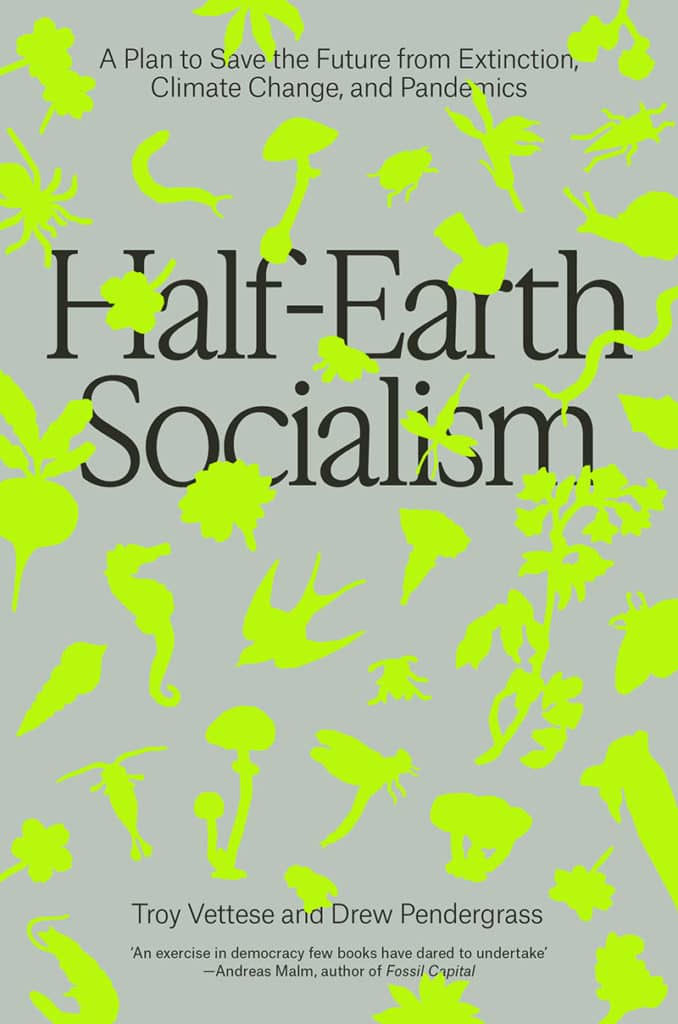
Le socialisme d’Otto Neurath était pourtant imprégné du scientisme du Cercle de Vienne, dont il fut un membre parmi les plus actifs et éminents. Il y défendait alors une science positiviste unifiée, capable de régler les problèmes de la vie économique et sociale. En faisant du calcul socialiste la base d’une utopie constructiviste, d’une organisation rationnelle de la production, il a cédé à un rationalisme aride et désincarné.
La perspective de Karl Polanyi était différente en ce qu’elle articulait une critique du socialisme centralisé et de la concentration industrielle à grande échelle. Sa tentative – confuse – d’élaboration d’une « comptabilité socialiste », le conduisit à une critique de la planification soviétique et de son identification au socialisme : « Par crainte de rester enlisé dans la conception fétichiste de l’économie politique classique, laquelle voit dans les “marchandises” la richesse d’une société, la conception d’une économie dirigée tombe aisément dans l’attitude extrême et erronée du naturalisme grossier pour lequel l’économie ne se compose que d’objets tangibles, machines, matières premières. »3 Ainsi l’économie dirigée a oublié les besoins humains, la souffrance au travail. Karl Polanyi conteste donc l’inspiration saint-simonienne d’un gouvernement comme « gouvernement des choses » et souligne l’oubli du travail vivant, concret, écrasé par la planification soviétique. Il défendait un socialisme décentralisé, avec un marché non pas supprimé mais encastré dans la société, soumis aux besoins des humains et de la Terre. Sa réflexion, nourrie par son exil en Angleterre dans les années 1930, était inspirée du socialisme associationniste plutôt que du socialisme célébrant le plan et le productivisme soviétique.
Ludwig Von Mises a toutefois trouvé un écho parmi les « socialistes de marché » comme Oscar Lange, qui estimait pour sa part qu’un conseil de planification était finalement l’équivalent du « commissaire priseur » du modèle néo-classique d’équilibre du marché4. Ainsi la planification consisterait à trouver une solution mathématique à l’équilibre économique. Friedrich Hayek, défenseur du marché, fut à ce propos plus lucide : le marché est pour lui un organisme complexe, irréductible à la vision mécanique de l’équilibre général des économistes néo-classiques. Il n’est pas principalement un mécanisme d’échange de biens mais d’échange d’information. Un conseil de planification ne pourrait résoudre tous les calculs car des informations essentielles, étrangères au planificateur, se dégagent des marchés et contribuent à l’équilibre.
Le calcul socialiste fut par la suite un serpent de mer dans l’Union soviétique et ses satellites. Lorsqu’il s’est agi de réformer le Gosplan, il fut sophistiqué par nombre de scientifiques, venus du calcul statistique, de la programmation linéaire ou de la cybernétique. Sans succès. Les problèmes étaient d’un autre ordre.
Près d’un siècle plus tard, du côté de la gauche, les impasses de la société techno-industrielle restent en partie les angles morts de la planification écologique.
Geneviève Azam
Près d’un siècle plus tard, du côté de la gauche, les impasses de la société techno-industrielle restent en partie les angles morts de la planification écologique. Une part de la gauche « anti-libérale », toujours sensible aux arguments prométhéens et aux vertus de l’État modernisateur, entend rompre avec le capitalisme vert et l’écologie de marché grâce à un système techno-économique étatisé, celui du nucléaire, de l’intelligence artificielle, de l’exploitation spatiale ou de la conquête des océans. Dans ce cas, la planification écologique consisterait davantage en un renforcement de l’État pour administrer la catastrophe écologique qu’en une bifurcation.
Dans une version plus écologiste, voire non productiviste, la planification écologique préconisée s’articule clairement avec le refus du nucléaire, public ou privé, le refus des plans de pilotage technique de la planète et l’affirmation du choix démocratique décentralisé de « Ce qui compte », exprimé en terme de besoins5. Pourtant, comme dans les années 1920, cette planification pourrait bien achopper sur le « Comment compter », qui n’est pas seulement un sujet technique. Plusieurs propositions, en effet, misent sur les nouvelles possibilités de la cybernétique et des big data pour surmonter les difficultés du calcul socialiste et organiser au mieux les interactions entre la nature et les sociétés, grâce à un surcroît d’information, de capacités de calcul et de connaissance. Cette thèse, défendue en particulier par les écosocialistes Troy Vettese et Drew Pendergrass6, inspirée par Neurath notamment, est également défendue par des économistes de la mouvance des Insoumis.
« Les informations produites à flux continu par l’ensemble des acteurs économiques, recueillies par les systèmes des big data, permettraient de connaître les préférences d’un grand nombre de consommateurs quasi instantanément, sans passer par le système des prix »7, à condition, ajoutent Durand et Keucheyan, que ces informations soient « socialisées, placées sous contrôle démocratique et réorientées vers l’utilité sociale. »8 Une des failles majeures de la planification soviétique, soulignée par Hayek, serait ainsi dépassée.
Ces propositions expriment-elles une foi progressiste dans la technologie, au nom cette fois d’une écologie radicale – qui ignorerait les critiques de la neutralité de la technique – et/ou le retour du « calcul socialiste », nécessaire pour élaborer un Plan central ? Pourtant, comme l’écrit ailleurs l’un des auteurs9, les big data ne sont pas neutres. C’est justement pourquoi, socialisées ou privées, elles mettent en œuvre une raison calculante, un gouvernement par les chiffres, et la construction de citoyens-consommateurs abstraits, standardisés (malgré l’apparence de diversité) et au final « extra-terrestres ». Ces technologies annihilent ainsi la possibilité d’ingérence ou d’autonomie de la part des travailleurs, des consommateurs, des citoyens, face aux dirigeants et bureaucrates, prétendant tout prévoir, calculer et planifier en flux tendu, qui savent ce qui compte et comment le compter. Voir dans ces techniques, même socialisées, un moyen puissant pour élaborer un plan central, équilibrant l’offre et la demande globale, laisserait finalement entendre que les limites du plan central et du calcul seraient d’ordre technique, une fois l’État décentralisé et démocratisé.
Le planisme des années 1920-1930 ou le gouvernement des experts
Les années 1920 et 1930 ne furent pas seulement celles du Gosplan. Le choc du passage à des sociétés industrielles de masse, particulièrement sensible à la fin du XIXème siècle, ainsi que les expériences de planification du ravitaillement pendant la première guerre mondiale, l’effondrement des économies libérales avec la crise de 1929 et les interrogations sur « la fin du capitalisme », ont donné naissance, à l’extérieur de la sphère soviétique, à un courant planiste.
La doctrine planiste fut représentée par Henri de Man, dirigeant du Parti Ouvrier Belge. Venu des courants de gauche de ce parti, sa pensée connut une inflexion après la première guerre, lors d’un séjour aux États-Unis. Il y fut séduit par les idées technocratiques naissantes, par le Human Engineering, par le taylorisme et la nouvelle organisation « rationnelle » du travail. Selon ce mouvement technocratique « progressiste », seul un gouvernement de techniciens et ingénieurs serait apte à diriger une économie industrielle centralisée, de manière « apolitique » et selon les règles de la rationalité et de la rigueur scientifique. Thorstein Veblen, plus connu pour La théorie de la classe des loisirs, en fut un des inspirateurs avec son ouvrage The Engineers and the Price System (Les ingénieurs et le capitalisme)10. Imprégné du saint-simonisme, il préconise la prise de pouvoir par un « soviet des ingénieurs »11 capable de dépasser le régime des propriétaires absentéistes et de promouvoir l’industrie. Le management scientifique fascinait aussi, il est vrai, les élites communistes, de Lénine à Trotsky, jusqu’à Gramsci, convaincu de « la nécessité que le monde entier soit comme une seule et immense usine, organisée avec la même précision, la même méthode »12.

Passionné par la psychologie sociale13 comme stratégie du gouvernement des masses, Henri de Man en déduisit la nécessité d’une élite prenant en charge l’émancipation des travailleurs. En 1922, il rejoignit l’Allemagne, où il enseigna à Francfort la psychologie sociale jusqu’en 1932. La publication en 1927 de son ouvrage Au-delà du marxisme lui valut l’intérêt de ceux qui rejetaient le déterminisme économique du marxisme. Cependant, l’abandon de la lutte des classes l’éloigna de nombre d’entre eux, notamment de l’École de Francfort.
De retour en Belgique, de Man fut nommé directeur du Bureau d’études sociales du Parti et responsable du « Plan du travail ». Il entendait rompre avec le marxisme dans sa dimension internationaliste et collectiviste et défendait une stratégie intermédiaire entre réforme et révolution, le planisme. Avec au programme, la création d’un secteur public, la socialisation du capital financier, du crédit, des monopoles et des grandes propriétés foncières.
De Man en vint à considérer l’organisation d’une société guidée par « l’idée socialiste » comme une question technique. Sa direction incomberait aux experts, à une élite clairvoyante, qui, marque de l’époque, saurait s’attaquer au capitalisme parasitaire, dont les juifs seraient les maîtres. Passé au service du roi Léopold en 1940 après sa capitulation sans condition face à l’invasion nazie, il fonda un syndicat, l’Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels (UTMI), prémices d’un socialisme national organisé comme un État corporatiste. Son glissement vers le fascisme n’est pas un accident. D’autres planistes proches, tel Paul Henri Spaak, futur fondateur de la Communauté européenne, choisirent la résistance en 1940.
En France, le planisme fut repris par un courant politique dissident de la SFIO, incarné par le futur collaborationniste Marcel Déat. Ces « néo-socialistes » soutenaient l’idée d’un régime intermédiaire entre capitalisme et socialisme, avec pour devise : « Ordre, autorité et Nation ». Le pouvoir y serait donné à des techniciens. Un colloque des groupes planistes fut organisé en l’abbaye de Pontigny en 1934, en compagnie d’intellectuels « non-conformistes » comme Bertrand de Jouvenel, pionnier de la prospective et rêvant d’un État fort, libéré des contraintes parlementaires et dirigé par les savants. Ce planisme conduit à l’abandon de l’idéal de démocratie économique au profit de directions d’experts, seules aptes à poursuivre un projet d’industrialisation massive et à faire face à des situations inédites. Il s’accompagnait d’une critique ouverte ou larvée du parlementarisme et plus largement de la démocratie. Ainsi, conformément à sa visée de « modernisation » des structures économiques et d’« aménagement » du territoire national, le gouvernement de Vichy fit une place importante aux planistes ayant choisi de le rejoindre. Il multiplia le nombre des statisticiens avec la création du Service National des Statistiques en 1941.
Ces courants planistes et les débats qu’ils ont suscité ont été en partie oubliés. Pourtant, le planisme fut la cible de Hayek dans La route de la servitude (1943), ainsi que celle des néo-libéraux de toute obédience, réunis à l’occasion du Colloque Walter Lippman à Paris en 1938. Les économistes ont plutôt retenu de ce courant l’opposition à la macro-économie keynésienne, de ce fait, souvent confondue avec la planification. Or, si Keynes a ouvert une brèche définitive dans la pensée orthodoxe et la vulgate libérale de la main invisible et de l’auto-régulation du Marché, il n’était ni dirigiste, ni anti-libéral, ni même socialiste. Inspiré par Freud, le Marché selon Keynes, loin de constituer un mécanisme rationnel, est un marché-foule, fait de spéculation, de mimétisme et de fantasme d’accumulation. Il doit être régulé par l’intervention de l’État. À rebours des conceptions planistes, sa théorie est fondée sur le postulat de l’incertitude radicale : le futur est non mesurable, non probabilisable et non calculable ; l’idée de lois en économie est pure fantaisie. Ainsi, le Green New Deal, aujourd’hui au programme de la gauche aux États-Unis, préconise des politiques keynésiennes écologisées et non un plan central de direction de l’économie.
Cependant, si les planistes ont été fustigés par les néo-libéraux dans les années 1930 et après, ils se rejoignent pour préconiser un gouvernement d’experts. Pour les ordo-libéraux, l’ordre passe par une Constitution économique, approuvée par le peuple, qui régira le système économique selon des normes ayant une valeur juridique structurante et supérieure à la loi ordinaire. Pour Hayek, le marché produit du savoir, contrairement aux autres institutions, et il revient aux économistes de le diffuser et de le traduire en lois. Économistes qui connurent leur heure de gloire à l’apogée du néolibéralisme dans les années 1980-1990. À l’heure de la débâcle néo-libérale et de sa radicalisation, de la flambée des menaces et des incertitudes, les options planistes refont surface.
Le planisme des ingénieurs : du groupe X-Crise des années 1930 au Shift Project
Dans le contexte trouble de ces années 1930, des groupes de techniciens et ingénieurs revendiquèrent un « planisme des ingénieurs », seul capable de formuler des « solutions » à la crise et de moderniser le capitalisme. Le plus fameux, le groupe X-Crise, fut fondé en 1931 à l’École Polytechnique. Le Centre Polytechnicien d’Études Économiques (CPEE, créé en 1933), fut un lieu de rencontre entre ingénieurs et personnalités politiques. Jean Coutrot, membre de X-Crise et un des fondateurs de ce Centre, y exposa sa vision d’une humanité organisée comme une entreprise, rationalisée de manière à faire advenir un type humain supérieur, l’homme intégral. Le groupe X-Crise fut divisé par la guerre : certains de ses membres se sont engagés dans la résistance active et d’autres ont participé au gouvernement de Vichy, où « les modernisateurs » occupèrent des postes-clé. Dans l’après-guerre, les « planistes » de Vichy ont quitté la scène politique mais leurs réseaux ont irrigué la haute fonction publique. L’idée du « plan » comme voie intermédiaire entre socialisme et libéralisme, comme contrôle rationnel du capitalisme ne fut pas abandonnée. Elle a inspiré les technocrates dans leur « modernisation » de l’État.
Après 1945, l’analyse de la technocratie s’est diffusée avec James Burnham14. Il voyait l’irruption de l’ère technocratique comme la naissance d’une nouvelle forme de société, ni capitaliste, ni socialiste. La philosophe Simone Weil, au contraire, l’analysait lucidement, et dès les années 1930, comme une forme du capitalisme et comme l’expression d’une nouvelle oppression : « Les technocrates américains ont tracé un tableau enchanteur d’une société où, le marché étant supprimé, les techniciens se trouveraient tout-puissants, et useraient de leur puissance de manière à donner à tous le plus de loisir et de bien-être possible. Cette conception rappelle, par son caractère utopique, celle du despotisme éclairé chère à nos pères. Toute puissance exclusive et non contrôlée devient oppressive aux mains de ceux qui en détiennent le monopole. Et dès à présent l’on voit fort bien comment se dessine, à l’intérieur même du système capitaliste, l’action oppressive de cette couche sociale nouvelle »15.
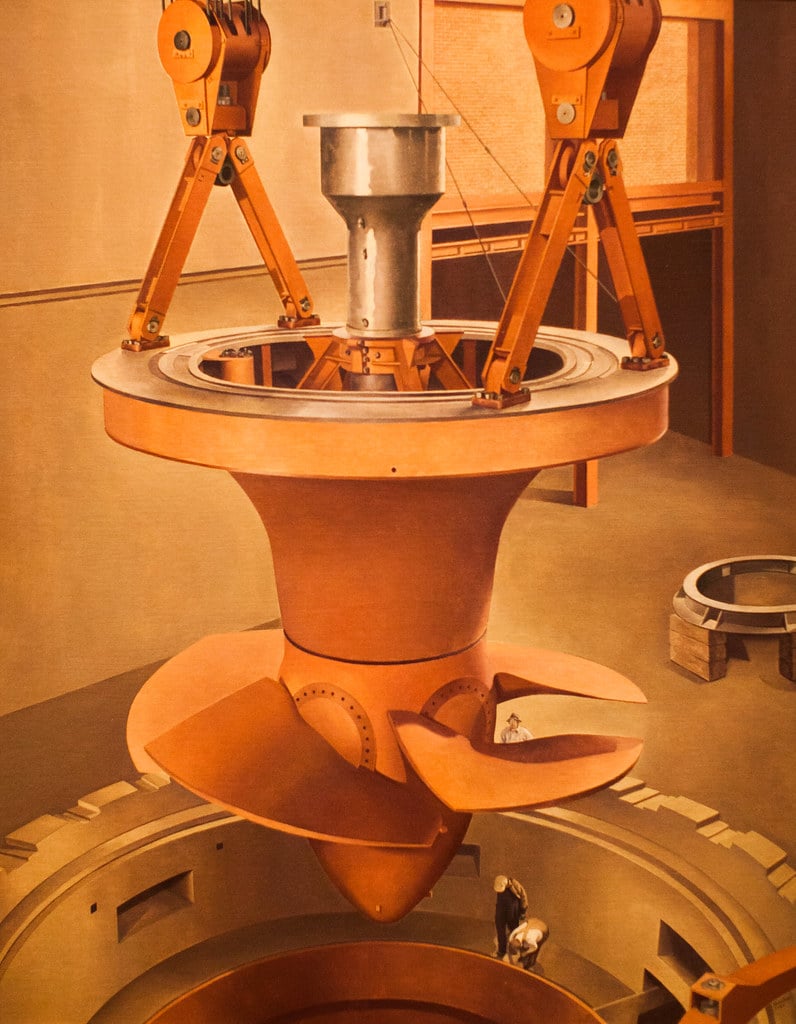
Ce détour par les années 1930 inscrit l’émergence du club d’ingénieurs et gestionnaires du Shift Project, dirigé par Jean-Marc Jancovici, dans le bégaiement d’une histoire plus longue. Tout est consigné dans son plan de transformation de l’économie française16. L’électrification générale : tel est le projet féerique pour « Un monde sans fin »17. Un monde sans rapports sociaux particuliers, un mécanisme sans frottement, un monde de « nous » indifférenciés. Je ne discuterai pas ici du catalogue des propositions par secteurs, des choix et des données utilisées18. C’est l’avant-propos, rédigé par Jancovici, ainsi que son « mot de la fin » qui ont retenu mon attention et m’ont replongée dans les années 1930 et la musique du fameux « ni-ni » : « Notre plan n’est ni croissantiste, ni décroissantiste. Il se situe sur un autre terrain »19, peut-on lire dans l’avant-propos. Alors, quel est ce terrain ? La décarbonation planifiée de tous les secteurs de l’économie française. Un terrain « positif », en lieu et place d’une écologie punitive, pour « Concilier sobriété et capitalisme ».
L’électrification générale : tel est le projet féerique de Jean-Marc Jancovici. Un monde sans rapports sociaux particuliers, un mécanisme sans frottement, un monde de « nous » indifférenciés.
Geneviève Azam
Le Plan du Shift Project est un plan chiffré en flux physiques avec UN objectif, la décarbonation nationale, UNE variable de décarbonation, les énergies fossiles, UNE unité de mesure, le CO₂ émis ou « évité », UNE méthode, un plan réalisé selon les principes réductionnistes de l’optimisation économique sous contrainte, la contrainte étant ici physique. Le fait que les désastres écologiques, irréductibles au seul CO₂, soient le produit de nombreux facteurs enchevêtrés et interdépendants n’entre pas dans ce modèle. La mesure unique (CO₂) est un équivalent général qui assure le passage du qualitatif au quantitatif et unifie le monde. Un Plan donnant une direction commune à des acteurs devant actionner la machine en même temps : « Qu’un seul engrenage se grippe, et tout le système resterait bloqué »20. Gare donc à tous les grains de sable qui viendraient détraquer ce merveilleux mécanisme automatique ! Il en va de la grandeur de la France, une Nation sachant combiner « raison et audace ». Voilà donc un Plan National, bouclé sur lui-même, la comptabilité physique jancovicienne ignorant la quantification des matériaux nécessaires à la Grande électrification et la dépendance vis-à-vis de ces matériaux. Un Plan porté par un groupe d’ingénieurs, qui saura naviguer, tenir la barre et « embarquer tous les citoyens dans un imaginaire commun », qui saura les accompagner, eux qui restent prisonniers d’un « cerveau primitif », animaux grégaires animés d’un désir de toujours plus : « Nous sommes câblés pour en vouloir plus et pas moins (…). Il n’y a rien d’étonnant à cela : c’est juste le résultat de l’évolution »21. C’est « le monde sans fin », doté d’une énergie potentiellement illimitée – l’énergie atomique et la fée électricité.
Cette démarche charrie les préjugés, les simplifications et idéologies nous ayant conduits au désastre écologique, à la dépolitisation de ses enjeux et à une expertocratie dévorante. Jusqu’à ses saillies sexistes et l’emprunt à des approches de l’évolution les plus idéologiques et réactionnaires.
Face à ce ratissage de la pensée, les appels collectifs d’ingénieur·es à déserter et refuser de servir le techno-monde ou bien à discuter le modèle de l’ingénieur et de l’ingénierie prennent tout leur sens. Ils ne relèvent pas d’un caprice de nantis : ils touchent au cœur même de ce qui fait tenir la machine techno-industrielle.
Plan et Marché ou la gestion « rationnelle » du capitalisme industriel
Le choix binaire, Plan ou Marché, met en scène une opposition irréductible entre deux fictions avec majuscules, éliminant toute autre forme d’organisation. Seront passées sous silence aussi bien le caractère illusoire d’un marché spontané et horizontal qui surgirait naturellement de la libération des forces économiques que celui d’une planification verticale et impérative, qui, dans les faits, n’a pu s’imposer durablement que par le recours à des improvisations, des relations horizontales, non déclarées, informelles, remplissant souvent des fonctions vitales pour la subsistance de la société et s’apparentant à des marchés concrets. Relations informelles qui ont aussi alimenté les réseaux structurés d’une économie souterraine et mafieuse. Ainsi seront ignorées les autres formes d’organisation, marchandes ou non marchandes, décentralisées, coopératives ou communales, tout comme celles qui ne font pas de l’accumulation le cœur de la présence au monde.
Cette représentation duale a nourri la construction d’un monde bipolaire, divisé entre des sociétés à économie dirigée par l’État, planifiées et des sociétés capitalistes à économie de Marché. Elle fut particulièrement active pendant la guerre froide. Elle s’alimente tout autant de la croyance libérale en un Marché naturel, inconscient, un Marché sans État, que des critiques venues souvent d’un marxisme sommaire, qualifiant le Marché de « sauvage », « anarchique » et le jugeant opposé à l’État. Quand Hayek vénérait le caractère inconscient, neutre et harmonisateur du marché dans un système économique spontanément auto-organisé, les planificateurs socialistes entendaient remplacer ce processus par un plan conscient et scientifique de contrôle socialiste de l’économie. La main invisible du Marché remplacée par la main visible de l’État. Le Plan devient alors l’alternative au Marché – et vice-versa. Incompatible avec le capitalisme – assimilé au marché –, il résumerait la transition, le passage au socialisme.
Adhérer à une telle vision était aller très vite en besogne. Précocement, dès les années 1920-1930, la nature « socialiste » de l’économie et de la société soviétique fut en effet contestée. Ses opposantes et opposants, conseillistes ou libertaires, l’ont très tôt analysé comme une forme de capitalisme d’État, empruntant les voies de la rationalisation technicienne et de l’efficacité capitaliste22.
Du côté des pays capitalistes de marché, loin de s’opposer, Plan et Marché ont cheminé de conserve après la seconde guerre mondiale. En France, le mouvement planiste a laissé des traces au sein d’une nouvelle génération de hauts fonctionnaires, née de la Résistance et de réseaux vichystes. Elle a inspiré une planification « indicative »23 qui se donnait pour objectif de reconstruire et « moderniser » l’appareil industriel. « Modernisation ou décadence », telle était la formule de Jean Monnet, membre des Commissions interalliées du ravitaillement pendant les deux guerres mondiales, négociateur du Plan Marshall, commissaire au Plan en France de 1946 à 1952 et l’un des fondateurs en 1957 de la CEE, la Communauté économique européenne. Cette stratégie s’est appuyée sur trois leviers essentiels : les nationalisations, la recherche et les statistiques, le Plan. Magistralement analysée par François Fourquet24 au début des années 1980, elle visait à la conquête par l’État de la direction de l’économie dans un but de puissance nationale. Avec, en son centre, la croissance industrielle. « La bataille de la production » s’écrit sur tous les murs, jusqu’à ceux du puissant Parti communiste qui, en 1945, en faisait la forme la plus élevée du devoir de classe. Ainsi le premier plan (1946-1952), centré sur six secteurs de base (charbon, électricité, ciment, machinisme agricole, transport et acier) fit consensus et fut efficacement exécuté. Les plans suivants avaient pour but majeur de consolider l’armature industrielle de la France et de construire des équipements collectifs.

Jusqu’au milieu des années 1970, la planification indicative fut un outil majeur de la concentration du capitalisme industriel et de l’enrôlement du travail dans le processus d’expansion. Suite à la crise de ce capitalisme industriel, elle fut attaquée par les néolibéraux qui entendaient lever les « obstacles » à la croissance en adaptant les institutions à un capitalisme financiarisé et globalisé. Loin de « laisser faire » et de sanctifier « l’anarchie du marché », les coalitions néolibérales engagèrent les États dans une remise en ordre des institutions monétaires et financières, en les libérant du pouvoir politique. Jusqu’à tenter de constitutionnaliser l’économie de marché, conformément à l’ordo-libéralisme d’inspiration allemande, qui s’est notamment exprimé dans le projet de la Constitution européenne, refusé en France en 2005, et recyclé dans le Traité de Lisbonne en 2007. Les néolibéraux d’inspiration anglo-saxonne, fidèles aux enseignements d’Hayek, ne furent pas en reste. Tout en sanctifiant le marché comme ordre spontané, ils préconisaient une armature juridique solide afin de lui permettre de coordonner efficacement les activités. Hayek écrivait en 1943: « Il est important de ne pas confondre l’opposition à cette sorte de planisme avec une attitude de laissez faire dogmatique »25. En d’autres termes, « on ne peut combiner planisme et concurrence, qu’en faisant des plans pour la concurrence, mais non pas contre elle »26.
À l’heure du dépassement des limites terrestres, des incapacités humaines à prévoir et même imaginer les forces soulevées par les dérèglements écologiques, la planification écologique est une déclaration de puissance et de reprise en main.
Geneviève Azam
« Des plans pour la concurrence » : la leçon est entendue au moment où le chaos écologique remet au devant de la scène la matérialité de l’économie, les infrastructures industrielles et la logistique. L’impératif de modernisation s’accélère et se déplace. Il prend la forme d’un Plan de décarbonation pour atteindre « les objectifs de neutralité carbone en 2050 » grâce à une écologie industrielle de marché. À l’heure du dépassement des limites terrestres, des incapacités humaines à prévoir et même imaginer les forces soulevées par les dérèglements écologiques, la planification écologique est une déclaration de puissance et de reprise en main. Il s’agit de se saisir du choc climatique pour « rationaliser », « moderniser », « décarbonner » le capitalisme et lui donner une nouvelle respiration.
Il s’agit aussi d’une tentative de planification et de pilotage du « système Terre », afin de le rendre compatible avec les exigences de la civilisation industrielle et du capitalisme. Pour la Terre, le « laissez-faire » est proscrit. Intervention massive, forçage, domestication, humanisation, traque du « sauvage » et du « nuisible », géo-ingénierie : la maîtrise « rationnelle » de la nature est soumission des milieux de vie terrestres, humains et autres qu’humains, aux mouvements alliés du capital et de la technique. Le « laissez-faire » écologique fut également proscrit par les planificateurs soviétiques, bravant les conceptions « bourgeoises » de la Nature et n’hésitant pas à sacrifier l’agriculture pour l’industrie lourde, à détourner des fleuves pour irriguer des terres sablonneuses, comme il l’est aujourd’hui par les planificateurs chinois qui entendent piloter la pluie avec les outils de la géo-ingénierie. Cet acharnement dominateur a produit les désastres présents, qui, loin d’être assumés comme l’échec concret et avéré de ce délire de maîtrise, produisent à la fois une honte prométhéenne27, dirait Günther Anders, et du ressentiment. Ils accélèrent la volonté de puissance et les projets virilistes d’extraction, de manipulation, de profanation de la Terre.
Les chemins pour une dé-planification techno-industrielle
Le Plan – comme le Marché – n’est pas un outil technique et encore moins un outil neutre. La planification de la transition a une histoire. Elle fut hier celle du passage du capitalisme au « socialisme des soviets plus l’électricité », selon la formule de Lénine. Elle fut aussi celle du passage du « sous-développement au développement » dans les pays du Tiers-Monde inspirés par la planification soviétique, comme le fut l’Algérie par exemple, qui n’en finit pas de panser les blessures des « industries industrialisantes ». Celle de la modernisation des intouchables « Trente Glorieuses », racontée par les modernisateurs et aujourd’hui revisitées à la lumière de leurs conséquences écologiques et sociales28. Elle est aujourd’hui celle du passage du « capitalisme carboné au capitalisme décarboné ». De la même façon que l’électricité et le système militaro-industriel se sont passés des soviets en Union Soviétique, les planificateurs de l’économie verte et les experts technocrates ne s’encombrent ni de la fiction du marché, ni de la concurrence libre et non faussée, ni de la démocratie parlementaire, ni de la démocratie tout court.
L’histoire de l’État modernisateur et planificateur, accomplie parfois pour le bien des peuples et au nom du « développement », est lourde de misères et de destructions écologiques. L’anthropologue James Scott29 en a étudié plusieurs expériences dans le monde et montré comment elles ont sapé toute créativité sociale et détruit les conditions de vie terrestres, y compris dans les formes plus douces d’une ingénierie sociale de grande ampleur, telle l’expérience de l’État de Tanzanie entre 1973 et 1976.
La planification est indissolublement liée à l’émergence de sociétés industrielles de masse, à la logistique étatique du temps des guerres industrielles, et à la croissance infinie.
Geneviève Azam
Au regard de cette histoire, la planification est indissolublement liée à l’émergence de sociétés industrielles de masse, à la logistique étatique du temps des guerres industrielles, et à la croissance infinie. Elle est orientée vers un futur transparent et maîtrisable, selon un temps progressiste s’écoulant de manière linéaire, un temps abstrait. Elle vise l’ « amélioration ». Or, cette « amélioration » s’est retournée en désastre : alors que devait s’élargir l’horizon des possibles, il ne cesse de se rétracter. Nulle part, avec plus ou moins d’intensité, elle n’a échappé à l’affaiblissement et à la dévalorisation de la démocratie, quand ce ne fut pas sa suppression : « Les environnements étriqués et planifiés, quant à eux, engendrent des populations moins compétentes, moins innovantes et moins ingénieuses. Une fois créé, ce type de populations personnifierait ironiquement exactement le type de matériau humain qui aurait besoin d’une étroite supervision par le haut »30.
Que faire aujourd’hui alors que se déchaîne une guerre globale, menée à plus ou moins bas bruit par un monde armé d’infrastructures et de technologies meurtrières, d’appareils technocratiques, d’industries de la consolation tenant les populations tranquilles, guerre dont l’issue se dessine déjà à coup de catastrophes écologiques, de pandémies, de déchaînements de violences racistes et sexistes, de destructions irréversibles des milieux de vie et des mondes familiers, de guerres militaires ?

Face à ces catastrophes, il n’y a ni réponse unique, ni stratégie unique, ni « front » unique, ni hiérarchie des priorités. Les choix politiques, du local au global, sont confrontés à des temps qui les dépassent, non plus seulement à un incertain radical, celui des sociétés humaines et de leur capacité inventive, mais à un incertain radicalement étranger au temps économique et social, au calcul, fût-il éclairé par les meilleures statistiques. Nous en faisons l’expérience concrète tous les jours. Les rapports entre les choses de l’économie pure se dérèglent car la Terre est active, les « choses » s’animent, tels ces feux qui produisent leurs propres vents. Aucun plan écologique central ne pourra trouver une trajectoire linéaire, connue et « normale », ni s’abstraire de la matérialité de notre condition terrestre, de ses limites et de ses multiples interdépendances. Considérons cette situation comme une bonne nouvelle, tardive mais féconde.
Les expériences sensibles de destructions irréversibles alertent les consciences et la raison. Nous avons en héritage un lourd passé industriel et sa part toxique, souvent irréversible et non maîtrisable, atteint les corps et les esprits. Aucune prospection pour le futur ne peut s’en abstraire. Le temps n’est plus au développement des forces productives et à la socialisation de ses fleurons, mais au désarmement des forces dévastatrices, à la dé-« modernisation », à la décroissance, à « une écologie du démantèlement »31. Prévoir, organiser et coordonner ce désarmement est une contre-histoire de l’État modernisateur et planificateur. Pour pouvoir bifurquer, il faut libérer le terrain et l’horizon et pour y parvenir reconquérir et reconstruire des lieux, des zones et des institutions, elles-mêmes polluées, en les fondant sur la mutualité, la coopération, les communs. Habiter la Terre, c’est aussi habiter un territoire particulier, une géographie voire une bio-région, retrouver des compétences perdues, des savoir-faire essentiels pour une autonomie matérielle. C’est pourquoi l’autonomie politique requise pour une planification démocratique ne peut se résumer à une démocratisation-décentralisation de l’État32.
S’il est un enseignement concret des catastrophes présentes, c’est à la fois notre appartenance à des milieux de vie, tissés d’interdépendances, et à des sociétés complexes, enchevêtrées, minées par le capitalisme jusqu’au niveau le plus local, voire le plus intime. Au lieu de s’en remettre exclusivement à des statistiques globales, de plus en plus sophistiquées et finalement abstraites, soumises à des évènements improbables, de se soumettre à l’ordre des masses et des quantités, faisons aussi confiance à une intelligence sensible, concrète, alliant les savoirs-experts et les savoirs pratiques33 nés de l’expérience, de luttes, d’enquêtes. Des « enquêtes », car « nous ne voulions pas partir de réponses toutes faites », écrit le collectif Reprises de terres34, qui est le nom d’un groupe d’enquête militant engagé pour répondre à la catastrophe foncière.
Le temps n’est plus au développement des forces productives et à la socialisation de ses fleurons, mais au désarmement des forces dévastatrices, à la dé-modernisation, à la décroissance, à une écologie du démantèlement.
Geneviève Azam
La place donnée aux enquêtes pour retrouver une autonomie politique réactualise la pensée de John Dewey, philosophe américain incarnant le courant pragmatiste. Dans les années 1930, il s’est revendiqué de la planification contre Walter Lippmann et les néo-libéraux35 tout en étant opposé à une planification centralisée fondée sur un gouvernement des experts et le calcul mathématique. Il fut conduit à critiquer le New Deal de Roosevelt, non par crainte qu’il contienne les prémisses du bolchévisme à la manière des néolibéraux (!) mais parce qu’il annonçait une forme de capitalisme d’État. John Dewey préconisait un nouvel ordre social dessiné par une planification sociale, décentralisée, testée de manière expérimentale, avec des institutions permettant de libérer une « intelligence sociale coopérative », condition de la démocratie et véritable force pour une société créative et auto-organisée. Il fut cependant, comme d’autres philosophes en ce temps-là, héritier d’une pensée faisant de la production matérielle un joug dont il faudrait se délivrer pour atteindre à la liberté : « Maintenant que le fardeau de la production matérielle ne repose plus sur les muscles et le cerveau de l’homme mais sur la vapeur, l’électricité et les processus chimiques, la réalisation effective de cet idéal est désormais possible. »36 Cet espoir d’une libération de la nécessité par l’abondance matérielle, exprimé également par Keynes dans ses derniers écrits, contient encore celui d’un exil des limites de la condition terrestre. Il fut vivement critiqué dans ces mêmes années par Simone Weil37.
La perspective de la subsistance
C’est pourquoi je conclus en me tournant du côté du « tournant matérialiste » et des perspectives de la subsistance, réactualisées depuis les années 1970 par des féministes allemandes, et depuis, par nombre d’expériences et de réflexions38. Ces chercheuses s’inspirent de Rosa Luxembourg et de son analyse du développement du capitalisme par la destruction de la subsistance : « Ce n’est qu’après avoir détruit la capacité de survie des gens qu’ils deviennent totalement et inconditionnellement soumis au pouvoir du capital »39.
Il s’agit, selon cette perspective empirique, d’une réévaluation des travaux de subsistance, celui des femmes mais aussi des paysan·nes40, des immigré·es et plus généralement de celles et ceux subissant la housewifization41 d’une grande part du travail salarié : « La perspective de la subsistance consiste à regarder le monde par en bas, depuis la vie quotidienne, et non par en haut, depuis les instances de pouvoir qui manipulent l’opinion dans le seul but de se perpétuer »42. Engagées dans le mouvement écologiste, elles font de la subsistance l’expression de la continuité entre les éléments naturels et les humains. Il ne s’agit pas d’une « économie » de la subsistance, d’un nouveau modèle économique, mais bien d’une perspective, d’un processus, engageant une vision et des pratiques, à partir du constat suivant : « Pour les hommes et les femmes qui profitent de la guerre contre la subsistance, la subsistance représente l’arriération, la pauvreté et les corvées. Pour les victimes de cette guerre, elle est synonyme de sécurité, de vie bonne, de liberté, d’autonomie, d’autodétermination, de préservation des moyens d’existence économiques et écologiques et de diversité culturelle et biologique »43.
Si le paysage capitaliste est ravagé, d’autres paysages fragiles se dessinent, articulant la subsistance avec l’autonomie politique. Cependant, des sociétés orientées vers la subsistance ne peuvent éclore spontanément par simple addition d’expériences menées sur les ruines du capitalisme et de la société industrielle. Alors, comment faire ? La perspective de la subsistance n’est pas une « réponse », un outil de remplacement dans le cadre de l’opposition binaire État/Marché. Elle pourrait néanmoins être éclairante et cela reste à explorer. Un tel processus, à l’échelle d’une biorégion par exemple, pourrait s’inaugurer et s’organiser à partir d’expériences concrètes, d’états des lieux, d’une connaissance partagée des multiples interdépendances au sein des milieux de vie, entre régions, entre les peuples du monde. Le soin et la réparation des blessures et dévastations, la prise en compte de la diversité des histoires et des devenirs, l’importance des communs et de leurs institutions, sont constitutifs d’un tel processus. Une perspective de la subsistance suppose de s’affranchir du Marché ou du Plan comme pourvoyeurs de la subsistance.
Notes
- https://theshiftproject.org/article/vision-globale-v1-plan-de-transformation-shift/[↩]
- Serge Audier, 2019, L’âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques, La Découverte. Pour une analyse précise et passionnante du débat entre Neurath, Von Mises et Hayek, voir le livre de Troy Vettese et Drew Pendergrass, Half-Earth Socialism: A Plan to Save the Future from Extinction, Climate Change, and Pandemics, Verso, 2022.[↩]
- Karl Polanyi, « Nouvelles considérations sur notre théorie et notre pratique » (1925), in Essais de Karl Polanyi, Seuil, 2008, p. 328.[↩]
- Ce modèle libéral s’inspire de la Bourse, avec l’image d’un commissaire-priseur qui réalise l’équilibre entre l’offre et la demande par ajustements successifs des prix de marché.[↩]
- Razmig Keucheyan, Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme, Zones, La Découverte, 2019.[↩]
- Troy Vettese et Drew Pendergrass, op. cit.[↩]
- Selon la vision d’un éditorialiste du Financial Times en 2017.[↩]
- Cédric Durand & Razmig Keucheyan, « L’heure de la planification écologique », Le Monde diplomatique, mai 2020.[↩]
- Cédric Durand, Technoféodalisme. Critique de l’économie numérique, Éditions La Découverte, Paris, 2020.[↩]
- Thorstein Veblen, Les ingénieurs et le capitalisme (1971), Publications Gramma, Paris.[↩]
- Thorstein Veblen, op. cit.[↩]
- Antonio Gramsci, La settimana politica. L’operiaio di fabbrica (1920), cité par Alain Supiot, dans l’Introduction au livre de Bruno Trentin, La Cité du travail, le fordisme et la gauche, Fayard, 2012.[↩]
- Wallas, Graham, The Great Society. A Psychological Analysis (1914), New York, The Macmillan Company.[↩]
- Jean Burnham, L’ère des organisateurs, Paris, Calmann-Lévy, 1947.[↩]
- Simone Weil, 1934, « Allons-nous vers la Révolution prolétarienne ? », Œuvres Complètes II, Vol 1, p. 273.[↩]
- Le Shift Project, Climat, Crises : Le plan de transformation de l’économie française, Odile Jacob, 2022.[↩]
- Titre de la BD de Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain (Dargaud, 2021).[↩]
- Voir notamment l’analyse récente d’Antoine de Ravignan pour la revue Alternatives économiques : https://www.alternatives-economiques.fr/discours-trompeurs-de-jean-marc-jancovici/00105505[↩]
- Shift Project, op. cit., p. 17.[↩]
- id , p. 28[↩]
- id., p. 236.[↩]
- Une littérature importante en témoigne, en voici quelques repères non exhaustifs : Rudolf Rocker, Les soviets trahis par les bolcheviks (La faillite du communisme d’État) (1921), Spartacus, Paris, mai-juin 1973 ; Otto Ruhle, dans le livre publié sous le pseudonyme de Carl Steuermann, La crise mondiale ou vers le capitalisme d’État, NRF, Paris, 1932 ; Piotr Archinov, Les anarchistes russes et les soviets (1927), Spartacus, février-mars, 1973 ; Emma Goldman, « Le communisme n’existe pas en URSS (1935) ; Anton Pannekoek, Karl Korsch et les conseillistes allemands et hollandais ; Simone Weil, et un peu plus tard le groupe Socialisme ou Barbarie.[↩]
- Cette planification est incitative. Elle s’oppose au caractère impératif de la planification soviétique. Un Commissariat général du Plan réunit une trentaine d’experts animant des commissions spécialisées composées de représentants des syndicats, de l’administration, des entreprises. Il décide des productions et des entreprises à soutenir, sans porter atteinte à l’initiative privée.[↩]
- François Fourquet, Les Comptes de la puissance. Histoire de la comptabilité nationale et du Plan, Éditions Recherches, 1980.[↩]
- Friedrich Hayek, La route de la servitude (1943), PUF, 1985, p.33.[↩]
- Friedrich Hayek, op. cit., p.37.[↩]
- La « honte prométhéenne » a été défini par le philosophe Günther Anders comme « la honte qui s’empare du « honteux » (« beschämend ») devant l’humiliante qualité des choses que l’homme a lui-même fabriquées »[↩]
- Céline Pessis, Sezin Topçu, Christophe Bonneuil, Une autre histoire des « Trente Glorieuses ». Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre, La Découverte, 2013.[↩]
- James C. Scott, L’œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 1921.[↩]
- James C. Scott, op. cit., p. 525.[↩]
- Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, Alexandre Monnin, Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement, éditions divergences, 2022.[↩]
- Voir Alexis Cukier, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-24-ete-2020/dossier-la-transformation-du-systeme-productif/article/democratiser-le-travail-dans-un-processus-de-revolution-ecologique-et-sociale[↩]
- Sur les savoirs pratiques et la planification, voir Scott, pp. 465 et sq.[↩]
- Collectif Reprise de terres, rédacteur en chef du hors-série de la revue Socialter, « Ces terres qui se défendent », hiver 2022-2023. Voir l’édito p. 9, ainsi qu’en ligne sur terrestres.org.[↩]
- Pour ce débat, voir Barbara Stiegler, Il faut s’adapter. Sur un nouvel impératif politique, Gallimard 2019.[↩]
- John Dewey, Après le libéralisme ? Ses impasses, son avenir, Climats, 2014, pp. 168-169.[↩]
- Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1934), Gallimard, 1955.[↩]
- Aurélien Berlan, Terre et liberté, La lenteur, 2022 ; Geneviève Pruvost, Le quotidien est politique, La Découverte, 2021.[↩]
- Maria Mies, Veronika Benhodt-Thomsen, La subsistance. Une perspective écoféministe (1997), Éditions la Lenteur, 2022, p.55.[↩]
- Maria Mies et Vandana Shiva, Écoféminisme, L’harmattan, 1998.[↩]
- Traduit littéralement, ce concept désigne la « femme-au-foyerisation ». Ce concept est repris par Geneviève Pruvost, op. cit, La Découverte, 2021. C’est un processus de domestication étendue à partir du modèle de la femme au foyer.[↩]
- Maria Mies et Veronika Benhodt-Thomsen, op. cit., p.18.[↩]
- p. 56.[↩]







