A propos du Manifeste conspirationniste, Paris, Seuil, 2022
Illustrations : œuvres d’Alexandra Duprez.
Un point de prudence avant de commencer…
La pandémie de Covid-19 et sa gestion, à la croisée des sciences et de la politique, ont suscité des débats nombreux, parfois violents. Nous connaissons tou·tes des groupes, des familles, des collectifs qui ont été déchirés par ces désaccords, aboutissant à une fragmentation toujours plus nette du tissu social en France. Tout cela est la conséquence directe de la politique d’un gouvernement qui fabrique le séparatisme comme l’envers stratégique du consentement, rendant encore plus difficile toute tentative de penser la situation autrement que sur le mode du clash.
Au sein du collectif de rédaction de Terrestres, ces désaccords existent aussi et ils ont donné lieu à des discussions parfois vives entre nous. Pour autant, nous avons toujours tenté de faire vivre ces dissensus, en les envisageant non pas comme des motifs de scission, mais plutôt comme les signes d’une vie intellectuelle et démocratique intense, dont nous essayons aussi de témoigner dans nos colonnes.
Revendiquer la fécondité de ces dissensus pour mieux faire émerger une description juste et plurielle de la situation contemporaine, voilà aussi le signe d’un attachement à ce qu’Isabelle Stengers appelle l’irréduction, c’est-à-dire la méfiance à l’égard de toutes les thèses qui impliquent, plus ou moins explicitement, « le passage de “ ceci est cela ” à “ ceci n’est que cela ” ou “ est seulement cela1 ” ».
Tenir ainsi à l’irréduction contre la réduction d’une situation à une explication définitive, c’est aussi résister à tout ce qui cherche à se draper dans la pureté de l’évidence, c’est-à-dire d’une vérité dévoilée. Ainsi, examiner la manière dont une thèse peut en faire balbutier une autre, la compléter, l’infléchir ou en renforcer la pertinence, voilà une toute autre affaire que de chercher une thèse officielle ou alternative qui révèlerait enfin le vrai d’une situation — et de préférence tout le vrai.
C’est pour ces raisons que nous avons collectivement décidé de continuer à publier une variété de textes sur la situation pandémique. Des textes qui ne reflètent pas forcément le point de vue de l’ensemble des membres du collectif de rédaction. Des textes avec lesquels certain·es d’entre nous sont même parfois en franc désaccord. Mais des textes qui nous semblent à même, par leur diversité et les rencontres qui en procèdent, d’esquisser ensemble un tableau analytique de la situation pandémique et politique.
La tâche n’est pas facile, mais nous essayons de faire de notre mieux, en respectant la temporalité qui est celle de la revue : celle du recul et de la réflexion, plutôt que celle de la réaction et de la polémique. Aussi, n’hésitez pas à nous suggérer des textes qui pourraient contribuer à ce travail lent et patient de description et d’éclairage du présent.
Bonnes lectures dans les méandres !
Le collectif de rédaction de Terrestres
« C’est le paradoxe de l’État biopolitique : il est censé avoir pour but de s’assurer de notre santé, mais en réalité, il nous rend malades. »
— Boris Groys, Philosophy of care
Le Manifeste conspirationniste propose une analyse de la série d’opérations de pouvoir en cours depuis le début de l’épidémie de covid-19. La thèse défendue est que la cohérence de ces opérations n’est intelligible que si l’on comprend que l’âme en est l’enjeu central. De l’âme, disait Foucault, il ne s’agit pas de dire qu’elle n’existe pas ; il s’agit de voir comment elle est continuellement fabriquée1. La dite « crise » sanitaire permet de franchir un seuil dans cette fabrication (section 1). La question essentielle est bien sûr de savoir comment y répondre. Mais pour cela il faut tout d’abord savoir d’où partir, où s’ancrer, pour regarder et comprendre les transformations qui se déroulent sous nos yeux (section 2). On pourra alors revenir sur les discussions suscitées par la publication de ce livre (sections 3 et 4), et tenter de déplacer leur centre de gravité (section 5).
1 — L’âme fabriquée
Faire de l’âme l’enjeu de la politique ne relève pas d’une évidence, mais on peut écouter sur ce point le propos saisissant de Margaret Thatcher : « L’économie c’est la méthode ; l’objet c’est de changer l’âme » (cité p. 340). La fameuse « course au profit » n’est pas un but, mais un moyen. Il s’agit, pour la classe des capitalistes, de maintenir leur pouvoir. Pour cela, il faut à tout prix conserver l’initiative. Et pour conserver l’initiative, il faut contrôler l’âme des sujets de l’économie.
Grâce aux travaux de Foucault, prolongés notamment par Grégoire Chamayou, on a pu mieux comprendre de quelle manière la pensée néolibérale a permis un développement inouï de l’ensemble des processus qui coupent les êtres de leur milieu relationnel et les enchaînent aux structures fabriquées par le projet des militants du capital. Il ne s’agit pas tant, pas d’abord, pas essentiellement de contraindre à agir ; il s’agit d’amener à agir, de conduire en douceur le sujet à prendre lui-même la libre décision qui, comme par miracle, correspond au choix optimal du point de vue des gouvernants. Et pour cela, il faut configurer de la bonne manière le milieu de vie de l’individu2.
Le Manifeste prolonge ces analyses en relevant notamment trois types d’opérateurs essentiels pour travailler à cette configuration, et pour en approfondir les prises à la faveur de la situation actuelle : des opérateurs technologiques, épistémologiques et psychologiques.
Admettons que l’âme soit immatérielle, il faut alors envisager les technologies qui permettent d’agir sur l’immatériel par le biais des matérialités. Mais des matérialités situées en amont de nous-mêmes, qui s’intègrent si quotidiennement à nos gestes qu’elles ne sont plus perçues pour elles-mêmes, d’autant qu’elles sont faites, précisément, pour qu’on ne s’y arrête pas. Les infrastructures ont pour rôle de fabriquer le milieu de vie des sujets en amont de qu’ils peuvent en ressaisir consciemment. Ce que l’on a éprouvé à l’occasion de la gestion de crise, c’est combien ce façonnement a une fonction politique. « Il aura suffi d’un claquement de doigts, il aura suffi qu’un quarteron de pervers domiciliés à l’Élysée déclarent “la guerre” pour réaliser notre condition : nous habitions dans un piège, qui était resté longtemps ouvert, mais pouvait se refermer à tout moment. Le pouvoir qui nous détenait s’incarnait bien moins dans les guignols hystériques qui peuplent, pour notre plus grande distraction, la scène politique, que dans la structure même de la métropole, dans les réseaux d’approvisionnement à quoi notre survie est suspendue, dans le panoptique urbain, dans tous les mouchards électroniques qui nous servent et nous cernent, bref : dans l’architecture de nos vies » (p. 200).
Outre la matérialité invisible des infrastructures, il y a l’immatérialité de ce que l’on tient pour vrai. Que l’épistémologie ne soit pas une région académique de la philosophie universitaire, mais un terrain de lutte politique majeur, c’est ce que l’on croit savoir depuis longtemps, mais que l’on ne prend plus vraiment la peine d’examiner. Cela nous aiderait pourtant à voir pourquoi le complotisme (disons celui de QAnon ou Trump) est si coriace face à la science. La source du problème est peut-être l’idée, désormais largement diffusée, selon laquelle « le partage entre réalité et illusion, la distinction entre vérité et mensonge sont désormais caducs » ; selon lequel aussi « le réel n’existe pas » et « la réalité s’invente » (p. 184).
Or fabriquer la réalité, cela ne relève pas seulement d’une série d’énoncés performatifs ou de constructions théoriques, mais d’un ensemble de techniques de gouvernement. Celles-ci sont attachées à une vision globale du monde envisagé comme un ensemble de positivités quantifiables. Les « ontologies plates » (object-oriented ontology) ont pu susciter l’espoir d’un dépassement du point de vue humain, mais se sont finalement avérées être le symptôme d’un monde qui ressemble en effet toujours plus à sa description, non parce que les sciences seraient toujours plus ajustées, mais parce qu’elles permettent de produire l’objet qui correspond à leur description. Les techniques de gouvernement les plus ramifiées s’enracinent dans cette puissance conférée aux sciences de générer le monde qu’elles connaissent.
Que la réalité soit produite par la démarche scientifique qui entend la connaître, cela est particulièrement vrai quand ce qui est à produire est la conduite humaine. Ici, épistémologie et psychologie se confondent, ou tout au moins deviennent inextricables. Il y a bien une « ingénierie sociale » qui passe notamment par les sciences comportementales (p. 165). Un rapport de l’OTAN insiste sur le « plan cognitif » qui transversalise tous les autres (p. 106 sq.), un autre, de la CIA, souligne l’enjeu de « la bataille pour l’esprit des hommes » (p. 110). Dans tous les cas, l’idée que le pouvoir passe par la manipulation des esprits est énoncée en toutes lettres à l’époque de la Guerre froide. La thèse du livre sur ce point est que ce projet n’a pas pris fin avec l’Union soviétique, qu’il s’est développé et n’a cessé de prendre de l’ampleur jusqu’à nos jours. Pendant la Guerre froide, il s’agissait de produire le sujet démocratique libéral, comme contre-modèle du sujet du monde totalitaire (p. 147 sq.). Aujourd’hui, il s’agit de produire le sujet adapté à l’obéissance requise en une période d’instabilités qui vont aller s’amplifiant, si l’on veut contrôler les effets de celles-ci et les empêcher d’aboutir au renversement de la domination technocapitaliste3. Que la guerre froide soit à ce point revenue à l’ordre du jour depuis la guerre en Ukraine confirme que nous étions loin d’avoir même commencé à nous délivrer de ce projet.

Pour terminer cette évocation des thèses du livre, relevons seulement deux exemples de théories opératoires qui permettent de conduire la conduite des humains. Il y a d’abord cette thèse issue de la Psychologie de l’engagement (1971) de Kiesler, qui a si bien démontré son efficace au cours de la crise sanitaire, selon laquelle les discours suivent les actes : « L’hypothèse anthropologique de Kiesler et de toute la psychologie sociale est que les humains n’agissent pas en fonction de ce qu’ils pensent et disent. Leur conscience et leur discours servent uniquement à justifier a posteriori les actes qu’ils ont déjà posés » (p. 168). Il faut donc seulement faire en sorte que des décisions soient prises dans l’urgence (porter un masque à l’extérieur, ne plus serrer la main d’un ami, se vacciner) et les sujets de ces décisions seront amenés rétrospectivement à les rationaliser.
Le second exemple, c’est « l’effort pour rendre l’autre fou », qui passe notamment par le fait de favoriser en lui « un conflit affectif », de « saper sa confiance dans la fiabilité de ses propres réactions affectives et de sa propre perception de la réalité extérieure », comme l’écrit Harold Searles (cité p. 178-179). C’est bien cela, en effet, que nous avons vécu : « Qui peut dire que, depuis deux ans, nous ne sommes pas systématiquement soumis à une succession de stimuli de peur visant à générer un état de régression docile, à un rétrécissement méthodique de notre monde, à des injonctions contradictoires visant à nous rendre suggestibles » (p. 174-175). Si, selon les données actuelles de l’OMS, les cas de dépression et d’anxiété ont augmenté de 25 % dans le monde à l’occasion de la crise sanitaire, ce n’est pas seulement en raison de la peur du virus, mais au moins autant à cause de tous les dispositifs de contrainte qui n’ont eu aucun égard pour les fragilités psychiques des êtres, et qui ont produit un gigantesque « gaslighting » (en référence au magnifique film de Cukor, Gaslight) qui a généralisé la disposition à douter de soi-même. De ce point de vue, on ne pourra qu’éprouver de la gratitude envers un texte qui aura permis à quelques-uns de ses lecteurs de ne pas rester enfermés dans un esseulement dévastateur.
2 — Le point de vue
Il faut alors en venir à la question de la position d’énonciation du livre. La compréhension de ce que signifie le terme « âme » relève de la perception éthique. Or on ne comprendra pas ce Manifeste si l’on ne voit pas qu’il cherche à faire consister une perspective ou un point de vue que les responsables du cours des choses voudraient, eux, faire disparaître. On dira ce point de vue éthique, une fois admis que pour les auteurs de ce livre il ne s’agit pas de le définir, car il convient d’éviter toute théorie éthique, comme l’a jadis enseigné Wittgenstein. Car s’il y a selon ce dernier une disposition de pensée qui doit être rejetée, c’est bien celle qui conduit à proposer une telle théorie, pensée comme un ensemble structuré de propositions enchaînées en bon ordre. Non parce qu’une telle théorie serait inévitablement dogmatique, mais au contraire parce qu’elle renverrait ses propres principes à la contingence des raisonnements et des argumentations, à quoi pourraient naturellement s’opposer d’autres raisonnements et argumentations.
Un siècle avant les propos de Wittgenstein, on trouve une semblable condamnation de la théorie éthique dans la Phénoménologie de l’Esprit, à la toute fin du chapitre IV (moment essentiel où se joue le passage de l’examen des formes de la conscience de soi à celui des formes de l’Esprit) : ce que Hegel appelle la substance éthique se reconnaît en tant que telle, ou plus exactement elle peut animer notre expérience dans la mesure seulement où elle n’est pas renvoyée à la contingence des démonstrations, et où elle est portée comme un ensemble de vérités qui ne peuvent être mises en doutes. Les auteurs du Manifeste pourraient ici parler d’un partage d’évidences éthiques qu’il ne s’agirait pas de mettre en formules, mais de présupposer. Il faut voir selon eux dans la mise en œuvre effective de ce présupposé la seule consistance réelle d’une communauté vivante.
Bien sûr, la substance éthique ainsi désignée n’est, dans le mouvement de pensée de Hegel, qu’une étape : pour devenir pleinement morale, la communauté devra tout d’abord dialectiser (c’est-à-dire ici dépasser) l’opposition entre loi humaine et loi divine – c’est le début du chapitre 5, où est évoquée l’opposition de Créon et d’Antigone. La substance éthique reste attachée à la loi divine, et Antigone en est la militante. Laissons de côté l’optimisme dialectique de Hegel, et considérons la situation actuelle sous l’angle que sa description pourrait suggérer, mais qu’il ne voudrait pas lui-même envisager : l’opposition entre la loi humaine et la loi divine s’est désormais irréversiblement figée, et n’est plus dialectisable. Il y a d’un côté, les citoyen(ne)s qui s’en tiennent aux prescriptions fournies par les législateurs, c’est-à-dire aux lois écrites, censées être tournées vers l’universel, celles qui en l’occurrence permettent de fabriquer en chacun une âme adéquate aux mutations en cours du monde du capital. De l’autre, celles et ceux qui restent attachés à la loi divine, non-écrite, qui n’a pas à se formuler et à se démontrer. La loi promulguée par les gouvernants et plus généralement les maîtres de l’économie-monde, d’un côté ; et de l’autre, la loi souterraine, qui, comme pour Antigone, continue de relier à la terre et aux vivants du passé.
Ce détour par la piété d’Antigone (une figure qui a pu revenir à la mémoire de toutes celles et ceux qui, dans les premiers temps de la pandémie notamment, n’ont pu enterrer leurs défunts) peut sembler préparer une stratégie de disqualification visant à rejeter le « mysticisme » du Manifeste – de même peut-être l’allusion à une substance éthique à l’heure où tout un chacun est censé avoir admis l’indépassable déconstruction de toute substance. Mais avant d’explorer les désaccords, il s’agit bien plutôt dans ce qui suit (sections 2 et 3) de cerner davantage le point de vue de ce livre et l’exigence qu’il transmet, celle de prendre irréversiblement parti contre la loi du nouvel ordre du monde globalisé – qui nous tient lieu d’universel.
Insistons une fois pour toutes sur le fait que le terme « loi », dans le syntagme « loi humaine », est ici une image, où il faut voir rassemblés non seulement les lois édictées comme telles, ou plutôt les innombrables décrets pris par les gouvernements, mais aussi bien les prescriptions médiatiques ou scientifiques, et les modèles de comportement qu’ils promeuvent. Toute consistance éthique, au sens que les auteurs donnent à ce mot et donc, parce que c’est pour eux la même chose (on y reviendra), toute consistance politique, ne peut se construire que radicalement hors la loi, en cette acception élargie. La « loi divine » est alors elle aussi une image qui renvoie aux formes trouvées par une communauté, capable d’exister en dehors de la loi reconnue, pour maintenir ou inventer une expérience du vivre que cette loi officielle, la « loi humaine », s’efforce d’occulter. La loi divine est une loi informulée, une loi qui n’a rien à faire avec la forme de la Loi, et qui anime de l’intérieur les vivants assemblés qui la reconnaissent, non comme un ensemble de prescriptions, mais comme un ensemble de gestes partagés.
Le point de vue du Manifeste est donc celui d’une communauté du refus attachée à une même substance éthique, qui demeure tacite, qui est même au moins partiellement informulable, et dont les principes énonçables ne se confondent pas avec les raisons (les évidences éthiques) qui conduisent à y appartenir. Pour faire consister cette communauté éthique, ce « nous éthique », il faut retrouver ou instaurer une âme qui ne se laisse pas fabriquer par la loi globale – la loi du monde globalisé. Et pour cela, il faut garder une relation avec la loi divine, mais d’une divinité qui resterait immanente au monde, sans se confondre pour autant avec cet ersatz d’horizon théologique qu’est la santé. « La poursuite de la santé s’est substituée à celle du salut, dans un monde qui n’en promet plus – c’est que, si la foi chrétienne s’est perdue, la perception qu’“il y a des dieux aussi, ici bas”, comme disait Héraclite, n’a pas gagné du terrain pour autant » (p. 234). Il faudrait alors désormais faire en sorte que cette perception d’un divin non-religieux, d’une amplitude de vie partageable fondée sur aucune transcendance, puisse gagner du terrain. Un divin qui n’est donc plus un monde projeté au-delà de la vie, mais la forme que peut se donner la vie commune elle-même dans son plein épanouissement, auquel elle peut parvenir dès lors qu’on cesse de la confondre avec l’objet de connaissance des sciences, en particulier médicales, ou avec l’objet d’une gestion gouvernementale.

On accordera donc qu’il faut commencer par éviter d’être parmi « ceux qui se soumettent à toutes les normes inventées d’hier et de nulle part dans l’espoir d’un “retour à la normale” qui, pour cette raison même, n’adviendra jamais » (p. 30). La nouvelle loi humaine empêche en effet de prendre au sérieux toute idée d’un retour à la normale, quand bien même les passes, sanitaire ou vaccinal, se trouveraient quelques temps suspendus. L’arsenal d’exception fabriqué à l’occasion de cette pandémie sera désormais intégralement à disposition, et ne manquera pas d’être réactivé pour gérer les pandémies à venir (de covid, de grippe, de maladies nouvelles, ou dont le mode de diffusion semble nouveau, comme la variole du singe), et d’autres catastrophes qui nous sont promises. Mais si la loi nouvelle étend déjà son autorité dans le futur qu’elle nous dessine, il faut voir qu’elle plonge aussi ses racines dans le passé. Même s’il y a bien eu du nouveau dans cette crise, la situation actuelle n’est pas seulement issue de la gestion dans l’urgence d’un événement imprévisible.
Selon les auteurs du Manifeste, même si elle n’a sans doute pas donné lieu à une concertation de gouvernants (mais il suffit que ces derniers soient formés à défendre une même logique – et c’est en cela qu’ils conspirent : p. 22), cette gestion doit avant tout se comprendre comme la réponse aux mouvements qui ont marqué la fin des années 2010, dont les Gilets jaunes sont l’emblème en France, mais qui ont éclos aussi à Hong Kong, en Catalogne, au Chili, au Liban, en Irak et en Colombie (p. 83-89). Ces mouvements esquissent bien une communauté du refus – qui pour être une doit trouver sa manière d’apparaître (d’abord à elle-même) en tant que telle.
Mais toute la question est d’abord de savoir comment faire consister cette communauté, ou plutôt, diraient peut-être les auteurs, comment faire en sorte qu’elle trouve son plan de consistance. Qu’il ait ou non réussi, le livre a en tout cas cherché à être un opérateur permettant l’instauration d’un tel plan. Faire d’un livre d’intervention un opérateur politique, c’est supposer qu’un certain type d’énonciation4 serait à même d’opérer ce qu’elle décrit, du moins ce qu’elle convoque comme un « potentiel réel » : l’unité, et donc la force décuplée, de cette communauté du refus.
3 — La question du « style »
Mais nous nous heurtons alors à la première objection qui a pu être formulée au fil des recensions, la plupart très hostiles au texte, mais généralement peu soucieuses d’en restituer le projet d’ensemble. Cette objection concerne précisément cette volonté de trouver une forme d’énonciation messianique, qui fait barrage pour nombre de lecteurs. Une énonciation qui conduirait à tracer une trop franche ligne de démarcation entre d’un côté les faibles, qui se soumettent, de l’autre les forts, qui refusent la soumission ; par ailleurs, ces derniers ne seraient forts que parce qu’ils ont le luxe de pouvoir choisir de se soustraire aux dispositifs de pouvoir. L’énonciation messianique serait ainsi le support d’une position aristocratique, depuis laquelle seulement on peut rester indifférent au sort des faibles. Ce que prouverait le fait que le livre n’a pas suffisamment souligné le sort des personnes ayant subi de plein fouet les politiques de gestion les plus criminelles, des habitants des bidonvilles de l’Inde de Modi à ceux des favelas du Brésil de Bolsonaro.
L’énonciation messianique supposerait donc le tracé d’une ligne de partage séparant nettement ceux qui se soumettent et ceux qui ne se soumettent pas, mais aussi, d’un même mouvement, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ou ne veulent pas savoir. Le rejet de cette énonciation s’est dès lors souvent, voire exclusivement focalisé sur le style de l’ouvrage – un style perçu comme dogmatique, parce qu’il énoncerait des propositions sans les démontrer, sans les soutenir par de véritables arguments. Il faut alors revenir sur les questions esquissées plus haut sous l’angle de l’épistémologie, et repartir de cette question du point de vue – c’est-à-dire de ce que les auteurs ne voudraient pas appeler « subjectivité », mais qui pourrait peut-être être désigné ainsi du moins pour indiquer qu’il s’agit de mettre à distance l’objectivisme régnant.
Tout « esprit libre », au sens que Nietzsche donnait parfois à ce terme, ne pourra sur ce point qu’être du côté de ce Manifeste, à l’heure où il semble chaque jour plus difficile, pour un lectorat qui a appris à l’université la notion de « sérieux », d’accepter un ouvrage qui ne cite que partiellement ses références, qui s’autorise à parler depuis des « champs » supposés distincts (politique, sociologie, psychologie et même biologie) et qui ne se soucie pas de démontrer ce qu’il avance. Une démarche qui contrevient en tout point à ce qui s’est imposé comme la « philosophie spontanée des savants », à savoir ce que les auteurs du Manifeste appellent positivisme, et qui va bien au-delà du courant philosophique généralement désigné ainsi. On peut en effet dire « positiviste » la posture de tout intellectuel dont le souci principal est de gagner et de conserver la reconnaissance de ses pairs, bien au-delà des seules sciences « dures ». On l’a vu dans toute cette période, où le plus grand nombre des intellectuels « engagés » se sont courageusement absentés de toute polémique, où ils ont même montré une frilosité quelque peu grotesque à l’idée de pouvoir être associés de près ou de loin à celles et ceux qui ont osé proposer une lecture des opérations politiques pouvant être jugée irrecevable. Et même chez ceux qui ont depuis longtemps cru déconstruire le positivisme, même dans les cercles de pensée les plus constructivistes, les suiveurs de Stengers et Latour se sont également abstenus de toute prise de position risquée, alors que la situation semblait exemplairement se prêter à la mise en œuvre de leurs problématiques et de leurs méthodes (examen des controverses scientifiques, de la manière dont elles se construisent, de ce qu’elles excluent ; place de la science dans le débat public, etc.).
Mais peut-être n’est-ce pas un hasard, peut-être le constructivisme, même « spéculatif », n’est-il au fond lui-même qu’une variante du positivisme. Car ni les positivistes rigides ni les constructivistes subtils n’ont jamais commencé à comprendre ce que pouvait signifier le concept même de politique ; ils ignorent donc tout du rapport entre politique et vérité. Mario Tronti l’a martelé fortement depuis quelques décennies : la partialité du savoir politique n’est pas ce qui fait obstacle à sa vérité, c’en est au contraire la condition. Comprendre par exemple le monde capitaliste dans les années 1960, c’est adopter le point de vue ouvrier, qui n’aurait jamais pu se superposer à celui des patrons. Il en va de même pour toute « grande politique » : « on ne fait une grande culture politique qu’à partir d’un soi collectif, d’un point de vue partial non individuel, d’une raison, ou de plusieurs raisons, de contraste entre deux parties du monde, deux genres d’êtres humains, deux présences sociales, deux perspectives de futur »5. L’image utilisée ici de la dualité loi humaine/loi divine est une manière de prolonger cette indication.
Mais il est devenu très difficile, pour bien des gens qui font profession de penser, d’assumer pleinement cette partialité vraie. D’où sans doute l’état de panique à la fois sourde et aphone chez les intellectuels, à de rares exceptions : il y a bien quelque chose d’inacceptable dans ce qui s’impose aujourd’hui à l’occasion de la gestion de crise ; mais si l’on s’aventure par exemple à contester les préconisations de l’OMS sans être médecin ou épidémiologiste (ou parfois même en l’étant), on est potentiellement soupçonné de ne pas comprendre les raisons de la science, et de voir ses prises de position démenties par les faits – alors que l’université nous a si bien appris à esquiver une telle épreuve. Pour conjurer ce spectre, on comprend qu’il vaille mieux tout simplement s’abstenir.
Mais au-delà, justement, de la lâcheté ordinaire des universitaires et des penseurs « radicaux » soucieux de ménager leur place, il a bien fallu constater un trouble dans la vérité. C’est bien un problème d’ordre épistémologique qui s’est posé aux universitaires eux-mêmes, qui « à force de spécialisation concurrentielle, à force de tout savoir sur presque rien », ont perdu tout rapport à un usage possible de leur « science » (p. 101-102). Mais c’est au sein de chaque famille (y compris les familles militantes), que l’on n’a cessé de constater avec effroi l’extraordinaire réversibilité des arguments. Passée cette stupéfaction, on s’est le plus souvent essayé à dissimuler ce constat, et à redoubler d’assurance, en essayant de tenir bon sur l’un des côtés du déni – par exemple : « la maladie n’est pas si grave » contre « il n’y a pas d’effets secondaires de la vaccination ». Le Manifeste va parfois dans le sens du premier déni ; en réponse peut-être à ceux qui ont exagéré le second. En tout cas, cette double exagération fausse la perception claire que nous devrions construire de la situation, qui nous dispenserait des faux débats qu’elle occasionne, de ce qu’ils nous font perdre de temps, d’énergie, et parfois d’amitié.
L’étonnement devant la profondeur de ce trouble dans la relation à la vérité tient à ce que l’on a pu voir, à l’occasion de cette « crise », combien la démarche scientifique, censée incarner à elle seule la fonction du dire-vrai, ne pouvait être à la hauteur de ce qu’on lui demandait. Comme le souligne le Manifeste, on s’est finalement aperçu du fonctionnement ordinaire de la science au-delà des cénacles constructivistes. On s’est aperçu que les vérités scientifiques étaient étroitement locales, qu’elles dépendaient de la définition de leur objet et de leur champ d’études, nécessairement restreints ; on s’est aperçu que la diversité des façons même d’interroger tel objet dans tel champ d’étude pouvait conduire à des descriptions incompatibles. On s’est bien aperçu de cela, mais on n’a pas voulu en tirer la conclusion pourtant nécessaire : nos sociétés (et plus encore nos communautés politiques) souffrent du fait d’avoir confié l’intégralité du dire-vrai à la démarche scientifique ; et d’avoir ainsi à refouler l’idée que pour comprendre dans son ensemble une situation historique et politique, une approche scientifique ne suffit pas – et ne peut au mieux donner autre chose que des matériaux épars.

Pour comprendre une situation politique, il faut disposer d’un point de vue politique, irréductible à ce que la connaissance objective (la somme nécessairement dispersée, intotalisable, des connaissances objectives) peut en dire. Le fait même de faire disparaître ce point de vue autre que scientifique dans la recherche de la vérité de la situation est lui-même une victoire pour notre adversaire ; et cela ne constitue en aucune manière un accident, car sa volonté politique est précisément de faire disparaître l’espace de la politique en tant que tel.
Il y a cependant une difficulté : on a souvent souligné que les gouvernants, par exemple en France, n’avaient justement pas suivi les préconisations des scientifiques. Il ne faut donc pas postuler une unité entre pouvoir politique et véridiction scientifique – et il s’agit précisément d’expliquer alors de quelle manière a fonctionné la référence à la science, d’une part, et d’autre part quelle logique a suivi le pouvoir dans la plupart des pays (j’y reviens dans la section 4).
Que le pouvoir obéisse à une logique propre, qui ne découle pas du suivi scrupuleux des énoncés scientifiques, c’est une chose. Qu’en revanche il utilise le poids donné à ces énoncés dans nos sociétés pour disqualifier tout autre type de discours, c’en est une autre. On ne demande pas au lecteur une gymnastique intellectuelle excessive, quand on lui dit que le pouvoir a, en France comme ailleurs, rappelé l’éminence indiscutable du discours scientifique dans l’approche de la maladie pour disqualifier ses adversaires potentiels, précisément pour avoir l’espace politique libre pour lui-même ; précisément pour pouvoir mener sa politique qui, une fois la contestation éteinte, pouvait bien, et devait même suivre une autre logique en effet que celle de l’OMS ou du conseil scientifique. Dans les jeux de pouvoir, la fonction de la science n’est pas de dicter ce qu’il faut faire, mais de faire taire ce qui n’est pas scientifique.
Pour qu’il y ait une existence politique, il faut tout d’abord que l’ensemble de ce qui existe, ou de ce qui est, ne soit pas réductible à ce que les sciences peuvent en dire. Selon les auteurs du Manifeste, la victoire de l’ennemi, dans sa volonté de faire disparaître la vérité politique en tant que telle, prend ses racines dans la manière dont les sciences du vivant ont envisagé la vie, rouage essentiel de l’inscription du vivant dans l’espace de la gouvernementalité biopolitique. Peut-être aurait-il fallu évoquer les approches hétérodoxes qui existent au sein même des sciences biologiques elles-mêmes, mais on peut bien admettre en tout cas que c’est bien le monopole du vrai accordé aux sciences qui a fini par imposer très largement cette « vision moléculaire de la vie » (p. 304), selon laquelle chaque être doit être envisagé comme un stock de réactions physico-chimiques quantifiables. L’avantage d’envisager les êtres ainsi, c’est qu’ils deviennent alors parfaitement malléables. Conduire les humains avec la même science que celle qui permet de conduire les particules, les gènes ou les navettes spatiales, tel est le projet du biopouvoir contemporain, énoncé en tant que tel dans les documents cités au long des pages du livre.
4 — La question des morts
La place sociale donnée au discours scientifique dans nos sociétés est donc un rouage central du pouvoir biopolitique. Concernant la description de ce biopouvoir, ce qui est dit dans ce livre sera assez familier aux lecteurs de Foucault et de Agamben, deux auteurs qui ont construit une précieuse intelligibilité de la manière dont la vie se trouve inscrite dans les dispositifs de pouvoir, et ont ainsi éclairé les enjeux politiques de cette inscription. Si on prend la peine de lire ou relire Foucault, on voit clairement que le concept de « biopolitique » a toujours désigné le souci pour la vie en tant qu’elle permet l’accroissement des richesses. « Biopolitique » n’a jamais nommé autre chose pour lui que l’inscription de la vie dans l’horizon du développement économique. La santé des populations, aussi bien que celle des individus, sont bien devenues des préoccupations majeures depuis deux siècles et demi, mais dans la seule mesure où elles peuvent être des rouages essentiels de ce développement. Le fait de pouvoir laisser mourir ceux qui ne remplissent plus cette fonction, ou même celui d’envoyer à la mort par le biais de la guerre, n’ont jamais été contradictoires avec le « souci pour la santé » des populations (p. 238). D’une façon générale, la gestion biopolitique est structurellement confrontée au tri nécessaire entre la vie qui mérite de vivre et celle qui ne mérite pas de vivre6.
Sur ce point il faut cependant s’arrêter à nouveau sur la critique la plus virulente adressée aux rédacteurs du Manifeste, accusés d’adopter le point de vue biopolitique dont ils entendaient pourtant faire la critique, ou de devenir eux-mêmes les tenants d’un nouvel eugénisme. On leur a objecté par exemple d’être indifférents aux morts du covid, parce qu’ils n’évoquaient pas ces derniers. On pourrait dire que, là encore, c’est une question de « style ». Les auteurs ont le tort de laisser entendre qu’ils minimisent les effets de la maladie, mais ils répondraient sur ce point précis que s’ils n’évoquent pas directement les morts du covid, ce n’est pas qu’ils nient cette réalité ; c’est qu’ils refusent d’adopter la précaution d’usage devenue une règle tacite : parler de la crise sanitaire n’est possible que si l’on commence par citer les chiffres du nombre de morts, et plus largement le nombre de personnes touchées par la maladie.
S’il est permis de refuser cette précaution, c’est parce que l’essentiel ici se joue bien au niveau de l’énonciation, pas à celui de l’énoncé. Dire que la maladie est grave, montrer que l’on en connaît les « données », ce n’est pas seulement reconnaître des faits ; c’est valider la morale qu’ils sont censés contenir. Une morale qui ne concerne justement pas les morts (nul besoin de montrer qu’on les déplore pour en être attristé), mais qui impose d’exhiber son appartenance au clan des gens éclairés, loin des sombres milieux complotistes. Refuser à l’inverse de se soumettre à cette morale, ce n’est pas adopter un point de vue eugéniste ( : peu importe les faibles, les vieux, les malades), c’est refuser de considérer que d’autres morts, ou d’autres personnes gravement invalidées, psychiquement ou physiquement, comptent moins, même s’ils sont moins nombreux : ceux qui n’ont pas supporté la solitude ou l’impossibilité de réaliser ce qui leur tenait à cœur, ceux qui n’ont pu être soignés parce qu’ils souffraient d’autre chose, ou ceux qui n’ont pas supporté l’expérimentation vaccinale, entre autres exemples.
L’objection de fond revient toujours à associer ce livre à un geste fasciste, et de fait la perspective du livre semble validée par l’extrême-droite (Soral en a fait une recension, aussi nulle que tout ce qu’il écrit par ailleurs), ce qui montrerait, quelles que soient les intentions des auteurs, qu’elle est compatible avec cette posture politique. Problème d’autant plus aigu qu’il a pris une nouvelle portée depuis les émergences populaires récentes – pensons aux Gilets jaunes, au mouvement contre le passe sanitaire ou aux convois pour la liberté. Il faut reconnaître à l’extrême-droite un mérite : celui de continuer à tracer des lignes de partage, là où la tradition de la gauche n’a cessé, depuis quelques décennies, de les estomper, ou même de les conjurer. Le problème est que ses leaders tracent cette ligne en ramassant ce qu’il peut y avoir de pire dans les dispositions subjectives diffuses : racisme, virilisme, transphobie, traditions « rurales », etc. Ils ne comptent que sur ces forces de la réaction qui mèneront encore plus vite au gouffre que celles d’un macronisme aussi lisse que criminel. Ils s’empêchent de voir par exemple de quelle manière le féminisme et plus généralement les tentatives de dépassement de la binarité des genres peuvent aujourd’hui constituer une matrice de subjectivation politique féconde pour les générations nouvelles.
On supposera, au vu de l’intelligence déployée dans ces pages, que l’opération du Manifeste n’est pas de s’adresser aux cerveaux bouchés des « penseurs » de l’extrême-droite, mais de construire un espace de pensée capable de se substituer à celui qu’ils occupent, et de pouvoir alors s’adresser aux participant(e)s des mouvements cités (Gilets jaunes, etc.). Pour cela, il faut tracer la bonne ligne de partage : non l’une de celles qui sépare un nous identitaire d’une figure d’altérité (migrants, trans, etc.), mais celle qui sépare un nous politique des responsables du désastre planétaire – disons la classe des technocapitalistes et de leurs servants, tous ceux qui ont pris les initiatives menant à ce désastre. C’est sur le tracé de cette ligne de partage qu’il y a discussion, car c’est bien l’enjeu central (section 5).
Les objections évoquées ont permis de remplir quelques recensions rageuses dont le principal effet aura été de faire disparaître le véritable enjeu de la discussion, qui suppose la claire identification des deux camps ennemis. C’est pour aller dans le sens de cette double identification qu’il faut revenir sur la logique politique qui a animé les décisions des gouvernants, lesquels, on l’a dit, sont loin d’avoir systématiquement suivi les préconisations scientifiques. Une logique apparemment fracturée, divisée, disparate selon les pays, et pourtant en réalité relativement unifiée.
Karl Heinz Roth, un ancien théoricien de l’autonomie, qui est aussi médecin et historien, a écrit récemment une analyse de la gestion de la crise sanitaire 7. Ses développements sont comparables à certaines idées défendues en France par Barbara Stiegler, avec un point de vue politique différent, mais elles recoupent aussi parfois les analyses du Manifeste, par exemple pour ce qui concerne le rôle de la fondation Bill et Melinda Gates dans les programmes de recherche sur les pandémies. Ce rôle aura été principalement de favoriser l’idée d’une gestion de crise à partir du « scénario du pire » qui a été suivi dans cette gestion de crise, mais qui ne convenait pas à la forme effective de la pandémie. Roth parle d’une maladie « de gravité modérée » (sous réserve de nouvelles mutations toujours possibles), ce qui n’est aucunement une provocation mais selon lui la classification adéquate, en termes de santé publique, pour une maladie transmise par un virus effectivement bien plus grave que la grippe saisonnière standard, mais qui, avec à peu près une moitié de personnes asymptomatiques, appelait un traitement ciblé : les personnes les plus exposées auraient pu bénéficier d’une protection spécifique – ce qui aurait aussi mieux permis d’accueillir les cas de forme grave développés chez des personnes non répertoriées comme « à risque ». L’important n’est cependant pas dans la classification elle-même, mais dans ce paradoxe : face à cette situation, l’adoption du « scénario du pire » n’a aucunement entraîné, comme on pourrait le croire, une plus grande efficacité des soins, bien au contraire.
Car les maîtres du monde, après avoir prouvé leur titre en enfermant la quasi-totalité de la population mondiale, ont voulu conjuguer ce scénario du pire avec le maintien à tout prix des « acquis » de la période néolibérale dans la gestion des institutions de soin. Dans l’entretien, Roth explique qu’après avoir examiné les divers plans de lutte proposés contre la pandémie dans divers pays, il a été forcé de constater que « ces plans étaient tous orientés vers le maintien des infrastructures politiques et économiques nécessaires, mais ne proposaient rien pour le secteur de la santé ». D’où la parfaite aberration dans laquelle il nous a fallu vivre : d’un côté la diffusion d’un état de panique justifiant les mesures d’urgence les plus grotesques ; de l’autre, du fait de la déficience structurelle des systèmes de soin, ce qui devait être fait pour protéger les plus exposés est resté très insuffisant. Il a alors fallu désigner d’autres coupables que les gouvernants, quelques boucs émissaires (ceux qu’on a appelé sans rire « les non-vaccinés »), et amplifier le clivage ainsi créé au sein de la population grâce à la politique des passes, promise à un grand avenir.
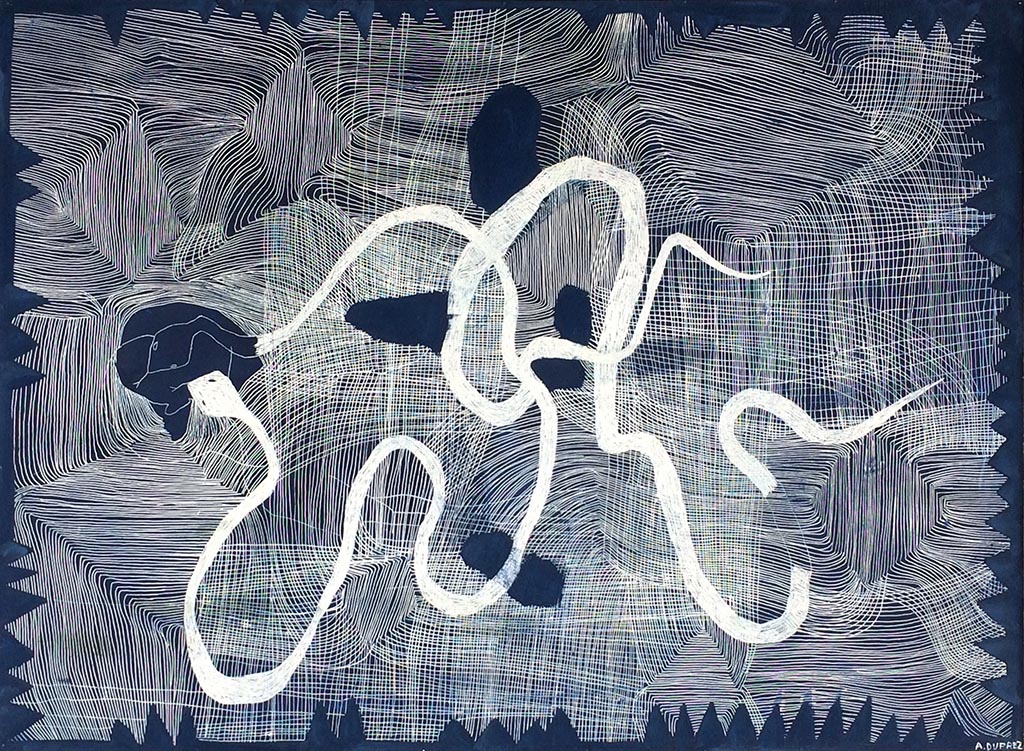
On pourrait trouver étrange que, quelques semaines seulement après que cette hystérisation eut atteint un point culminant, tout le monde se soit empressé d’accepter le déni officiel de la maladie. Il se trouve que l’expérimentation à grande échelle du scénario du pire avait (provisoirement ?) pris fin. L’alternative entre la gestion raisonnée et civique à l’européenne et les paris fascistes du type Trump ou Bolsonaro semblait dès lors s’estomper : on s’accordait désormais, un peu partout, sur la nécessité de « vivre avec le virus ». C’est que l’essentiel était acquis : on avait pu gérer la pandémie en maintenant ce qui en avait été la cause, à savoir la politique même qui est responsable de la dégradation généralisée des milieux de vie (par le dérèglement climatique, la destruction des territoires des animaux sauvages, l’élevage industriel) qui est la cause de cette pandémie et des pandémies à venir. Et qui est donc aussi, en toute logique, responsable de l’état désastreux des institutions de soin. Le plus drôle est que « nous », les bons citoyens que nous devions nous soucier d’être, sommes devenus par un tour de magie les responsables de la bonne santé de l’institution hospitalière. Quand la politique de vaccination a montré ses limites eu égard au projet annoncé d’éradiquer le virus, il s’est agi pour chacun(e) de faire les bons gestes pour ne pas encombrer les hôpitaux (Manifeste, 245). C’était le « chantage à l’hôpital : soit vous obtempérez, soit l’hôpital craque. La truanderie ne manque pas de saveur : qu’un service soit à tout moment sur le point de craquer, c’est la définition même de son état optimal du point de vue de sa gestion néolibérale » (p. 245). Il est possible que ce chantage soit à nouveau mobilisé dans les semaines qui viennent. On notera que le déni de la contagiosité aérosol pendant plus d’un an et plus largement l’absence de prise en compte de la circulation du virus par l’air confiné est aussi un élément de cette logique de responsabilisation individuelle ; car cette prise en compte devrait conduire en toute logique à stopper la dégradation globale des conditions de vie, mais c’est bien ce que les gouvernants sont parvenus à éviter jusqu’à présent.
Le constat du délabrement des infrastructures de soin organisé par la politique néolibérale ne devrait pas pour autant conduire à relayer le discours sur la défense de l’institution hospitalière telle qu’elle était « avant ». Les rédacteurs du Manifeste n’ont pas tort de rappeler les critiques essentielles adressées à cette institution, et à l’institution médicale de façon plus générale, qui avaient pu être formulées par Foucault dans les années 1970, ou sous un autre angle par Ivan Illich. D’autant que dans la situation de crise, ces critiques étaient devenues inacceptables (« la critique du quasi-monopole hospitalier des ressources médicales voire de l’aberration essentielle de cette institution est une des banalités devenue inaudible »), en même temps que disparaissait le regard bienveillant sur les tentatives de soin issues des médecines « parallèles » ou traditionnelles : face à l’urgence, il s’agissait d’être sérieux. Et être sérieux, on le sait, c’est être rationnel et « positif ».
Il serait absurde de dire que dans une telle situation il aurait fallu déserter les hôpitaux ; mais il était sans doute essentiel de prendre en considération ce qui se déroulait en dehors des institutions médicales, ou à leurs marges, et en tout cas en dehors des politiques étatiques. Roth insiste sur ce qu’on pourrait appeler une forme de care communisé hors institution, à travers les réseaux d’entraide, les formes collectives spontanées de solidarité qui se sont développées à plus ou moins grande échelle, hors de tout cadre étatique, dans tous les pays. On ne pouvait s’étonner de trouver ces formes au sein de la communauté zapatiste au Chiapas ; il était plus étonnant de les voir apparaître dans les favelas brésiliennes8. La négligence par les gouvernants de ces formes populaires d’entraide (à l’exception du Japon et du Danemark selon Roth) n’a fait que décupler la catastrophe.
5 — L’expérience politique
Retournons au problème du point de vue, celui de la communauté du refus. « Ce livre est anonyme car il n’appartient à personne ; il appartient au mouvement de dissociation sociale en cours » (p. 11). Le problème est que ce mouvement est pour l’heure disparate, sans unité. J’entends bien que la visée des auteurs n’est pas explicitement de l’unifier, plutôt de l’amplifier, mais le singulier ici (un mouvement) est révélateur, et me semble contraindre à cette alternative : soit le « un » indique précisément une visée et l’on peut alors se poser la question de la manière dont peut être construite l’unité du mouvement en tant qu’elle n’est pas donnée ; soit il y a bien déjà un mouvement, et à suivre les auteurs, on pourrait croire qu’en tant que tel il est l’expression de son époque – ou de l’époque à venir. Ce qui suppose que l’époque, présente ou à venir, cherche une voix. Or il me semble que ce n’est pas « l’époque » qui est la source de cette parole politique disparate et potentiellement unie, ce n’est pas elle qui parle. Ce qui parle, ce sont des sujets politiques hétérogènes.
S’il peut y avoir une voix de notre côté, si une unité doit être dès lors pas seulement invoquée, mais construite, ce doit être celle d’un processus politique. Si elle doit être cherchée, c’est qu’elle ne peut être trouvée en prêtant l’oreille. S’il y a processus, c’est dans la mesure où il engage la composition d’éléments hétérogènes, qui doivent demeurer tels ; s’il y a unité, c’est qu’elle ne se conquiert donc pas par l’effacement, ni même par la subsomption de l’hétérogène – en l’occurrence : des formes hétérogènes de subjectivation politique.
N’oublions pas pour autant que la question de la composition avec le monde existant n’est pas, comme chez Hegel, de s’accorder à la loi qui le structure. Il faut ici rester pleinement du côté de la révoltée Antigone – mais d’une Antigone qui ne regretterait pas son geste. La question de la composition de l’hétérogène est attachée aux restes de loi divine, si l’on reprend l’image donnée en commençant, c’est-à-dire à la visée d’une vie délivrée des bassesses et des mutilations qu’on lui impose, et pour cela en conflit irréductible avec la loi humaine entendue comme loi du monde intérieur du capitalisme global.
Composer avec l’existant, c’est composer avec les formes disparates du refus, avec les manières disparates d’envisager une vie ainsi délivrée. Il est vrai que les auteurs du Manifeste prennent acte de la pluralité de ces formes et de ces manières. Dans la proposition « il y a des nous éthiques » (p. 269), le pluriel est essentiel : on peut admettre une diversité de formes données à la consistance éthique, une diversité de formes de vie. Mais dès lors la question est double : elle est d’une part de savoir comment mettre en œuvre la compatibilité de l’hétérogène. Elle est d’autre part de savoir si ce qui relie les différences composables est la dissémination elle-même, c’est-à-dire précisément leur pluralité au regard de l’unité du monde global. Si l’on rejette cette seconde hypothèse, un peu facile et un peu usée, et si l’on considère qu’il faut chercher une unité propre, une unité qui ne se dirait pas seulement en négatif, alors quelque chose doit être ajouté pour relier et nommer l’espace commun que ces différences composent.
L’hypothèse que je ferais est que cet espace commun n’est pas donné par une consistance éthique, mais par une consistance proprement politique. Autrement dit : peut-être faut-il concevoir qu’un espace politique doit venir en supplément des consistances éthiques. Je ne dis pas que ces dernières ne sont pas politiques, mais qu’elles ne sont pas le tout de la politique. Dans le Manifeste, la substance éthique laissée à sa positivité est pensée négativement au regard de l’espace politique auquel elle se soustrait, et cela découle de l’informulabilité des propositions éthiques. Ce n’est pas cette informulabilité que je mets en question, mais la capacité de la consistance éthique à dessiner à elle seule l’espace d’une politique ajustée à la situation globale. Or l’espace proprement politique envisagé comme espace supplémentaire permet une pensée de la positivité du refus, c’est-à-dire qu’il permet de porter le refus lui-même comme affirmation. Pas l’affirmation d’un monde particulier contre celui du capital, ni une simple collection de mondes hétérogènes contre le monde globalisé, mais celle d’autre chose qu’un monde : une visée politique qui a trouvé sa stratégie. Une camaraderie qui s’ajoute aux amitiés éthiques.
Ce qui précède propose donc une articulation dialectique, mais pas avec « la loi humaine », la loi du capital. Le point de vue politique sur la situation actuelle ne peut être seulement celui de la substance éthique. Le point de vue politique suppose une articulation dialectique avec le monde tel qu’il est, via les formes plurielles du refus, et pas une séparation radicale. Le Manifeste n’a pas tort d’insister sur les impasses qui peuvent piéger les mouvements féministes ou décoloniaux – un piège identitaire, sachant que les identités plurielles peuvent être en tant que telles de parfaits objets de gestion ; sachant aussi que dans ses impasses, ces mouvements font proliférer le surmoi de groupe à l’intérieur des cercles militants, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle. Mais il semble difficile de construire un espace politique conséquent sans s’appuyer sur toutes celles et ceux qui, au sein de ces mouvements, ne se laissent pas prendre à ces pièges. Car c’est par là aussi que se forment aujourd’hui des « nous éthiques ».
Dit autrement : on peut difficilement contourner le motif de l’alliance, et c’est par lui que l’on peut appréhender la composition de l’hétérogène. Il est vrai que ce motif peut être entièrement vide ou purement invocatoire, si l’alliance est envisagée comme pure agrégation du disparate, sans aucun trait d’un pensé en tant que tel ; si elle n’est pas unifiée par un objet, un horizon, c’est-à-dire si elle n’est pas porteuse d’une hypothèse politique supplémentaire. Le désastre du monde militant radical est d’être devenu incapable de mettre en discussion, donc en travail, de telles hypothèses, ou seulement de la façon la plus velléitaire. Il a tellement appris à déconstruire son dogmatisme, tellement intégré l’irréductible pluralité des « terrains » de lutte et des formes de vie qu’il semble paniqué à l’idée de porter ce qui ressemblerait même de loin à une nouvelle volonté d’unification. Il se rend ainsi parfaitement homogène à la vision pragmatiste du monde, sans comprendre que celle-ci est précisément ce qui permet à son ennemi de pérenniser sa victoire.
J’indique seulement ici, pour ne pas en rester à la pure invocation, qu’une hypothèse politique susceptible de dessiner un trait d’un reliant des situations et des formes de lutte tout à fait disparates pourrait se dégager des analyses de Jason Moore sur la mise au travail des êtres de nature, qui permettent de mieux voir rétrospectivement la cohésion du processus de l’économie-monde et sa force de destruction des milieux naturels et de leurs habitants – source de la destruction des espèces sauvages autant que des pandémies et du dérèglement climatique, mais aussi de la mise au travail des peuples du monde entier. Le travail n’est pas une « abstraction réalisée », il correspond à l’ensemble des dispositifs concrets de contrainte au travail, qui s’imposent à l’ensemble des êtres de nature, humains ou non, et parmi les humains, que le travail soit reconnu en tant que tel ou non (travail « domestique », travail des esclaves, etc.). Il correspond aussi à l’ensemble des dispositifs tout aussi concrets de captation de l’activité « libre » comme travail dans la mesure où elle est prise dans les circuits de valorisation du capital (marché des données). La contrainte au travail et la captation de l’activité libre comme travail sont le foyer des opérations de contrôle et de suture subjective à l’ordre économique. Car le capital a lui aussi ses lois non écrites. La plus importante d’entre elles concerne la désirabilité du travail : c’est une loi, dans l’espace du capitalisme, que l’on n’y existe que depuis la position que l’on y occupe dans le marché du travail – ou plus généralement, comme sujet productif. Le travail, dans le capitalisme, c’est le nom de la subjectivation pour le capital. D’où l’enjeu du télétravail aujourd’hui, qui est celui d’une avancée dans l’indiscernabilité vie/travail. Le verrouillage des dispositions subjectives est irréversible lorsque cette indiscernabilité elle-même en vient à être désirée en tant que telle.

Il y a encore quelques années il était de bon ton dans certains milieux militants de montrer que l’on avait dépassé les « vieux concepts », parmi lesquels celui de travail. Peut-être ce dépassement peut-il désormais être lui-même dépassé. Il me semble possible de revenir à Marx, ou à Tronti, en rappelant que la lutte contre le capitalisme est une lutte contre le développement économique en tant que tel, c’est-à-dire (en leur adjoignant Jason Moore) contre la mise au travail de tous les êtres de nature pour le capital. Pas tant pour viser la « décroissance », qui demeure trop souvent une proposition éthique sans grande conséquence, que pour viser le cœur de l’ennemi. Une image indiquera peut-être le sens du propos qu’il y aurait à déployer : lorsque nous nous révoltons, nous ne sommes pas des travailleurs, mais des animaux sauvages dont le territoire se réduit chaque jour. Mais le problème n’est pas de passer des luttes de classes aux luttes territoriales ; le problème est d’ensauvager la lutte de classes elle-même.
Que les classes n’aient pas disparu, je veux dire les classes en tant qu’opérateurs de subjectivation politique, c’est aussi ce qu’a montré cette gestion de crise : non seulement parce que les plus pauvres dans l’espace mondialisé ont été les plus exposés, mais aussi parce que le seul mouvement important dans cette période, autour de Black Lives Matter, a aussi été une expression de cette réalité de classes. Si l’on admet cela, on est peut-être à même de tracer la bonne ligne de partage. Mais celle-ci, après avoir été effacée, est chaque jour un peu plus recouverte par un état du monde qui ne semble laisser le choix qu’entre les forces du capital dans sa version néolibérale autoritaire et les forces du capital ancrées dans les formes les plus abjectes de la réaction. Des couches de confusion ne cessent de s’ajouter ainsi les unes aux autres, à différentes échelles, nous sommant de choisir le moins pire contre le vraiment pire, mais dans tous les cas, on sait seulement que ce choix lui-même n’est qu’un degré de plus dans notre aliénation.
Il faudrait donc envisager une supplémentation proprement politique aux espaces de consistance éthique. On admettra que sans substance éthique, la politique demeure purement formelle. Mais cette substance éthique, toujours nécessairement limitée, doit être supplémentée. Les rédacteurs du Manifeste pourraient soupçonner ici une ultime esquive pour retarder le moment de sauter dans la décision radicale qu’ils proposent. Une décision qui ferait que la seule question, la seule urgence, serait d’organiser le décrochage d’avec tout ce qui organise le nouvel espace de la loi humaine. Travail radical de la séparation sans articulation dialectique. Saluons un dernier aspect du livre : au cœur de l’énonciation du Manifeste, il y a l’exigence de ne pas se mentir à soi-même. La question est de savoir si la recherche des articulations dialectiques participe de ce mensonge. Je ne le crois pas, mais c’est bien ce qui devrait être discuté en priorité. Cela supposerait il est vrai que les tenants des positions adverses sur la question acceptent de se parler au-delà du jeu d’accusations réciproques, de procès d’intention et de rivalités par quoi notamment le milieu radical, tel qu’il est, se donne l’illusion d’être vivant.
Notes
- Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 34[↩]
- Voir Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Seuil-Gallimard, 2004 ; et Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable, La Fabrique, 2018[↩]
- Si je parle ici de « domination technocapitaliste », c’est en pensant à ce que dit Tronti : le mouvement ouvrier était la chance unique de civiliser la technique, mais cette chance est passée. Voir Mario Tronti, Nous opéraïstes, L’Éclat, 2013, p. 120-121.[↩]
- disons-la « messianique », au sens donné à ce terme notamment par Agamben dans Le Temps qui reste, Payot, 2000[↩]
- La politique au crépuscule, L’Éclat, 2000 p. 98[↩]
- voir Agamben, Homo sacer, Le pouvoir souverain et la vie nue, Seuil, 1995[↩]
- Blinde Passagiere : Die Corona-Crise und ihre Folgen, Kunstmann, 2022 ; un entretien en anglais de l’auteur sur son livre est disponible en ligne sur le site de la revue Endnotes, ainsi qu’une traduction française sur dndf.org[↩]
- voir l’article de Nathalia Passarinho, Les leçons de la favela de Maré : https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2022/05/20/les-lecons-de-la-favela-de-mare/ ; merci à Denis Paillard de m’avoir indiqué cet article[↩]








