Extrait de La Terre, les Corps, la Mort. Essai sur la condition terrestre, Dehors, Paris, 2022
L’histoire philosophique et religieuse de l’Occident est celle d’une constitution réciproque du déni de la mort et du déni de notre condition terrestre. C’est dans le cadre de ce double déni que s’est imposée peu à peu une représentation dualiste du monde, au sein de laquelle l’être humain a été défini en son essence comme un être étranger à la Terre. Nous avons ainsi assisté, pour reprendre les termes désormais consacrés de Philippe Descola, à l’émergence progressive de deux sphères « autonomes » l’une par rapport à l’autre, de deux régions ontologiques étanches ; c’est le « grand partage » entre la Culture – domaine exclusif des êtres humains, ou tout au moins d’une certaine catégorie d’êtres humains – et la Nature, domaine à l’intérieur duquel furent au contraire inclus non seulement l’ensemble des êtres « non-humains », mais également tous les aspects de la vie humaine associés à la nature, comme le corps1.
Aussi juste que puisse être ce constat à bien des égards, il semble néanmoins que l’usage du terme « autonome » pour désigner le statut acquis par la nature à l’âge moderne ne soit pas totalement satisfaisant. Certes, et c’est là sans doute la principale raison qui pousse Descola à parler « d’autonomisation », la révolution scientifique des xvie et xviie siècles conduit à considérer que tous les phénomènes terrestres sont gouvernés par des lois universelles, qu’ils constituent donc à leur façon une totalité homogène que l’on choisit de désigner sous le nom de « Nature », et qu’ils sont en ce sens précis bel et bien autonomes dans la mesure où ils répondent à une nécessité qui leur est propre. Mais d’un autre côté, si la Terre se trouve exclue des propriétés qui définissent de façon exclusive l’identité du soi ou du sujet humain, si elle est constituée comme son autre, ce n’est pas pour être reconnue et respectée comme telle. C’est au contraire pour être aussitôt incluse dans la sphère de l’agir technique du sujet et intégralement soumise à sa volonté, dans le cadre d’un projet civilisationnel dont le terme ne peut être que l’instrumentalisation intégrale de cet autre, et même, nous l’avons vu, son annulation et sa dévoration. En ce sens, il semble totalement impropre de parler d’autonomie de la nature, et l’on devrait même plutôt parler d’une hétéronomie maximale puisque la nature et les êtres qui la peuplent se voient désormais privés de tout « droit » à poser leurs propres fins, à suivre leur propre cours, à se développer librement et de façon indépendante, et qu’ils sont constamment sommés d’obéir aux finalités qui leur sont assignées par leur maître.
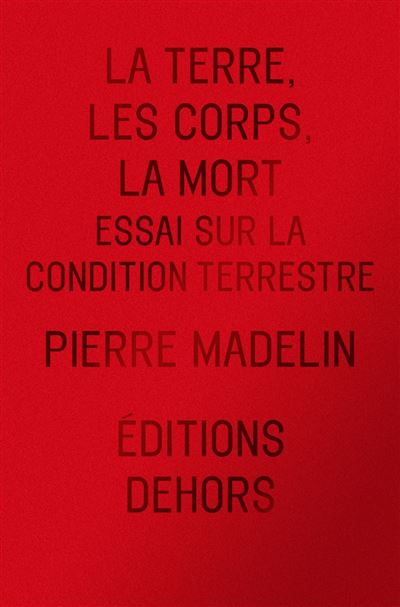
Plutôt que d’autonomie, il semblerait donc préférable de parler d’altérité pour désigner le statut de la nature à l’âge moderne, altérité dont la fonction principale est de conforter l’être humain dans son identité « d’extra-terrestre », ou tout au moins de terrestre différent et supérieur. Car aussitôt reconnue à un niveau ontologique, cette altérité se voit niée et soumise à un niveau éthique, afin de satisfaire les besoins du maître et pour lui permettre d’asseoir son statut de dominant. Aujourd’hui, la géo-ingénierie et le transhumanisme peuvent être considérés, chacun à leur façon, comme l’expression de cette négation radicale de l’autonomie de la nature et du projet de domination absolue qui l’accompagne, révélant un « triomphe unilatéral de la volonté sur le don2 ». Là où la géo-ingénierie se propose de manipuler et de piloter le fonctionnement de la biosphère en coproduisant la composition de son atmosphère, le transhumanisme se propose d’optimiser nos corps via le formatage génétique, quand il n’envisage pas tout simplement d’abolir la condition humaine dans sa dimension incarnée et mortelle.

Au lieu de chercher à dominer le donné et à éradiquer l’altérité qu’il révèle en le soumettant à notre volonté, pourquoi ne pas plutôt, comme nous y invite Geneviève Azam, « considérer que les choses et espèces vivantes, celles qui existent en dehors de l’ingéniosité humaine, qui n’ont pas été créées mais seulement transformées, sont un don dont nous héritons. Un don particulier, sans sujet donateur, mais un don qui nous engage. Recevoir ce don revient finalement à assumer l’humus, la réalité sensible et physique du monde. Et plus encore à faire naître l’altérité des choses naturelles, attestée par leur permanence, leur autonomie et leur efficacité propres. Ignorer le don ou le faire disparaître en refusant de le recevoir accomplit le désir de maîtrise, de possession, de capture des éléments naturels3. » Mais reconnaître l’altérité des « choses naturelles », leur caractère « donné », ne signifie en aucun cas que cette altérité doive être conçue de façon dualiste, dans les termes d’une exclusion radicale. Il serait au contraire tout à fait possible d’admettre que cette altérité est constitutive du soi tout en le dépassant, qu’elle le fonde sans se confondre avec lui, et que c’est à la seule condition de reconnaître ces fondements « autres qu’humains » de son être que l’humain peut habiter la Terre sans la détruire.
En lieu et place d’une configuration où la Terre se trouve exclue de l’identité du soi humain pour être aussitôt soumise à son emprise et à sa volonté, il faudrait au contraire inclure la Terre dans l’identité du soi mais pour aussitôt la libérer, si ce n’est de toute forme d’instrumentalisation – car il est bien évidemment impossible d’habiter le monde sans l’instrumentaliser un tant soit peu, sans en faire usage – tout au moins de tout projet de maîtrise et de tout rapport de domination. Il nous faudrait admettre qu’il y a dans la réalité quelque chose de « donné », et qu’il y a dans ce donné quelque chose d’indisponible, d’irréductible à tout « arraisonnement », à toute entreprise de la volonté humaine. Plus important encore, les êtres humains ne peuvent vivre qu’à condition d’honorer ce donné à la façon dont on honore ses dettes. Cela ne signifie évidemment pas que tout soit bon dans le donné ni qu’il ne faille ménager aucune marge de manœuvre à la volonté humaine, y compris, bien sûr, dans la lutte contre la souffrance, la maladie et la mort. Mais cela signifie en revanche que la liberté ne peut plus être conçue dans les termes d’une toute-puissance qui nie purement et simplement le donné, auquel il faudrait à tout prix « s’arracher », qu’il pourrait au contraire être judicieux de la redéfinir, dans les termes du philosophe américain Michael Sandel, comme « une négociation permanente avec le donné4 ».
Mais s’il a été historiquement si difficile de négocier avec le donné, et même tout simplement de l’accepter plutôt que de le fuir et de le remplacer par des fictions métaphysiques, c’est parce qu’il est le lieu de la naissance et plus encore de la mort. Or ces deux moments-limites de l’existence, les plus importants dans la vie d’un individu, sont également et paradoxalement ceux sur lesquels il n’exerce strictement aucun contrôle, aucune maîtrise. La mort, par la brisure qu’elle trahit dans la structure de l’être, manifeste qui plus est au cœur du donné naturel une puissance privative et traumatisante qui est le contraire même d’un don. Elle constitue ainsi ce que l’on pourrait appeler un indisponible indésirable, tout en révélant au cœur de la condition humaine une impuissance primordiale. Tout l’objet de ce livre a été de montrer que nous cherchons d’une certaine manière à accumuler de la puissance pour conjurer cette impuissance primordiale et pour jouir de l’illusion de l’immortalité qu’elle nous procure. Nous refoulons la mort, car celle-ci est un défi posé à notre propre puissance : elle règne là où nous voudrions régner. Altérité radicale échappant à notre maîtrise, la mort devient un motif de honte et de ressentiment, comme l’avait bien vu Günther Anders5. Or la honte et le ressentiment, nous le savons au moins depuis Nietzsche, appellent la vengeance : nous voulons maîtriser et éradiquer la nature pour nous venger d’être mortels, pour que la mort, enfin, entre elle aussi dans le champ des réalités disponibles et appropriables.
Mais qui refoule la mort la sème et la répand, car il ne peut le faire sans refouler dans un même geste la vie, celle-ci étant, en un sens non seulement métaphorique mais également biologique et écologique, intimement liée à la mort. Aussi les corbillards luisants qui glissent silencieusement à la périphérie de nos villes pour conduire les morts à leur dernière demeure dans l’indifférence générale sont-ils indissociables de ces zones mortes qui ne cessent de croître dans les océans, ou encore de ces millions d’hectares de forêts qui disparaissent chaque année dans le vrombissement des tronçonneuses pour laisser place aux monocultures et aux pâturages extensifs. Ces mourants qui peuplent hôpitaux et maisons de retraite à l’abri des regards indiscrets ne se comprennent pas sans ces millions d’animaux quotidiennement abattus dans d’autres mouroirs préservés des regards, ou sans ces milliers d’espèces qui s’éteignent et sont autant de maillons brisés dans la chaîne du vivant. Ces corps qui se rêvent éternellement jeunes, libérés de la tyrannie du vieillissement et de la mort, ne peuvent se comprendre sans ces multiples territoires saccagés et engloutis par la voracité d’une économie gouvernée par un principe d’illimitation absolue. Cette incapacité à habiter la Terre dont témoignent les mines à ciel ouvert répandant leurs poisons dans les fleuves et les sols, les continents de plastique qui flottent à la surface des mers ou les déserts biologiques de l’agriculture industrielle ne sont jamais que l’écho d’une incapacité intime à accepter, à habiter la mort.
C’est qu’un sujet indestructible ne meurt pas. Aussi peut-il, sans en être affecté, consommer et dévorer le monde jusqu’au dernier arpent. Il est manifestement impossible de tenir compte de la vulnérabilité de la Terre, d’accorder la moindre importance à la fragilité des territoires qui la composent, tant que l’on n’a pas pris acte de notre propre fragilité et de la dépendance structurelle qu’elle révèle vis-à-vis des autres, humains ou non-humains. Ceci explique qu’il n’y ait en réalité pour le sujet indestructible que deux avenirs possibles : soit il continue à imposer ses normes à l’ensemble des humains, et alors il s’autodétruira et entraînera dans sa perte des pans entiers de l’humanité et de la biosphère ; soit il s’efface au profit d’une subjectivité vivante, incarnée et mortelle, susceptible d’assumer jusqu’au bout la fragilité inhérente à sa condition. En ceci, il y aurait sans doute beaucoup à apprendre de la figure d’Ulysse telle qu’elle nous a été dépeinte par Homère dans l’Odyssée.
Alors qu’il cherche à rentrer chez lui après la longue guerre menée à Troie en compagnie d’autres guerriers grecs, Ulysse, « qui pendant des années erra6 » et qui a déjà traversé mille épreuves, se retrouve prisonnier « dans la demeure de la nymphe Calypso qui le retient contre son gré7 ». Calypso, désireuse de plaire à Ulysse et d’adoucir les peines causées par son exil, « ne cesse de l’assiéger d’insidieuses douces litanies, pour qu’il oublie Ithaque8 ». « Calypso sut me choyer, me nourrit, me promit de me rendre immortel et jeune pour toujours9 » relate Ulysse par la suite. Et Calypso lui propose en effet de devenir immortel, « malgré ton désir de revoir cette épouse que tu espères tous les jours10 ». Ce à quoi il répond : « Pénélope est mortelle, tu ignores l’âge et la mort. Et néanmoins, j’espère, je désire à tout moment me retrouver chez moi et vivre l’heure du retour10. » Car « je ne connais rien de plus beau que cette terre » et « il n’y a rien pour l’homme de plus doux que sa patrie »11.

Ulysse, qui aurait été immortel mais aurait continué à vivre en exil s’il avait décidé de rester avec Calypso, choisit donc de retrouver Pénélope et de rentrer chez lui en dépit de la mort qui, tôt ou tard, l’y cueillera. Bien qu’il s’agisse d’une lecture extrêmement libre de l’Odyssée et que telle n’ait sans doute pas été l’intention explicite d’Homère, il faut saluer le geste du poète dans ce texte, diamétralement opposé au geste inaugural de la métaphysique occidentale qui sera quelques siècles plus tard celui de Platon. Homère établit en effet ici une équivalence insurmontable entre la Terre-foyer et la finitude d’un côté, et l’exil et l’immortalité de l’autre.
Tel Ulysse, nous autres modernes – ou tout au moins un certain type d’être humain moderne – n’avons cessé de livrer bataille à la Terre, en une guerre de conquête et de domination dont les effets dévastateurs se font chaque jour plus sensibles. Cette guerre, nous ne pouvons pas la gagner. Peu importe que nous fourbissions des armes toujours plus redoutables et élaborions des stratégies sans cesse plus complexes. Si nous sommes condamnés à la défaite, c’est avant tout parce que c’est aussi à nous-mêmes, créatures terrestres pétries dans la même glaise que le reste des vivants, que nous la livrons. Mais au milieu des cendres fumantes du désastre en cours, un nombre croissant de collectifs et d’individus ont décidé de réaffirmer leurs liens avec la Terre. Certains, indigènes canadiens ou mexicains, paysans chinois ou africains, n’étaient jamais partis, et luttent aujourd’hui pour ne pas être emportés par les puissances mortifères de l’exil. D’autres – zadistes, décroissants ou étudiants des grandes métropoles en rupture de ban –, depuis longtemps enrôlés par les puissances de la destruction, ont décidé de déserter et de prendre le chemin du retour, d’appareiller en direction de notre Terre-Ithaque.
D’autres encore, hésitants, s’interrogent. Non seulement parce que le chemin du retour est semé d’embûches et de difficultés, mais parce qu’il arrive aussi que la voie de l’exil s’annonce prometteuse, parce qu’au milieu des ruines s’élève encore le chant des sirènes, les « insidieuses douces litanies » qui nous promettent l’abondance, le confort et même, chaque jour un peu plus, la jeunesse éternelle et l’immortalité. Calypso a cédé la place au Capital tout-puissant, à ses fantasmes et à ses projets délirants, véritable « dragon-tyran » de notre époque, qui nous retient prisonniers d’un rapport appauvri au monde et à nous-mêmes, mais également destructeur et autodestructeur.
Ce sont les chaînes puissantes de ce geôlier, dont les charmes et les promesses n’ont rien à envier à ceux de la déesse, qu’il nous faut rompre. C’est à cette condition, et à cette condition seulement que nous retrouverons notre Terre-Ithaque, que nous pourrons habiter à nouveau ce monde que nous avons cessé d’habiter. Mais il nous faudra alors, comme Ulysse, renoncer aux rêves d’immortalité, affronter cette vérité ancestrale que nous avons manifestement encore tant de mal à accepter : la Terre est le lieu où nous mourrons et verrons mourir les êtres aimés. Tel est le prix à payer pour que cesse enfin l’exil et la course folle de notre errance destructrice, et pour que la Terre redevienne enfin, pour tous ses habitants, un foyer.
Notes
- Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.[↩]
- Michael Sandel, Contre la perfection. L’éthique à l’âge du génie génétique (2007), Paris, Vrin, 2016, p. 63.[↩]
- Geneviève Azam, Osons rester humains. Les impasses de la toute-puissance, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015, p. 217.[↩]
- Michael Sandel, Contre la perfection, op. cit., p. 62.[↩]
- Voir L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle (1956), Paris, L’Encyclopédie des nuisances, 2002 p. 68-69, où Günther Anders écrit : « La seule chose qui ne soit pas notre œuvre, c’est notre propre mortalité. Elle seule n’est pas calculée. C’est pour cela qu’elle constitue un motif de honte. »[↩]
- Homère, L’Odyssée, Paris, La Découverte, 2017, p. 11.[↩]
- Homère, ibid., p. 79.[↩]
- Homère, ibid., p. 13.[↩]
- Homère, ibid., p. 128.[↩]
- Homère, ibid., p. 97.[↩][↩]
- Homère, ibid., p. 155.[↩]








