Ce texte est disponible en livret à imprimer ici.
À propos de Matthieu Ansaloni et Andy Smith, L’expropriation de l’agriculture française. Pouvoirs et politiques dans le capitalisme contemporain, Paris, Éditions du Croquant, 2021.
Invoquant les risques de crise alimentaire mondiale suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la FNSEA, principal syndicat agricole en France, a demandé un assouplissement des (déjà fort peu contraignantes) règles environnementales de la Politique agricole commune (PAC). Il s’agit notamment de permettre la culture de zones sensibles sur le plan écologique (jachères et infrastructures agroécologiques : haies, bosquets, mares, etc.). Ce en quoi elle a été immédiatement soutenue par le ministère de l’Agriculture. Pourtant l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) indique que l’année 2022 sera globalement dans la moyenne de production des dernières années1. En moyenne depuis plusieurs années, la production de céréales mondiale serait à même de nourrir environ 12 milliards d’êtres humains. Plus que jamais, les crises alimentaires sont des problèmes politiques d’accès et non pas des questions agronomiques de production.
Comment expliquer alors ce soutien irrationnel à première vue de l’État français à ces demandes du syndicalisme agricole dit « majoritaire » (car il gagne les élections professionnelles agricoles) ? Ces deux protagonistes forment depuis au moins 70 ans un couple soudé au service de l’accumulation capitaliste dans l’agriculture française. Toute autre perspective ou considération (la sécurité alimentaire nationale ou mondiale, la préservation de l’environnement, l’emploi paysan, la qualité de vie dans les campagnes, etc.) n’est qu’une question d’affichage dans l’agenda agricole français. Le fonctionnement de cette rationalité capitaliste est au cœur du livre de Matthieu Ansaloni2 et Andy Smith3 : L’expropriation de l’agriculture française. Pouvoirs et politiques dans le capitalisme contemporain. Ces deux sociologues se proposent d’y analyser les rapports de pouvoir dans l’agriculture française contemporaine, dans un contexte surdéterminé par des impératifs économiques capitalistes. Ils y décrivent comment l’alliance de l’élite agricole à l’État au service de l’accumulation de capital dans les filières agricoles et alimentaires a transformé à marche forcée l’agriculture française, notamment en dépeuplant les campagnes. La part d’agriculteur·rices dans la population active française est passé de 31 % en 1950 à 2,5 % en 2020.
L’accumulation du capital, œil du cyclone des bouleversements agricoles en France depuis les années 1950
Une sociologie du pouvoir dans l’agriculture française
En 2017, François Purseigle, Geniève Nguyen et Pierre Blanc avaient amorcé la description du Nouveau capitalisme agricole4. Ils y décrivaient, entre autres, les nouvelles formes prises par les exploitations agricoles françaises qui ressemblent de plus en plus à des firmes. Malheureusement, cela restait purement descriptif sans s’intéresser aux relations de pouvoir et encore moins à leurs conséquences. S’il propose une description plus légère du capitalisme agricole contemporain, le livre de Smith et Ansaloni va beaucoup plus loin dans la compréhension de son intégration dans l’histoire, l’économie et la société française. Il s’inscrit dans une tradition sociologique d’analyse critique des transformations de l’agriculture en France qu’elle complète, prolonge et ramasse5. Ce livre sera utile à elles et ceux qui essayent de comprendre comment la Fin des paysans, déjà annoncée par Henri Mendras dans les années 19706, s’est muée en une lente agonie qui paraît paradoxalement sans fin7.
La persistance du « fordisme », produire en masse pour consommer en masse
Le livre s’attache à démontrer que l’agriculture française est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un régime d’accumulation fordiste. Il s’appuie en cela sur la théorie de la régulation8 développée, entre autres par le sociologue Robert Boyer, sous l’égide duquel les auteurs se posent. Ce régime d’accumulation se caractérise par le branchement d’un régime de production de masse sur une consommation de masse. Il passe par la spécialisation des tâches des travailleur·ses et la standardisation de la production permettant cette massification selon une rationalité productiviste dans un espace national avec une régulation étatique forte. Ce régime d’accumulation a permis le développement de l’accumulation capitaliste dans tous les secteurs des économies occidentales au XXème siècle, mais il a été remis en cause pour son inadaptation à la globalisation de l’économie dans la mondialisation.

La thèse centrale du livre est que ce régime persiste pourtant dans l’agriculture française jusqu’à aujourd’hui. Il y a une continuité du régime d’accumulation fordiste, même après que la puissance publique eut abandonnée l’organisation directe des marchés agricoles, notamment via la Politique agricole commune de l’Union européenne ; et ce malgré les crises économiques, sociales et environnementales traversées par le monde agricole. Est ici décrit le passage d’un régime « fordiste version dirigiste » (1960-1990) à un régime « fordiste version libre concurrence » (1990-2020).
Ce dernier fait fortement penser à ce qu’il est désormais convenu d’appeler le néolibéralisme, sans que ce terme ne soit mobilisé par les auteurs. Ainsi, la libéralisation de l’agriculture française n’a pas amené à une « économie de la qualité » structurant et segmentant les marchés agricoles selon divers type de qualités répondant aux attentes des consommateur·rices. La production sous signe de qualité (bio, label rouge, etc.) est marginale dans la consommation française qui reste construite par l’offre, c’est-à-dire par la production agricole. La majorité de la production est de masse et standardisée. Pour les auteurs, l’évolution de l’agriculture française des années 1950 à nos jours ne se déroule ni en vase clos selon des logiques internes à l’agriculture, ni n’est déterminée par la compétition économique internationale et sa globalisation : elle est « le produit d’une construction politique, contingente, en ce qu’elle aurait pu prendre des formes bien différentes » (p. 14). Ce constat n’est peut-être pas original, mais renforce encore celles et ceux qui croient qu’une autre agriculture est possible.
Décrypter les jeux de pouvoir à l’œuvre dans l’accumulation fordiste agricole française
Une fin des paysan·nes « planifiée »
L’histoire de l’accumulation dans l’agriculture française révèle un processus d’expropriation et d’exclusion d’une partie majeure des paysan·nes entre 1945 et 1992. Cette expropriation, a été théorisée a priori par les élites du syndicalisme agricole du Cercle des jeunes agriculteurs (CNJA, l’ancêtre du syndicat Jeunes agriculteurs d’aujourd’hui) dans la « thèse des trois agricultures » dans les années 1950. Les plus petites fermes, considérées comme arriérées et incapables de se moderniser, doivent disparaître pour libérer des surfaces et renforcer les revenus des fermes dans la moyenne des surfaces de l’époque. Les plus grosses fermes doivent, elles, ne pas s’agrandir. Il s’agissait de s’engouffrer dans la modernité, mais sans susciter la résistance massive qu’aurait généré dans la paysannerie française une industrialisation agricole ne conservant que les plus grandes fermes. Sans surprise, la politique gaullienne de modernisation agricole qui va en découler, notamment par les lois de 1960 et 1962 (politique des structures), va justement bénéficier à cette élite agricole (p. 29). Cette modernisation agricole est en fait la conversion d’une partie des agriculteur·rices à l’économie capitaliste et l’élimination des autres, qui ne peuvent ou ne veulent réaliser cette conversion. L’exode rural qui s’ensuit profite aux bras de l’industrie et à la tertiarisation de l’économie.

Cette conversion à l’économie capitaliste n’est pas pour autant une évolution naturelle inéluctable. Elle demande une action publique très importante. Celle-ci passe notamment par la création du Crédit Agricole et sa mise sous tutelle du Trésor public jusqu’en 1963. Même ensuite, l’État garantit les prêts du Crédit Agricole pour permettre aux agriculteur·rices restant·es de concentrer toujours plus leurs moyens de production. Rien qu’entre 1950 et 1970 le capital par actif agricole a doublé (p. 41). L’endettement croissant des agriculteur·rices financé par la puissance publique n’est pas une aumône, elle est un levier puissant d’orientation des pratiques agricoles. Au-delà du crédit, c’est la PAC qui va organiser les marchés et garantir les prix agricoles, pour permettre aux agriculteur·rices de justement rembourser les prêts contractés pour concentrer les moyens de production.
Ainsi, « l’alchimie entre la “politique des marchés” (soutenant les revenus agricoles) et la “politique des structures” (éliminant ceux qui ne peuvent ou ne veulent investir9 accentue nettement, à partir de la fin des années 1960, les taux d’endettement [des agriculteur·rices français·es] » (p. 54). L’encours de prêts agricoles en France double entre 1960 et 1965 en francs constants, et double presque de nouveau entre 1965 et 1970. Le tout est planifié et accompagné par la puissance publique incarnée en l’occurrence par le Commissariat au Plan10. Malgré des crises majeures de surproduction agricole dues aux politiques de prix dès les années 1970, la PAC ne sera réformée en profondeur et libéralisée qu’en 1992.
Libéralisation de l’agriculture française : tout changer pour que rien ne change
À partir des années 1990, la libéralisation de l’agriculture, et des politiques qui l’encadre, dans le sillage de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) puis de l’Organisation mondiale pour le commerce (OMC), fait basculer le régime d’accumulation de l’agriculture française dans un « fordisme version libre-échange ». La PAC va alors donner un filet de sécurité aux revenus des plus gros agriculteur·rices, par des aides directes proportionnelles à la production puis à la surface des exploitations. Mais la baisse du nombre de paysan·nes crée une asymétrie de pouvoir dans les filières entre les agriculteur·rices et l’amont et l’aval (agrofourniture et semences d’un côté, agroalimentaire et grande distribution de l’autre), qui va permettre à ces deux derniers maillons de capter la plus-value produite dans l’agriculture (p. 101). Ainsi, la promesse faite aux paysan·nes de bénéficier de l’entrée dans le capitalisme ne sera pas tenue. Les groupes coopératifs de fourniture, de transformation et de commercialisation mis en place par les agriculteur·rices sont mis en concurrence sur le marché capitaliste et vont adopter des pratiques capitalistes au détriment de leurs coopérateur·rices, jusqu’à devenir des mastodontes de l’agroalimentaire comme les autres. Ainsi, ces coopératives conçues comme une mise en commun au service des agriculteur·rices, vont devenir la porte d’accès au pouvoir dans les filières agricoles des quelques membres ayant accédé à leur direction. En effet, dans ces filières le profit, et donc le pouvoir, se concentre dans les entreprises de l’amont et l’aval. On peut considérer ces dernières comme des exploiteurs (au même titre que les banques et les rentiers terriens) des agriculteur·rices considéré·es en tant que travailleur·ses (même s’ils sont techniquement des travailleur·ses indépendant·es).

Les nouvelles politiques publiques ne vont nullement enrayer l’expansion d’une agriculture industrialisée, capitalisée et une production de masse standardisée dopée aux intrants chimiques. L’émergence de signes de qualité (origines contrôlées, label rouge, etc.) ne produit pas une émancipation du régime de concurrence général. Ces signes de qualité perdent presque systématiquement leur sens pour devenir les arbres qui cachent la forêt de la production de masse par un agroalimentaire industriel qui les récupère abondamment. Et malgré la mise à l’agenda des questions environnementales, les auteurs remarquent la relative faible progression de la consommation de produits issus de l’agriculture biologique. Une part substantielle et croissante de cette production est récupérée par l’industrie : « [la bio] tend à prendre la forme d’un instrument aseptisé de la “modernisation agricole” » (p. 95). De même, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles, en concurrence avec la production standardisée à bas prix, ne parviennent pas à infléchir la trajectoire dominante de l’agriculture.
Les grands groupes industriels de l’aval « ont réussi l’exploit de définir ce qui constitue la “demande alimentaire” […] en invoquant la figure du “consommateur” qui, sociologiquement, n’existe pas. » (p. 102). Si les auteurs ne développent pas cette dernière idée, on peut penser aux « demandes du consommateur » érigée en justification de toutes les stratégiques des industriels de l’agroalimentaire et de la distribution, alors que les consommateurs sont extrêmement hétérogènes dans leurs besoins, et que leurs demandes sont fortement construites par la publicité et l’offre limitée de produits disponibles dans des lieux précis de distribution. Tout cela a permis de construire pour la Fédération nationale des exploitants agricoles (FNSEA), syndicat agricole majoritaire, et les pouvoirs publics un discours sur la « coexistence » de formes d’agriculteurs (de masse et de qualité) alors que ces dernières sont en concurrence, la première détruisant la deuxième.
Les aides de la PAC sont à envisager comme des primes dirigées vers les exploitations agricoles déjà les plus dotées en capital et donc comme instrument politique de la reproduction et de la concentration du capital. Ainsi, les aides de la PAC sont majoritairement distribuées à concurrence de la surface des fermes. Mais, les aides à l’installation, distribuées aux jeunes agriculteurs, le sont selon des règles qui aboutissent aussi à favoriser les mieux dotés : la valeur de la dotation jeune agriculteur (DJA)11 augmente aussi avec la taille des exploitations.

Loin du contenu du discours libéral sur la libre concurrence, ce système maintient une agriculture française économiquement moins rentable que celles des autres pays européens. En effet, le profit en France est concentré dans d’autres secteurs économiques comme l’amont et l’aval des filières agricoles et alimentaires. L’accumulation n’est pas un processus économique autonome, mais bien une construction politique issue de la collaboration entre l’État et l’élite des syndicats agricoles majoritaires. « Le ”bon” agriculteur de la PAC contemporaine n’est pas celui qui se distingue par ses pratiques agricoles, mais par ses pratiques de prédation des terres que cultivaient jadis ses voisins. » (p. 143)
Porosité des élites agricoles : syndicales, politiques, académiques et industrielles
Pour conclure le livre, les auteurs s’attachent à décrire finement qui sont les « expropriateurs en chef » (p. 143), entre élite syndicale agricole, dirigeant·es de l’agroalimentaire ou de la recherche agronomique, agent·es de la haute fonction publique et personnel politique. Il en ressort que « loin d’assurer la défense des agriculteurs, les édiles syndicaux favorisent le déclassement de la majorité d’entre eux au profit d’une fraction ascendante ». Cependant, il ne s’agit pas d’un phénomène seulement corporatiste, ni même des institutions agricoles, mais bien de tout l’État français, et ce malgré les alternances politiques. En cela l’État peut s’appuyer sur un corps de fonctionnaires, les Ingénieurs des ponts, eaux et forêts (IPEF), construit au service de l’accumulation fordiste et sur une recherche agronomique dont la majorité des agent·es partage les orientations, voire les intérêts de l’État, de l’agroalimentaire et de l’élite syndicale agricole. Tous ces acteurs peuvent avoir des buts différents (carrière dans la haute fonction publique, carrière politique, reconnaissance académique, développement entrepreneurial, etc.) et ne se concertent pas toujours ensemble. Cependant, tous profitent de la pérennité du régime d’accumulation fordiste établie de longue date dans l’agriculture française pour asseoir leur domination dans leur champ social respectif. En adhérant à ce fordisme agricole, ils garantissent leur position sociale, et perpétuent ce système économique et politique dans un cycle qui semble sans fin.
Cette confusion et collusion avec l’État se révèle à travers le pantouflage de haut·es fonctionnaires dans les grandes entreprises industrielles de l’amont et de l’aval agricole, où la plus-value des filières est captée. Au final, qu’importent les convictions des agent·es des champs agricole, syndical ou politique, ils n’ont d’autre choix que d’adhérer et de participer à cette accumulation ou d’être exclu·es de l’agriculture. Ainsi pour accéder à la plus haute responsabilité syndicale de l’agriculture française, l’actuelle présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a dû abandonner toutes les positions antagonistes à la ligne générale de la FNSEA qu’elle tenait lorsqu’elle était présidente du syndicat Jeunes Agriculteurs12 (JA) (p. 159).
Comprendre les ressorts du capitalisme agricole pour mieux le désarmer
Dissection de la « cogestion »
Un des grands apports du livre est de fournir une description du phénomène dit de cogestion dans l’agriculture française, c’est-à-dire la collusion entre l’État et une élite syndicale agricole qui coproduisent les politiques et les marchés agricoles de concert, et comment elle se reproduit à travers les décennies. Cette cogestion est souvent décriée, et a été maintes fois analysée. L’apport du livre réside dans sa méthode analytique, certes très classique, mais qui rigoureusement mise en œuvre lui donne une grande force démonstrative.
Le dernier chapitre montre aussi que l’élite agricole impliquée dans cette cogestion ne restreint pas son activité à la production agricole, mais étend son pouvoir dans divers maillons de la filière (stockage, transformation, etc.). On peut imaginer qu’elle y fait des profits plus intéressants que ceux possibles via l’activité agricole au sens strict, peu productive de valeur ajoutée en France. En effet, la rationalité agricole toujours centrée sur la production à outrance ne garantit pas de profit dans l’acte productif agricole. Les charges de production, notamment liées à l’équipement et à l’énergie, sont élevées et la production de masse induit des prix agricoles bas. Cette faible efficacité économique nécessite d’ailleurs le soutien des revenus agricoles par la PAC. Comme déjà évoqué ci-dessus, le profit se fait ailleurs dans la filière.
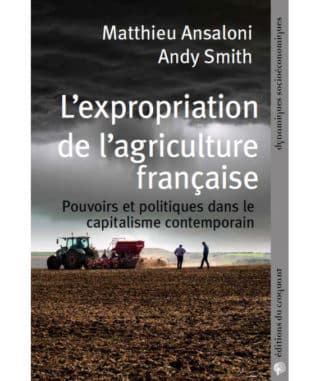
Si ce n’est pas forcément le but du livre, ce dernier sera d’une grande aide pour tout·e militant·e souhaitant comprendre et agir sur et dans le monde agricole en France. Mais la démonstration va un cran plus loin en montrant que cette cogestion est bien au service du développement à marche forcée du capitalisme en France et des intérêts de grands groupes industriels au détriment des agriculteur·rices et de l’espace rural. La collusion des intérêts étatiques (pour ne pas dire publics) et professionnels au service de l’accumulation du capital n’est pas propre à l’agriculture et à la France, mais on trouve ici un véritable cas d’école.
Les limites de la démonstration
La contrepartie de la force démonstrative du livre évoquée ci-dessus est un certain nombre d’angles morts et la frustration de ne pas les voir abordés. On pense en premier lieu à un outillage sociologique bourdieusien classique qui implique une vision surplombante presque déterministe, voire fataliste, des mécanismes sociaux. Ce n’est pas forcément un problème pour l’analyse descriptive, mais cela se ressent dans les solutions proposées en conclusion. On peine à comprendre comment les agriculteur·rices et la société arriveraient à mettre en place les quelques préconisations évoquées en fin d’ouvrage (détaillées ci-dessous), face à l’implacable rouleau compresseur de l’accumulation fordiste.
La méthode analytique très classique adoptée par les auteurs les amène à ne s’occuper que des acteurs qui ont le pouvoir. Cette démarche conduit à faire l’impasse sur les luttes et les résistances au processus de modernisation de l’agriculture française.

Elles ont pourtant été nombreuses. On peut regretter ainsi que le chapitre 1 (« Le modèle de développement agricole entre 1945 et 1992. Sociohistoire d’une accumulation tirée par l’administration de la demande ») n’ait pas un pendant qui aurait révélé une socio-histoire des luttes paysannes des résistances à la modernisation. Ils auraient, par exemple, pu partir des travaux de Michelle Salmona sur la souffrance des paysans13 et des critiques de la modernisation agricole qui les ont suivis14. Il est remarquable d’ailleurs que ce terme de modernisation agricole ne soit pas utilisé en tant que tel dans le livre. On aimerait savoir si c’est un simple choix de vocabulaire ou une rupture par rapport aux travaux cités ci-dessus. Enfin, une histoire populaire des luttes paysannes a été esquissée lors d’un atelier des journées Reprises de terres à Notre-Dame-des-Landes à l’été 202115.
Enseignements politiques pour lutter
Nombre des démonstrations du livre étayent les critiques des systèmes agricole et alimentaire français porté par l’Atelier paysan dans leur récent essai Reprendre la terre aux machines16, qui tente de repolitiser la critique actuelle des systèmes agricoles et aliemntaires. Pour eux, cette critique semble parfois se perdre dans des questions telles que comment faire une agronomie durable ou développer un label de commercialisation, etc. Selon l’Atelier paysan, ces questions purement techniques et sectorisées se révèlent inoffensives pour lutter efficacement contre le capitalisme agro-alimentaire. D’ailleurs, les critiques (constructives) de Smith et Ansaloni et de l’Atelier paysan sur le label Agriculture biologique ou les circuits courts semblent très convergentes. Ainsi, l’Atelier paysan analyse que l’agriculture biologique est devenue un « complément de gamme de l’agriculture industrielle ».
En revanche, les deux livres divergent sur les réponses à apporter. La conclusion de l’ouvrage de Smith et Ansaloni est l’occasion pour eux de faire quelques préconisations pour espérer sortir l’agriculture française de ce régime d’accumulation fordiste. Les aides publiques doivent aller prioritairement vers les tenant·es d’une agriculture plus écologique ou viser la lutte contre les inégalités de capital au démarrage de l’activité agricole. Plus généralement, les politiques agricoles doivent servir à résister à la spécialisation agricole des territoires et à relocaliser la production à proximité de la consommation. Et enfin, ces politiques doivent s’appuyer sur un triptyque : planification, contractualisation et régulation des marchés et des prix agricoles. Ainsi, selon Smith et Ansaloni la solution ne peut venir que d’une politique de l’offre (changement endogène de l’agriculture). Au contraire, l’Atelier Paysan appelle à un renversement vers une politique de la demande (modification exogène de l’agriculture pour répondre à la demande sociale alimentaire). Cette divergence est peut-être à rattacher à la vision surplombante décrite ci-dessus. Smith et Ansaloni en restent à leur critique (pertinente) du consommateur·rice comme illusion construite par l’agroalimentaire. Ils n’envisagent pas qu’un mouvement social cherche à prendre en charge la construction démocratique des mangeur·ses comme sujet politique. C’est pourtant ce que l’Atelier paysan défend avec le collectif Pour une sécurité sociale de l’alimentation17.
En expliquant ainsi que l’agriculture française, malgré ses normes, labels et certification n’est pas sortie d’un régime de production de masse branché sur une consommation de masse (fordiste), les auteurs s’éloignent du modèle dominant des sciences sociales critiques qui s’intéresse aux « régimes agroalimentaires » (food regimes en anglais18.) Ce dernier postule la mise en place d’une économie de la qualité déterminée par les demandes sociales des consommateurs, notamment en matière d’environnement. Ils s’éloignent aussi de ce modèle en postulant que les déterminants centraux du régime sont avant tout nationaux, là où les théories des « régimes agroalimentaires » expliquent le fonctionnement de ces derniers par une hégémonie internationale, dans la droite lignée de l’idée d’économie-monde de Fernand Braudel19. Il ne s’agit pas là d’une simple querelle de chercheur·ses, la position de Smith et Ansaloni donne l’indication qu’il est important et nécessaire de mener la lutte contre le capitalisme agricole à l’échelle nationale.
À l’heure de crises alimentaires majeures provoquées par une déstabilisation des échanges internationaux de céréales suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il serait présomptueux de penser que la France qui est une grande exportatrice de céréales ne soit pas affectée par les marchés internationaux. Cependant, notre espace national présente une histoire agricole spécifique qui mène à la cogestion telle que critiquée ci-dessus. Pierre Muller20 rapporte par exemple que l’élite agricole française au sein du Cercle national des jeunes agriculteur (CNJA, ancêtre du syndicat JA) est une des seules à avoir accueilli favorablement le plan de modernisation de l’agriculture européenne du commissaire Mansholt dans les années 197021, alors que les autres syndicats européens s’y opposaient farouchement. Il est donc plausible de postuler une certaine autonomie nationale du champ agricole en France. Ainsi chercher à détricoter la cogestion État-syndicats majoritaires en France n’a certainement rien perdu de sa pertinence et pourrait dégager des marges de manœuvre politique agricole émancipatrice en France. On pense par exemple à ce que pourrait être des chambres d’agricultures émancipées de la cogestion.
Il en résulte un dernier enseignement pour nos luttes. Seules, la résistance corporatiste et la bataille pour l’hégémonie syndicale en France ne seraient pas à même de transformer l’agriculture. En complément, elles nécessitent des stratégies s’attaquant aux politiques publiques et aux maillons amont et aval des filières agricoles et alimentaires. C’est ce que s’emploient à faire, avec un succès très mitigé pour l’instant, de larges coalitions d’acteurs et d’organisations de défense de l’environnement et de bien-être animal, de solidarités, de consommateur·rices et de la gauche paysanne22 pour tenter d’influencer les politiques publiques agricoles ou dénoncer l’agrochimie et l’agroalimentaire industriel.
On peut aussi noter que la Confédération paysanne a récemment appelé à voter aux élections législatives de 2022 pour les candidat·es de la Nouvelle alliance populaire écologiste et sociale (NUPES) qui regroupe les principaux mouvements et partis de gauche actuellement. Il s’agit d’une rupture forte avec l’indépendance syndicale habituellement revendiquée par ce syndicat23. Ces stratégies « non-corporatistes » ne sont pas sans créer des tensions sur le leadership des luttes et la légitimité à définir leurs objets entre organisations paysannes et organisations citoyennes24.
La terre invisibilisée
Enfin, un dernier manque de l’ouvrage est la faible importance accordée à l’accès à la terre, à la concentration de sa propriété et à l’évolution des politiques publiques régulant cet accès. Ainsi, des organisations comme les SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ne sont que mentionnées et leur gouvernance n’est pas du tout étudiée, de même pour les Chambres d’agriculture. C’est d’autant plus dommageable que dans une économie capitaliste complexe le rôle des propriétaires du foncier, grand·es absent·es du livre, tend à se confondre avec celui des banquiers, eux bien analysés dans l’ouvrage25. Sur ce sujet, un récent livre de la journaliste Lucile Leclair26 essaye d’illustrer une tendance à l’accaparement de terres hexagonales par de grands groupes, phénomène dont la France était plutôt préservée jusqu’alors. C’est la fin logique de l’expropriation décrite par Smith et Ansaloni qui aboutit à une agriculture de firme où il n’y a même plus d’agriculteur·rice à exproprier, et où le travail agricole résiduel est un travail uniquement salarié. Autrement dit, l’agriculture française est peut-être en train de finir sa transition capitaliste vers cette agriculture de firme prédite par Karl Marx dans les années 1870.
Notons à ce sujet que le recensement agricole de 2020, récemment publié, confirme la continuation des tendances dessinées dans le livre. Entre 2010 et 2020, la France a encore perdu 80 000 équivalents d’emploi agricole. Et une nouvelle tendance se dessine et confirme la lente conversion à une agriculture de firme : la progression significative de la proportion des emplois salariés par rapport à ceux des emplois de chef·fes d’exploitation (travailleur·ses indépendant·es). Ce recensement confirme aussi la concentration des moyens de production agricole entre les mains de moins en moins de personnes : dans la dernière décennie, la France a perdu 100 000 fermes (unités de productions agricoles) et la taille moyenne de ces fermes est passée de 56 hectares à 69 hectares (contre 24 hectares en 1988). Dans son Rapport sur l’état des terres de 2022, l’association Terre de Liens relève même que « les grandes exploitations d’une surface moyenne de 136 ha, quasi inexistantes il y a 60 ans, représentent aujourd’hui une ferme sur cinq et couvrent 40 % du territoire agricole métropolitain27.
Si la thèse de L’expropriation de l’agriculture française n’est pas forcément originale, ce livre vient prolonger de manière étayée et ramassée la critique du capitalisme agricole qui s’est installée en France depuis les années 1950. En cela, il est utile pour étayer les témoignages, enquêtes journalistiques, études scientifiques et intuitions empiriques pour comprendre le fonctionnement social de ce que le journaliste Gilles Luneau a qualifié de Forteresse agricole28. D’ailleurs, cette forteresse ne se résume pas à la FNSEA comme le laisse penser le sous-titre de ce dernier ouvrage, mais bien à des réseaux de pouvoir public et privé. Le livre de Smith et Ansaloni est une brique nécessaire à l’édification de tout argumentaire sur la question agricole française contemporaine et à la compréhension de l’interminable destin de la modernisation agricole en France. De plus, en se focalisant sur les spécificités françaises hexagonales, ce livre encourage à l’action ici et maintenant, sans attendre que le modèle agricole hégémonique international ne soit renversé.
Notes
- Les projections indiquent un léger repli de la production mondiale de céréales 2022, comparée à la production record de 2021. Voir https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr/. Consulté le 13/06/2022.[↩]
- Inrae Toulouse[↩]
- Sciences-Po Bordeaux[↩]
- Purseigle François, Nguyen Geneviève et Blanc Pierre (2017), Le nouveau capitalisme agricole. De la ferme à la firme, Presses de Sciences Po.[↩]
- Voir notamment Muller Pierre (2014) [1984], Le technocrate et le paysan, L’Harmattan.[↩]
- Henri Mendras (1967), La fin des paysans, innovations et changement dans l’agriculture française, Futuribles.[↩]
- Cependant cela est peut-être en train de changer : https://www.contretemps.eu/modele-agricole-macron-agribusiness/[↩]
- La théorie de la régulation vise à expliquer le passage de la croissance à la crise, sans invoquer de chocs externes. Elle détaille plusieurs régimes d’accumulation capitaliste dont le modèle fordiste : une production de masse en relation avec une consommation de masse.[↩]
- La « politique des structures » instaure un système d’autorisation administrative d’accès au foncier qui favorise les fermes qui visent un niveau de production économique soutenu, y compris contre l’avis du propriétaire dans le cas de terres en location. https://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-607.html[↩]
- Créé en 1946, le Commissariat au Plan était chargé de proposer à titre indicatif des plans quinquennaux, il a été supprimé en 2006.[↩]
- Subvention de plusieurs milliers, voire dizaine de milliers d’euros, versée à un jeune de moins de 40 ans qui s’installe en agriculture sous réserve d’avoir un diplôme agricole et un plan économique validé par l’administration.[↩]
- Syndicat agricole, sorte de groupe des jeunes de la FNSEA.[↩]
- Michèle Salmona (1994), Souffrances et résistances des paysans français. Violences des politiques publiques de modernisation économique et culturelle, L’Harmattan.[↩]
- Jean-Philippe Martin (2005), Histoire de la nouvelle gauche paysanne, La Découverte. Michèle Zancarini-Fournel (2016), Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Zones. Pierre Bitoun et Yves Dupont (2016), Le Sacrifice des paysans. Une catastrophe sociale et anthropologique, L’Échappée. Margot Lyautey, Léna Humbert, Christophe Bonneuil direction (2021), Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle, Presses Universitaires de Rennes.[↩]
- https://www.terrestres.org/2021/07/29/reprise-de-terres-une-presentation/[↩]
- Atelier Paysan (2021), Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, Le Seuil.[↩]
- https://securite-sociale-alimentation.org/[↩]
- Il est marquant que d’autres travaux « régulationistes » dans la lignée de Robert Boyer, comme ceux de Gilles Allaire, soient eux très en phase avec les théories des « régimes agroalimentaires » – Gilles Allaire, Benoit Daviron coordinateurs (2017), Transformations agricoles et agroalimentaires – Entre écologie et capitalisme, Quae.[↩]
- Fernand Braudel (1979), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve-xviiie siècle. Tome 3 : Le temps du monde, Armand Colin.[↩]
- Muller Pierre (2014) [1984], Le technocrate et le paysan, L’Harmattan.[↩]
- Ce plan prévoyait notamment une diminution drastique du nombre d’exploitations agricoles. Il a été rejeté par la majeure partie des syndicats agricoles en Europe. En France, il a au contraire recueilli le soutien total du CNJA et d’une partie de la FNSEA.[↩]
- Principalement la Plateforme pour une transition citoyenne agricole et alimentaire (https://www.sol-asso.fr/ega-les-organisations-de-la-plateforme-citoyenne-pour-une-transition-agricole-et-alimentaire-rendent-publiques-leurs-demandes) et la plateforme Pour une autre PAC (https://pouruneautrepac.eu) qui représentent ensemble une cinquantaine d’organisations et devraient très prochainement fusionner ensemble.[↩]
- Cette indépendance syndicale a été théorisée et diffusée en France pour les syndicats de travailleurs dans la Charte d’Amiens en 1906.[↩]
- Pascal Lombard (2020), De la société civile au mouvement social, géographie d’une redistribution des cadres institutionnels de gouvernance des communs : le cas du mouvement Terre de Liens, Thèse de doctorat sous la direction de Hélène Guétat-Bernard et de Pascale Maïzi, Université Toulouse 2.[↩]
- David Harvey (1982/2020), Les limites du Capital, Amsterdam.[↩]
- Lucile Leclair (2022), Hold-Up sur la terre, le Seuil.[↩]
- https://terredeliens.org/etat-des-terres-agricoles.html[↩]
- Gilles Luneau (2004), La forteresse agricole – Une histoire de la FNSEA, Fayard.[↩]








