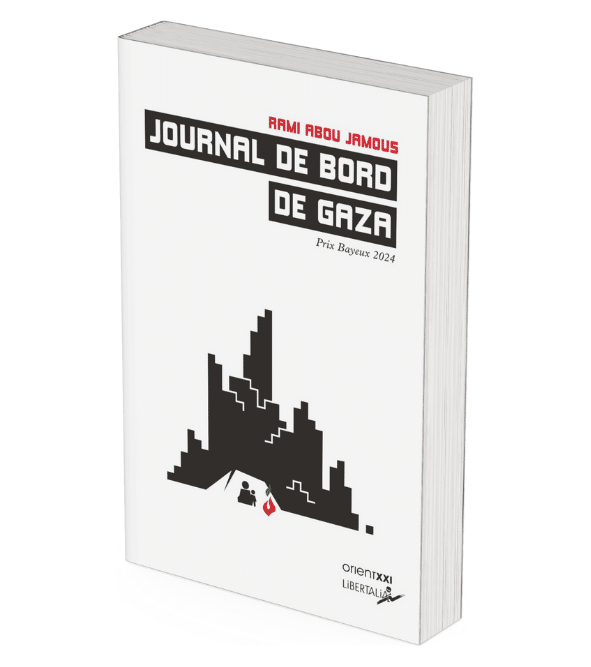
Cette sélection d’extraits est tirée de l’ouvrage de Rami Abou Jamous, Journal de bord de Gaza, paru aux Éditions Libertalia dans la collection OrientXXI avec une préface de Leïla Shahid et une présentation de Pierre Prier. L’ouvrage rassemble les chroniques du même nom publiées depuis février 2024 dans la revue en ligne OrientXXI. Chaque extrait correspond à une chronique.
« On a pris des risques pour aller à la plage parce qu’on aime la vie », le 24 avril 2024.
« Après la guerre, une autre catastrophe nous attend », le 20 août 2024.
« Cette année, il n’y aura pas de récolte », le 18 septembre 2024.
« Israël est en train de nous faire détester l’endroit où l’on vit », le 30 septembre 2024.
« La mort rôde autour d’eux. Ils ne savent pas quand elle va arriver », le 17 octobre 2024.
Pour illustrer ces bonnes feuilles, nous avons choisi d’utiliser des photographies de Hosny Salah, un photographe palestinien vivant à Gaza.
« On a pris des risques pour aller à la plage parce qu’on aime la vie »
Mercredi 24 avril 2024.
Aujourd’hui, il faisait à peu près 36 degrés. En rentrant des courses, j’ai annoncé à ma famille qu’on allait à la plage. Ils ont été étonnés, c’est un endroit risqué, les navires de guerre israéliens le bombardent régulièrement. Je savais pourtant qu’on ne serait pas les seuls, vu la température. Beaucoup de gens vont à la plage car la chaleur est insupportable sous les tentes.
On aurait pu croire que c’était une journée d’été ordinaire à Gaza : il y avait beaucoup de monde sur la plage comme avant la guerre, des enfants construisaient des châteaux de sable ou fabriquaient des cerfs-volants aux couleurs du drapeau palestinien. À cette différence près : pour voir la mer, il fallait descendre de la corniche, envahie par les tentes des déplacés.
Beaucoup de femmes étaient là pour laver le linge, parce qu’il n’y a pas d’eau. L’eau de mer ne lave pas bien, mais elles n’ont pas le choix. Des marchands ambulants vendaient des petits gâteaux pour les enfants, d’autres faisaient du pain chaud et des feuilletés au fromage avec des fours en argile. Certains vendaient des vêtements d’occasion pour femmes ou enfants.
Les femmes se baignaient avec leur tenue de prière, parce qu’elles n’ont plus que ça. C’est une espèce de voile qui couvre tout le corps. Beaucoup d’entre elles n’avaient plus de chaussures. Chez nous, il n’y a plus ni tongs ni pantoufles, ou alors elles sont abîmées, déchirées. On voit aussi des gens qui ont des paires de chaussures dépareillées. Mais à la plage, on oublie tout cela.
Pour la première fois, [mon fils] Walid était très content. Avant, il avait peur des vagues. Mais cette fois, il s’est baigné avec ses frères. On a construit des châteaux de sable. C’était la première fois qu’il prenait conscience de la plage, de la mer, des châteaux.
Heureusement qu’il y a la mer à Gaza. C’est vrai qu’on vit dans une prison à ciel ouvert. Mais même dans les pires conditions, il y a cette petite fenêtre. Je regardais les gens heureux de se baigner, le sourire des enfants. On oubliait tout, la misère, l’humiliation, les tentes, les bombardements, les massacres… Et ce spectacle m’a fait d’autant plus plaisir que cela n’a pas plu, je le sais, à Benyamin Nétanyahou, et aux Israéliens en général.
On a pris des risques pour aller à la plage parce qu’on aime la vie. On a continué à célébrer des mariages parce qu’on aime la vie. Nous risquons notre vie parce que nous aimons la vie.
Nétanyahou a dit au ministre des Affaires étrangères allemand qu’il n’y avait pas de misère à Gaza, puisque les gens s’amusaient à la plage. Les Israéliens n’arrivent pas à comprendre que malgré toutes ces années d’occupation depuis 1948, malgré le blocus, malgré les incursions militaires et les bombes, nous sommes un peuple qui aime la vie et qui veut toujours vivre, même si la mort est le prix à payer. Ils croient que nous sommes un peuple qui recherche la mort, mais nous sommes un peuple qui recherche la vie.
On a pris des risques pour aller à la plage parce qu’on aime la vie. On a continué à célébrer des mariages sous les tentes de fortune, parce qu’on aime la vie. Mahmoud, le frère de Sabah, ma femme, devait se marier le 3 novembre. Le mariage avait été reporté. Maintenant, il a pris la décision de se marier en mémoire de son père qui voulait voir ce jour. Il célèbrera son mariage sur les décombres de sa maison.
Nous risquons notre vie parce que nous aimons la vie. Nous allons chercher des sacs de farine en sachant que nous risquons d’être bombardés. Nous allons à la plage parce que nous aimons la vie, même si l’on sait très bien que les navires israéliens peuvent nous tirer dessus. On veut rester à Gaza, on ne veut pas quitter cet endroit parce qu’on aime la vie.
Mahmoud Darwich l’a bien dit :
Nous aimons la vie autant que possible
Là où nous résidons, nous semons des plantes luxuriantes et nous récoltons des tués
Nous soufflons dans la flûte la couleur du lointain, lointain, et nous dessinons un hennissement sur la poussière du passage
Nous écrivons nos noms pierre par pierre. Ô éclair, éclaire pour nous la nuit, éclaire un peu
Nous aimons la vie autant que possible
On voyait très nettement les navires israéliens à quelques milles nautiques de la plage de Rafah. On entendait les bombardements des F-16, surtout du côté de Nusseirat et de Deir El-Balah. Mais ce moment à la mer nous a fait oublier tout ce bruit de tonnerre et de mort.

L’âne « plus fidèle que les humains »
Je voulais parler de ça parce que tout le monde croit que Gaza, c’est juste la mort et la destruction. Malgré toutes les années de blocus, on a continué à vivre, on a fait des fêtes, on a fait des mariages, on est allé à la plage, on y a fait des barbecues et des fêtes.
On rentre de la plage à pied, ou à bord d’une charrette tirée par un cheval ou un âne, comme les gens les plus pauvres en utilisent à Gaza ; parfois la charrette est attelée à une voiture. Il y a aussi le bus bondé où les gens s’entassent les uns sur les autres. Nous avons eu la chance de trouver une charrette tirée par un âne. Cela m’a rappelé le jour où l’on a quitté la ville de Gaza : Walid et ma femme étaient montés pour la première fois sur une charrette, avec l’humiliation d’être chassé de chez soi.
Mais aujourd’hui, à bord de cette charrette, nous étions heureux. Nous venions de passer un très beau moment à la plage qui nous avait rappelé la belle époque où l’on s’amusait tout le temps, où l’on pouvait faire la fête sans risquer la mort, sans crainte de bombardements. L’homme qui conduisait la charrette disait qu’on était un peuple qui n’a pas peur de la mort, et que même si tout le monde parle d’une prochaine incursion militaire israélienne à Rafah, les gens continuent de vivre. Il a ajouté : « Soit nous avons perdu le sens de la peur, soit nous fuyons la peur pour rechercher un moment de joie. » C’est vrai : nous fuyons la peur pour chercher la joie, oublier tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes un peuple qui a toujours su s’adapter au pire. Ce n’est pas forcément quelque chose de positif, c’est vrai. S’adapter au pire, c’est aussi ne pas se révolter et accepter tout ce qu’on vous fait subir.
Nous sommes abandonnés par le monde entier qui nous regarde nous faire massacrer, pourtant cet animal, lui, ne nous a pas abandonnés.
J’ai demandé à notre chauffeur : « Et toi, tu es prêt s’ils entrent à Rafah ? » Il m’a répondu :
« Moi, je suis un déplacé du nord de la bande de Gaza. Ma famille et moi sommes arrivés ici à bord de cette charrette. Nous avons été les premiers touchés à Beit Hanoun1. Nous avons été déplacés plusieurs fois, au début c’était à Deir Al-Balah, puis Khan Younès et nous avons fini à Rafah. Cette fois-ci c’est pareil. On s’installera là où ils nous diront de s’installer. À Mawassi, au bord de la mer ? À Nusseirat, au centre de la bande de Gaza ? Je ne sais pas si l’on va rester en vie — ce serait tant mieux — ou si l’on va mourir. On a déjà affronté la mort plusieurs fois. »
Quand il parlait de son âne, il disait :
« Il est plus fidèle que les humains. Il a transporté des blessés et des morts au risque de se faire tuer, surtout au début de l’offensive, quand on était pris pour cible. Il n’y avait plus d’ambulances, ni de secouristes. »
J’ai aimé cette ironie, sa façon de parler de cet animal plus fidèle que les êtres humains, ça m’a vraiment, vraiment touché. Malgré la violence de la guerre, cet âne n’a pas fui. Au contraire, il était là quand il fallait, comme un vrai ami, pour aider les gens. Ces mots sont restés gravés dans ma tête : nous sommes abandonnés par le monde entier qui nous regarde nous faire massacrer, pourtant cet animal, lui, ne nous a pas abandonnés.
« Après la guerre, une autre catastrophe nous attend »
Mardi 20 août 2024.
Je discutais aujourd’hui avec mon ami Mounzer, qui est avocat depuis presque dix ans. Comme moi, il habitait Gaza-ville et il a été forcé de se déplacer, avec le même itinéraire : d’abord Rafah, puis Deir El-Balah. Je lui ai demandé comment il voyait l’après-guerre. Une question qui me tracasse, parce que des « après-guerre », nous en avons déjà vécu plusieurs, et mon constat, c’est qu’après la guerre, il y a toujours une autre guerre.
Je lui ai parlé de 2014. Après cette offensive israélienne qui avait fait environ 2 100 morts, je savais que le nombre de procès à Gaza avait augmenté. J’ai demandé à Mounzer quels étaient les litiges les plus nombreux, il m’a tout de suite répondu : « Des affaires d’héritages. » Parce que 2 100 morts, c’était beaucoup, ce qui faisait beaucoup de problèmes de succession à régler.
Aujourd’hui, ce chiffre correspond au nombre de personnes tuées en une dizaine de jours seulement. Sans oublier les destructions. Tous ces chiffres sont sans commune mesure avec 2014. On parle de 50 000 morts2, des familles entières ont été rayées de l’état civil, et 70 % des habitations ont été détruites.
Mounzer me dit : « Après la guerre, une autre catastrophe nous attend. » Il m’a donné plusieurs exemples de familles étendues qui ont été entièrement effacées de l’état civil : « Normalement, les successions se font dans un ordre vertical. Les enfants héritent des parents. Là cela se fera en horizontal, entre cousins par exemple, ce sera très compliqué. » Mais la vraie catastrophe, a ajouté mon ami, c’est qu’il n’y a plus d’archives pour documenter ces procès. Pour la première fois depuis 1948, les Israéliens ont brûlé les archives des tribunaux, ainsi que ce qu’on appelle le « taabou », c’est-à-dire le registre foncier, où l’on enregistre les propriétés, les bâtiments et surtout les parcelles de terrain.
Qui devra adopter qui ? La famille paternelle ? Ou bien la famille maternelle ? Mais si beaucoup d’enfants ont perdu leur mère ou leur père, nombre d’entre eux ont perdu les deux.
Les Israéliens ont méthodiquement fait exploser le palais de justice, où se trouvaient les archives judiciaires, ainsi que le bâtiment qui abritait le cadastre et le registre foncier. Ils l’ont fait sciemment, pour détruire la société gazaouie, pour détruire un tissu social qui était très dense. Ils veulent effacer toute preuve de notre appartenance à cette terre. C’est complètement inédit. Quand les Ottomans ont perdu la Palestine, ils n’ont pas détruit les archives, ils les ont emportées avec eux et la Turquie les a ouvertes au public en 2022. Mounzer en a vu passer beaucoup dans des procès d’héritages, « des originaux, avec tampons, timbres et tout ».

Personne ne savait où était sa maison
Certes, une partie de ces archives a été numérisée, mais beaucoup de gens vont mettre en doute l’authenticité de ces documents numérisés. Pour eux, seul le papier fait foi. Celui qui a gardé un bout de papier peut gagner, mais pour celui qui n’a rien, ce sera difficile. Il y aura des problèmes au sein d’une même fratrie, entre les enfants, entre les oncles, alors que la majorité des gens à Gaza ont perdu la preuve de la propriété de leur terrain.
Il y aura aussi la question des orphelins. Qui devra adopter qui ? La famille paternelle ? Ou bien la famille maternelle ? Mais si beaucoup d’enfants ont perdu leur mère ou leur père, nombre d’entre eux ont perdu les deux. D’après les Nations unies, entre 15 000 et 25 000 enfants ont perdu un de leurs parents. Dans beaucoup de familles, tout le monde est mort. Mounzer m’a cité l’exemple de la famille Khorshid, une famille très connue de Gaza-ville. C’est une famille d’opticiens, ils avaient plusieurs magasins. Il ne reste que deux survivants : la grand-mère et une de ses petites-filles. Comment va-t-on faire pour l’héritage ? La grand-mère pourra-t-elle avoir la garde de sa petite-fille ? Il y aura sûrement des débats juridiques, la garde étant liée à l’argent, bien sûr.
« Je suis sûr qu’après cette guerre-là, il n’y aura plus de justice sociale, il n’y aura plus de tissu social, il n’y aura que des problèmes », me dit Mounzer. Pour la reconstruction, il faudra prouver qu’on possédait telle ou telle parcelle, et ce sera impossible en l’absence du registre foncier. Or, quand l’armée israélienne détruit un lieu, elle rase tout. On l’a déjà vu en 2014 : il ne restait plus rien pour permettre d’identifier une maison ou un immeuble. Dans le quartier de Chadjaya, personne ne savait où était sa maison, parce que les bulldozers avaient repoussé les décombres à 300 ou 400 mètres de là. Les décombres de tout un quartier étaient entassés au même endroit. Il y a eu beaucoup de problèmes pour reconstruire. À l’époque, les gens ont utilisé Google maps pour retrouver l’emplacement de leur maison, et ensuite, avec le registre foncier, on a pu délimiter les terrains, leurs surfaces, leurs limites.
Tout cela est parti, et les propriétaires aussi. L’après-guerre ressemblera donc à une autre guerre, cette fois au sein des familles. La guerre pour savoir qui hérite de quoi, pour les études, pour les enfants. Et surtout, la guerre de la santé mentale. Nul ne sait dans quel état psychologique nous allons sortir de toute cette destruction. Il n’y aura plus de vie à Gaza.
« Cette année, il n’y aura pas de récolte »
Mercredi 18 septembre 2024.
On est fin septembre et d’habitude, on prépare « le mariage ». C’est comme cela qu’on appelle la récolte des olives : al ’ors al falastini, « le mariage palestinien ». Cela commence début octobre. Pendant la récolte, toute la famille va dans les champs. Dès le matin, on prépare un petit-déjeuner traditionnel composé de galayet bandoura (un plat en sauce à base de tomates), du foul (des fèves) et du houmous. Les scouts, les élèves et les étudiants viennent aider à la récolte. On chante des chansons traditionnelles. C’est vraiment la grande fête, comme une célébration de naissance ; une naissance qui prouve que l’on appartient à cette terre et qu’elle nous appartient. On attend la pluie, parce qu’elle augmente le volume des olives, ce qui donnera une bonne huile.
Mais cette année, il n’y aura pas de récolte. À Gaza, il y a un quartier qui s’appelle Zaytoun. Cela veut dire « olive ». Ce quartier était couvert d’oliviers. Mais les Israéliens l’ont bombardé et rasé, comme ils ont fait avec d’autres quartiers proches de la frontière avec Israël. Des oliviers, qui remontent pour certains à 1905 et 1920, ont été détruits.
Les Israéliens connaissent très bien l’attachement des Palestiniens à cet arbre, qui n’est pas seulement une source de revenus. L’olivier, c’est l’existence même des Palestiniens.
Avant, Gaza arrivait en troisième place en Palestine pour la production d’olives, ex æquo avec Naplouse, après Jénine et Tulkarem. Gaza produisait entre 15 000 et 20 000 tonnes d’olives, et entre 3 000 et 4 000 tonnes d’huile. C’est vraiment une grande perte, pas seulement en termes de revenus, mais de lien avec la terre. L’olive (zeitoun) et l’huile d’olive (zeit) sont présentes partout, dans les noms de lieu comme Birzeit, Zeita, Tour Zeita, Jabal Al-Zeytoun, et dans les noms de famille comme Zaytouna, Zaytounia, Zayyat…
À écouter ailleurs, sur Radio Zinzine : un entretien des membres du Forum palestinien de l’agro-écologie, basé en Cisjordanie, « L’acharnement contre la paysannerie palestinienne », novembre 2024.
Les Israéliens connaissent très bien l’attachement des Palestiniens à cet arbre, qui n’est pas seulement une source de revenus. L’olivier, c’est l’existence même des Palestiniens. C’est pour cela que lorsque les colons attaquent des villages en Cisjordanie, autour de ce que l’on appelle « le mur de séparation », c’est-à-dire le mur de l’apartheid, leur première cible, ce sont toujours les oliviers. Ils les coupent, alors qu’ils datent en majorité d’avant la création de l’État d’Israël. Tout le monde sait que le plus vieil olivier au monde, âgé de plus de 4 000 ans, se trouve à Bethléem.
Les Israéliens veulent effacer ce lien en s’appropriant tout ce qui est palestinien. Lors d’une rencontre avec Mahmoud Abbas, le président de l’AP, le ministre israélien Benny Gantz lui a offert… une bouteille d’huile d’olive. Pour comprendre ce geste, il faut savoir que Abbas est originaire de Safad, ville connue pour ses oliviers, aujourd’hui en Israël.
La peur transforme la société
C’est une façon symbolique d’inverser la réalité. Comme si les Israéliens, venus du monde entier pour nous coloniser, nous avaient précédés ici. Ce lavage de cerveau fonctionne pour les Israéliens et en Occident, mais il commence aussi à s’infiltrer dans la tête des Palestiniens eux-mêmes, qui perdent leurs repères.
Nous avons oublié notre histoire, oublié nos droits. La crainte de la punition collective et du génocide nous change jusque dans notre comportement avec les autres et avec nous-mêmes.
Nous avons visité, avec [ma femme] Sabah, un appartement à louer, pour éviter de passer l’hiver sous la tente. Il était trop cher, et Sabah l’a trouvé trop grand, alors qu’il ne faisait pas la moitié de la surface de notre appartement de Gaza-ville, qu’Israël nous a forcés à quitter. Mais à trop vivre sous une tente, cet appartement lui semblait démesurément grand. Notre espace s’est rétréci, physiquement et mentalement.
Il ne reste dans la bande de Gaza que quelques oliviers à l’intérieur des villes, dans des jardins. Mais on replantera des oliviers, on refera des fêtes pour le « mariage palestinien ». Mahmoud Darwich, le grand poète palestinien, écrivait :
« Si l’olive se souvenait de son planteur, son huile se transformerait en larmes »

« Israël est en train de nous faire détester l’endroit où l’on vit »
Lundi 30 septembre 2024.
Ce matin, à l’aube, c’était l’heure de notre conversation quotidienne. C’est le seul moment où nous pouvons nous parler tranquillement, Sabah et moi. Pendant la journée, on est trop occupés, et entourés de beaucoup de gens. La nuit, tout le monde reste un peu éveillé par peur de ce qui peut arriver. Mais à l’aube, c’est le silence presque total ; les enfants dorment et on peut se parler.
J’évoquais l’après-guerre. Je disais : « Quand tout ça finira, on partira quelque part pour changer d’air, surtout pour les enfants. On ira en France et on plantera une tente à la montagne. » Je n’avais pas terminé ma phrase que Sabah a réagi : « Non, non, pas de tente ! Plus jamais de tente dans ma vie, même pour quelques jours de vacances ! Même si c’est pour l’installer au paradis ! »
Sa réaction m’a rappelé un ami qui vit en Jordanie. Je lui avais rendu visite, et lui avais demandé d’aller voir Petra ensemble, la célèbre cité nabatéenne du désert. Il m’avait répondu : « Hors de question ! Toute ma vie, j’ai vécu dans des quartiers pleins de sable, du sable partout, de la poussière partout. Cet endroit-là me rappellerait de bien mauvais souvenirs ! Je ne veux pas y aller ! »
Comment ces gens pourront-ils revenir chez eux ? Comment pourraient-ils y vivre ? Maintenant, tout le monde déteste son environnement.
Je me rends compte que tout ce qu’on fait, tout ce qu’on vit aujourd’hui est en train de nous faire détester l’endroit où l’on vit, et c’est ce que veulent les Israéliens. J’ai pensé à notre voisine chrétienne, Najwa, qui ne veut plus revenir à l’église où elle est actuellement réfugiée. Pareil pour les enfants de Sabah, qui n’ont pas envie de retourner dans leur école, qui a été bombardée et cernée par les chars israéliens. Désormais, ils détestent cet endroit. Et encore, eux n’ont pas vu la destruction de leur établissement, comme beaucoup de leurs camarades… qui ont aussi vu leurs parents déchiquetés sous leurs propres yeux.
Pareil pour les gens qui ont trouvé refuge dans les hôpitaux. Ils ne voudront plus y retourner. Ceux qui sont réfugiés à la plage ne voudront plus y retourner après que la marée a inondé leurs tentes. Et ceux dont les maisons ont été détruites ? Souvent, les corps leurs proches sont encore enterrés sous les décombres…
La chaleur, les serpents, les insectes…
Comment ces gens pourront-ils revenir chez eux ? Comment pourraient-ils y vivre ? Maintenant, tout le monde déteste son environnement. Vivre sous une tente ? C’est l’humiliation totale. La chaleur, les serpents, les insectes, le sable partout… Et aucune vie familiale possible sous ces morceaux de tissu qui ne protègent pas non plus de la peur et les bombardements.
Plus tard, c’est tout Gaza qui nous rappellera de mauvais souvenirs. Ceux qui ont trouvé refuge dans des chalets ne voudront plus y revenir en vacances. Un chalet, à Gaza, c’est une villa avec piscine qu’on loue pour une journée ou quelques jours. Ces maisons sont un peu à l’écart de la plage car, à l’époque du blocus, il y avait beaucoup de déchets sur le rivage, et des égouts qui se déversaient dans la mer. Et c’étaient des endroits où les femmes pouvaient se baigner en maillot, à l’abri des regards.
Aujourd’hui cette vie de luxe est devenue une vie d’humiliation. Des centaines de personnes s’entassent dans ces chalets. Mahmoud, un ami, y vit depuis presque la première semaine de la guerre. Il est originaire de quartier Zeitoun, qu’il a été l’un des premiers à quitter. Ils sont près de 90 personnes à vivre dans cette villa ! Il dit : « Avant la guerre, c’était un endroit de détente, on faisait des barbecues. Aujourd’hui, on galère pour avoir de l’eau et de l’électricité. »
Lire aussi sur Terrestres : Ali Zniber, « Prise de terre et Terre promise : sur l’État colonial d’Israël », août 2024.
Si la guerre s’arrête, lui non plus ne sait pas s’il a envie de revenir à cet endroit. Alors qu’avant, on aimait la plage, on aimait la mer, on aimait les chalets, on aimait planter une tente à la plage, y faire des barbecues… Avant la guerre, j’aimais préparer le foul (les fèves) pour toute la famille, à partir de conserves, auxquelles j’ajoutais une sauce de ma fabrication. Aujourd’hui je hais toutes les conserves, parce qu’on ne mange que ça !
Au final, on va finir par quitter Gaza. Et c’est ça le vrai but de cette guerre. Le véritable objectif de Nétanyahou et de l’armée, c’est de faire sortir les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza.
Déjà, il n’y a plus ni les piliers ni les bases de la vie. La reconstruction prendra des années, pendant lesquelles les gens continueront à vivre sous les tentes. Ceux qui ont dû fuir le nord, s’ils retournent dans cette partie de Gaza entièrement détruite, devront installer leurs tentes là où ils ont tout perdu, leur famille, leurs amis, leur maison. La peur, l’angoisse, l’humiliation se mélangeront pour donner la non-vie. Les enfants qui travaillent sur les marchés comme petits marchands ambulants ou porteurs de marchandises détesteront le marché. C’est vrai qu’ils peuvent gagner dix ou vingt shekels par jour (entre deux et cinq euros), et que beaucoup d’entre eux apprécient l’autonomie et l’autorité que ces jobs leur apportent. Mais ils ne les font pas par plaisir, mais par obligation. Les trois garçons de Sabah ont été embauchés par leurs oncles, qui sont des commerçants. Au début, ils étaient enthousiastes. Moi, j’étais contre, je ne souhaitais pas que les enfants apprennent la culture du marché, et surtout pas la culture du marché pendant la guerre. Mais ce sont les oncles qui décident. Les enfants m’ont dit : « On est devenus des businessmen, on va faire notre propre business. » Mais je savais qu’ils ne tiendraient pas le coup. Le quatrième jour, Moaz, l’aîné, m’a dit : « On ne veut plus y aller, je n’en peux plus, on ne veut plus devenir des businessmen. » Ils ont fait l’expérience de l’humiliation. Et maintenant ils détestent le marché.
L’université Al-Aqsa de Khan Younès, la seule qui n’a pas été entièrement détruite, est devenue un abri pour les déplacés. Les étudiants vont la détester, parce que pour eux, c’est désormais un lieu d’humiliation. C’est un endroit invivable où ils auront vécu leurs pires moments.
Au final, on va finir par quitter Gaza. Et c’est ça le vrai but de cette guerre. Nétanyahou et l’armée disent qu’ils veulent éradiquer le Hamas, libérer les prisonniers israéliens, c’est n’importe quoi. Leur véritable objectif, c’est de faire sortir les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza.
Le Hamas est toujours là. Mais Israël ne combat pas contre une véritable armée, comme le prétend sa propagande. Ils ont juste des armes automatiques, des RPG et des roquettes. Le vrai but, je le répète, c’est d’expulser 2,3 millions de personnes. On verra, après la guerre, si ma théorie est vraie. En tout cas, je sais ce que les gens pensent. Une grande majorité des habitants, surtout les jeunes, vont partir si on leur ouvre les portes. Tout simplement parce qu’il n’y a plus de vie à Gaza.

« La mort rôde autour d’eux. Ils ne savent pas quand elle va arriver »
Jeudi 17 octobre 2024.
Cela fait presque cinq jours que la ville de Jabaliya et son camp de réfugiés sont encerclés. Malheureusement, avec ce qu’il se passe au Liban, on parle moins de Jabaliya. Le camp et le village, situés tout près de la frontière avec Israël, au nord de la bande de Gaza, ont été des cibles depuis le début de cette guerre. Ses habitants ont dû quitter plusieurs fois leurs maisons pour aller se réfugier ailleurs. Mais cette fois, c’est différent.
Les gens ne peuvent plus partir. Peu d’infos nous arrivent de là-bas. J’ai essayé plusieurs fois d’appeler un ami journaliste, Issa Saadallah, qui travaille au quotidien Al-Ayyam. Lui et sa famille ont refusé d’obtempérer à l’ordre des Israéliens de quitter Jabaliya. Issa est l’un des rares journalistes à être resté sur place. La plupart ont fui vers Gaza-ville ou ont été pris pour cible par l’armée israélienne. Vous avez vu comment un journaliste a été tué et deux autres blessés, dont le caméraman d’Al-Jazira.
J’ai fini par joindre Issa ce mercredi 16 octobre. Sans s’en rendre compte, ce dernier parlait tout bas au téléphone, comme s’il se cachait. J’avais eu la même expérience quand nous étions encerclés ; moi aussi, je parlais tout bas. C’est psychologique, comme si cela pouvait protéger contre les chars et les bombes.
Le plus dur, c’est la faim des enfants. Quand mon fils Mahmoud, 6 ans, m’a dit qu’il voulait des œufs, une demande simple à satisfaire en temps normal, je me suis senti déchiré de l’intérieur.
Issa Saadallah
Issa vit avec sa femme et leurs cinq enfants. Ils sont une cinquantaine de personnes en tout dans l’immeuble, tous de la même famille, à vivre sur quatre étages. Quand je l’ai appelé, il m’a dit que pendant longtemps, il n’avait pas pu recharger son téléphone. Il a finalement pu le faire grâce à des panneaux solaires qui lui fournissaient un peu d’électricité, de quoi faire fonctionner quelques ampoules, et surtout charger les téléphones. Quant à leur situation, il m’a dit : « C’est simple : on est complètement encerclés par les chars israéliens au sol, et par les drones et les quadricoptères dans les airs. Il y en a pratiquement un dans chaque ruelle. Ils tirent sur tous ceux qui tentent de sortir. »
La première question que j’ai posée à Issa, c’est : « Pourquoi n’as-tu pas quitté Jabaliya ? Au moins pour aller à Gaza-ville… » Il m’a répondu : « Tu sais bien ce que cela signifie : quand tu as quitté Gaza-ville, tu t’es fait tirer dessus, et tu t’en es sorti de justesse. » Puis il a ajouté : « De toute façon, pour moi, Gaza-ville ou le sud, c’est pareil, ça veut dire partir de chez moi. Je suis chez moi, j’y reste. » Toute sa famille, ses frères, leurs femmes et les enfants, ont pris la même décision.
Aujourd’hui, leur situation est dramatique : « Outre la peur, nous n’avons plus grand-chose à manger. On ne trouve plus rien à Jabaliya. On a seulement des réserves de farine et quelques boîtes de conserve. Celles-ci font presque partie de notre estomac, on en mange depuis presque un an. On a oublié le goût des fruits, des légumes et de tout le reste. » Puis il ajoute : « Pour te dire les choses franchement : depuis le premier jour de la guerre, on ne dort pas rassasiés. » C’est une litote chez nous pour dire que l’on se couche en ayant faim. « Le plus dur, c’est la faim des enfants. Quand mon fils Mahmoud, qui a 6 ans, m’a dit qu’il voulait des œufs, une demande simple à satisfaire en temps normal, je me suis senti déchiré de l’intérieur. Je n’ai jamais rien éprouvé d’aussi insupportable. »
Je ne savais pas quoi dire à Issa. Je sais ce qu’il endure, parce que j’ai été dans la même situation. Je n’arrive pas à oublier le jour où Walid m’a demandé du « jaja », et que je ne pouvais pas lui en acheter. Aujourd’hui, on peut en trouver à Deir El-Balah, où nous avons planté notre tente. Mais certainement pas au nord.
Il m’a aussi raconté la réaction de sa nièce May, 3,5 ans : « C’était il y a trois ou quatre semaines, avant le siège, mais on n’avait déjà plus grand-chose à manger. Un ami de son père est venu de la moitié sud, sans doute un de ces transporteurs qui travaillent pour les ONG et qui pouvaient passer les checkpoints. Cet ami est arrivé avec un beau cadeau : six pommes. Il en a donné une à May. La petite fille l’a jetée tout de suite. Elle en a eu peur. Elle n’en avait jamais vu, ou elle avait oublié ce que c’était. Moi j’ai un seul désir : que mes enfants sortent de cet enfer, parce que je veux qu’ils puissent manger et boire normalement, qu’ils voient de leurs propres yeux des fruits et des légumes. Je ne veux pas qu’ils meurent en ayant tout oublié. Mais il n’y a plus rien à Gaza. La vie n’existe plus. »
« Un verre par personne et par jour »
Surtout, ils ne peuvent pas aller chercher de l’eau. « C’est ça la vraie catastrophe, dit Issa. On peut survivre avec les conserves et en faisant un peu de pain. Mais sans eau, c’est impossible. On rationne l’eau potable : un verre par personne et par jour. » Ils doivent aussi économiser au maximum l’eau non potable, qu’ils seront sans doute obligés de boire bientôt.
Je sais ce que cela signifie. Quand nous étions encerclés, nous aussi nous économisions l’eau, dans les moindres détails. J’ai honte d’en parler, mais il faut que tout le monde s’en rende compte. Cela veut dire par exemple ne pas tirer la chasse d’eau qu’après trois ou quatre utilisations des toilettes, parce que chaque chasse d’eau c’est 17 litres, le contenu d’un jerrycan.
Mais nous, au moins, nous pouvions sortir un peu en bas de notre immeuble pour faire prendre l’air à Walid. Issa et sa famille ne peuvent même pas mettre le nez dehors. Il ne sait ce qu’il se passe à l’extérieur qu’en communiquant avec les autres habitants. « Les Israéliens sont en train de raser des quartiers entiers », me dit-il. Il vient d’apprendre la mort d’une de ses cousines, de son mari et de leur fille. « Voilà ce qu’est notre vie à Jabaliya. Des gens qui meurent bombardés dans leurs maisons. On ne sait pas quand notre tour viendra. Nous sommes au centre de la zone assiégée. On attend… »
Issa et sa famille sont encerclés. La mort rôde autour d’eux. Ils ne savent pas quand elle va arriver. Et entre la vie et la mort, il y a la famine.
Comme il est journaliste, il commente aussi la situation politiquement : « Peut-être que nous assistons à la mise en œuvre du “plan des généraux” : vider toute la partie nord de la bande de Gaza et l’annexer. Ils pousseraient vers la moitié sud tous les habitants qui restent dans le nord de la bande de Gaza, qui passeraient par des checkpoints, où l’identité de chaque personne serait vérifiée. Les combattants du Hamas n’auraient d’autre choix que de se rendre ou de mourir de faim dans la zone assiégée. »
Il reste environ 100 000 personnes qui sont toujours à Jabaliya et qui ne veulent pas bouger. « On vit des massacres au quotidien. On ne les voit pas de nos propres yeux, mais on les entend. Et on a les récits des témoins. Toutes les heures, on apprend qu’une famille entière a été tuée dans le bombardement de sa maison, ou en voulant en sortir. C’est très dur. »
Issa et sa famille sont encerclés. La mort rôde autour d’eux. Ils ne savent pas quand elle va arriver. Et entre la vie et la mort, il y a la famine. Ils ne savent pas si leur maison va être bombardée « sur leur tête », comme on dit chez nous, ou s’ils vont mourir de faim.

Des images sont sorties récemment de Jabaliya et de ses environs. Vous avez sans doute vu les premières vidéos sorties du quartier Al-Falloujah. Des secouristes sont venus faire sortir les gens qui voulaient fuir. Ils ont découvert une famille gisant dans son sang, sous les décombres de sa maison bombardée. Il n’y avait que deux survivants. Un adolescent d’environ 17 ans, avec des lunettes, visiblement encore sous le choc, qui répétait les mêmes phrases, parlant de sa mère qui était morte : « Mais elle était vivante, je voulais la secourir, mais il y a eu un deuxième bombardement et elle est morte sous mes yeux ! »
Toujours à Al-Fallujah, un bombardement a frappé la famille des cousins d’un ami. Par respect, je ne cite pas son nom de famille, vous allez comprendre pourquoi. Le père de ce cousin a un puits dans son jardin, et des panneaux solaires qui lui fournissent un peu d’électricité pour faire monter l’eau et remplir des citernes. Quand il peut, il remplit les citernes de ses voisins. Le grand-père était en train de relier la pompe à une citerne, assisté de son petit-fils. C’est à ce moment-là qu’un avion israélien est passé et a lâché une bombe directement sur eux.
Sur les 10 personnes qui se trouvaient là, sept ont été tuées sur le coup et trois ont survécu : la cousine de mon ami, sa mère et sa nièce. Quand les voisins et les secouristes sont venus, ils ont trouvé tout le monde, les morts et les survivants. Sauf le petit Imad, un des enfants de la famille. Ils l’ont cherché pendant deux jours. À un moment, dans une ruelle pas loin, ils voient une meute de chiens affairés autour de quelque chose : ils étaient en train de manger le cadavre du petit Imad, qui avait été projeté là par la bombe. Ils s’étaient déjà attaqués à une partie de sa tête et de son ventre.
Je ne comprends pas pourquoi personne ne bouge
Personne ne peut comprendre ce que veut dire l’humiliation, s’il ne l’a pas vécue. L’humiliation de mourir alors qu’on n’a rien fait. L’humiliation de mourir chez soi. L’humiliation de mourir parce que l’on est en train de donner de l’eau à ses voisins. L’humiliation de ne pas retrouver nos corps, déchiquetés et dispersés par les bombes, dont on ramasse les morceaux pour les mettre dans des sacs en plastique. L’humiliation de retrouver un gamin de six ans, dévoré par les chiens. C’est ce que cherchent les Israéliens. Nous garder dans l’humiliation. Nous faire mourir dans l’humiliation.
Quand tout cela va-t-il s’arrêter ? Quand les gens vont-ils bouger ? Nous sommes des êtres humains. Nous méritons de vivre comme des êtres humains. Notre péché, c’est d’être occupés par les Israéliens.
Je ne comprends pas pourquoi personne ne bouge. Cela se passe sous les yeux du monde entier, sur tous les écrans. Nous ne sommes pas des nombres. Nous ne sommes pas seulement 42 000 morts et 100 000 blessés. Chaque victime a sa propre histoire. Chaque victime a quelque chose à dire. Chaque victime avait des espoirs, des ambitions, des rêves, et voulait tout simplement vivre comme les autres. Je ne comprends pas pourquoi ce monde aveugle refuse de voir toute cette souffrance. Pourquoi personne ne dénonce l’impunité totale de l’occupant ? Mais arrêtez ! Soit ces occupants sont vraiment les leaders du monde, soit le monde nous considère comme des animaux, comme l’a dit Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense. Si nous sommes des animaux sauvages, ce n’est pas grave que nous soyons dévorés par les chiens. Cela arrive, entre animaux.
Quand tout cela va-t-il s’arrêter ? Quand les gens vont-ils bouger ? Nous n’avons ni les yeux bleus ni les cheveux blonds, mais nous sommes des êtres humains. Nous méritons de vivre comme des êtres humains. Notre péché, c’est d’être occupés par les Israéliens. C’est tout ce qu’on a « fait » dans notre vie. Nous sommes nés sur cette terre, qui est occupée par les Israéliens ; nous méritons donc tout ce qu’ils sont en train de nous faire. Et parce qu’ils savent que nous tenons beaucoup à la dignité, ils veulent nous humilier jusqu’au bout. Tout ça pour nous faire partir de cette terre, devenue une terre d’humiliation.
Retrouvez les photographies de Hosny Salah sur Pixbay, Instagram et Facebook.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !






