Léo Magnin est l’auteur de « La vie sociale des haies : enquête sur l’écologisation des mœurs » (La Découverte, 2024) et, avec Rémi Rouméas et Robin Basier, de « Polices environnementales sous contraintes » (Rue d’Ulm, 2024). Longtemps considérées comme des obstacles à la modernisation de l’agriculture, les haies sont désormais parées de toutes les vertus et de nombreuses règlementations visent désormais à les conserver. Quant aux polices de l’environnement (dont la plus importante est l’Office français de la biodiversité), elles sont chargées d’inspecter chasse, agriculture et autres usages de la nature, dans un contexte de tensions croissantes autour des règlementations environnementales. Croiser ces deux sujets permet d’avoir une vue panoramique sur les politiques de la nature, leur élaboration dans les institutions, les débats qu’elles provoquent dans la société et leur (non)application sur le terrain. Une lecture indispensable, alors que reprend le mouvement de contestation agricole.
Un entretien publié en partenariat avec la revue Ballast.
Une haie, qu’est-ce que c’est ?
Question faussement facile ! Les débats autour de la définition de la haie sont vifs dans les sciences et dans le droit. Pour faire simple, disons que le mot « haie » désigne des lignes d’arbres et de buissons. Mais pour quoi faire ? Historiquement, elles sont des clôtures végétales qui entourent les parcelles. Avec la modernisation agricole, elles ont été perçues comme des « obstacles à l’utilisation rationnelle du sol », d’après les termes d’un décret de 1955. À ce titre, elles ont été massivement détruites pour obtenir des champs plus grands. À partir des années 1970, elles sont progressivement requalifiées en éléments du paysage à conserver : elles sont des « corridors biologiques » où se déplace la faune, des « trames vertes » organisant le paysage et les bassins versants ou encore des « puits de carbone » qui captent le CO2 par la photosynthèse. Ajoutons une dimension patrimoniale et esthétique forte : le bocage évoque une campagne préservée. Une haie est donc un élément du paysage d’apparence anodine — d’apparence seulement — sur lequel se fixent des dynamiques sociales contradictoires. Plantées, détruites, maintenant protégées mais toujours détruites : les haies se situent à l’intersection de puissants mouvements historiques.
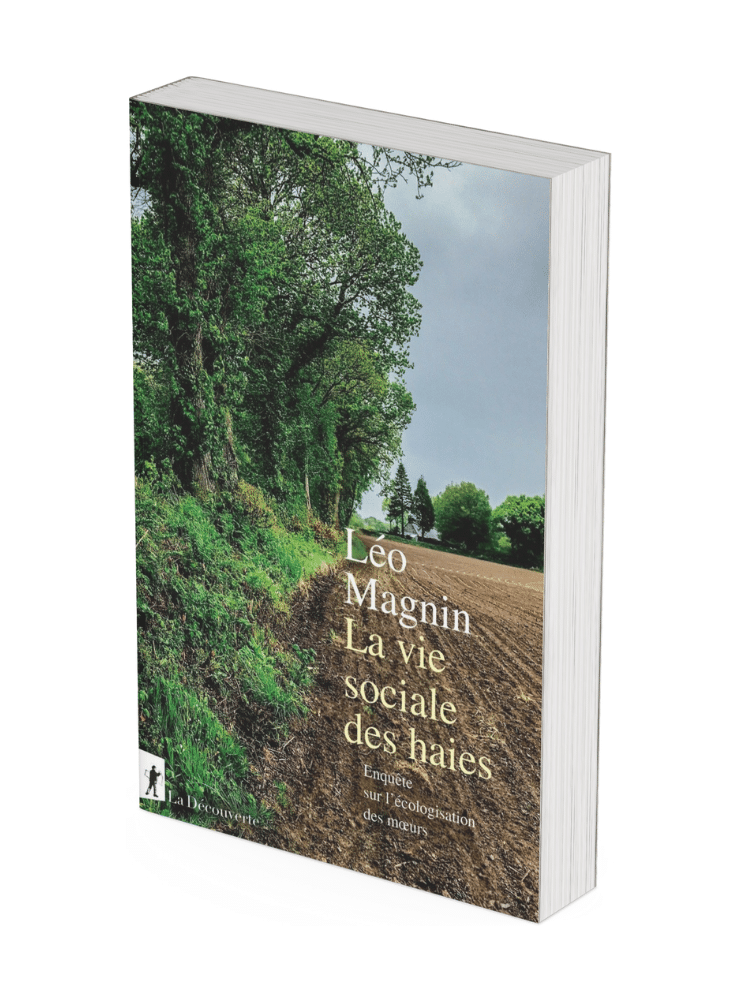
Que vous évoquaient-elles au moment de commencer à travailler dessus ?
Une certaine indifférence. D’abord, parce que, pour les éleveurs que j’avais rencontrés en Auvergne, elles relevaient surtout d’obligations bureaucratiques relatives à l’écologisation de la Politique agricole commune (PAC). Je suis donc arrivé sur ce sujet avec une connaissance très limitée de l’objet lui-même. Je n’étais pas un amoureux des haies de prime abord, je ne connaissais pas grand-chose de leurs effets sur l’érosion causée par le vent ou par l’eau, sur ce qu’elles peuvent apporter en termes agroécologiques. Pour moi, c’était plus un élément du paysage qu’un véritable élément agricole. J’ai commencé mon enquête sur l’écologisation de l’agriculture à partir de documents hérissés de sigles, de seuils administratifs, de coefficients. Mais très vite m’est venue l’idée d’étudier plutôt la protection des haies dans la PAC d’un point de vue ethnographique, en allant voir les gens au travail, que ce soit dans l’administration ou dans les champs. Comment se passe l’écriture de la règle, quel contrôle est mis en œuvre par l’administration, quelles critiques sont formulées par les agriculteurs et des associations ? À partir de cette enquête, j’ai voulu montrer la richesse de cet objet qui, bien au-delà du dispositif de la PAC, renseigne sur un mouvement plus général de transformation de la société : l’écologisation.
Qu’entendez-vous par-là ?
L’écologisation — greening en anglais — est un terme qui désigne l’intégration de critères environnementaux dans des politiques publiques qui ne sont pas environnementales, comme les transports, la santé, l’éducation, la culture, l’agriculture. Le terme désigne aussi désormais des pratiques tout à fait quotidiennes, ordinaires, qui peuvent mettre en jeu des émotions, des affects et des relations sociales en dehors des rapports avec l’État. Pensons par exemple aux pratiques de sobriété dans l’alimentation (végétarisme et véganisme), les transports (ne plus prendre l’avion) ou le numérique (se passer de smartphone)… Je parle pour ma part d’un processus d’écologisation des mœurs afin de lier ces deux aspects. J’entends par là qu’il n’est pas uniquement question d’une politique publique, qui s’incarne ou non dans des manières de vivre, mais aussi du mouvement inverse : ce sont parfois des manières de vivre qui, formalisées d’une certaine manière, s’incarnent dans des politiques publiques.
Lire aussi sur Terrestres : Marine Fauché, Virginie Maris et Clara Poirier, « Sauvages, naturelles, vivantes, en libre évolution… Quels mots pour déprendre la terre ? », février 2022.
Est-ce qu’il a paru évident à vos interlocuteurs de mener une enquête ethnographique sur les haies ?
Pour les personnes que j’ai rencontrées dans l’administration ou dans les associations, oui. Dans d’autres cadres, ça a suscité de nombreuses incompréhensions. Une thèse de sociologie sur les haies, ça brouille les pistes. Mais j’ai constaté une immense transformation entre le moment où j’ai commencé à travailler sur le sujet et aujourd’hui. Je pense que si ce livre était paru il y a huit ans, au moment où je commençais l’enquête, il n’aurait pas intéressé grand-monde, en tout cas probablement pas mon éditeur. Sur les haies, il y avait des livres pour enfants, des manuels de plantation. Aujourd’hui, on assiste à un véritable engouement. Il y a des effets de mode, bien sûr, mais aussi une recherche de solutions qui convoque la haie, comme on peut convoquer la forêt. On est passé d’une sous-question d’un dispositif de politique publique à, en exagérant à peine, un sujet de politique générale.
Aujourd’hui, on assiste à un véritable engouement pour les haies. On est passé d’une sous-question dans un dispositif de politique publique à un sujet de politique générale.
Léo Magnin
Justement, fin 2023, l’ancien ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a lancé un « Pacte en faveur de la haie » à horizon 2030. Pourquoi les haies interviennent-elles au cœur de la politique agricole française ?
Quand Marc Fesneau arrive au ministère, il commande un rapport sur l’état du linéaire de haies, son évolution, et ce qui pourrait être fait pour répondre à la situation. L’organe du ministère qui produit des rapports publie un chiffre inédit révélant qu’on a perdu 20 000 kilomètres de haies par an entre 2017 et 2021, soit quasiment deux fois plus que les 10 400 kilomètres perdus entre 2006 et 2014. Du fait de ce chiffre, le rapport est très médiatisé, ce qui n’était pas du tout attendu. Il est relayé par l’AFP, des grands médias nationaux, Le Monde, France Inter… Fesneau rebondit en lançant un Pacte en faveur de la haie, qui doit comprendre des mesures issues de concertations entre des représentants de l’agriculture et de l’environnement, publics et privés.

Comment le ministre de l’Agriculture envisage-t-il le problème des haies à ce moment-là ?
Pour Fesneau, la haie permet de créer du compromis politique. C’est quelque chose de visible, notamment quand on en plante. C’est aussi un moyen de faire participer les syndicats agricoles qui, quoique ayant des positions diverses, se retrouvent autour d’un élément positif. Il est possible de montrer aux riverains que les haies sont plantées et entretenues, ce qui fait également intervenir les chasseurs, qui parfois s’en chargent, et les associations environnementales. Bref, la haie se trouve au croisement de tous ces groupes sociaux et des conflits politiques qui les traversent. Pour le ministre, il s’agit, à travers la haie, de proposer une sorte d’agroécologie qui, finalement, s’inscrit assez bien dans ce qu’avait voulu faire Stéphane Le Foll avant lui avec l’agroforesterie. L’idée n’est pas de transformer radicalement l’agriculture : on essaye plutôt d’embarquer le plus de monde possible — des personnes qui peuvent être aux antipodes les unes des autres. Pourtant, pour avoir participé aux négociations du Pacte en tant que sociologue qui a travaillé sur le sujet, je peux dire que c’était loin d’être aussi consensuel que ce que laisse entendre ce récit conciliateur.
En quoi ?
Il y a des oppositions anciennes entre d’un côté les représentants agricoles institués — les chambres d’agriculture, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) — qui poussent pour que les mesures de protection des haies soient les moins contraignantes possibles et, de l’autre, les représentants de l’environnement — des associations écologistes comme France Nature Environnement (FNE) et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), mais aussi des administrations publiques comme l’Agence de la transition écologique (ADEME) ou le ministère de la Transition écologique — qui pensent qu’il faudrait les protéger un maximum. La proposition du ministère de l’Agriculture est de couper la poire en deux : plus de contrôles tout en assouplissant la règle. C’est un compromis qui donne une direction particulière : la préservation des haies existantes n’est pas au cœur des discussions, c’est la plantation qui occupe une place centrale dans le Pacte en faveur de la haie1.
C’est extrêmement complexe aujourd’hui d’être agriculteur et la dimension environnementale complexifie encore plus le métier.
Léo Magnin
Quelques mois plus tard, en pleine crise agricole, Gabriel Attal déclare que les « 14 réglementations » concernant les haies vont être réduites à une seule. Comment se fait-il qu’elles servent de levier pour mettre fin à un conflit social ?
Dans les mobilisations agricoles, la haie a été érigée comme l’emblème de l’absurdité bureaucratique. Lorsque Gabriel Attal fait son discours le 26 janvier 2024, le mouvement des agriculteurs est fortement monté en puissance depuis une dizaine de jours. C’est à ce moment-là que le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, critique les « 14 réglementations » autour des haies. Ce chiffre, médiatisé parce qu’il parle à tout le monde, devient emblématique du mille-feuille administratif français. Le Premier ministre s’en empare et annonce passer de 14 réglementations à une seule — ce qui en droit n’est pas réalisable, à moins par exemple de supprimer les réglementations de protection des zones de captage d’eau potable… Sa réponse ne porte pas tant sur la question de la préservation des haies que sur l’administration, la bureaucratie que celle-ci représenterait. Concrètement, il s’agit de faire des guichets uniques. Les réglementations existantes, toutes différentes, perdurent. L’administration propose de donner une réponse unique à l’agriculteur, à la collectivité, au particulier ou à l’entreprise qui demande une destruction de haie.
Lire aussi sur Terrestres : Benoît Dauguet, « Mesures contre nature », juillet 2021.
À quoi aurait pu ressembler une réponse constructive sur le long terme ?
Un chantier politique d’importance, c’est de prendre au sérieux la demande de simplification qui a été exprimée dans les mobilisations. C’est extrêmement complexe aujourd’hui d’être agriculteur et la dimension environnementale complexifie encore un peu plus le métier. Ce sont ceux qui sont le plus conseillés qui peuvent le mieux s’en sortir face aux demandes de conformité administrative, comme on l’observe dans le domaine fiscal pour la population générale : ceux qui ont le plus de capital économique peuvent le convertir en prestations pour diminuer les coûts de conformité par rapport à l’administration, pratiquement sans changer leurs pratiques. Mais il ne s’agit pas simplement de dire qu’il y a trop de règles, car elles sont globalement très peu appliquées. Il y aurait un vrai chantier de mise à plat à faire pour hiérarchiser clairement les objectifs et placer la préservation de l’existant au centre, afin qu’il devienne beaucoup plus facile pour les agriculteurs d’être en conformité et de savoir s’ils le sont. Plus fondamentalement, de prochaines « crises » sont prévisibles parce que la disparition de l’agriculture familiale est un mouvement de fond. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, avec des exploitations de plus en plus grandes. Si on revient au sujet initial, qui est un révélateur de cette situation, ils ont donc plus de haies à entretenir et de moins en moins de temps pour le faire.
Par ailleurs, dans son discours Gabriel Attal ne se contente pas d’aborder la réglementation, il interroge aussi celles et ceux dont le métier est de la faire appliquer. Il ajoute en effet une question : « Est-ce qu’il faut vraiment venir armé pour contrôler une haie ? ». Il sous-entend par-là que la police de l’environnement de l’Office français de la biodiversité (OFB) n’est pas habilitée à porter une arme dans une exploitation agricole. Rappelons pourtant que les agents de l’OFB contrôlent beaucoup plus de chasseurs que d’agriculteurs ; on peut donc trouver relativement équilibré qu’ils soient armés face à des particuliers détenteurs d’une arme. Avec cette phrase, le Premier ministre envoie un message politique qui anticipe une éventuelle prochaine crise agricole. Il a probablement essayé de parer au plus pressé, sauf qu’en voulant résoudre rapidement une crise — la FNSEA menaçait alors de bloquer Paris — il a établi les conditions de la prochaine. Peu de temps après l’annonce d’un possible désarmement des agents de l’OFB, il y a eu des dégradations de locaux de l’agence dans le Sud-Ouest à l’initiative de la Coordination rurale, qui a déclaré qu’il était inadmissible que des agents arrivent armés sur un terrain agricole. À l’inverse, nous n’avons aucune mention ou donnée, ni administrative, ni syndicale, qui documente des intimidations ou des agressions d’agriculteurs par des agents.
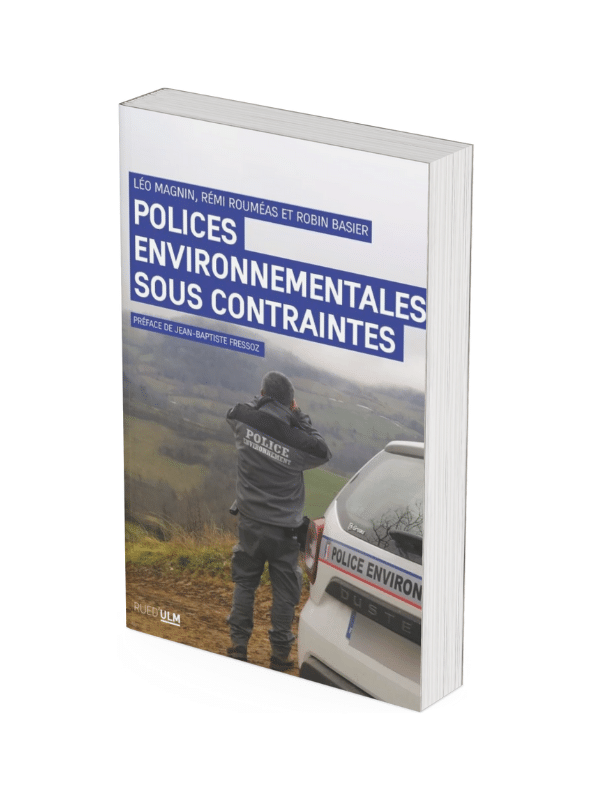
Ces polices de l’environnement sont méconnues. Que font précisément leurs agents ?
Il y en a environ 1 500 inspecteurs de l’environnement à l’OFB, entre 12 et 15 par département en moyenne. Les missions de police ne représentent que 50 % à 60 % de leur temps. Le reste comprend des missions de connaissance des milieux, de sensibilisation des publics et d’appui technique, par exemple à des collectivités. Quand ils font de la police, ils contrôlent d’abord des particuliers et ensuite des agriculteurs, des entreprises, des collectivités. Ils habitent le territoire dans lequel ils interviennent, certains sont en place depuis plusieurs décennies, étaient gardes-chasse ou gardes-pêche avant, et sont connus des instances agricoles. Contrairement à la police de droit commun, il ne s’agit pas, pour la police de l’environnement, de maintenir un ordre social ou économique qui préexiste, mais de faire appliquer le droit pour qu’il y ait moins de haies arrachées, moins de phytosanitaires utilisés près des cours d’eau, par exemple. C’est pourquoi, avec Rémi Rouméas et Robin Basier, nous parlons d’une « police d’avant-garde », c’est-à-dire d’une force d’un ordre environnemental qui se heurte à l’ordre social en place. De ce fait, la sanction n’est pas là uniquement pour rappeler à l’ordre un individu qui serait un petit peu en marge, mais plutôt pour essayer d’orienter tout un ensemble de pratiques, celles des agriculteurs mais aussi des aménageurs, des collectivités, des particuliers, des chasseurs, des utilisateurs de quads et de motos sur les chemins, des ramasseurs de champignons, des exploitants forestiers… Ça concerne finalement beaucoup de monde !
En matière environnementale, la question de la réparation est centrale : qu’est-ce qu’il est possible de faire pour remettre en état ?
Léo Magnin
Si cette police est « d’avant-garde », tâtonnante, ne serait-ce pas l’occasion d’essayer autre chose, voire de s’en passer ?
C’est le souhait des responsables de pollutions ! Mais j’imagine que vous faites allusion aux positions abolitionnistes qui proposent de supprimer la police. Si je formule la question autrement : faut-il reconduire cette idée de forces de l’ordre avec des sanctions pénales sur des sujets progressistes, comme le féminisme ou l’environnement ? Rémi Rouméas est confronté à la même question dans ses travaux sur la correctionnalisation — comment un crime est traité en tant que délit. Cet aiguillage judiciaire concerne en bonne partie les viols, qui sont requalifiés en agression sexuelle. Ce sont des points très discutés par des militantes. Faut-il conserver les forces de police et un traitement pénal inchangé ? Si ce n’est pas un corps de professionnels qui prend en charge la recherche et la constatation d’infractions, s’il n’y a pas un tiers qui est représenté par un procureur et un juge pour essayer de désenclaver un conflit interindividuel, comment s’y prend-on ? La question est ouverte et dépasse mes compétences de sociologue.

En matière environnementale, ce sont des débats qui travaillent l’institution judiciaire, que ce soit la police, les procureurs, les juges, et même le versant administratif, qui dépend du préfet. Plus que dans certains domaines, peut-être, la question de la réparation est centrale. Un cours d’eau est complètement recalibré, son lit est totalement changé, il y a une zone humide qui est drainée : qu’est-ce qu’il est possible de faire pour le remettre en état ? C’est la première des questions posées par les personnes qui travaillent dans l’institution judiciaire, bien au-delà de la sanction répressive du pénal. Il y a de nombreuses alternatives aux poursuites, qui peuvent théoriquement aller jusqu’au tribunal, voire à la prison — ce qui, rappelons-le, n’est pratiquement jamais le cas, dans les faits, sur les litiges environnementaux.
Est-ce qu’on peut imaginer une jonction entre, par exemple, les agents de l’OFB chargés d’aller dans le sens d’une écologisation des pratiques dans les milieux agricoles et naturels et des associations et militants écologistes ?
Vous pourriez écrire un roman, peut-être [rires] ! Sans vouloir faire le sociologue rabat-joie, la pyramide des âges des agents de l’OFB est à peu près similaire à celle des agriculteurs. La moyenne se situe autour de 55 ans. Ils sont arrivés à ce métier principalement par la pêche, et par la chasse — deux tiers de ses effectifs travaillaient à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) avant sa fusion avec d’autres structures au sein de l’OFB. On n’est absolument pas sur des profils de zadiste ou d’antispéciste ! Je schématise, mais c’est important de le rappeler, car même si certains agents étaient auparavant dans des associations environnementales, cela ne doit pas amener à projeter trop d’attentes. On ne parle pas d’une force sociale, mais d’un métier en construction.
Le « solutionnisme social » entérine le recul continu des métiers de la production primaire (agriculture, forêt, pêche) dans les économies des pays dits développés.
Léo Magnin
Quant aux policiers de l’environnement que nous avons rencontrés, s’ils se montrent critiques vis-à-vis des discours comme celui d’Attal, c’est principalement parce qu’il fragilise la légitimité de leur institution. Ils mettent un point d’honneur à rappeler qu’ils ne sont pas militants. Ils font appliquer la loi, ils ne décident pas de son contenu. Un point de jonction avec le monde associatif n’est pas inimaginable, mais il faudrait lever certains malentendus. Des agents font face à des attentes contradictoires et ont parfois le sentiment de toutes les décevoir : d’un côté, leurs rapports techniques sur des projets d’installations peuvent être perçus comme trop critiques du point de vue des aménageurs ; de l’autre des associations peuvent leur reprocher de ne pas avoir complètement interdit l’installation. C’est précisément pour ça qu’il est passionnant d’analyser sociologiquement le travail des agents : c’est une lorgnette empirique qui nous renseigne sur l’écologisation heurtée de la société française.
Vous parlez de « solutionnisme social » pour décrire un recours croissant aux agriculteurs pour répondre à des problématiques toujours plus complexes. On pense aussi à cette campagne de communication du ministère de l’Agriculture sur les « métiers du vivant » qui rassemblaient agriculteurs, donc, mais aussi pêcheurs, paysagistes…
La critique se focalise souvent sur le solutionnisme technologique, la géo-ingénierie, les startups censées nous sauver. Il importe de comprendre que ces promesses sont fondées sur un solutionnisme social, c’est-à-dire sur une division sociale du travail toujours plus poussée. Dans ce schéma, il est admis que les métiers de la production primaire (agriculture, forêt, pêche) doivent continuer à régresser dans les économies des pays dits développés. Or la question environnementale invite justement à repenser la place de ces secteurs-là, qui sont bien plus que des secteurs économiques démographiquement minoritaires.
Lire aussi sur Terrestres : Salvador Juan, « Défendre les normes pour défendre une autre agriculture ? », février 2024.
Aujourd’hui, la surface agricole, soit 52 % du territoire français, est exploitée par moins de 2 % de la population active. Ces chiffres posent une question proprement politique : est-il logique, viable et durable, dans un sens social et environnemental, de confier à si peu de personnes le fait de produire de la nourriture — dans une proportion plus importante que nos besoins afin d’exporter — et dans le même temps d’entretenir et de préserver un paysage auquel nous sommes attachés pour des raisons de biodiversité, d’esthétique, de patrimoine et d’adaptation au changement climatique ? Le solutionnisme social consiste à laisser dans l’ombre la dynamique de la division sociale du travail. Pointer du doigt cet impensé revient à penser autrement l’évolution possible des structures sociales : qui se préoccupe d’environnement et, surtout, qui s’en occupe ? Quelle pensée du travail, quelle hiérarchie des professions faudrait-il réinventer pour dépasser la délégation des enjeux massifs à une si petite portion de la population ?
Les critiques du monde agricole à l’égard des politiques environnementales ne se réduisent pas à un face-à-face entre des agriculteurs et l’État : il s’agit en fait d’un conflit interne à l’État.
Votre démarche est avant tout descriptive. Vous écrivez, en réaction à des appels plus théoriques, philosophiques et politiques, que « l’intention louable d’aider les lecteurs à s’orienter dans un monde bouleversé fait souvent primer la prescription sur la description ». À l’impératif employé dans ces textes, vous opposez l’indicatif présent ?
À mon sens, l’action politique qui souhaite produire des effets ne peut se passer de descriptions dépassionnées des mécanismes sociaux. Mon livre n’est ni une utopie, ni un traité, ni un manifeste. Ce n’est pas non plus un livre de poétisation du rapport à la nature ordinaire. Sur les sujets environnementaux, c’est principalement ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui — et c’est important que ces publications existent. En ce qui me concerne, je préfère tirer des fils pour arriver à des constats. Pour cela il faut être patient, laborieux, prendre le temps de l’enquête et de l’analyse, tout en ayant à cœur l’aspect compréhensif de la tradition sociologique : se mettre à la place des personnes dont on essaye de décrire la manière de vivre et les contraintes auxquelles elles sont confrontées. Je souhaitais aussi prendre quelques évidences à rebrousse-poil, notamment sur l’aspect économique, pour montrer que les haies ont été édifiées, plus que plantées, parce qu’elles ont été ensuite travaillées principalement pour des motifs économiques. On a perdu ces motifs au fur et à mesure de l’industrialisation, de l’allongement des chaînes de commercialisation, jusqu’aux Castorama et Bricomarché d’aujourd’hui. Nous n’avons plus besoin d’aller tailler des branches dans des haies pour pouvoir faire des balais, des habitations, nous chauffer. Interroger les usages sociaux des haies revient aussi à explorer le poids de l’économie dans la société, son inertie et ses possibles émergents.

On peut enfin noter que dans La Vie sociale des haies comme dans Polices environnementales sous contraintes, votre précédent livre co-écrit avec Rémi Rouméas et Robin Basier, l’État apparaît comme un acteur omniprésent des tensions, conflits et pratiques que vous décrivez.
L’unicité de l’État est un mythe. C’est un enseignement fondamental de la sociologie politique, que nos enquêtes confirment. L’État ne s’accorde pas au singulier. C’est une foule d’institutions diverses et qui ne se situent pas en dehors des groupes sociaux. Dans Polices environnementales sous contraintes, nous montrons que les critiques du monde agricole à l’égard des politiques environnementales ne se réduisent pas à un face-à-face entre des agriculteurs et l’État, mais qu’il s’agit en fait d’un conflit interne à l’État. Les représentants agricoles ont en effet des relais dans l’État, y compris d’un point de vue électoral, avec des élus Les Républicains qui étaient il y a quelques années encore dirigeants de leurs syndicats. Je pense par exemple au sénateur Laurent Duplomb, en Haute-Loire, qui était président des JA de son département et qui souhaite réformer fortement l’OFB. L’itinéraire de François Guillaume est le plus paradigmatique : en 1986, il passe directement de président de la FNSEA à ministre de l’Agriculture de Jacques Chirac.
Dès qu’on regarde de près les personnes qui travaillent à l’intérieur de l’État, l’histoire des institutions et leurs rapports de force, le pluriel devient évident, parce qu’il y a de puissants affrontements en son sein. L’un d’entre eux, classique, oppose le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Transition écologique. C’est devenu proverbial depuis la création du ministère de l’Environnement en 1971. On peut aussi penser à l’opposition, schématique et qui dépend de configurations locales très variables, entre d’un côté le préfet, qui est là pour faire appliquer les consignes de l’exécutif et dont la principale mission est de maintenir l’ordre économique et social en place localement et, de l’autre, le procureur qui, à condition qu’il soit sensibilisé aux enjeux environnementaux, a pour mission de faire déboucher des affaires au pénal sans se préoccuper de contestations éventuelles. Dans certains départements, on constate donc un conflit entre le judiciaire et l’exécutif. En définitive, parler de l’État au singulier est commode mais paresseux et trompeur, surtout pour élucider ce qui se joue dans l’écologisation de notre société.
Photo d’ouverture : Vincent van Gogh, Champ clos avec paysan, 1889.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Depuis que cet entretien a été réalisé, ledit pacte a vu son enveloppe réduite de 72 % par le budget proposé par le gouvernement Barnier [ndlr].[↩]








