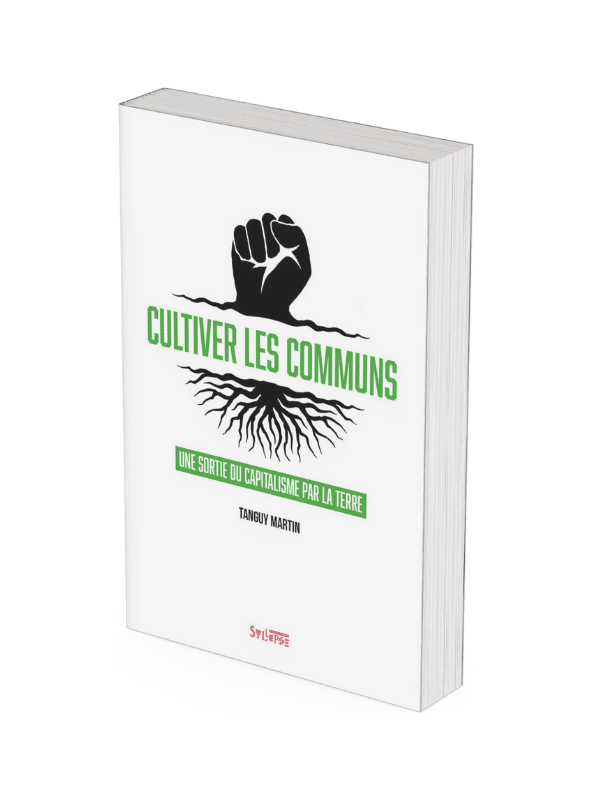
À propos de Cultiver les communs. Sortir du capitalisme par la terre de Tanguy Martin, Syllepse, 2023.
Il y a bien longtemps que les projets de réforme agraire ont déserté les imaginaires socialistes européens. La bourgeoisie qui « ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production1 » ne se prive pas, quant à elle, d’annoncer une troisième révolution agricole « numérique, robotique, génétique2 » fondée sur l’usage d’intelligences artificielles, le développement d’une machinerie de pointe et la modification génétique du vivant. Les propositions politiques qui visent à « reprendre la terre aux machines3 » et au capital apparaissent d’autant plus salutaires qu’elles sont minoritaires. C’est dans ce contexte qu’il faut lire l’excellent livre de Tanguy Martin, Cultiver les communs. Une sortie du capitalisme par la terre. L’auteur travaille pour Terre de liens et milite dans différents collectifs, dont Reprise de terres et pour une sécurité sociale de l’alimentation. L’ouvrage est écrit depuis cette situation qui offre un ancrage dans les luttes paysannes contemporaines et fournit de nombreux exemples de réappropriation des moyens de vivre4.
Pour Martin, la révolution vers une agriculture paysanne suppose une réforme institutionnelle de grande ampleur qui commence par la transformation du foncier agricole en bien commun, grâce à une réappropriation des institutions déjà-là. La socialisation de la terre est une condition nécessaire pour une agriculture paysanne favorisant la conservation de la diversité des mondes vivants, domestiques et sauvages.
La révolution vers une agriculture paysanne suppose une réforme institutionnelle de grande ampleur qui commence par la transformation du foncier agricole en bien commun.
Disons d’emblée que le thème majeur de l’ouvrage, la socialisation du foncier agricole, tout à la fois prolonge et déplace la question des communs naturels. Elle la prolonge puisque la fin ultime est bien celle d’une mise en commun, c’est-à-dire d’un partage démocratique, équitable et soutenable de l’accès aux ressources. Elle la déplace cependant car la socialisation désigne la répartition du foncier par l’intermédiaire d’institutions juridico-politiques mobilisant la force universalisante du droit. Loin d’une auto-institution des communs, la socialisation de la terre se présente à la fois comme un partage institutionnalisé des conditions de production (une socialisation de la valeur dirait Bernard Friot, dont l’auteur semble politiquement assez proche) et comme une étape de transition vers la communisation agraire, c’est-à-dire vers la suppression de l’appropriation privée des moyens de vivre.

L’auteur se propose ainsi de « doter les mouvements sociaux d’une grille de lecture anticapitaliste du foncier agricole, en lien avec la notion de commun » en élaborant « des lignes directrices stratégiques à débattre pour mieux construire un horizon commun5 » aux luttes anticapitalistes. Or cet objectif me semble être d’une grande originalité dans le paysage intellectuel des pensées de l’émancipation. D’une part, il propose des institutions formelles des communs à partir du « déjà-là » de la socialisation de la terre, proposition qui confère à l’ouvrage un caractère plus concret que celui que revêt souvent la littérature académique sur les communs. D’autre part, il propose d’instituer le foncier en commun comme condition pour une transformation des pratiques agricoles, pour le renforcement des communautés habitantes rurales et pour servir de « base arrière » aux luttes d’émancipation. D’allure modestement juridique, Cultiver les communs a donc une grande ambition politique. Cette écologie politique du foncier agricole articule une réflexion sur les normes politiques désirables, sur les institutions juridiques qui pourraient les mettre en œuvre et sur les forces sociales capables de les porter. Son originalité tient à l’expérience de terrain de son auteur et à son érudition quant aux politiques agraires.
Cette écologie politique du foncier agricole articule une réflexion sur les normes politiques désirables, sur les institutions juridiques qui pourraient les mettre en œuvre et sur les forces sociales capables de les porter.
L’ouvrage se découpe en quatre chapitres, ponctués de trois « respirations6 » – « Fumure », « Semis », « Récolte ». Le premier chapitre porte sur la marchandisation de la terre dans le néolibéralisme contemporain. Le deuxième aborde la spécificité de la régulation foncière française, héritée de l’après-guerre, et qui joue souvent le rôle d’exemple possible pour une régulation démocratique du foncier agricole. Le troisième chapitre est consacré au type de propriété qui peut permettre de faire sortir la terre du capitalisme tandis que le chapitre final s’interroge sur les usages du foncier nécessaires pour « effacer la propriété capitaliste ».
Problèmes et méthodes
J’ai abordé ma lecture de Cultiver les communs avec trois séries de questions qui organisent cette recension. Premièrement, l’une des questions classiques de la sociologie rurale et des études agraires critiques est de savoir si la paysannerie forme une classe à part entière – dominée par le capital marchand même lorsqu’elle est propriétaire de la terre et des moyens de production – ou bien si elle est au contraire fragmentée entre un prolétariat rural (ouvriers agricoles, travailleurs saisonniers…) et une bourgeoisie paysanne (parfois en voie de prolétarisation). Pour le dire de manière très schématique : tandis que la sociologie rurale d’inspiration marxiste insiste sur la fragmentation de la paysannerie en refusant absolument l’idée d’une classe et d’un mode de production paysans7, les études agraires critiques d’inspiration « néo-populiste8 » ou libertaire9 insistent au contraire sur l’unité des paysan·nes dans les luttes d’émancipation à l’heure du désastre écologique. Cette question, aussi caricaturale qu’elle puisse paraître présentée de manière succincte comme je viens de le faire10, contient pourtant d’importants enjeux théoriques et stratégiques.
À s’intéresser principalement aux formes de propriété des moyens de production agricoles – à commencer par le foncier lui-même – est-ce qu’on ne risque pas de rater les formes spécifiquement capitalistes d’exploitation du travail en contexte agro-industriel au sens large (ouvriers agricoles, travail saisonnier, travail dissimulé, travail non payé, travailleurs de la logistique, des abattoirs, etc.) ? Cette deuxième question a immédiatement un enjeu tactique sur le type d’alliance à construire : avec quels travailleur·ses ? Avec quels syndicats ? Par l’entremise de quelles institutions ? Pour le dire concrètement, faut-il viser des alliances avec les tendances les plus à gauche des agriculteur·ices (y compris dans les syndicats majoritaires comme la FNSEA) ou bien avec les travailleur·ses non paysan·nes de l’agro-industrie ? Comment mettre en place une agriculture paysanne et lutter en même temps contre les formes d’exploitation du travail dans l’agro-industrie ?

Enfin troisièmement, si le capitalisme agraire fonctionne par l’articulation d’un certain régime de propriété de la terre et de différentes formes d’exploitation du travail, humain et autre qu’humain, qui s’intègrent dans un vaste système agro-industriel, on peut se demander si l’institutionnalisation de communs permet, à elle seule, de sortir de ce système. Il semble qu’il y ait parfois un décalage entre la stratégie de la socialisation institutionnelle du foncier et l’objectif final qu’elle est censée réaliser.
Cultiver les communs propose des réponses nuancées à ces trois questions témoignant d’un pragmatisme stratégique qui cherche à élargir les pratiques qui « marchent » sur la base d’institutions déjà existantes.
Une écologie politique de la terre
Une bifurcation agroécologique suppose une socialisation de la terre, c’est-à-dire la répartition de la terre organisée par les normes contraignantes du droit et des institutions politiques adéquates (comme la réappropriation démocratique des SAFER, j’y reviendrai). Cette thèse originale de Martin s’enracine dans une définition de la terre en provenance de l’écologie politique contemporaine qui permet de critiquer l’économie politique agraire classique.
« Support de fonctions écosystémiques11 », la terre est un espace où s’entrelacent les dynamiques conjointes propres aux mondes vivants, à l’atmosphère et à la lithosphère. La terre ainsi définie renvoie au substrat matériel et spatial de la « zone critique » sur laquelle la vie a pu se développer. Ces interactions complexes sont le produit de fonctions écosystémiques multiples qu’elles favorisent en même temps. Dans Cultiver les communs, cette définition de la terre comme support de fonctions écologiques variées fournit une norme immanente aux pratiques agricoles elles-mêmes.
Si une terre en bonne santé est le support d’un grand nombre de fonctions écosystémiques variées et redondantes, une agriculture paysanne doit elle aussi combiner de multiples usages du foncier, à la fois productifs (élevage, polyculture, sylviculture), récréatifs (fonctions de loisirs ou éducatives) et de conservation (espaces non cultivés et en libre-évolution favorisant la biodiversité sur les espaces agricoles comme le préconise par exemple l’association Paysans de nature12,). La définition multifonctionnelle de la terre fournit donc une norme écologique au développement de communs agricoles. Par-là, l’un des vieux débats de la philosophie environnementale sur l’anthropocentrisme et l’écocentrisme s’en trouve réglé en quelques lignes, avec un bon sens qui ne manque pas dans l’ouvrage.
Une agriculture paysanne doit combiner de multiples usages du foncier : à la fois productifs, récréatifs et de conservation.
En effet, la conservation des écosystèmes au sein des espaces agricoles répond à la fois à des intérêts humains (la vie humaine en général et l’agriculture en particulier ont besoin d’écosystème viable) et à des intérêts autres qu’humains : la singularité, la vitalité et la beauté des écosystèmes méritent qu’on les préserve pour eux-mêmes13. Socle des intérêts humains et des intérêts écologiques, la terre acquière de ce fait une définition territoriale. Elle ne renvoie donc pas seulement à la parcelle délimitée et appropriable, ni à l’ensemble des relations écosystémiques qui permettent aux entités naturelles de se coproduire et de s’engendrer, elle désigne également un paysage et un territoire, produits par les activités multiples des relations humaines et autres qu’humaines14. « Résultat matériel d’un processus de co-évolution », le territoire produit par des communs agricoles permet de dépasser la dualité ville-campagne et de reconstituer une vie culturelle communautaire dans les campagnes.

À la lecture de Cultiver les communs, on est parfois saisi par une tension fertile entre la technicité des institutions du foncier agricole et le rêve arcadien d’une communauté paysanne vivante15, d’une « Gemeinschaft » rurale comme aurait dit le sociologue allemand Ferdinand Tönnies. La nécessité d’arracher la terre à la propriété privée ne s’inscrit pas seulement dans une analyse écologique de la multifonctionnalité des écosystèmes et dans une lecture stratégique de ses effets possibles sur la territorialité rurale. Elle se fonde également sur une présentation claire et rigoureuse de l’économie politique classique.
Reprenant à Karl Polanyi l’idée que la terre est une marchandise fictive, Martin propose de sortir la terre du marché de la propriété privée. Il étudie le fonctionnement de la rente foncière en reprenant la distinction marxienne entre rente absolue et rente différentielle16. La rente absolue renvoie à la rareté de la terre, au fait que son appropriation par l’intermédiaire du marché permet de dégager un bénéfice pour le propriétaire quelle que soit sa richesse écosystémique, sa situation spatiale et la quantité de capital qui y a été investi pour la rendre plus productive. Tous ces éléments (nature, espace, capital) constituent en revanche la rente différentielle qui explique les mécanismes de spéculation foncière et de rentabilité de la terre : la différence de situation entre un champ et un autre (plus ou moins fertile par exemple), la position géographique des infrastructures (plus ou moins accessibles des grands réseaux de communication), l’investissement en capital (plus ou moins importants), toutes ces dimensions contribuent à établir une hiérarchie entre les terres agricoles et favorisent la spéculation.
Partant d’une analyse de la rente foncière, l’auteur en conclut que la terre ne peut être une marchandise, car « si le marché n’est pas un mauvais mode de coordination des activités humaines en soi, il n’est pas adapté à la question des terres17 ». La propriété privée de la terre explique le phénomène de la rente foncière et la spéculation à laquelle elle se prête. Elle est pourtant insoutenable écologiquement et politiquement inégale puisqu’elle favorise la concentration des terres (pensons à Arnaud Rousseau, chef d’une exploitation céréalière de plus de 700 hecatres, président de la FNSEA ainsi que du groupe agroalimentaire Avril) et un accroissement des rendements productivistes.
« Si le marché n’est pas un mauvais mode de coordination des activités humaines en soi, il n’est pas adapté à la question des terres. »
Tanguy Martin
Il me semble que le statut stratégique de la socialisation de la terre par la force du droit et la réappropriation des institutions politiques de répartition du foncier n’est pas toujours très clair dans l’ouvrage. S’agit-il de penser une étape transitoire avec les outils institutionnels dont nous disposons ? Ou s’agit-il au contraire d’une stratégie ultime qui viserait seulement à exclure certains biens spécifiques du marché tout en maintenant l’existence d’un marché capitaliste pour les autres produits ?
Les marxistes politiques anglais, Robert Brenner et Ellen Meiksins Wood, ont développé quelques arguments convaincants contre le socialisme de marché18. Le principal exprime un doute quant à la possibilité de transformer le marché capitaliste lui-même vers un marché non capitaliste. Peut-être tous les marchés ne sont-ils pas néfastes en tant que tels, mais le capitalisme se présente comme un système économique qui impose la marchandisation de la terre et de la force de travail par la contrainte, c’est-à-dire par le droit mais aussi par la violence.
En effet, la matrice de l’exploitation capitaliste est la marchandisation de la force de travail : pour que des individus soient contraints d’assurer leur subsistance par l’intermédiaire du marché (marché de l’emploi et marché des biens de consommation), il faut qu’ils aient été privés de l’accès à leurs moyens de subsistance, à commencer par la terre. Cette séparation initiale est en permanence reproduite par le capital car elle est la condition essentielle de sa survie. La socialisation de la terre ouvre au contraire des espaces d’autonomie. Si des institutions juridico-politiques permettent un partage plus égalitaire et plus soutenable de la terre, la dépendance au marché capitaliste s’en trouvera nécessairement diminuée. La socialisation de la terre à grande échelle n’est donc pas qu’une question de foncier agricole ou d’institutionnalisation des communs, comme Martin le sait bien. Elle est un coin enfoncé dans la reproduction des rapports de classe.
Pour que des individus soient contraints d’assurer leur subsistance par l’intermédiaire du marché, il faut qu’ils aient été privés de l’accès à leurs moyens de subsistance, à commencer par la terre.
Telle que je la comprends, la socialisation de la terre défendue par Tanguy Martin ne peut donc être qu’une étape provisoire vers la réalisation du communisme19. En revanche, s’il s’agit d’une fin ultime, elle me semble historiquement contradictoire avec la nature du marché capitaliste. Mais une telle socialisation de la terre à grande échelle suppose des forces révolutionnaires ou, a minima, des forces capables de radicaliser l’antagonisme avec les institutions politiques qui assurent la perpétuation du marché.
Il paraît difficile de compter sur la naïveté de l’État et des capitalistes agroindustriels, qui se laisseraient berner par une dissémination locale d’expériences de gestion de terres en communs. Peut-on alors vraiment isoler la stratégie de la socialisation de la terre d’une analyse du rapport de force politique à construire pour élargir et maintenir cette socialisation ? C’est peut-être la seule critique de fond que j’adresserais à l’ouvrage. S’il convient de socialiser la terre et si Tanguy Martin nous montre les institutions déjà existantes dont on pourrait se saisir pour la réaliser, comme nous le verrons plus bas, il reste prudent sur la manière d’instaurer un rapport de force qui permette d’élargir et d’accélérer le mouvement de socialisation de la terre. Si l’ouvrage n’aborde pas de stratégies précises pour radicaliser l’antagonisme avec les expropriateurs, Cultiver les communs est en revanche particulièrement percutant dans la description critique des mécanismes du marché foncier capitaliste et des formes d’oppression auxquelles il donne lieu.
Une théorie de l’oppression en contexte agraire
Tanguy Martin reprend à la philosophe féministe Iris Marion Young sa théorie des formes d’oppression. Dans Justice and the Politics of Difference20, elle distingue cinq formes possibles d’oppression qui peuvent s’entrelacer : a) l’exploitation du travail qu’il soit payé ou non ; b) le pouvoir de la classe dominante d’empêcher l’action et l’organisation des dominé·es ; c) la marginalisation d’une partie des dominé·es qui a notamment pour effet une disciplinarisation par la peur de celles et ceux qui n’en sont pas encore victimes ; d) la capacité à légitimer sa domination par l’impérialisme culturel ; e) l’usage de la violence pour affecter l’intégrité physique ou psychique d’un individu ou d’un groupe. Cultiver les communs applique cette théorie de l’oppression à l’histoire du capitalisme agraire dans le monde moderne depuis les plantations coloniales de Sao Tomé jusqu’à l’implantation idéologique du productivisme dans les esprits contemporains21. Son analyse des structures patriarcales de l’accès au foncier constitue une des pistes les plus originales de cette théorie des oppressions en contexte agraire.

À la suite des travaux de la sociologue Sabrina Dahache et d’une enquête qu’il a réalisée avec Matthieu Dalmais, Martin montre en effet que l’accès des femmes au foncier est beaucoup plus compliqué que celui des hommes malgré les lois qui défendent l’égalité des droits. Le fait qu’elles manquent de « ressources propres et d’appuis solides s’ajoute à la défiance des organismes prêteurs et des bailleur·eresses de terres potentiels22 ». Puisque les banques leur consentent plus difficilement des prêts et des montants moins importants que ceux des hommes, elles sont obligées de se « reporter sur les plus petites unités de production23 ». Dans la mesure où les femmes sont plus éduquées à prendre soin des autres et des environnements, « la limitation dans de nombreuses parties du globe de l’accès des femmes à la terre et / ou à un statut professionnel agricole est un facteur aggravant de la destruction des écosystèmes24. »
L’accès des femmes au foncier est beaucoup plus compliqué que celui des hommes malgré les lois qui défendent l’égalité des droits.
Cultiver les communs insiste également sur la dimension coloniale-raciale de l’oppression foncière. En affirmant que « la question du foncier agricole et de son accaparement est consubstantielle à la question coloniale », Tanguy Martin insiste sur la différence entre impérialisme et capitalisme. Si le capitalisme a toujours été impérialiste, ayant vocation à soumettre le monde entier à la logique de la valorisation en prenant « la planète entière pour théâtre25 », l’impérialisme ne se réduit pas à une question économique. Il répond également à des logiques raciales et territoriales de conquête du pouvoir. On pourrait dire à la suite de Giovanni Arrighi et de David Harvey que la domination des nations répond à une double logique : logique économique de l’accumulation de valeur, logique politique de l’extension du pouvoir territorial. Dans le contexte actuel des pratiques génocidaires à Gaza, on peut citer l’un des exemples de Martin :
« Plus proche dans le temps, en Palestine l’extension des colonies israéliennes sur les terres attribuées au proto-état palestinien par les accords internationaux dépasse la logique économique capitaliste et vise une pure extension de la puissance israélienne. Et il s’agit bien aussi de foncier agricole, et pas que d’habitat pour les colonies. Cela saute aux yeux si l’on comprend qu’un des enjeux de ces extensions est l’accès à l’eau pour l’irrigation des terres. Il est certain que cette configuration impérialiste est utilisée à ses fins par le capitalisme. Mais ce dernier n’en épuise pas pour autant toute explication26. »
S’il existe une possibilité que le foncier devienne un levier d’émancipation par sa socialisation, c’est parce qu’il est le support de rapport d’oppression multiples, de genre, de race et de classe. Telle est, somme toute, la leçon critique de Cultiver les communs.
Cependant, pour revenir à une remarque que je faisais en introduction, on peut se demander s’il n’y a pas parfois un certain « réductionnisme foncier » qui empêche ici d’insister sur le triple socle de l’oppression raciale dans les campagnes. En effet, le problème immédiat du racisme en agriculture ne peut se limiter au problème bien réel de l’accès à la terre et à l’installation. Fondée en 2021 par des personnes exilées, l’Association accueil agricole et artisanal (A4) cherche à développer l’installation en milieu rural de travailleur·ses étranger·es avec des conditions de vie décentes. Former, installer, régulariser, telles sont les trois piliers de l’association qui lutte contre le racisme systémique. Développant également une pratique de l’enquête militante, les membres d’A4 documentent les conditions de travail actuelles des saisonniers étrangers dans les exploitations agricoles.

L’oppression raciale y est reproduite à grande échelle dans des fermes industrielles et des serres où une main d’œuvre saisonnière étrangère est exploitée dans des conditions parfois semi-esclavagistes, comme en témoigne la lutte en cours des 17 saisonniers agricoles marocains à Malemort du Comtat27 ou la condamnation pour « traite d’être humain » de la société de ramassage de volailles Prestavic en Bretagne28. Ici, l’oppression raciale n’est donc pas immédiatement liée à la propriété de la terre des populations non blanches mais à des formes très spécifiques d’exploitation raciale et capitaliste du travail. Évidemment, Martin répondrait sûrement à cette objection que l’un ne va pas sans l’autre : qu’un accès à la propriété de la terre permettrait de soulager la pression qu’il y a à vendre sa force de travail sur le marché. D’autre part, comme il le précise lui-même à plusieurs reprises, l’ouvrage n’a pas vocation à répondre à toutes les questions soulevées par une bifurcation agraire29 mais seulement à insister sur la question des communs fonciers et à leur possible institutionnalisation par le droit existant.
Démocratie foncière et socialisation des terres
Le cœur de l’ouvrage de Tanguy Martin est bien de proposer une description des institutions politiques et des structures sociales déjà-existantes qui peuvent favoriser une socialisation de la terre. L’ouvrage est d’une très grande richesse dans la présentation des mécanismes d’accaparement, de régulation et de reprise du foncier agricole. De mon côté, je m’aventure ici sur un terrain que je connais fort mal, celui des institutions françaises du foncier agricole. Je dirais cependant que le mérite de l’ouvrage consiste à articuler les normes d’une nouvelle organisation foncière, les institutions politiques, économiques et juridiquesqui peuvent les incarner et les forces sociales qui peuvent soutenir leur réalisation. À cet égard, l’ouvrage se présente comme une écologie politique de la socialisation de la terre.
La richesse de cette position dérive à la fois de l’expérience de terrain de l’auteur et de l’idée qu’un partage plus équitable de la terre repose sur des institutions politiques qui permettent de la désencastrer du marché. Suivant les analyses de Marx sur « l’accumulation primitive30 », on peut en effet défendre que le capitalisme ne peut fonctionner qu’en instaurant une dépendance contrainte au marché. Le capitalisme suppose la séparation des travailleur·ses et de la terre : la majeure partie de la population n’a plus accès à ses moyens de subsistance et doit vendre sa force de travail sur le marché tandis que la terre elle-même est transformée en capital permettant d’obtenir une rente. On le voit, cette séparation initiale, sans cesse rejouée dans l’histoire du capitalisme, comporte une dimension écologique, économique et politique. Écologique parce que la transformation de la terre en capital impose une exigence de rentabilité, une injonction à produire toujours plus. Économique, parce qu’elle conduit la plus grande partie de la population à dépendre du marché capitaliste pour avoir accès aux moyens de subsistance. Politique enfin, parce que cette dépendance économique se paye au prix de l’autonomie individuelle et collective.
Lire aussi sur Terrestres : Paul Guillibert, Jason W. Moore, cosmologie révolutionnaire et communisme de la vie, mai 2024.
Le partage démocratique, soutenable et équitable de la terre (la « socialisation ») doit donc, selon Martin, permettre de lutter contre la séparation d’avec la nature, contre la dépendance au marché capitaliste et contre la perte d’autonomie politique dans les campagnes. En somme, la socialisation de la terre apparait comme une condition nécessaire mais non suffisante d’une politique d’émancipation. Dans la suite de cette recension, je me demanderai cependant si l’étude magistrale des institutions politiques d’une possible socialisation de la terre ne prend pas le pas sur une analyse des forces sociales capables de les porter. Qui sont les acteur·ices d’une possible socialisation de la terre ? Qui en sont les ennemis ? Avant de répondre à ces questions, encore faut-il préciser que Cultiver les communs se donne parfois comme un ouvrage de philosophie politique, soulevant le problème de l’articulation entre des normes politiques, des institutions juridiques et des forces sociales.
Le partage démocratique de la terre doit permettre de lutter contre la séparation d’avec la nature, contre la dépendance au marché capitaliste et contre la perte d’autonomie politique dans les campagnes.
Concernant les normes, il s’agit d’abord d’arracher la terre au marché, la constituer en bien commun afin que des usages socialement justes et écologiquement soutenables prennent le pas sur la logique marchande de la valorisation capitaliste. La stratégie doit donc viser l’instauration d’un « gouvernement politique du foncier agricole » ayant pour finalité de sortir le foncier de ses usages capitalistes par une « gestion en commun » de la terre31. Celle-ci doit être « démocratique » pour favoriser la multiplicité des usages et donc la multiplication des fonctions écosystémiques (une forêt en bonne santé par exemple contribue à la fois à réguler les températures et l’humidité, à purifier l’eau, à abriter de nombreuses espèces, à stocker du carbone, ,etc.). Réaliser des communs démocratiques suppose donc de créer des « entreprises sans capital et gouvernées par leurs usagè·res » avec une attention particulière aux relations écosystémiques.

L’institution des communs fonciers pourrait s’appuyer sur la propriété publique de la terre qui permet de la louer ou de la mettre à disposition d’agriculteur·ices du territoire communal ou bien de la mettre à disposition d’un collectif politique comme dans le cas de la société civile des terres du Larzac (SCTL) qui gère les 6 000 hectares récupérés lors de la lutte du Larzac contre l’installation d’une base militaire. Or Martin insiste sur le fait que l’expropriation des expropriateurs de la terre n’est pas qu’un lointain mot d’ordre socialiste. Elle est déjà prise en charge, ici et maintenant, par des institutions économiques, juridiques et politiques qui régulent l’accès et l’usage des terres agricoles. Cultiver les communs insiste sur deux institutions centrales qui pourraient jouer l’effet d’un levier de socialisation de la terre, bien qu’elles soient aujourd’hui au service de l’agriculture intensive.
La première institution est le contrôle des structures, qui « régit la délivrance de l’autorisation d’exploiter » la terre. C’est elle qui donne le droit à une agricultrice ou un agriculteur d’appliquer la loi après un avis consultatif des Commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA). Bien que le pouvoir du Contrôle des structures soit très affaibli et très inégal géographiquement, elles n’en perdurent pas moins.
La seconde institution étudiée regroupe les Safer, les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural qui régulent le marché des terres agricoles depuis les années 1960. Sociétés anonymes à buts non lucratifs, elles sont composées en collèges constitués de chaque syndicat agricole représentatif, des collectivités territoriales, de la société civile. En raison de ses missions et de son mode de fonctionnement (l’achat de terre), la Safer apparaît comme « un mode de régulation non-capitaliste du marché foncier rural en France32 ». À l’encontre de ses détracteurs qui y voient ou bien un instrument insupportable de régulation étatique du marché, ou au contraire, un instrument aux mains des syndicats productivistes majoritaires, Tanguy Martin, pourtant très critique à l’endroit de leur fonctionnement actuel, y voit l’une des ressources institutionnelles majeures pour une institutionnalisation des communs fonciers.
En somme, voilà une thèse stratégique pour l’écologie politique : l’abolition de la propriété privée doit se développer à partir de la réappropriation démocratique des institutions déjà existantes permettant la socialisation de la terre, même si ces institutions sont au service, et depuis longtemps, de politiques productivistes. Liées à l’histoire du remembrement et de la concentration agraire, pour beaucoup elles apparaissent en effet comme un instrument productiviste dans les campagnes, aux mains des grands exploitants et des syndicats majoritaires. Aussi contraire à l’égalité soient-elles pour l’instant, leur démocratisation relève d’un futur possible et doit donc servir de fondement à une bifurcation écologiste et sociale des institutions du foncier agricole. Comment envisager cette démarchandisation démocratique de la terre ?
L’abolition de la propriété privée de la terre pourrait se développer à partir de la réappropriation démocratique des institutions déjà existantes.
Martin imagine que l’ensemble des terres agricoles soient rachetés progressivement « soit par la puissance publique, soit par des organisations collectives démocratiquement organisées qui s’engageraient à ne pas les revendre. Les terres seraient alors techniquement sorties du marché33 ». En rétablissant l’impôt sur la fortune, il « faudrait, selon l’auteur, une cinquantaine d’années pour racheter l’ensemble des terres agricoles ». « Les sécurités sociales de l’alimentation pourraient aussi devenir propriétaire de terres qu’elles mettraient ensuite à disposition des paysan·nes34 ». Il est certain, Martin en est conscient, que de telles propositions relèvent de la « politique-fiction ». C’est la raison pour laquelle il s’intéresse plus précisément à des collectifs et des institutions capables de changer le rapport de force.
Si l’argument du livre consiste à affirmer qu’il n’est pas nécessaire d’envisager une grande réforme agraire (avec ces risques d’autoritarisme et d’inefficacité) pour penser une transition agro-écologique, on a parfois l’impression qu’il faudrait néanmoins une grande réforme institutionnelle pour y parvenir : fixer des règles pour modifier la composition de ces institutions et s’assurer une gestion plus transparente et démocratique de leur fonctionnement. Auquel cas, l’argument tactique de la facilité (il serait plus facile de passer par les institutions existantes que d’en créer de nouvelles ad hoc) parait moins convaincant. Il n’est pas certain qu’il soit plus facile de déclencher une grande réforme institutionnelle du foncier qu’une grande réforme agraire. C’est la raison pour laquelle l’auteur insiste sur l’importance des forces sociales qui réalisent d’ores et déjà la socialisation de la terre à petite échelle.
Selon Martin, la capacité des Soulèvements de la terreà imposer des rapports de force doit s’articuler avec la constitution de contre-pouvoir du foncier porté par des organisations moins radicales mais dont l’action s’inscrit dans le temps long. Parmi ces organisations, ilinsiste sur les foncières agricoles, ces associations qui rachètent ou reprennent la terre pour la redistribuer selon des principes de justice sociale et agro-écologiques. Parmi celles-ci, l’auteur s’arrête longuement sur le cas de Terre de liens, dont il est membre, qui donne une bonne illustration de ce qu’il appelle des « structures de portage foncier solidaires35 ».

Ces structures peuvent prendre différentes formes : des groupements fonciers agricoles (GFA) qui détournent l’usage initial visant à faciliter la succession des terres agricoles dans une perspective mutualiste et solidaire comme le GFA Lurra, fondé dans les années 1970 au pays Basque ; des coopératives d’intérêt collectifs comme les coopératives Terrafine créée en 2017 ou Passeurs de terre créée en 2018 ; des fonds de dotation ou des fondations qui récupèrent des terres par legs ou par des dons en argent et en nature comme à Longo Maï ou comme la foncière Antidote créée en 2019 qui est « un outil au service de collectifs d’habitant·es et d’usager·es de lieux autogérés, qu’ils soient des fermes ou accueillent des activités non-agricoles, à la campagne ou en ville36 » ; des sociétés en commandite par actions comme celle de la foncière Terre de liens liée à une fondation d’utilité publique. La finalité de toutes ces structures de portage foncier solidaires est de desserrer l’étau de la propriété privée et du marché capitaliste sur l’accès aux terres agricoles en favorisant des usages soutenables.
Ainsi la fédération Terre de liens propose sept critiques éthiques pour circonscrire le champ des « initiatives foncières citoyennes35 » : a) la terre doit tendre à être gérée en commun ; b) les usages doivent viser une agriculture paysanne, écologique, nourricière et locale et favoriser des actions concrètes pour l’environnement ; c) le portage du foncier auprès des fermier·es doit respecter une durée minimale qui garantit une stabilité aux paysan·nes ; d) elles prônent un modèle économique qui lutte contre la spéculation et favorisent des activités non lucratives ; e) elles réservent une place importante aux initiatives citoyennes ; f) une place est accordée aux collectivités locale afin de favoriser un ancrage territorial. La foncière Terre de liens a ainsi racheté 8 500 hectares afin d’établir des contrats de fermage avec des paysan·nes s’engageant dans des pratiques agricoles différentes. Pour Terre de liens, « acquérir une ferme n’est plus la finalité de l’action mais le vecteur d’une réappropriation territoriale au motif d’une volonté de construction d’un “monde commun37’’ ».
La foncière Terre de liens a racheté 8 500 hectares afin d’établir des contrats de fermage avec des paysan·nes s’engageant dans des pratiques agricoles différentes.
S’il existe donc des forces sociales prêtes à défendre une réforme institutionnelle ouvrant la possibilité d’une socialisation de la terre, le récent mouvement des agriculteur·ices semble avoir montré que ces forces sont loin d’être majoritaires. L’issue du mouvement paraît plutôt favorable aux exploitants importants et au capital commercial dit de « la grande distribution ». Peut-être cette séquence témoigne-t-elle des impasses d’une réflexion qui partirait uniquement de la question foncière, c’est-à-dire de la propriété et de l’allocation des terres agricoles. Car il s’est d’abord déclenché par un rejet des prix des produits agricoles, c’est-à-dire par le constat d’une injustice du point de vue de l’ « économie morale » des paysans : non pas une revendication sur la terre mais une revendication sur les revenus du travail.
La difficulté vient évidemment du fait que les revenus du travail sont ici ceux de capitalistes : certes des petits capitalistes dominés par d’autres secteurs bien plus puissants du capitalisme mais des capitalistes néanmoins, qui possèdent – au moins en droit – leurs moyens de production même s’ils sont dominés par le capital bancaire qui fournit des prêts, par le capital biotechnologique qui fournit des semences, par le capital industriel qui fournit des tracteurs, par le capital commercial qui achète les marchandises et les fait circuler, etc. Le choix des organisations de gauche, de la Confédération paysanne par exemple, a été de rejoindre tardivement le mouvement de manière critique. Leur stratégie visait donc à intervenir dans un mouvement d’exploitants agricoles afin d’introduire une ligne de fracture sur des bases politiques entre les revendications des syndicats majoritaires sur les normes environnementales et bureaucratiques et celles des exploitants moins importants acculés par le marché à vendre à des prix indignes.
Lire aussi sur Terrestres : Reprise de terres, Reprise de terres : une présentation, juillet 2021.
Or dans cette stratégie d’alliance au sein de la paysannerie, aucune alliance avec des travailleur·ses (ouvrièr·es agricoles, salarié·es de l’agro-industrie, saisonnié·res temporaires) n’a pu émerger. Pourtant, la revendication pour de meilleurs revenus du travail contre la domination imposée par certains secteurs du capitalisme agro-industriel aurait pu créer un front large. La position de l’intellectuel qui condamne a posteriorides mouvements auxquels il n’a pas pris part n’est pas de mise ici. Il s’agit plutôt de réfléchir aux conditions idéologiques futurs d’un élargissement des luttes pour une communisation de la subsistance. À cet égard, il faut accueillir avec enthousiasme et prudence le projet d’une réforme institutionnelle de l’accès au foncier agricole.
Enthousiasme évident au vu des outils politico-juridiques proposés par Martin et dont il est certain qu’ils indiquent des pistes tactiques importantes. Prudence néanmoins, car le programme de réformes institutionnelles et démocratique du foncier suppose d’identifier – mais plus encore de composer – des forces sociales capables de le porter. Or, si la propriété privée de la terre est la clef de voute d’un colossal édifice de dépossession des conditions de la subsistance, les mots d’ordre portant sur les revenus du travail et les formes d’exploitation sont sans doute plus à même de composer une force révolutionnaire de paysan·nes et de salarié·es contre la domination du capital.
Conclusion
Pour conclure, je repartirai de l’anecdote inaugurale de Cultiver les communs qui illustre à quel point une position en apparence consensuelle (une réappropriation démocratique d’institutions permettant un partage plus soutenable de la terre) peut sembler révolutionnaire : alors qu’il informe un propriétaire que la Safer du Poitou-Charente pour laquelle il travaillait à l’époque préempte la terre qu’il vend, Martin s’est vu rétorquer : « mais c’est du communisme ! ». Pour se prémunir contre toute transformation du foncier et de l’agriculture paysanne, on a beau jeu d’assimiler une politique de socialisation de la terre à la collectivisation forcée des campagnes dans la Russie post-révolutionnaire.
Cultiver les communs est donc un livre rare qui propose des solutions à partir d’une connaissance fine, complexe et personnelle des institutions agraires françaises. À la lecture, se dessine l’horizon concret d’une socialisation de la terre grâce à la multiplication des expériences de portage solidaire du foncier. Ce livre présente donc un panorama original sur l’avenir de l’émancipation. La possibilité d’une transformation de la société s’articule à la fois à des forces sociales réellement existantes et à des institutions agricoles dont la réappropriation ne paraît pas impossible. Elle impose maintenant de penser la manière dont ces expérimentations foncières peuvent s’articuler avec des stratégies capables d’imposer un rapport de force à une autre échelle. Il est fort à parier que la socialisation de la terre suppose des soulèvements terrestres dont le surgissement transformera l’antagonisme des forces en présence.
Crédit de la photo d’ouverture : Max.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Karl Marx, Le manifeste du parti communiste, traduit par Émile Bottigelli, Paris, GF Flammarion, 1998, p. 77.[↩]
- Discours d’Emmanuel Macron au salon de l’agriculture 2022.[↩]
- L’Atelier paysan, Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une économie paysanne et alimentaire, Paris, Seuil, 2021.[↩]
- C’est dans le contexte de Reprise de terres que j’ai rencontré le camarade Tanguy Martin. Pour être partiale, cette recension n’en n’est pas moins critique.[↩]
- Tanguy Martin, Cultiver les communs. Une sortie du capitalisme par la terre, Paris, Syllepse, 2023, p. 10-11.[↩]
- Ibid., p. 11.[↩]
- Pour les études agraires marxistes, on consultera principalement la revue anglophone Journal of Agrarian Change et les travaux de l’un de ses fondateurs, Henri Bernstein. Voir notamment Henri Bernstein (entretien avec Paul Guillibert et Edouard Morena), « Lutte des classes et paysannerie : les études agraires critiques », Actuel Marx, 2024/1,n°79, « Socialismes agraires » (à paraitre).[↩]
- Le populisme (ou narodnisme) renvoie ici au plus important courant révolutionnaire russe du xixe siècle, très ancré dans les campagnes, défendant une organisation socialiste autonome de la paysannerie fondée sur des communes agraires rurales de tradition collectiviste. Parmi les chercheur·ses en études agraires critiques, certains revendiquent une filiation avec cette héritage. Voir par exemple Joan-Martinez Alier, « De l’économie à l’écologie en passant par les Andes », Mouvements, 2008/2, n°54, pp. 111-126.[↩]
- Kristin Ross, La forme-commune, Paris, La Fabrique, 2023.[↩]
- Pour une présentation historiographique précise de l’écart entre la sociologie rurale française et les études agraires critiques d’inspiration marxiste anglophone, on se reportera à l’excellent article d’Edouard Morena et Thierry Pouch, « L’inépuisable rapport sur l’agriculture dans ses débats avec le capitalisme », Actuel Marx, 2024/1, n°79, « Socialismes agraires ».[↩]
- Tanguy Martin, Cultiver les communs. Une sortie du capitalisme par la terre, Paris, Syllepse, 2023, p. 24.[↩]
- Ibid., p. 180-181.[↩]
- Ibid., p. 26.[↩]
- Ibid., p. 178.[↩]
- Ibid., p. 100.[↩]
- Ibid., p. 38-40.[↩]
- Ibid., p. 42.[↩]
- Voir par exemple Robert Brenner, « La théorie du système-monde et la transition au capitalisme : perspectives historiques et théoriques », Période [en ligne], 17 novembre 2014 ; Ellen Meiksins Wood, L’origine du capitalisme. Une étude approfondie, Paris, Montréal, Lux, 2020.[↩]
- Appelons ainsi le mouvement réel d’abolition des conditions matérielles de la misère dans les campagnes et dans les villes.[↩]
- Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990.[↩]
- Tanguy Martin, Cultiver les communs, op.cit., pp. 59-61.[↩]
- Cultiver les communs, p. 61.[↩]
- Ibid., p. 61.[↩]
- Ibid., p. 62.[↩]
- Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, traduit par Marcel Ollivier et Irène Petit, Paris, Maspero, 1972.[↩]
- Tanguy Martin, Cultiver les communs, op.cit., p. 63.[↩]
- https://reporterre.net/Travail-non-paye-habitat-indigne-un-agriculteur-accuse-de-traite-d-etres-humains[↩]
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/brest-les-gerants-d-une-entreprise-de-nouveau-juges-pour-traite-d-etres-humains-2780578.html[↩]
- Tanguy Martin, Cultiver les communs, op.cit., p.10.[↩]
- Voir T. Martin, Cultiver les communs, op. cit., pp. 51-52.[↩]
- Ibid., p. 103.[↩]
- Ibid., p. 76.[↩]
- P. 108.[↩]
- P. 109.[↩]
- Ibid., p. 130.[↩][↩]
- Ibid., p. 121.[↩]
- Pascal Lombard, De la société civile au mouvement social : géographie d’une redistribution des cadres institutionnels de gouvernance des communs. Le cas du Mouvement des Terre de Liens,thèse de doctorat à l’université Toulouse 2 Jean Jaurès, 2020 ; cité dans Tanguy Martin, Cultiver les communs, op. cit.,p. 133.[↩]








