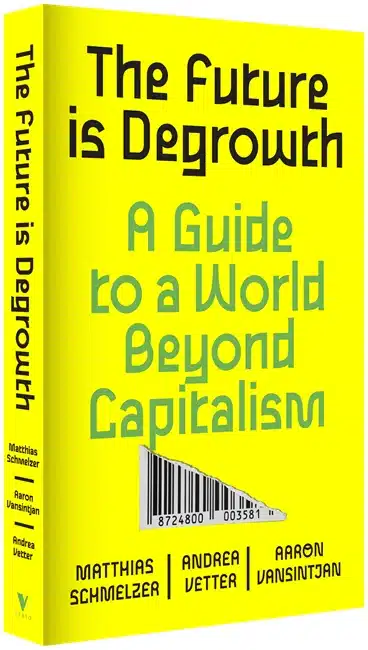
A propos de Matthias Schmelzer, Andrea Vetter, et Aaron Vansintjan, The future is degrowth, a guide to a world beyond Capitalism, Londres – New-York, Verso, 2022.
Imaginez un monde égalitaire où tout le monde, toute sa vie, est assuré de manger à sa faim, qui plus est des produits de qualité qu’on puisse choisir. Où tout le monde a un logement décent et des conditions sanitaires sûres, dans un environnement non pollué. Où tout le monde a accès aux soins et à l’éducation, sans discrimination ni compétition. Où il y a du travail pour tout le monde, qui plus est du travail qui a du sens. Où tout le monde a du temps libre pour s’occuper et profiter de sa famille et de ses ami·es, pour se promener dans la nature, pour aller voir des spectacles, pour participer soi-même à des activités créatives, artistiques, scientifiques, sportives, sociales ou politiques.
Dans ce monde, tout le monde a le droit et la possibilité de se déplacer librement, grâce à des transports en commun très développés, mais on se déplace lentement, donc plus rarement loin, et donc seulement quand on a de bonnes raisons de le faire. Dans ce monde, on partage les lieux d’habitation et de loisir, les voitures, l’électroménager ou les outils. On partage le travail et le temps libre. Dans ce monde, on a compris que la consommation ne rend pas heureux. Les moyens de l’intégration et de la distinction sociale ne passent plus par la richesse et le pouvoir. Et surtout, on est conscient que toute l’abondance dépend du travail de toutes et tous, on est foncièrement solidaire, ce qui explique que nul ne peut prétendre valoir beaucoup plus que les autres.
Pour qu’un tel monde soit possible (avant même d’envisager les possibilités politiques pour le faire advenir), de nombreuses conditions – des contreparties – doivent être réunies. Dans ce monde, par exemple, il n’y a sans doute pas de place pour les jets privés, les SUV ou les voitures de sport, ni même les voitures individuelles, le tourisme à fort impact carbone (type week-end en avion ou vacances sous les tropiques), les sports mécaniques (adieu la Formule 1 et les Grands Prix moto, les buggys et quads de loisir ou le jet ski), la publicité ou toute la gabegie d’objets inutiles qu’on nous incite à acheter, pas de place pour les besoins artificiels. Il n’y a pas de place pour les très riches, pour l’accumulation, pour la spéculation.
Dès lors, ce monde d’abondance partagée et restreinte aux « besoins fondamentaux » est-il vraiment désirable ? Sans doute pas pour tout le monde, pas pour toutes celles et tous ceux attachés à leurs besoins artificiels, à leurs privilèges, à leurs « richesses », à leur pouvoir, à leur croyance que leur bonheur tient à posséder des choses que les autres n’ont pas. Ce monde inégalitaire et de compétition est le nôtre, et beaucoup le revendiquent et le défendent comme un monde de liberté où chacun et chacune aurait sa chance d’avoir sa place, seule, au soleil. Après tout, pourquoi pas, ne s’agit-il pas juste d’un choix de société différent de celui du monde de l’abondance partagée pour toutes et tous, affaire d’opinions et de préférences privées devant se régler par la délibération démocratique ?
Un mode de vie impérial qui butte sur les limites planétaires
Mais il se trouve qu’il ne s’agit pas seulement d’un choix de société, et c’est là où la réflexion proprement scientifique est nécessaire, et non plus une réflexion purement politique ou une matière d’opinions : notre monde inégalitaire basé sur la croissance économique est tout simplement incompatible avec les limites planétaires. Les rapports du GIEC et plus récemment de l’IPBES détaillent depuis des années et avec de plus en plus de détails et de force les conséquences dramatiques et intenables de la société de consommation dopée aux énergies fossiles, à l’extraction des matériaux, à la destruction de la biodiversité et l’artificialisation des milieux naturels. L’analyse socio-historique critique démontre comment le mode de vie occidental, devenu modèle hégémonique, n’a été possible que par l’exploitation et la destruction de la nature, des femmes, des pays non-occidentaux et de leurs habitant·es racisé·es, des travailleurs et travailleuses.
Ce mode de vie est décrit comme « impérial », il est fondamentalement colonialiste. Il n’est donc en aucun cas généralisable à l’ensemble de la société et du monde, et il bute sur les limites planétaires. Face à ces limites, il ne pourra continuer que pour un nombre de plus en plus restreint de personnes (ce qu’on observe déjà très clairement au sein des pays occidentaux), qui devront dès lors protéger leurs privilèges de façon de plus en plus agressive, ce qu’on observe également par la montée de l’obsession sécuritaire, des populismes et de la militarisation. Comme le résume fort justement le philosophe japonais Kōhei Saitō 1, à la suite de Paul Ariès 2, la société peut évoluer dans deux directions opposées, barbarie ou société décroissante (que Saitō appelle communisme décroissant).
L’analyse socio-historique démontre comment le mode de vie occidental n’a été possible que par l’exploitation et la destruction de la nature, des femmes, des pays non-occidentaux et de leurs habitant·es racisé·es, des travailleurs et travailleuses.
La décroissance, c’est justement ce monde égalitaire décrit plus haut. Ce monde n’est-il qu’une douce utopie irréaliste ? Une utopie certes, puisque par étymologie une utopie est ce pays qui n’existe pas encore, mais que l’on peut faire advenir. Ce monde, c’est en effet celui qui est pensé depuis des décennies par les auteurs et autrices qui défendent le concept de décroissance, terme généralement caricaturé par ses détracteurs et détractrices comme une récession économique volontaire, alors qu’il signifie justement l’opposé de la récession. La décroissance désigne l’opposition fondamentale à l’obsession – au culte – de la croissance économique et au système socio-économique qui s’y attache. Le modèle de la décroissance, ou, plutôt, les modèles multiples et divers qui peuvent s’en réclamer, ne visent pas à ralentir le système économique actuel (ce qui pourrait en effet correspondre à une récession), mais à en inventer d’autres, placés sous le signe de l’abondance et de la joie. Le pluriel est important : les penseurs et penseuses de la décroissance ne se réclament pas d’un universalisme quant aux choix de société. Le monde de la décroissance est un « plurivers ».
Une synthèse de la littérature scientifique sur la décroissance
Dans The Future is Degrowth, dont nous faisons ici une recension personnelle traduisant l’esprit général du livre3, Schmelzer, Vetter et Vansintjan proposent une synthèse de la littérature scientifique sur la décroissance. En cela, l’ouvrage se distingue d’autres essais sur la décroissance, anciens comme récents : les auteurs et l’autrice se sont mis à distance de leur objet pour tenter de dégager les lignes de force et le consensus qui se dégagent depuis une quinzaine d’années dans les recherches universitaires autour de la décroissance. Auteurs ou autrice dans ce milieu, non seulement la littérature leur est familière (articles dans des revues à comité de lecture, ouvrages savants et essais) mais ils et elle ont participé également aux conférences internationales sur la décroissance (voire les ont organisées) qui se sont tenues depuis 20084.
La décroissance est un « plurivers » : il est vital d’imaginer et d’engendrer une pluralité de mondes, sous le signe de l’abondance et de la joie.
Cette connaissance et cette approche justifient le commentaire de Timothée Parrique : « ce livre est à la décroissance ce que le GIEC est aux sciences du climat : la meilleure revue de littérature sur le sujet5 ». Alors que les réflexions sur la décroissance sont anciennes (pas toujours sous ce nom, voir la collection « Les précurseur.ses de la décroissance » aux éditions le passager clandestin) et le plus souvent riches et justes, elles ne se sont longtemps exprimées que principalement sous forme d’essais pouvant être dédaignés des courants universitaires dominants. La grande nouveauté depuis une dizaine d’années est que ce qu’on peut appeler la bataille culturelle autour de la décroissance se joue désormais également dans le champ académique. Et ces travaux académiques, de plus en plus nombreux et précis, démontrent à quel point le mode de fonctionnement capitaliste est une aberration suicidaire pour l’humanité. En en décryptant les rouages, l’ouvrage permet d’éclairer les voies alternatives possibles et les moyens pratiques de sortir de cette trajectoire mortifère.

La critique du culte de la croissance économique est évidemment au cœur de l’ouvrage. Schmelzer et ses collègues rappellent que l’objectif politique de la croissance économique infinie n’est devenu consensuel puis hégémonique que depuis la seconde guerre mondiale (suivant notamment l’analyse du politiste Timothy Mitchell), avec la systématisation de la boussole du PIB après 1945 (c’est l’objet de la thèse de Schmelzer) et l’invention du « développement ». Pour les politiques comme les économistes jusqu’à Keynes, l’horizon souhaitable était la stabilité économique. Ce n’est qu’après 1945 que la croissance est devenue une « hégémonie culturelle » (au sens d’Antonio Gramsci, c’est-à-dire ce qui est considéré comme le « bon sens » par presque tout le monde), partagée autant par la droite que par la gauche. La promesse d’un gâteau toujours plus gros permet d’éviter les confrontations autour d’un partage inégal. Tant que les classes travailleuses ont une part de gâteau toujours plus importante, même s’il s’agit d’une part absolue et non pas relative, il devient plus acceptable que les riches soient toujours plus riches.
Mais ce « compromis Fordiste » a été mis à mal par la vague néolibérale depuis les années 80. Les parts du gâteau se réduisent désormais pour la majorité tandis que les inégalités explosent de façon indécente. En outre, la croissance continue du « métabolisme économique »6 (utilisation des matières premières dont les énergies fossiles en entrée, pollutions et destructions environnementales en sortie) est la cause du changement climatique et de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, menaçant les conditions de vie humaine sur Terre. L’économie n’est immatérielle que dans les fantasmes des économistes orthodoxes, le « découplage » entre croissance économique et métabolisme est impossible, la croissance verte tout comme le développement durable sont des fictions idéologiques : en d’autres termes, du greenwashing. Tout ceci est désormais bien documenté dans des articles scientifiques.
Revenir à Marx pour penser la décroissance
La logique de la croissance économique précède cependant largement son hégémonie culturelle. Car il s’agit du mode de fonctionnement fondamental du capitalisme qui s’est développé progressivement avec les expansions coloniales occidentales et s’est imposé avec succès grâce à la révolution industrielle et la puissance des énergies fossiles. Pour les lecteurs et lectrices familières de la littérature de la décroissance « classique », notamment française7, c’est là que The Future is Degrowth montre une évolution significative récente de la littérature internationale bourgeonnante de la décroissance, qui n’hésite pas à renouer avec les analyses critiques du capitalisme de Karl Marx. La pensée de la décroissance s’est en effet forgée dans les années 70-80 à la fois contre le productivisme capitaliste et contre l’exemple écologiquement désastreux du productivisme soviétique inspiré du programme technoscientiste de « domination de la nature » du Manifeste du Parti Communiste. Maintenant que la vulgate marxiste du XXème siècle ne domine plus la pensée à gauche, la pensée de la décroissance peut s’enrichir de la puissance des analyses théoriques et socio-historiques de Marx et de sa filiation. L’apport des analyses écomarxistes, mais aussi écoféministes et décoloniales, a ainsi été crucial à la pensée de la décroissance. Il rend possible une réconciliation entre les sensibilités écologistes et celles variées de la gauche anticapitaliste.
La pensée de la décroissance s’est forgée dans les années 70-80 contre le productivisme capitaliste et contre l’exemple écologiquement désastreux du productivisme soviétique.
Un premier élément conceptuel anticapitaliste se base en effet sur l’analyse de Marx. Pour Marx, une société « capitaliste » est une société où la relation au capital est la relation économique dominante. Cette relation se résume par le schéma M-C-M’ (en anglais : Money – Commodity – more Money), qui remplace la relation économique universelle de l’échange marchand C-M-C, où l’argent ne sert que d’intermédiaire pour fluidifier des échanges entre marchandises : tout échange marchand n’est évidemment pas capitaliste. Dans ce cas, l’échange s’arrête avec la jouissance de la marchandise. Une société non capitaliste n’est pas forcément sobre, elle peut chercher à cumuler des quantités insensées de richesses (l’histoire des empires le démontre assez), mais celles-ci sont accumulées à des fins de jouissance, ne serait-ce que de façon ostentatoire. Dans l’échange capitaliste, observe Marx, le but est de faire fructifier le capital : l’argent doit rapporter davantage d’argent, il doit forcément être réinvesti, ce qui entraîne un véritable tapis roulant de l’accumulation. La logique croissantiste est donc bien au cœur même de la logique capitaliste.
Lire aussi sur Terrestres : Kōhei Saitō, « Marx au soleil levant : le succès d’un communisme décroissant », mars 2023.
Un deuxième élément anticapitaliste hérité de Marx est son analyse historique de l’avènement du capitalisme en Angleterre, sa célèbre description du double mouvement des « enclosures ». En substituant la propriété privée aux « communs », qui permettaient l’autosuffisance de la population rurale anglaise, les « enclosures » ont appauvri cette population et l’ont forcé à aller travailler dans les villes, les mines et les usines pour survivre. C’est l’exploitation de son travail qui a permis de générer le « surplus » dont le capital avait besoin. Rosa Luxemburg et les écomarxistes ont ensuite montré comment cette « accumulation par dépossession » n’est pas seulement une « accumulation primitive » requise pour le démarrage du capitalisme, mais qu’elle se reproduit de façon systématique, notamment dans l’exploitation coloniale.
Les écoféministes ont également mis en évidence l’exploitation systématique du travail de femmes (dans le même mouvement que l’exploitation de la nature, en particulier dans les colonies) : les soins domestiques, non rémunérés mais nécessaires à la « reproduction » de la force du travail. La valorisation constante du capital ne peut avoir lieu sans une transformation et une destruction constantes du tissu de la vie, sans une extraction infinie de matières et d’énergies, humaines et non humaines, et conduit inévitablement à un dépassement des limites planétaires et un désastre social. Le compromis Fordiste évoqué plus haut n’a pu qu’un temps limiter l’exploitation humaine dans l’Occident, en ravageant les ressources terrestres et humaines du Sud global, comme l’ont bien montrées les analyses décoloniales.
La valorisation constante du capital ne peut avoir lieu sans une transformation et une destruction constantes du tissu de la vie, sans une extraction infinie de matières et d’énergies, et conduit inévitablement à un dépassement des limites planétaires.
Que faire ?
Cette analyse du lien entre enclosures et capitalisme est essentielle pour montrer la voie de sortie du capitalisme : pour nourrir leur gloutonnerie et réinvestir leur capital, les capitalistes ont constamment besoin de nouveaux marchés, et donc de marchandiser (« commodifier ») de nouveaux communs. Il s’agit en priorité de tous les espaces naturels (expansion spatiale du capitalisme), mais cela peut concerner toutes les relations humaines comme illustré récemment par l’émergence du capitalisme de plateforme numérique, et par exemple la marchandisation du partage de maison ou de transport. Pour sortir du capitalisme, il s’agit donc de promouvoir le mouvement inverse : reconstruire et défendre les communs. L’organisation socio-économique décroissante est basée sur les communs. La définition des communs est précise et bien comprise depuis les travaux d’Elinor Ostrom. Il ne s’agit pas d’un libre accès à une ressource, mais de leur gestion commune selon des règles décidées collectivement au sein d’une communauté, permettant une répartition juste et la pérennité de la ressource. C’est cette ré-expansion des communs qui permet l’abondance pour toutes et tous en ce qui concerne les besoins fondamentaux. C’est en référence à cette économie des communs que Kōhei Saitō parle logiquement de communisme, voire de « commonisme » (en référence à « commons », le terme anglais pour « communs »).
Les analyses des travaux sur la décroissance présentées par Schmelzer et ses collègues permettent non seulement de comprendre que l’utopie décroissante est désirable, qu’elle est la seule alternative viable à la barbarie capitaliste présente et à venir, mais également qu’elle est possible et qu’on peut en prendre le chemin dès maintenant.
Lire aussi sur Terrestres : Michael Lowy, « Pour une décroissance écosocialiste », octobre 2022.
Il ne s’agit pas d’attendre le grand soir d’une révolution pour mettre tout à plat et repartir de zéro. L’Histoire nous montre assez l’horreur qui le plus souvent (toujours ?) en résulte. Il ne s’agit même pas d’interdire les échanges capitalistes : il s’agit de faire en sorte que ceux-ci ne soient plus dominants pour sortir de la logique capitaliste destructrice. Politiquement, il s’agit de lutter pour obtenir des « réformes non réformistes », c’est-à-dire des réformes à l’intérieur du système démocratique actuel mais permettant la transformation radicale du système socio-économique : promouvoir les coopératives, les monnaies locales, les systèmes d’échange non marchands, les services publics, toutes les initiatives et expériences autonomes locales. Il s’agit de favoriser les initiatives qui restent dans les limites planétaires, et donc de proscrire toute exploitation des ressources naturelles et humaines du « Sud global ».
Les outils économiques et de gouvernement passent par la limitation des revenus et du capital (revenu maximum et taxation du capital à la Thomas Piketty) permettant dans un premier temps d’assurer à toutes et tous les services essentiels et un revenu décent, de façon inconditionnelle. En reprenant les analyses écoféministes montrant que la majorité du travail effectué dans le monde est en réalité non rémunéré (modèle de l’iceberg8 ), concerne les soins (le care), et est majoritairement assuré par les femmes et les populations racisées, il s’agit pour la pensée de la décroissance de reconnaître et valoriser ce travail sans le marchandiser. À partir du moment où le travail sort de la logique marchande et correspond à des besoins essentiels, il ne peut y avoir pénurie de demande de travail : on a rarement trop d’offres de soins. Par ailleurs, en devant se passer des énergies fossiles et des ressources exploitées dans les pays du Sud, les solutions technologiques permettant le bien-être, généralement gourmandes en énergie et métaux, deviennent plus rares. Il s’agit de les remplacer par des innovations technologiques low-tech (et « conviviales » au sens d’Ivan Illich) nécessitant davantage de main-d’œuvre. L’exemple le plus fondamental est la nécessité de remplacer l’agriculture industrielle, sous perfusion des énergies fossiles et destructrice des sols et des écosystèmes, par de l’agroécologie bien plus demandeuse en main-d’œuvre pour atteindre des niveaux de productivité suffisants. Il n’y a donc aucune raison de céder au chantage à l’emploi pratiqué par les apôtres de la croissance économique.
Face aux critiques
Les analyses détaillées dans The Future is Degrowth fournissent des arguments pour répondre aux critiques de la décroissance. Donnons-en deux exemples.
Une première objection fréquente aux discours de la décroissance concerne sa prétendue absence de considération envers les pays pauvres. Décroître serait un luxe de pays riches, et sa promotion serait obscène vis-à-vis de pays pauvres où les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Cette objection est mal informée. Tout d’abord, si on ne considère que la question du métabolisme économique (c’est-à-dire les quantités d’énergie et de matières utilisées par une société), il n’est pas question qu’il soit réduit partout et de façon proportionnelle. La décroissance promeut au contraire la convergence des niveaux de métabolisme des sociétés, à un niveau certes faible qui rentre dans les limites planétaires, mais qui reste supérieur au niveau actuel pour des centaines de millions de personnes.
Ensuite, la décroissance, comme expliqué plus haut, ne se résume pas à une réduction du métabolisme, mais valorise d’autres systèmes socio-économiques que le modèle occidental dominant (capitaliste néolibéral dans sa version actuelle). Il s’agit de promouvoir d’autres modèles pour éviter que les pays dits pauvres continuent de tenter de suivre le chemin mortifère occidental. Et donc surtout pas pour imposer un autre modèle unique. L’idée de plurivers est justement défendue par les Zapatistes du Chiapas, dont l’expérience constitue aujourd’hui l’exemple le plus durable et abouti, à une échelle importante, de société de type décroissant. Il est remarquable et symptomatique que cette expérience provienne justement du « Sud global ».
La décroissance promeut la convergence des niveaux de métabolisme des sociétés, à un niveau qui rentre dans les limites planétaires, mais qui reste supérieur au niveau actuel pour des centaines de millions de personnes.
Une seconde objection soutient l’impossibilité d’établir une société décroissante dans un monde ouvert. Si on instaurait un revenu inconditionnel décent, le plein emploi à 25 heures par semaine, des services publics gratuits étendus et performants, toute la misère du monde se précipiterait et rendrait le financement du système impossible. On retrouve cette peur panique d’une immigration massive, conjuguée au réflexe de vouloir fermer les frontières pour expérimenter « chez nous », dans une écologie réactionnaire. Mais de telles craintes, basées sur une mauvaise compréhension des communs et l’obsession du « passager clandestin », sont absentes chez les penseurs et penseuses de la décroissance.

Les communs ne sont en effet pas ouverts aux quatre vents. Un commun au sens d’Ostrom, on doit le répéter, n’est pas le libre accès. Mais ils ne sont pas fermés pour autant : il y a une porte, mais qui n’est pas fermée à clé. Il s’agit d’une maison accueillante. L’arrivée de nouveaux membres ne menace pas a priori le système, car ces nouveaux membres doivent respecter les règles et participer. Ainsi, une société basée sur les communs ne permet pas d’accumuler du capital. Toute personne est bienvenue et est garantie de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, mais elle ne peut pas accumuler pour envoyer l’argent ailleurs, dans un paradis fiscal par exemple. Si une personne ne travaille pas, elle ne coûte pas grand-chose à la communauté mais elle ne pourra pas faire grand-chose non plus ni s’épanouir. Si elle travaille, comme toute activité économique n’est possible que si elle répond à des besoins, et qu’il s’agit en priorité d’une économie du soin, il n’y a guère de risque d’avoir un surplus d’offre de travail amenant à une compétition : plus de travail, c’est juste toujours plus de liens (et moins de biens, pour reprendre un des slogans populaires de la décroissance).
Certaines critiques de la décroissance restent cependant pertinentes. Schmelzer et ses collègues en mentionnent certaines dans leur dernier chapitre. Ainsi la question de comment faire advenir une société décroissante n’est certainement pas résolue. Il est clair que la description des réformes non-réformistes et mesures gouvernementales souhaitables, si elles montrent certes la possibilité d’une transition vers la décroissance, n’expliquent pas comment transformer le rapport de force politique pour qu’elles aient une chance d’être réalisées. Le contexte géopolitique, violent et conflictuel constitue un obstacle majeur que la littérature de la décroissance ne semble pas trop savoir comment aborder, est-il rappelé dans ce dernier chapitre. Comme mentionné en introduction, les personnes qui bénéficient le plus du système capitaliste impérial actuel ont peu de chances de promouvoir la décroissance alors qu’elles ont le pouvoir économique et militaire. L’ouvrage propose que la décroissance rejoigne et renforce les mouvements pacifistes et de démilitarisation.
Une autre piste de réflexion, mentionnée ni dans l’ouvrage ni sans doute dans la littérature de la décroissance, pourrait s’inspirer au contraire des mouvements Zapatiste et du Rojava. Il est en effet symptomatique que les deux expériences actuelles d’organisation socioéconomique de type décroissant, concrètes et à l’échelle de proto-États, sont en guerre (actuellement apaisée au Chiapas) et requièrent une discipline militaire. Ce constat est peut-être dérangeant pour une pensée résolument pacifiste et qui parie sur un renouvellement démocratique. Est-ce que les appels de plus en plus fréquents à considérer que « nous sommes en guerre » contre les ravages climatiques et écologiques ne pourraient pas souder la population et favoriser un contexte équivalent à celui des Zapatistes ? A condition, a minima, que « l’ennemi » (capitaliste croissantiste) à l’origine de ces ravages soit identifié de façon consensuelle, ce qui est encore loin d’être le cas.
Conclusion
Ouvrage de référence indispensable, The Future is Degrowth est de nature académique et en anglais. Bien que très clair de bout en bout, il n’est cependant pas forcément le plus accessible à tout public. En français, Ralentir ou Périr de Timothée Parrique9 constitue une synthèse très équivalente et tout aussi recommandable10. Bien qu’il n’ait pas l’ambition de dégager le consensus de la littérature scientifique sur la décroissance, Parrique se base sur les mêmes travaux que Schmelzer et ses collègues, et la synthèse personnelle qu’il en fait en est très similaire. Parrique développe plus largement et de façon très convaincante pourquoi le découplage est impossible (c’était l’objet principal de sa thèse), ne laissant aucun doute sur l’illusion toxique du développement durable et de la croissance verte. Parrique propose également une distinction sémantique utile pour celles et ceux qui trouvent le terme de « décroissance » problématique, en différenciant le projet (une économie de post-croissance, qui ne croît plus et est viable dans les limites planétaires) du trajet (la décroissance comme transition pour y parvenir).
The Future is Degrowth suscite certainement de nombreux questionnements, et ce n’est pas là le moindre de ses mérites11. Il faut rappeler qu’il a moins l’ambition de présenter une thèse que de synthétiser l’état de l’art dans le champ académique récent de la décroissance, champ académique qui ne demande qu’à s’étendre. Imaginer un projet de société alternative touche à toutes les disciplines scientifiques, et à la lecture on aurait envie que par exemple l’histoire, la sociologie ou les sciences politiques s’emparent davantage de l’objet « décroissance ».
Lire aussi sur Terrestres : Timothée Parrique, Giorgos Kallis, « La décroissance : le socialisme sans la croissance », février 2021.
Image principale : Vincent van Gogh, Sower with Setting Sun, 1888.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- dans Le Capital dans l’Anthropocène, traduction en français à paraître en septembre 2024[↩]
- Décroissance ou barbarie, Golias, 2004[↩]
- Pour un compte-rendu plus précis du contenu du livre, nous renvoyons à la recension (en anglais) que Timothée Parrique a publiée sur son blog : https://timotheeparrique.com/book-review-the-future-is-degrowth/[↩]
- Cette première conférence peut être prise comme un marqueur de l’émergence de la communauté internationale de recherche sur la décroissance, structurée en particulier autour du réseau Research and Degrowth (https://degrowth.org/) basé à Barcelone. Voir le chapitre de Giorgos Kallis dans F. Jarrige et H. Tordjman (dir.), Décroissances. Regards croisés sur les urgences du temps, Le Passager clandestin, 2023.[↩]
- voir n°3[↩]
- Le terme de métabolisme souligne la matérialité des processus économiques, insérés dans des flux d’énergie et de matière.[↩]
- Parmi les auteurs cités et dont les analyses font toujours référence, on trouve notamment Ivan Illich, André Gorz (voir par exemple https://www.terrestres.org/2023/09/25/jadore-la-bagnole-andre-gorz-repond-a-macron/), Cornelius Castoriadis ou Serge Latouche. Le mouvement contemporain de la décroissance dont il est question ici est considéré comme naissant officiellement en 2002 en France avec un numéro spécial de la revue Silence sur le sujet (https://www.revuesilence.net/numeros/280-La-decroissance/) suivi par la création du Journal de la Décroissance en 2004. Il existe une véritable continuité dans la tradition française de la décroissance mais qui évolue ensuite avec l’internationalisation du mouvement et son enracinement universitaire.[↩]
- Cette métaphore illustre que le travail salarié ne représente que la partie visible du travail (la partie émergée de l’iceberg), partie bien moins importante que la partie invisible (la partie immergée de l’iceberg).[↩]
- Seuil, 2022[↩]
- Il existe également de nombreux ouvrages en français d’introduction à la décroissance, dont deux récents de la communauté internationale à laquelle appartiennent Schmelzer et collègues :G. Kallis, S. Paulson, G. D’Alisa, F. Demaria , Plaidoyer pour une décroissance heureuse, PUF, 2023 ; J. Hickel, Moins pour plus, Marabout, 2022. Pour la tradition française, on peut se référer par exemple aux ouvrages de Serge Latouche ou de Paul Ariès.[↩]
- Ces questionnements peuvent être prolongés par la lecture des débats actuels sur le sujet rassemblés par F. Jarrige et H. Tordjman (op. cit, note 2[↩]







