À propos de Alf Hornborg, La magie planétaire. Technologies d’appropriation de la Rome antique à Wall street, Divergences, Paris, 2021 (269 pages).
Si l’économie politique1 s’est depuis longtemps efforcée d’expliquer l’extraordinaire plasticité et l’impressionnante résilience de l’économie capitaliste face aux crises, et l’anthropologie culturelle de dévoiler les croyances fondamentales de notre modernité prétendument débarrassée de toute forme de superstition et de pensée magique, les ouvrages qui tentent de bâtir des ponts entre ces deux disciplines sont plus rares. C’est le projet d’Alf Hornborg, professeur d’anthropologie culturelle et d’écologie humaine à l’Université de Lund.
Si son nom n’est pas familier au public français, Hornborg est pourtant loin d’être un inconnu : il fut le directeur de thèse d’Andreas Malm2 à l’université de Lund, et est l’une des principales figures contemporaines, avec le regretté Bruno Latour, à tracer le sillon de Karl Polanyi en cherchant à retourner les outils de l’anthropologie et de l’analyse culturelle vers notre modernité capitaliste. Dans son ouvrage La magie planétaire, il tente d’expliquer par quelle forme de magie le capitalisme parvient à maintenir son emprise sur nos sociétés alors qu’il génère des inégalités choquantes et des destructions environnementales qui menacent la subsistance même de notre espèce.
Hornborg cherche ainsi à dévoiler les stratégies qui permettent aux dominants de s’approprier, à l’échelle de la planète, les ressources, le travail et les espaces naturels, et de les mettre au service de la reproduction du capital et de sa concentration au centre du système-monde capitaliste3. Son analyse porte en particulier sur la manière dont ces processus sont rendus invisibles et légitimés, jusqu’à être placés hors de toute remise en question possible. La « magie planétaire » est cette forme de fétichisme, qui, selon Hornborg, permet à ces processus d’appropriation de se dérouler avec l’apparence du normal et de l’inéluctable au sein de nos sociétés modernes pourtant réputées si attachées à la rationalité.
Alf Hornborg explique par quelle forme de magie le capitalisme parvient à maintenir son emprise sur nos sociétés alors qu’il génère des inégalités choquantes et des destructions environnementales qui menacent la subsistance même de notre espèce.
Simon Papaud
L’ouvrage d’Alf Hornborg n’est pas d’une lecture aisée. Il s’agit d’un recueil de huit articles parus indépendamment les uns des autres, que l’auteur s’efforce de mettre en cohérence. Son principal mérite est sans doute de permettre à son auteur d’exposer en un seul endroit toute l’ampleur de son raisonnement. Plutôt que de restituer l’argumentation de l’ouvrage dans l’ordre de ses chapitres, c’est donc à travers ses idées principales qu’on essaiera ici d’en exposer le contenu. Avec, pour ligne directrice, la thèse suivante, déclinée de mille manières par Hornborg : pour s’approprier les ressources et le travail de ses périphéries et soutenir l’accumulation du capital au cœur du système-monde4., le système économique capitaliste s’appuie sur des infrastructures physiques – la technologie – une capacité coercitive symbolique – la monnaie – et une idéologie – la science économique.
La capacité de transférer la charge de travail et la dégradation environnementale à d’autres peuples et d’autres espaces est le résultat de l’utilisation de ces symboles et de ces artefacts, qui sont autant de modes d’appropriation du travail d’autrui et des espaces naturels. Autrement dit, les relations politiques d’exploitation et d’échange inégal que nous entretenons avec nos périphéries sont rendues invisibles par la monnaie et la technologie, dont l’intervention est supposée neutre. C’est le pouvoir dont sont dotés ces symboles et ces artefacts qu’Hornborg qualifie tour à tour de « magie » et de « fétichisme »5. Sortir du fétichisme en repolitisant ces objets est un préalable indispensable à l’avènement d’un nouveau système économique – avènement qui passera, pense Hornborg, par la mise en place d’un nouveau système monétaire. La solution qu’il dessine est-elle praticable, et surtout, est-elle à la mesure du défi qu’il se lance ?
La technologie au service de l’exploitation
Start-up nation, obsession de l’innovation : l’idéologie du progrès imprègne les discours de nos gouvernants, et toute innovation technologique finit par nous sembler désirable en soi. Pour décrire notre rapport à ces objets omniprésents dans notre quotidien, et la place toujours plus centrale qu’ils semblent prendre dans nos interactions sociales, Hornborg emprunte à l’anthropologie le concept de fétichisme : un objet fétiche est un objet auquel on prête une volonté ou une capacité d’agir propre6. C’est le rapport que nous entretenons aux artefacts technologiques qui nous entourent : nous leur prêtons des besoins ou des volontés, et oublions que les rapports que nous entretenons avec eux sont en fait des rapports sociaux, dont ils ne sont que les médiateurs. Derrière notre rapport aux objets, qui sont supposés neutres, se dissimulent des rapports de pouvoir et de domination entre humains.
Le « fétiche », l’artefact, est la concrétisation de rapports sociaux, et notre façon de nous rapporter à lui détermine nos comportements et influence notre manière de voir le monde. Les objets technologiques, en somme, sont des « actants », pour reprendre le vocabulaire de Bruno Latour7. Une fois produits, ils demeurent actifs : une voiture, par exemple, demande à être alimentée en hydrocarbures par toute une chaîne d’extraction et de transport de matières premières, de raffinage et de distribution de carburant ; elle commande que l’on aménage le territoire de manière à lui permettre d’accéder à tous les lieux, de se garer partout sans un trop grand effort. Un ordinateur ou un smartphone demandent à être alimentés en électricité par tout un réseau suffisamment puissant et alimenté en continu – par exemple, par des centrales nucléaires ; une centrale nucléaire demande quant à elle à être entretenue par des ingénieurs, et protégée des intrusions et des risques d’attaque ou de sabotage par un appareil sécuritaire et des dispositifs de surveillance de très grande envergure.

En considérant les artefacts comme un donné, parfois presque comme un fait de nature, nous trouvons normal de nous plier aux volontés que nous leur prêtons – et si l’objet demande à être nourri, entretenu, réparé, s’il demande qu’on adapte le monde à lui, nous le ferons souvent sans considérer que ce faisant, ce n’est pas à l’objet que nous avons affaire, mais aux rapports sociaux qui l’ont produit. Dans le système capitaliste actuel, c’est comme si les artefacts technologiques commandaient des flux de matière, d’énergie et de travail : ils déterminent le métabolisme de la société qui les a produits, la forme du travail en son sein, et la façon dont celui-ci est distribué.
Dans les économies capitalistes, la technologie permet toujours l’optimisation de l’usage du temps et de l’argent des classes les plus aisées, au détriment des classes dominées ; elle permet, en somme, le transfert de la charge de travail et de la consommation d’espaces et de ressources des centres (urbanisés, aisés, développés) vers les périphéries – à l’échelle nationale (centres urbains/campagnes et zones périurbaines) comme à l’échelle internationale (des pays les plus avancés dans l’accumulation capitaliste vers des pays moins développés, qui sont souvent, sans surprise, les anciennes colonies des premiers).
Un ménage français qui achète un lave-vaisselle économise du temps de travail domestique, mais ce temps de travail ne disparaît pas : il est transféré vers l’entreprise qui produit les machines, qui emploie des personnes souvent issues de classes sociales moins favorisées que les acquéreur·euses des produits qu’elles fabriquent ; ces emplois industriels étant aisément délocalisables, ce temps de travail pourra même être transféré vers des pays où le coût du travail est moindre (Pologne, Maghreb, Chine, Vietnam, etc.). La consommation d’espace et les différentes pollutions associées à cette production industrielle sont transférées du même coup vers ces mêmes périphéries. Les artefacts technologiques sont ainsi la concrétisation de relations sociales d’exploitation : ils sont ce qui les rend possibles, et du même coup, ce qui les rend invisibles – les relations politiques entre classes étant dissimulées derrière des relations apparemment neutres avec des objets et des artefacts dont on oublie rapidement le caractère politique.
Concentration du capital au centre, déplacement de l’esclavage et des dégradations environnementales vers la périphérie : telles sont les seules conséquences à attendre du progrès technologique et du développement économique.
Simon Papaud
Le capital, nous dit ainsi Hornborg, pourrait être défini comme l’infrastructure matérielle qui permet l’extraction de l’énergie et du travail : le centre du système-monde procède à l’accumulation et à la concentration du capital, qui permet l’extraction de quantités de travail et d’énergie toujours plus grandes des classes dominées et de la périphérie. Le progrès technique se présente ainsi comme le processus d’intensification de cette extraction, et des logiques de domination qui l’accompagnent : s’il permet la libération du temps de travail humain et l’économie de consommation d’espaces au cœur du système-monde, c’est nécessairement par le transfert du temps de travail et de la consommation d’espaces vers les périphéries dominées8. L’histoire de l’industrialisation des pays occidentaux peut ainsi être lue, selon Hornborg, comme le déploiement d’une stratégie d’appropriation de l’espace-temps à l’échelle du monde. Concentration du capital au centre, déplacement de l’esclavage et des dégradations environnementales vers la périphérie : telles sont les seules conséquences à attendre du progrès technologique et du développement économique.

La monnaie comme dispositif de pouvoir
Pour attirer vers eux les flux de matière, de travail et d’énergie, les artefacts technologiques s’appuient sur une autre infrastructure, symbolique cette fois : la monnaie. Hornborg, une nouvelle fois, mobilise les outils de l’anthropologie pour décrire l’institution monétaire comme un système de signes, de même nature qu’un langage. La monnaie se caractérise ainsi, nous suggère-t-il, par sa grammaire spécifique, qui fait d’elle une quantité abstraite, universellement échangeable et accumulable sans limite9. À mesure que sa logique s’impose, les barrières posées par la société aux désirs individuels cèdent : en rendant commensurable, et donc échangeable, tout ce sur quoi le désir peut se porter – des ressources naturelles de la forêt amazonienne aux bouteilles de Coca-Cola, pour reprendre les exemples de l’auteur, en passant par le temps de vie humaine ou la propriété des entreprises – elle constitue le monde en ressources appropriables et exploitables sans limite.
Les barrières éthiques et morales à la marchandisation, qui s’expriment parfois dans des limites légales, sont des barrages fragiles à la logique monétaire. Les liens personnels perdent progressivement de leur caractère structurant pour la vie sociale : la monnaie représente en réalité une forme de lien social qui dispense de la réciprocité ou de l’attachement. Avoir accès à la monnaie, c’est ainsi accéder au pouvoir symbolique quasi-absolu10 sur les personnes et les choses – pouvoir de contrôler le travail d’autrui, de s’approprier la terre et ses ressources, et d’accéder aux biens marchands11. Le monopole des centres sur la définition de la monnaie et de ses caractéristiques institutionnelles est ainsi un autre élément déterminant de leur puissance : alors même que les échanges marchands semblent se dérouler selon la règle de la réciprocité (une fois l’échange effectué, chacun·e a obtenu ce qu’il ou elle désirait), les flux matériels qui leurs correspondent semblent systématiquement correspondre à un appauvrissement des périphéries et à un enrichissement des centres.
Cette apparence de réciprocité et de justice participe à la puissance de la monnaie comme dispositif de pouvoir. Si les inégalités s’accroissent, si les richesses s’accumulent dans les centres de l’économie mondiale, n’est-ce pas, de fait, que sous l’apparence de l’équité, l’échange est nécessairement asymétrique ou inégal ? C’est ce raisonnement qui est au fondement de l’économie politique marxiste – selon laquelle l’apparente réciprocité des échanges marchands dissimule en fait l’exploitation du travail par le capital. Les développements plus récents de la pensée marxiste, dans une tentative de synthèse avec les apports de l’économie écologique12, proposent d’élargir le constat de Marx : ce n’est pas seulement l’exploitation du travail humain dans le cadre de la relation salariale qui produit la plus-value et permet la concentration des richesses entre les mains des capitalistes et l’accumulation du capital dans les centres du système-monde, mais également la relation d’appropriation que nous entretenons vis-à-vis de la biosphère et des ressources planétaires.
Pour les écomarxistes, ce n’est pas seulement l’exploitation du travail humain dans le cadre de la relation salariale qui produit la plus-value et permet l’accumulation du capital dans les centres du système-monde, mais également la relation d’appropriation que nous entretenons vis-à-vis de la biosphère et des ressources planétaires.
Simon Papaud
Sans s’opposer frontalement au constat de ces courants de pensée, Hornborg propose une lecture un peu différente des relations qu’entretient la sphère matérielle (celle de la production et des flux de matière et d’énergie) avec la sphère monétaire (celle des échanges et des flux de valeur). Marxisme et économie écologique13 ont en effet pour point commun l’utilisation, pour développer leur théorie de l’exploitation et de l’échange inégal, de la catégorie de valeur : l’inégalité de l’échange est mesurée à l’aide d’une comptabilité du temps de travail socialement nécessaire à la production des marchandises (pour les marxistes) ou plus largement de l’énergie, d’origine humaine ou non-humaine, mobilisée dans la production (pour certains courants de l’économie écologique, dont l’écomarxisme).
Le point de désaccord de Hornborg avec les théories mobilisant la catégorie de valeur se situe dans le lien de causalité que ces dernières proposent d’établir entre les processus matériels (c’est-à-dire, la quantité de travail humain ou d’énergie investie dans la production) et les prix exprimés en monnaie. Pour ces théories, défendues tant par les auteur·rices classiques (Adam Smith, David Ricardo), les marxistes, et une partie de leurs héritier·ères (dont les écomarxistes comme John Bellamy Foster), les marchandises sont d’abord rendues commensurables par le temps de travail ou la quantité d’énergie nécessaires à leur production, et échangeables en proportion de ceux-ci – l’éventuel décalage entre la valeur d’une marchandise et son prix en monnaie permettant de mesurer de manière objective le degré de justice de l’échange.
Hornborg oppose à ce point de vue une théorie de la monnaie comme signe : les objets sont pour lui incommensurables a priori – et la monnaie est le langage qui, en permettant d’exprimer leur valeur, les constitue comme marchandises, c’est à dire comme objets possibles de l’échange marchand. Les valeurs des marchandises sont l’expression, dans le langage monétaire, des jugements que porte sur eux la société marchande : processus matériels et processus de valorisation se déroulent dans deux ordres bien distincts l’un de l’autre, et entre lesquels il n’existe pas de lien univoque.

Si les aspects matériels des processus de production peuvent bien sûr entrer en ligne de compte dans la définition des valeurs marchandes, il n’y a pas de relation stable entre la quantité de travail ou d’énergie investie dans la production et la valorisation d’une marchandise : les prix ne peuvent en aucun cas être déduits d’investissements matériels. De nombreux autres éléments (la rareté, le prestige, les jugements éthiques, ou simplement la polarisation mimétique du désir sur un objet donné – comme c’est le cas par exemple dans les phénomènes de bulle spéculative) peuvent contribuer à valoriser ou à dévaloriser une marchandise. L’institution monétaire, qui donne ses limites à la sphère de l’économie marchande et détermine les règles et le langage de la circulation, doit ainsi devenir, pour Hornborg un objet central pour l’économie politique14.
Analyser les aspects matériels des processus de production demeure bien sûr indispensable si l’on veut critiquer le discours économique dominant, ou élaborer une théorie de l’exploitation ou de l’échange inégal. L’échange marchand est subjectivement juste, puisqu’il implique un accord des personnes qui y sont impliquées, qui ont pour seul critère l’intensité de leurs désirs respectifs d’acquérir ce que détiennent les autres, et le sacrifice qu’ils et elles sont prêt·es à consentir pour ce faire. Pour juger de son caractère socialement équitable, il s’agit dès lors, affirme Hornborg, d’assumer de réintroduire des normes éthiques ou morales dans le discours économique.
Les théories dites « substantivistes » de la valeur tentent de rendre l’exploitation et l’injustice scientifiquement observables et quantifiables. Pour Hornborg, il nous faut désormais, à l’inverse, accepter que les critiques adressées au fonctionnement de l’économie capitaliste ne peuvent pas trouver leur fondement dans la sphère marchande elle-même, mais doivent se référer à des logiques issues d’autres sphères de la vie sociale – des logiques politiques ou éthiques, qui doivent servir de point d’appui à la critique de l’économie politique.
La comptabilité du temps de travail ou de l’énergie et la visibilisation, par ce biais, de l’inégalité de l’échange en termes de flux matériels, permet une critique des rapports sociaux induits par les échanges marchands : en ce sens, elles sont utiles et même indispensables, mais elles ne peuvent prétendre représenter le dévoilement d’une vérité des échanges marchands. Elles ne sont que l’outil d’une critique politique reposant sur des postulats éthiques, qui peuvent eux-mêmes être questionnés, modifiés ou remplacés15.
La monnaie est un dispositif de pouvoir puissant, qui permet de rendre invisibles les relations d’exploitation impliquées par les échanges internationaux, et de rendre sensé, sur le plan subjectif, le fait de s’affranchir des limites planétaires et écosystémiques.
Simon Papaud
Pour Hornborg, il est ainsi superflu de développer une théorie des valeurs comme grandeurs distinctes des prix : les prix sont les seules valeurs possibles dans la sphère marchande16. Cela n’empêche pas, bien sûr, de réfléchir aux processus de marchandisation et de valorisation qui permettent leur formation, et à la manière dont ils dissimulent, derrière l’apparente justice commutative des échanges marchands, l’inégalité matérielle de ces échanges ou leur injustice du point de vue social.
Comme « technologie symbolique », la monnaie fait l’objet du même fétichisme que la technologie : considérée comme une infrastructure, dont les mécanismes fondamentaux sont rarement questionnés sur le plan politique, elle est un dispositif de pouvoir puissant, qui permet de rendre invisibles les relations d’exploitation impliquées par les échanges internationaux, et de rendre sensé, sur le plan subjectif, le fait de s’affranchir des limites planétaires et écosystémiques.
La science économique comme idéologie
La technologie et la monnaie permettent ainsi, sous l’apparence de la justice et de la neutralité, le transfert des ressources matérielles, du travail et de la consommation d’espaces naturels et sociaux de la périphérie vers le centre. Le discours idéologique qui justifie ce transfert, nous dit Hornborg, est celui de la science économique. En cela, il pourrait toutefois être un peu plus spécifique : certains courants de pensée critiques peuvent être rattachés à la science économique, qui n’est pas un champ aussi unifié que le suggère l’auteur, et il serait sans doute plus exact de parler du discours dominant, en science économique, issu de la pensée libérale, et en particulier des théories économiques néoclassiques. En valorisant sans nuance la croissance de la production et du volume des échanges ainsi que le progrès technique, cette science économique parfois dite « mainstream » ou « orthodoxe » justifie et pérennise effectivement un ordre économique fondé sur l’exploitation des périphéries par les centres du système-monde, et sur la dissipation accélérée des ressources terrestres.
La science économique orthodoxe adopte un point de vue méthodologique individualiste sur les phénomènes économiques : focalisée sur la satisfaction des désirs individuels de consommation, elle est incapable de rendre compte des échanges sous un prisme moral ou matériel, et de déceler, sous la superficialité des accords et des transactions marchandes, les asymétries et les rapports de pouvoir qui sont à l’origine de l’exploitation.
Un surcroît d’échanges (comme reflété, par exemple, par une croissance du PIB) sera donc toujours considéré comme souhaitable par elle, car il correspond à un surcroît de satisfaction des désirs de consommation. Pourtant, une croissance du volume des échanges marchands correspond aussi toujours à un surcroît de destruction des ressources naturelles – c’est le sens des conclusions de l’économiste Nicolas Georgescu-Roegen, auxquelles Hornborg fait référence à de nombreuses reprises au fil de son ouvrage.
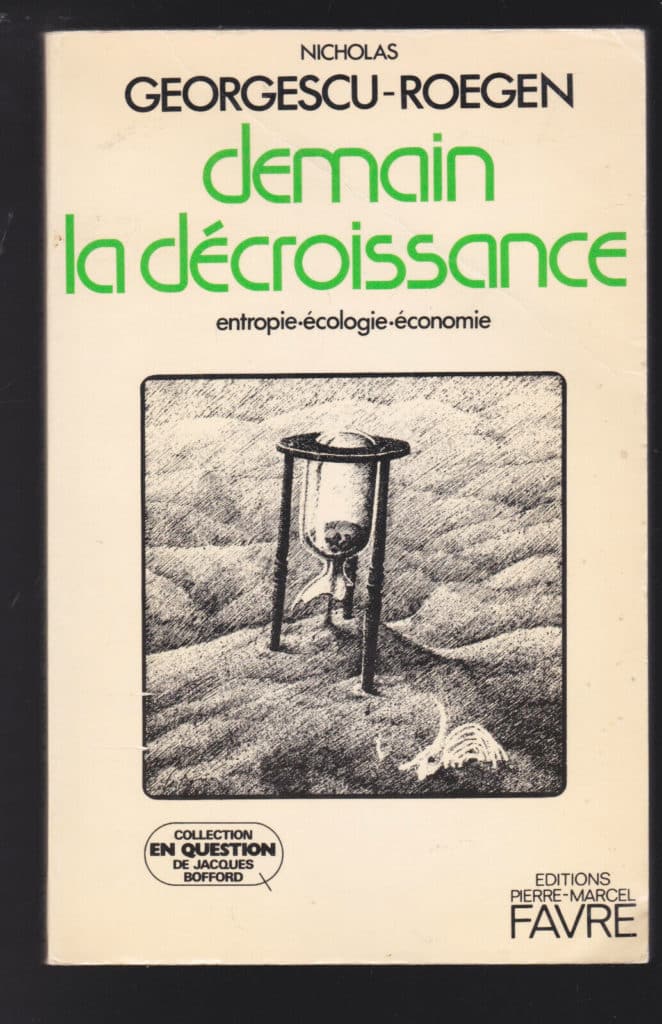
Georgescu-Roegen est l’un des premiers scientifiques à avoir tenté de rendre compte du fonctionnement de l’économie en termes de flux matériels. Il se réfère aux sciences physiques, et en particulier à la thermodynamique, pour montrer que toute production entraîne nécessairement une dissipation d’énergie irrécupérable (c’est l’entropie de la production)17. Du point de vue de la soutenabilité matérielle du fonctionnement de l’économie, c’est donc à une diminution du volume des échanges qu’il faut aspirer – à l’inverse des préconisations de la science économique mainstream.
De la même manière, l’orthodoxie économique aura tendance à voir tout progrès technique comme désirable en soi – sans voir que, comme on l’a dit plus haut, le progrès technologique correspond en général à un surcroît d’exploitation, et peut dans cette mesure, selon Hornborg, être regardé comme moralement condamnable. L’idéologie économique peut ainsi prétendre que tout va pour le mieux dans le monde du capitalisme : en légitimant un ordre économique qui fait abstraction des aspects matériels et moraux des échanges, elle dissimule le fait que notre prospérité repose sur l’exploitation des périphéries et la dilapidation des ressources terrestres. Il nous incombe, en tant que « cette part de la biosphère qui peut réfléchir sur elle-même » (p. 262), de réintroduire des normes éthiques et politiques dans nos institutions économiques.
Transformer le système monétaire pour sortir du capitalisme ?
« Si Gaïa est infectée par un virus, comme cela a pu être suggéré de façon métaphorique, ce n’est pas l’humanité mais la monnaie. […] La monnaie met en péril les principes de base de la vie » (p. 259, c’est l’auteur qui souligne), affirme Hornborg. Si tel est le cas, la transition vers un autre système économique doit nécessairement passer par une transformation de l’institution monétaire.
La monnaie que nous connaissons permet le déploiement de l’économie capitaliste à l’échelle planétaire, et l’extension de la sphère marchande à toujours plus d’aspects de la vie sociale, d’objets et d’artefacts. En rendant tout (ou presque tout) interchangeable, la monnaie permet aux désirs de se déployer sans limites morales ni matérielles. C’est donc en réduisant les possibilités de circulation de la monnaie que l’on parviendra à réorienter les désirs, et par là-même les flux économiques, vers des objets compatibles avec la reconstitution des ressources terrestres et avec des exigences de justice sociale. À cette fin, Hornborg propose un système de monnaie complémentaire qui vise à relocaliser une partie du métabolisme des économies humaines.
C’est donc en réduisant les possibilités de circulation de la monnaie que l’on parviendra à réorienter les désirs, et par là-même les flux économiques, vers des objets compatibles avec la reconstitution des ressources terrestres et avec des exigences de justice sociale.
Simon Papaud
Il s’agirait d’introduire une nouvelle monnaie (qu’il nomme, à titre temporaire, le « point »), qui circulerait en parallèle de l’Euro. Cette monnaie ne pourrait pas être convertie en euros : la sphère de circulation des euros et celle des points seraient étanches l’une à l’autre. Elle serait créée par les autorités publiques locales sous la forme d’un revenu de base versé en points18. Sa sphère de circulation serait limitée à un rayon de 30 km autour de son point d’émission (c’est-à-dire, restreinte à l’échelle d’un bassin de vie), et elle ne pourrait servir qu’à l’acquisition de biens et de services produits localement.
Les transactions en points seraient en outre rendues plus avantageuses par le fait qu’elles seraient exemptées de taxation. Des institutions spécialisées pourraient collecter les dépôts de points (qui ne seraient pas rémunérés) afin d’accorder des crédits gratuits en points. Les résultats espérés d’un tel système seraient, outre la relocalisation des flux économiques et un sens retrouvé de la communauté à l’échelle locale, une moindre dépendance des individus au travail salarié, ainsi qu’une plus grande capacité d’autofinancement des pouvoirs publics locaux et nationaux (qui pourraient financer une partie de leurs déficits par la création monétaire). Piégée dans le tissu des échanges locaux, la monnaie en « point » resterait ainsi un simple moyen au service de la circulation des marchandises – au contraire de la monnaie ordinaire, dont l’obtention est souvent considérée comme une fin en soi.
L’idée de Hornborg peut paraître séduisante sous certains rapports. Tout d’abord, contrairement à la plupart des monnaies locales actuellement en circulation, le point n’est pas converti à partir des euros mais directement distribué sous forme de revenu inconditionnel : son usage constitue ainsi un gain pur de pouvoir d’achat pour les personnes. C’est un avantage très net par rapport aux monnaies locales les plus répandues (l’Eusko dans le Pays-Basque, le Sol-Violette à Toulouse, la Gonette à Lyon, la Pêche à Montreuil…), que l’on obtient en les échangeant contre des euros. Le fait d’échanger des euros contre une monnaie qui a une sphère de circulation plus restreinte revient, pour l’usager·e, à renoncer volontairement à des opportunités d’achat.
Ce système présente donc, la plupart du temps, plus d’inconvénients que d’avantages pour les particulier·ères19. Le système de Hornborg permettrait donc sans doute d’obtenir un niveau d’inclusivité sociale supérieur à celui de ce type d’initiatives.
Quelle rupture avec l’économie capitaliste ?
Un certain nombre d’éléments demeurent cependant obscurs. Hornborg ne dit rien par exemple de la possibilité des entreprises et/ou des particuliers de payer leurs impôts en points, ce qui permettrait pourtant aux points de revenir à leur émetteur après avoir parcouru leur circuit, et de ne pas se trouver coincés (et donc accumulés, sans possibilité de trouver un débouché) dans les caisses des entreprises qui les accepteraient en paiement. Il reste également très évasif sur la manière dont il serait possible de distinguer les biens et les services produits localement des autre biens en services (on pourrait imaginer de recourir à un conventionnement des producteur·rices, comme le proposent les défenseur·euses d’une Sécurité sociale de l’alimentation20).
Ce qui frappe à la lecture de la proposition de Hornborg, c’est la faiblesse de sa portée contestataire, qui tranche avec la radicalité du constat qu’il pose tout au long de son ouvrage.
Simon Papaud
Mais ce qui frappe à la lecture de la proposition de Hornborg, c’est la faiblesse de sa portée contestataire, qui tranche avec la radicalité du constat qu’il pose tout au long de son ouvrage. Le point est en effet supposé coexister avec la monnaie capitaliste ; il n’est pas même en capacité de se substituer à tous les usages de l’euro (il peut servir de monnaie de paiement pour l’achat des marchandises bien sûr, mais ne peut en aucun cas financer l’investissement des entreprises, en l’absence d’institutions susceptibles d’accorder des crédits au-delà de leurs réserves). Sa mise en œuvre aurait certainement des effets politiques et économiques importants – mais porterait-elle une réelle rupture avec le système économique capitaliste dont Hornborg dénonce le caractère destructeur et immoral ?
Il semblerait qu’Hornborg analyse mal les rapports que la monnaie entretient avec la production et son financement, et ne propose d’introduire qu’une simple monnaie de consommation. Un projet à la mesure de la critique qu’il pose permettrait sans doute une sécession économique de plus grande ampleur, qui pourrait faire émerger un écosystème économique indépendant du système capitaliste, en permettant y compris le financement des entreprises par la création monétaire – un projet qu’on poursuivi plusieurs types de systèmes monétaires alternatifs dans l’histoire, et en particulier ceux inspirés des projets de réforme monétaire et bancaire de Pierre-Joseph Proudhon, comme la banque coopérative suisse WIR, ou les systèmes de crédit mutuel inter-entreprises à l’image du Sardex italien21.
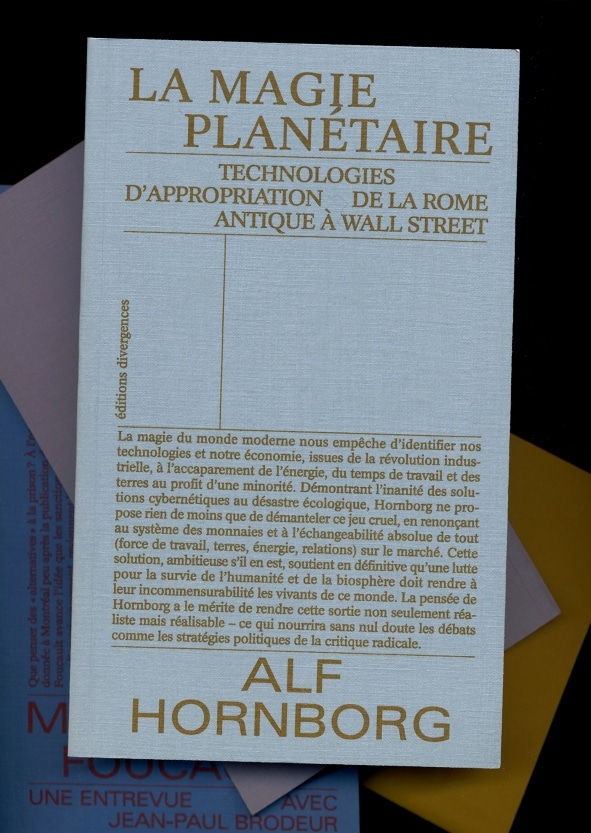
Par ailleurs, Hornborg ne se fend pas même d’une remarque sur la faisabilité politique de son projet : dans la mesure où il repose sur l’intervention et la participation de la puissance publique22, sa mise en place exige des mesures législatives nationales dont on peine à imaginer comment elles pourraient être obtenues dans le contexte actuel. Hornborg n’envisage pas non plus une mise en place de son système de manière autonome par des citoyen·nes. De fait, il existe une cryptomonnaie qui fonctionne selon ce principe de création monétaire directe sous la forme d’un revenu de base inconditionnel, la Ğ1 (June), rejoignable par parrainage, et qui souffre pour l’instant d’une diffusion trop restreinte, et qui butera sans doute, elle aussi, sur les limites évoquées plus haut. On peut ainsi douter de la capacité du projet de Hornborg d’alimenter un imaginaire politique assez fort pour déboucher sur des réalisations concrètes.
Le chemin qu’il reste à parcourir
On conclura en signalant un autre point problématique, qui n’est pas traité par l’auteur : au fond, qu’appelle-t-on monnaie ? Et l’idée de transformer l’économie en changeant la monnaie a-t-elle seulement un sens ? Si Hornborg utilise le terme « monnaie » de façon indifférenciée, on comprend que ses critiques s’adressent en réalité aux monnaies marchandes, c’est à dire aux monnaies qui permettent l’échange de marchandises sur un marché. Toutes les monnaies ne sont pourtant pas de cette nature, comme l’ont montré de nombreux travaux d’anthropologie23.
Si l’on entend « monnaie marchande » quand Hornborg écrit « monnaie », on voit assez vite que sa critique vise la faculté de la monnaie à être désirée pour elle-même : de moyen universel dans l’univers marchand, la monnaie devient assez naturellement, à mesure que celui-ci s’étend, une fin universelle – et les agents économiques finissent par rechercher son accumulation plutôt que son acquisition temporaire en vue d’acquérir d’autres biens24.
Suffit-il dès lors de décréter que la monnaie doit cesser d’être le moyen d’accéder à toutes les choses pour que ce soit effectivement le cas ? Le constat de Hornborg est juste : le désir d’accumulation monétaire illimité a partie liée avec l’émergence et le maintien du capitalisme comme système économique, et sortir du capitalisme implique de redonner des qualités aux usages monétaires, de dés-homogénéiser les flux, de rendre à nouveau incommensurables des choses que la monnaie marchande-capitaliste a fini par mettre sur le même plan. Cela ne peut être fait qu’en réintroduisant des limites politiques et éthiques au sein de la sphère économique. Introduire un système monétaire fonctionnant selon des règles différentes de celui que nous connaissons peut bien sûr être un outil dans ce but : encore faut-il cependant créer une adhésion des acteurs économiques aux valeurs et aux principes qui fondent ce système, afin d’éviter que les usages privés de la monnaie ne finissent par déborder les idées qui président à sa naissance. On mesure l’ampleur du chemin à parcourir pour voir émerger une proposition monétaire qui dessinerait réellement les contours d’un mode de production économique post-capitaliste.
Notes
- Du moins, une certaine économie politique. Voir par ex. Robert Boyer, Économie politique des capitalismes, La Découverte, Paris, 2015.[↩]
- Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Verso, 2016, ou encore — , Comment saboter un pipeline ?, La Fabrique, Paris, 2020.[↩]
- Hornborg mobilise le concept de « système-monde », développé par Immanuel Wallerstein à la suite de Fernand Braudel, pour parler de la manière dont l’économie capitaliste fonctionne en mettant en réseau des espaces dont les statuts sont différents : ce système est un monde à part entière, dans lequel existent des centres (plus ou moins forts) où les richesses se concentrent, et des périphéries dont les ressources et le travail sont extraits, et les espaces géographiques mis à profit et exploités au profit des centres.[↩]
- Pour ce concept, voir note 1[↩]
- Le concept de fétichisme a été développé par l’anthropologie (voir par ex. Marcel Mauss, Esquisse d’une théorie générale de la magie, L’Année sociologique, 1902-1903), et consiste à prêter à des objets inanimés des pouvoirs d’agir qui proviennent en dernière analyse de puissances sociales. Ce concept a fortement imprégné la pensée marxiste : dans Le Capital (Livre 1, section I, Ch.1, IV), Karl Marx parle d’un « fétichisme de la marchandise » qui naîtrait dans la société marchande. Marx entend par là que les marchandises nous semblent par nature pouvoir faire l’objet d’un échange (être vendues, achetées, posséder un prix de marché, c’est-à-dire une valeur d’échange), alors que ce rapport d’échangeabilité entre les choses dissimule en fait un rapport social : la division sociale du travail. La forme-marchandise rend commensurables des objets produits par le travail privé de producteur·rices indépendant·es : par là-même, elle rend les travaux privés eux-mêmes commensurables, et leur permet de devenir partie du travail social. On prête à la marchandise une caractéristique qui semble lui être intrinsèque (la valeur), et qui n’est en fait que le produit des rapports sociaux. Hornborg n’utilise pas le terme fétichisme au sens marxiste, mais bien au sens anthropologique, tel qu’on l’a brièvement défini plus haut.[↩]
- Voir la note précédente.[↩]
- Ce néologisme vient notamment de la sociologie de Bruno Latour. Il se distingue du terme d’acteur (centré sur l’humain) et entend échapper au dualisme du sujet (actif et intentionnel) et de l’objet (passif et déterminé) propre aux Modernes. Un actant se définit par sa capacité à agir/réagir et à modifier une situation par sa participation à un processus donné – qu’il soit un virus, une voiture, un groupe d’êtres vivants, un humain, une institution, etc. – et ce, indépendamment de la question de l’intentionnalité de l’action. Voir par exemple Bruno Latour, Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006.[↩]
- Hornborg se place ici dans la lignée d’auteurs comme Immanuel Wallerstein, Samir Amin ou Emmanuel Arghiri, qui ont étudié l’inégalité des échanges à l’échelle mondiale et analysé les relations de dépendance et d’exploitation entre les centres et les périphéries de l’économie capitaliste.[↩]
- Le fait de parler de monnaie en toute généralité pour se référer à la monnaie de nos sociétés marchandes capitalistes sans poser ce choix comme un problème, me semble être une façon simple d’évacuer une question complexe : qu’appelle-t-on au juste monnaie ou système monétaire ? Peut-on concevoir des systèmes monétaires qui n’auraient pas les propriétés de la monnaie telle que nous la connaissons ? Ce point sera développé infra.[↩]
- Ou tendant à l’être : la construction du code du travail ou du droit de l’environnement ont montré que la société pouvait intervenir en faveur de l’intérêt général humain, et contrecarrer la logique de la monnaie. Le rapport au monde et aux autres induit par la monnaie n’en demeure pas moins, tendanciellement, celui de la pleine disponibilité du monde au désir individuel.[↩]
- On peut être un peu plus spécifique : avoir accès à la monnaie n’est pas tout, encore faut-il avoir accès à une quantité suffisante de monnaie. Dans notre société, pour avoir réellement accès aux moyens de production et à la terre (et donc au travail), il est nécessaire d’avoir accès au crédit. La monnaie que l’on acquiert comme travailleur sous la forme de salaire ou de rémunération est une monnaie faible, disponible la plupart du temps en quantité trop limitée pour donner un réel pouvoir : elle ne donne qu’un droit de tirage sur les biens de consommation, et ne permet ordinairement pas à celui ou celle qui l’acquiert de changer de statut dans l’économie capitaliste.[↩]
- L’économie écologique étudie les flux de matière et d’énergie entrants et sortants générés par la production économique, et les interdépendances que les sociétés humaines entretiennent par conséquent avec la biosphère.[↩]
- Dans sa variante écomarxiste, principalement.[↩]
- La perspective développée par Hornborg est donc, on le comprend, incompatible avec la perspective marxiste traditionnelle, très attachée à la théorie de la valeur-travail puisqu’elle y trouve le fondement de sa théorie de l’exploitation dans la relation salariale, et qui tend à considérer la monnaie comme une marchandise parmi d’autres, choisie de manière conventionnelle (et quasi-arbitraire) afin d’exposer les valeurs de toutes les marchandises.[↩]
- On peut par exemple choisir de considérer que les échanges marchands doivent occasionner des émissions de gaz à effet de serre n’excédant pas la capacité de la Terre à les réabsorber ; ou qu’ils ne doivent pas rémunérer le travail moins qu’un certain seuil. Ces critiques de non-soutenabilité environnementale ou humaine de l’économie reposent sur des postulats et constituent une critique éthique du fonctionnement économique, qui n’ont pas besoin des grandeurs métaphysiques (comme la catégorie de valeur) pour donner à leurs arguments une apparence de scientificité.[↩]
- Hornborg saisit là un point fondamental de théorie économique : les théories fondées sur la valeur, de la théorie libérale classique au marxisme et à la théorie néoclassique, débouchent toutes sur des impasses. En particulier, la théorie économique marxiste bute depuis plus d’un siècle sur le problème de la transformation des valeurs en prix, et la théorie néoclassique ne sait pas intégrer la monnaie dans son modèle économique, et finit par décrire une économie de troc à grande échelle qui n’a qu’un rapport lointain avec la réalité des échanges économiques. Contre ces approches théoriques dites « réelles » (car leur analyse prend pour point de départ les biens et services réels qui font l’objet de l’échange), Hornborg adopte donc un point de vue compatible avec l’approche dite « monétaire » de l’économie – une approche qui réunit certains auteurs libertaires comme P.-J. Proudhon ou S. Gesell, John Maynard Keynes, ainsi que les économistes circuitistes et post-keynésien·nes. Des auteurs comme Jean Cartelier (Marchands, salariat et capitalistes, La Découverte, Paris, 1980), André Orléan (L’empire de la valeur, Seuil, Paris, 2011) ou Frédéric Lordon (La condition anarchique, Seuil, Paris, 2018) développent des perspectives proches.[↩]
- Voir Nicolas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, 1971.[↩]
- Une partie des dépenses sociales (retraites, allocations de sécurité sociale) pourraient également être versées en points selon le plan de l’auteur.[↩]
- Hormis bien sûr les bénéfices subjectifs tirés de la conviction d’effectuer une démarche éthique et engagée. Les monnaies locales convertibles reposent ainsi sur les convictions éthiques de leurs usagers, et ne semblent pas susceptibles de toucher un public large – c’est-à-dire de s’étendre au-delà d’un public relativement favorisé sur le plan économique et doté de convictions politiques fortes.[↩]
- Voir par ex. https://www.terrestres.org/2021/07/29/instituer-le-droit-a-lalimentation-en-france-au-xxie-siecle/, ou encore https://securite-sociale-alimentation.org/la-ssa/les-trois-piliers-du-mecanisme-de-ssa/[↩]
- Bien sûr, aucune de ces propositions n’est allée au terme de la démarche consistant à s’émanciper du capitalisme. Mais on pose ici l’hypothèse qu’elles portent un ferment plus fertile que les propositions du type de celle d’Alf Hornborg.[↩]
- Une partie des dépenses sociales (aides, prestations de sécurité sociale…) est supposée faite en points, ce qui implique nécessairement une participation au dispositif de l’État et des collectivités locales.[↩]
- On pourra se référer, pour en avoir la démonstration, à Michel Aglietta et André Orléan (éd.), La monnaie souveraine, Odile Jacob, Paris, 1998.[↩]
- Un processus bien exposé par Georg Simmel, Philosophie de l’argent, PUF, Paris, 2014 [1900].[↩]









