Bram Büscher est politologue et Rob Fletcher anthropologue de l’environnement (Université de Wageningen, Pays-Bas). Ils se sont tous deux intéressés à la conservation de la nature et à l’éco-tourisme dans leurs dimensions économiques et écologiques, dans le cadre de ce que l’on appelle la political ecology1.
Cet entretien revient en détail sur les principales thèses de leur livre publié en 20192, dont la traduction est à paraitre prochainement aux éditions Actes Sud3 : Le vivant et la révolution. Réinventer la conservation de la nature après le capitalisme (traduit de l’anglais par Antoine Chopot).
Propos recueillis et traduits par Antoine Chopot
Votre réflexion dans Le vivant et la révolution se fonde sur une critique de la conservation traditionnelle de la nature, essentiellement centrée selon vous sur les aires protégées et la préservation de la wilderness, ces grandes étendues sauvages dites « vierges » qui ont servi de modèle à l’expansion de la conservation dans le monde. Pouvez-vous tout d’abord revenir sur cette histoire ?
C’est une histoire très complexe, mais de manière simplifiée on peut dire que la conservation moderne et dominante est née comme un « contre-mouvement » face à la destruction à grande échelle des espèces et des écosystèmes aux XVIIIème et XIXème siècles, destruction causée par le développement du capitalisme industriel et son expansion à travers le monde via la colonisation européenne. Durant cette période, les scientifiques et les élites sociales ont de plus en plus déploré la destruction de la nature en Europe, en Amérique du Nord et dans de nombreuses colonies : ils ont ainsi commencé à préconiser des mesures de conservation des espèces végétales et animales, ainsi que des terres et des écosystèmes dont ces dernières dépendent. Dan Brockington, Rosaleen Duffy et Jim Igoe ont rassemblé ces éléments sous le terme de « conservation dominante » (mainstream conservation), désignant par là « une branche historique et institutionnelle particulière de la conservation occidentale, promue et pratiquée notamment par de grandes et puissantes organisations internationales de conservation » (comme The Nature Conservancy, Conservation International, et le World Wildlife Fund).
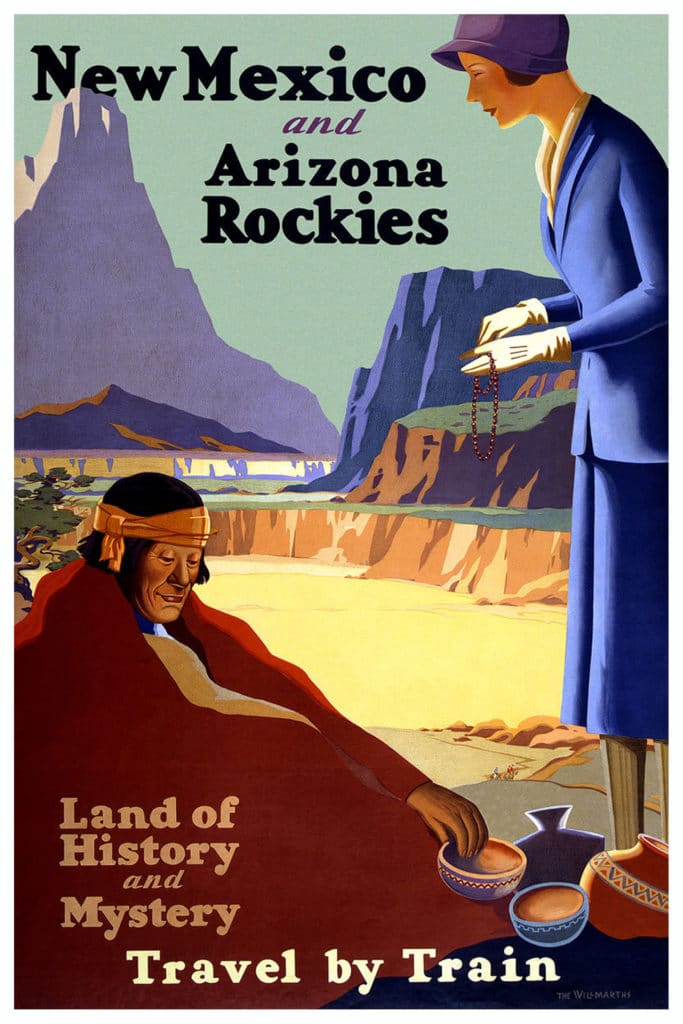
Ce concept met l’accent sur la manière dont ce « contre-mouvement » complexe a été consolidé et soutenu par des institutions toujours plus puissantes et influentes au fil du temps, qui se sont appuyées sur deux stratégies clés pour atteindre leur but : 1) la séparation physique des humains et de la nature par la mise en place d’ « aires protégées » ; 2) la séparation métaphysique des humains et de la nature, en concevant cette dernière comme un domaine distinct et séparé de l’humanité, compris avant tout comme un objet scientifique et instrumental dont la gestion doit être rationalisée par des autorités compétentes, étatiques ou autres. C’est ce qu’on peut appeler la dichotomie humain-nature, perspective que les aires protégées ont cherché à transformer en une réalité matérielle.
Ces deux stratégies, à leur tour, ont été très influencées par l’élite économique et les agents étatiques cherchant à tirer profit d’espaces naturels bien protégés pour des raisons d’identité, de statut, de loisir, de ressourcement, etc., ainsi que, avec le temps, pour des raisons commerciales. De manière ironique, cette dynamique est devenue si prépondérante que les organisations de la conservation dominante pensent à présent que cette force en grande partie responsable de la crise de la biodiversité – l’expansion coloniale-capitaliste – est la solution pour sauver la biodiversité ! Les critiques formulées à l’encontre de ce processus et de ses logiques sont nombreuses, allant des préoccupations relatives à la dépossession de nombreuses communautés (autochtones et autres) pour faire place à des espaces de conservation, jusqu’à la contradiction fondamentale qu’implique la tentative de recourir à la logique d’un problème comme la logique de sa solution.
En quoi cette forme de conservation de la nature fait-elle partie intégrante de l’histoire du capitalisme et n’a jamais pu véritablement jouer le rôle de rempart face à la destruction écologique ?
Dans notre livre, nous soutenons que la conservation dominante a fonctionné comme un rempart dans la mesure où, d’une certaine manière, la conservation a effectivement freiné certains des impacts les plus dévastateurs du capitalisme sur la biodiversité, par exemple en stoppant son expansion dans certaines zones de biodiversité. Mais notre argument est que cela a toujours été une bataille d’arrière-garde centrée sur les multiples effets de l’expansion capitaliste, et rarement sur l’expansion capitaliste en tant que cause profonde de la crise de la biodiversité elle-même. Nous appelons cela « passer la serpillère alors que le robinet reste grand ouvert ».

Selon nous, la conservation ne doit pas être comprise comme le contraire du développement, comme on l’entend souvent dans la bouche de ses partisans, mais plutôt comme partie intégrante du développement capitaliste. Pour trois raisons. Tout d’abord parce que la conservation provient de l’histoire du capitalisme colonial et industriel lui-même. Comme nous l’avons dit, la conservation dominante est née d’un vaste contre-mouvement visant à protéger la nature des ravages de la colonisation, de l’expansion urbaine et industrielle, de la pollution et de l’exploitation croissante des ressources naturelles par l’agriculture moderne, l’exploitation minière et d’autres processus similaires.
Ensuite, ce contre-mouvement a toujours été destiné à fonctionner au sein du capitalisme. La contestation dont nous parlons ne relevait pas d’une révolte ouvrière et n’était pas liée aux classes subalternes ou aux populations autochtones ; les partisans de la conservation étaient (et restent aujourd’hui) principalement des élites, dont de très puissantes élites commerciales euro-américaines, qui ont cherché à contrer la destruction de l’environnement par la mise en place d’initiatives et d’organisations visant à protéger certains paysages, écosystèmes et animaux (souvent charismatiques). Mais cela ne veut pas dire que les classes subalternes, les ouvriers et ouvrières et les peuples autochtones ne se souciaient pas de la destruction de la nature ! Bien au contraire, nombre d’entre elles et eux se sont soulevé·es contre cette destruction, souvent au prix de leurs vies. Mais leurs luttes ne sont pas à l’origine des formes institutionnalisées et « dominantes » de la conservation établies aux XIXème et XXème siècles. Pour l’élite qui a fixé les formes institutionnelles spécifiques de la conservation dominante (d’une nature préservée, rationalisée), ceci est allé main dans la main avec la poursuite du développement capitaliste. Ceci explique la raison pour laquelle, pour le dire plus franchement, la conservation dominante n’a jamais réellement reconnue ni travaillé contre les racines capitalistes de la crise de la biodiversité, dans la mesure où sa logique profonde appartient à ces mêmes racines capitalistes.

La troisième raison pour laquelle nous considérons la conservation comme partie intégrante du capitalisme est que l’une des conditions principales du développement de la production capitaliste – qui repose sur une masse de travailleurs et travailleuses qui ne possèdent ni la terre ni les outils pour subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait vendre leur travail à des capitalistes pour survivre – fut le déplacement d’un grand nombre de petits paysans et paysannes (et de celles et ceux dépendants du glanages) hors de la campagne rurale par le moyen des processus d’ « enclosure ». Processus qui prirent souvent la forme de zones de conservation préservées pour un usage récréatif par les élites sociales. De cette manière, la création des aires protégées aux XVIIIème et XIXème siècles peut être considérée comme l’une des principales forces permettant au capitalisme industriel d’accéder aux réserves de main-d’œuvre dont il avait besoin pour se développer.
Dans une veine marxiste inspirée du travail du géographe David Harvey, vous théorisez « l’accumulation par conservation », c’est-à-dire la manière dont aujourd’hui les objectifs de conservation fusionnent avec l’accumulation du capital et le mode de développement capitaliste. Quels sont les dispositifs dans lesquels s’incarne cette accumulation par conservation ?
Il y en a beaucoup : le capitalisme a toujours su se montrer créatif dans sa capacité à trouver des manières de faire de l’argent avec à peu près n’importe quoi – même avec ce qui pourrait à première vue apparaître comme ses propres limites ! C’est pourquoi, lorsque l’on est passé, dans les années 1970 et 1980, d’une reconnaissance générale de la nécessité de limiter le capitalisme pour permettre la conservation de la nature (par exemple par le biais de lois et de réglementations sur la protection de l’environnement) à l’idée que la conservation doit rendre profitable la nature préservée, de nombreuses stratégies anciennes ont été (ré)inventées en conséquence et de nouvelles stratégies ont été développées. La principale stratégie la plus ancienne, l’écotourisme de la faune sauvage, en fut extrêmement stimulée et étendue à de nombreuses régions du monde.
Les stratégies plus récentes construites sur cette même logique, cherchant à rendre la conservation de la nature plus rentable que l’extraction sont, tout d’abord, l’idée même de « développement durable », qui vise à faire de la conservation la base du développement, plutôt qu’une limitation de ce dernier. Ensuite, les inventions se sont succédées : « paiements pour services écosystémiques », banques de compensation écologique, marché carbone, mécanisme REDD+, évaluation du capital naturel, etc. Dans cette phase la plus récente, le langage du capital et de l’économie est littéralement devenu le langage de la conservation. L’argument principal est que la conservation n’avait pas été suffisamment intégrée dans le processus des prises de décision capitalistes, ce qui aurait permis à l’inverse de « rendre la valeur de la nature visible » pour l’économie. L’accumulation par conservation, c’est donc l’idée que si la conservation peut être rendue profitable, alors le capitalisme va de lui-même se mettre à préserver plutôt que détruire la nature. C’est une logique simple, mais profondément viciée.
Les réflexions sur l’entrée dans l’Anthropocène ont fait naître des alternatives radicales à la conservation dominante, ayant surgi en réaction aux limites de cette première forme historique de conservation. Quelles sont ces alternatives et sur quels points fondent-elles leurs critiques respectives ? En quoi sont-elles, selon vous, « radicales » ? Quelles sont leurs limites intrinsèques, voire leurs contradictions indépassables ?
Comme nous l’avons dit, l’intégration de la conservation au sein du capitalisme global s’est faite de manière plus ouverte et plus franche depuis les années 1990. Dans cette perspective, le capitalisme ou la croissance économique sont dorénavant présentés comme solution à la crise de la biodiversité, et non comme sa cause profonde.
D’un côté, la conservation dominante se voit aujourd’hui remise en question par la « nouvelle conservation », qui endosse cette position et préconise les « solutions » à la crise écologique basées sur la valorisation et l’évaluation du « capital naturel ». Bien sûr, il n’y a là rien de vraiment radical. Mais, ce faisant, les nouveaux conservationnistes ont dans le même temps radicalement remis en question le dualisme nature-culture qui est au cœur de la conservation dominante, en soutenant que la nature « plus qu’humaine » devait être considérée comme un élément intégré à un « jardin turbulent » socio-naturel (comme le dit la journaliste Emma Marris), devant être géré par les humains. À partir de l’idée éco-moderniste d’une innovation technologique mise au service de la réduction de l’utilisation des ressources et de la durabilité, la nouvelle conservation vise une fusion toujours plus poussée de la conservation et du capitalisme.

De l’autre côté, on trouve le « néo-protectionnisme », qui maintient volontairement ce dualisme nature-culture. Les néo-protectionnistes estiment qu’une séparation des humains et de la nature est nécessaire pour empêcher un effondrement total des écosystèmes vitaux de la planète. Cette position, à son tour, n’est pas réellement radicale, dans la mesure où c’est ce que la conservation dominante a elle-même toujours préconisé, bien qu’à une échelle moins ambitieuse. Ce qui est radical, en revanche, dans la perspective néo-protectionniste, c’est la proposition d’étendre désormais la surface des aires protégées à la moitié de la planète – proposition connue sous le nom Half Earth –, comme un outil central des politiques de conservation, avec l’objectif intermédiaire de « 30% d’ici 2030 ». Dans le même temps, les néo-protectionnistes se font toujours plus critiques à l’égard de la croissance économique, du consumérisme et de la volonté d’y recourir pour financer la conservation. À certains égards et à d’importantes exceptions près, les néo-protectionnistes sont donc nombreux·ses à être plutôt critiques à l’endroit du capitalisme contemporain, que ce soit explicitement ou implicitement : ceci rend radicale leur position étant donnée l’adhésion croissante de la conservation dominante aux mécanismes capitalistes.
Notre livre offre une réflexion détaillée et nuancée sur les différences cruciales qui existent entre ces diverses propositions, ce à quoi nous ne pouvons pas rendre justice ici. Il importe toutefois d’insister à nouveau sur le fait que ces deux mouvements remettent en question certains principes fondamentaux de la conservation dominante tout en en soutenant d’autres. Ceci indique deux choses : premièrement, qu’une révolution pourrait être en train de se préparer au sein même de la conservation dominante ; deuxièmement, que ces deux alternatives ne peuvent à elles seules engendrer une telle révolution, dans la mesure où aucune ne s’attaque véritablement aux racines socio-écologiques de la crise de la biodiversité liée à l’expansion capitaliste. C’est également, selon nous, l’une des raisons pour lesquelles les politiques associées à la conservation dominante ne peuvent pas ou ne parviennent pas réellement à s’attaquer aux dérives politiques réactionnaires que nous voyons surgir un peu partout dans le monde, qui, selon nous, sont elles-mêmes le pur produit du besoin d’alimenter cette même expansion.
Votre livre s’adresse non seulement au grand public et aux militants anti-capitalistes (pour leur rappeler combien la conservation est un nœud central de la question politique et de l’avenir de la planète), mais aussi aux conservationnistes eux-mêmes. Or, un certain nombre d’entre elles et eux pensent que leur travail consiste seulement à protéger la nature et la biodiversité, de manière neutre, et que la politique est une autre question, qui ne les concerne pas directement. Qu’auriez-vous à leur répondre ? Comment pouvez-vous les convaincre du fait que la conservation de la nature est nécessairement une affaire profondément politique, qui concerne au premier chef les conservationnistes eux-mêmes ? En quoi peut-il n’exister aujourd’hui qu’une conservation radicalement politique et à distance du capitalisme ?
Évidemment, certaines personnes ne veulent pas entendre que la conservation est politique, dans la mesure où cela rend leur travail un peu plus facile, puisqu’elles peuvent prétendre incarner une forme de neutralité. Mais cette attitude est en elle-même une position très politique : c’est ce que certains de nos collègues appellent une forme d’anti-politique, où le fait de revendiquer la neutralité – l’objectivité – est une stratégie clé pour faire valoir sa propre position politique ! La manière la plus claire (ou la plus simpliste) d’ expliquer cela est que, pour nous, A) la politique ne renvoie pas à la politique « officielle » des partis et des politiciens, mais plutôt B) à la discussion et à la médiation entre différents intérêts. Et il est clair que tous les acteurs ont leurs intérêts, y compris les conservationnistes, eux-mêmes souvent en contradiction avec les intérêts d’autres acteurs. Donc défendre la conservation de la nature face à des intérêts rivaux doit toujours être politique, au sens où nous l’entendons.
En réalité, dès lors qu’il s’agit du sort de la vie sur Terre en ses diverses formes, les enjeux sont monumentaux, et les intérêts associés à ces enjeux sont donc tout aussi considérables. Cette situation fait de la conservation un enjeu très, très politique. La clé, c’est de le reconnaître, puis de trouver des manières de s’y rapporter de manière constructive. Le premier point est assez facile à admettre quand on l’explique de cette manière ; le deuxième est évidemment bien plus difficile. En même temps, les conservationnistes agissent réellement au quotidien : ils se battent pour la biodiversité en se mobilisant, en influençant les politiques, et ils font avancer les choses. Ce qu’ils réalisent ou acceptent moins c’est la manière dont la conservation est elle-même historiquement et actuellement associée à la même logique capitaliste qui est à la racine de la crise de la biodiversité. Ceci veut très clairement dire que la conservation doit faire effort pour se repenser radicalement elle-même, et c’est ce que notre propre alternative – la conservation conviviale – essaie de faire. Heureusement, de plus en plus de gens attirent l’attention sur la politique de la conservation ces derniers temps, précisément de cette manière, de sorte qu’il est de plus en plus difficile de les ignorer.
Vous ne faites pas que dresser cette cartographie de la situation de la conservation mondiale dans l’Anthropocène. Vous proposez également votre propre alternative, basée sur vingt années de recherche en sciences de l’écologie politique. Quelle est cette alternative et quels sont ces principes fondateurs ?
Nous proposons la conservation conviviale comme une alternative aux trois formes de conservation (dominante, nouvelle et néo-protectionniste). La conservation conviviale cherche à transcender d’un même geste le dualisme nature-culture et la croissance économique capitaliste, offrant une alternative véritablement systémique. Autrement dit, la conservation conviviale affirme que sans s’attaquer au capitalisme et à ses nombreuses dichotomies et contradictions intrinsèques, nous ne pouvons pas relever les défis de la conservation qui se présentent à nous, ni le faire de manière réaliste et efficace à l’intérieur du climat politique actuel. La conservation conviviale repose sur une politique de l’équité, du changement structurel et de la justice environnementale. Elle cible directement les intérêts capitalistes extrêmes des élites mondiales et transcende définitivement la foi technocratique qui inspire de nombreux « pragmatiques » contemporains.
Plus important encore, elle se joint de manière enthousiaste à la vague émergeant des nombreuses régions du monde exigeant une transformation structurelle, notamment les luttes des collectifs autochtones et leur droit à gouverner leurs terres riches en biodiversité. La convivialité, cela consiste à « vivre avec » ; c’est donc mettre en avant l’importance de (ré)inventer de nouvelles relations individuelles et communes avec le reste de la nature par-delà les transactions commerciales rationalisées. Ce n’est pas une mince affaire, nous en sommes bien conscients. Il n’y a également rien de romantique dans le fait de vivre plus profondément avec le reste de la nature, mais nous sommes convaincus que cela est essentiel à la fois pour l’épanouissement des humains et pour une soutenabilité et une équité de toute vie sur notre planète.
Comment cela se traduirait-il concrètement ?
La conservation conviviale défend un large éventail de mécanismes et de pratiques, dépliés dans notre livre. Trois des éléments les plus importants préconisés ont trait à des changements dans les principaux modes de fonctionnement actuels de la conservation. Le premier concerne la manière dont les espaces de conservation sont organisés : par opposition avec les néoprotectionnistes, nous soutenons que l’avenir réside nécessairement dans la création d’espaces intégrés dans lesquels les humains et la vie sauvage coexistent plutôt que de les séparer par de nouvelles aires protégées encore plus strictes. Mais nous tenons à dire que cette coexistence est et sera extrêmement variée, et qu’elle englobe une très grande variété d’occupations humaines des terres, en termes d’intensité. La clé est que partout, des villes jusqu’aux espaces « sauvages » (ruraux), la coexistence entre les humains et les non-humains soit centrale (sous ses différentes formes et intensités).

Ensuite, en termes de gouvernance, la conservation doit promouvoir une délibération démocratique directe centrée sur les personnes vivant le plus étroitement avec les zones de biodiversité menacée – à savoir les populations autochtones et les communautés locales – plutôt qu’un processus de décision descendant et mis en œuvre par des élites technocratiques et économiques. Mais ceci doit arriver, dans le même temps, sans responsabiliser de manière indue ces mêmes populations et communautés en leur faisant porter le fardeau de la crise de la biodiversité. Bien au contraire, les responsabilités ainsi que les impacts doivent être reconnectés aux acteurs éloignés des ces zones de biodiversité, qui doivent être rendus bien plus responsables de ces mêmes impacts (voir ci-dessous).
Troisièmement, en termes de financement, et par différence avec la nouvelle conservation, nous pensons que la conservation doit prendre ses distances avec les mécanismes capitalistes reposant sur une croissance destructrice pour son financement, et trouver des manières de redistribuer la richesse dont nous disposons déjà à celles et ceux qui en ont besoin. Pour ce faire, nous préconisons de commencer avec ce que nous appelons le « revenu d’existence pour la conservation » (REC) : un paiement inconditionnel aux membres des communautés vivant dans ou à proximité des zones critiques pour la conservation, pour leur permettre de vivre dignement et sans dépendre de la dégradation des écosystèmes qui les entourent. Tout cela demande encore à être élucidé dans le détail, mais nous voyons cette proposition comme bien plus viable que la bataille d’arrière-garde consistant à « passer la serpillère alors que le robinet reste grand ouvert ».
La conservation conviviale fait aujourd’hui l’objet d’un travail concret au sein du réseau international CONVIVA, qui tente de mettre en place en différentes régions du monde cette conservation post-capitaliste que vous appelez de vos vœux. Pouvez-vous nous décrire l’histoire, le fonctionnement et les objectifs de ce réseau ?
Ce réseau de recherche vise à connaître dans quelle mesure les principes de la conservation conviviale sont déjà mis en œuvre, ou ont le potentiel de l’être, dans divers contextes de conservation. L’ambition est d’apprendre et de tirer les leçons d’un contexte situé pour les appliquer à d’autres de manière productive, et à partir de tous ces cas à notre disposition, de construire un modèle fonctionnel avec des exemples concrets de ce à quoi peut ressembler une approche globale de la conservation conviviale dans la pratique. Ce travail a été initialement soutenu par une bourse de recherche du Belmont Forum et de NORFACE (un réseau d’organismes européens de financement de la recherche), qui nous a permis de travailler avec un groupe exceptionnel de personnes étudiant les relations humains-prédateurs dans quatre contextes différents : les relations humains-loups en Finlande ; humains-lions en Tanzanie ; humains-jaguar au Brésil ; humains-ours aux États-Unis.
Grâce à ce projet, nous avons aussi pu développer des collaborations avec un large réseau de chercheurs et d’organisations étudiant des questions similaires dans bien d’autres contextes à travers le monde. Nous avons commencé à publier les résultats de ces nombreuses études de cas, et nous commençons maintenant à dégager les enseignements et modèles clés des différents cas pour développer le cadre plus général de notre conservation conviviale en pratique. Nous vous invitons à nous suivre pour en savoir plus sur ce réseau dans les mois et les années à venir.
Comment un projet de conservation conviviale se met-il en place ? Pouvez-vous partir d’un exemple du réseau CONVIVA ? Comment peut-on défendre une conservation de la nature depuis des communautés habitantes ? Quels sont les outils, les méthodes à notre disposition ?
Tout d’abord, il faut souligner que de nombreuses personnes défendent déjà et mettent en pratique des formes de conservation conviviale, tant dans le Nord que dans le Sud. Nous n’essayons pas de réinventer la roue mais de réfléchir aux nombreux débats et pratiques de conservation de ces dernières décennies pour mettre en lumière le fait qu’il existe une histoire et un message plus grands, qui pourraient, espérons-le, clarifier les raisons pour lesquelles des formes alternatives et conviviales de conservation sont vraiment indispensables. Il faut aussi rappeler que, dans de nombreux contextes, un projet de conservation conviviale ne naîtra pas du néant. Il est fort probable qu’il se passe déjà des choses sur le terrain qui témoignent d’une dynamique conviviale. La première étape est de les identifier et de les mettre en avant pour en discuter, les soutenir et les développer. La seconde étape consiste à identifier les aspects qui ne sont pas ou peu « conviviaux » dans un projet donné, en les comparant à ce à quoi ressemblerait une approche conviviale sur la base de nos principes généraux et d’autres exemples concrets. La discussion porte alors sur la manière dont il pourrait être possible d’introduire des éléments plus conviviaux dans les aspects du projet qui en ont le plus besoin. Cette discussion doit bien sûr être fondée sur la délibération démocratique directe avec les personnes habitant sur le territoire, qui doivent vivre avec la vie sauvage de manière quotidienne.
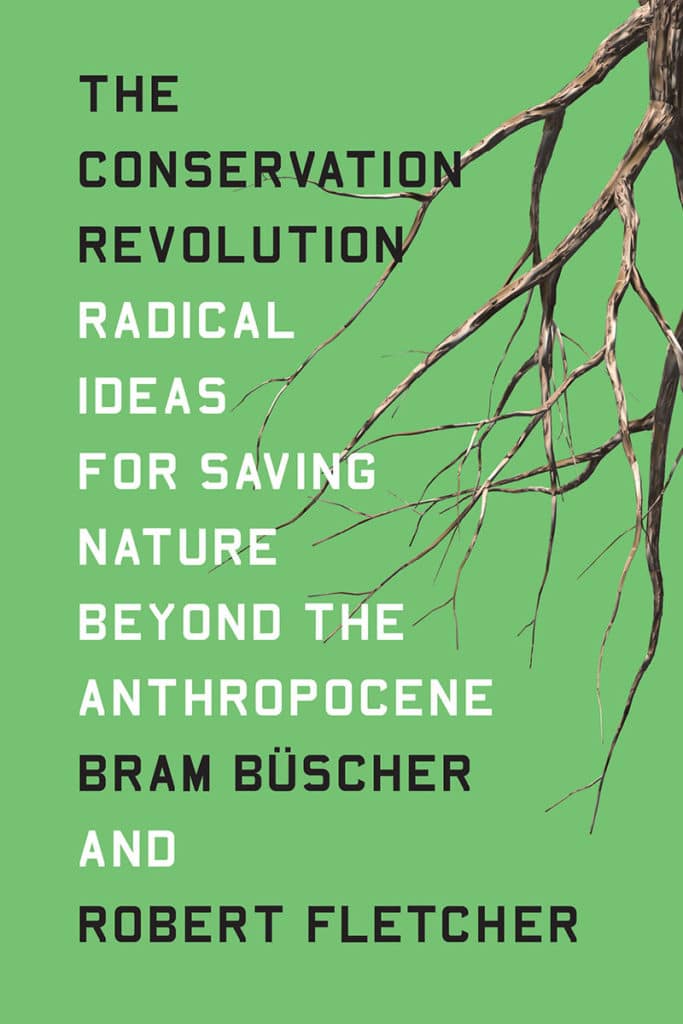
Mais pour nous, il est très important que cette discussion à l’échelle locale soit complétée par une analyse de la manière dont les contextes locaux s’inscrivent dans des processus politiques et économiques plus larges, et de la manière dont ceux-ci permettent ou empêchent une conservation conviviale sur le terrain. Par exemple, il ressort clairement de nos nombreux cas issus de CONVIVA qu’à l’origine des interactions négatives entre prédateurs humains et non-humains on retrouve le fait que les humains et les animaux se trouvent souvent coincés entre des zones de conservation dont les possibilités de subsistance sont limitées. De plus, les milieux environnants sont souvent dominés par des intérêts industriels qui ne profitent guère aux populations locales tout en rendant difficile pour les animaux – notamment les grands prédateurs – l’accès aux grands espaces dont ils ont besoin pour se déplacer et trouver leur nourriture. Il est donc essentiel de mettre en évidence ces contraintes structurelles qui pèsent sur la capacité de la conservation conviviale à fonctionner dans de tels espaces, quelle que soit la qualité de la planification et des intentions de départ, ainsi que la manière dont on peut transformer ces contraintes en supports constructifs, pour que la conservation conviviale se concrétise sur le terrain. De fait, une des principales difficultés est d’arriver à faire que les différentes facettes du pouvoir systémique se renforcent les unes les autres : rendre possible des relations locales conviviales entre les humains et les non-humains dans la vie quotidienne ; des structures de soutien régionales et des politiques macro-économiques qui fixent des limites et des lignes directrices claires, pour les connecter à d’autres domaines – comme l’agriculture, l’énergie, le logement, les politiques sociales, etc. – où des luttes similaires pour le changement structurel sont menées. Le défi est immense, mais il est nécessaire de s’y affronter si la conservation conviviale veut pouvoir s’épanouir en différents lieux. Mais cette situation est également porteuse d’espoir, dans la mesure où les luttes pour la conservation doivent toujours être liées à d’autres luttes apparentées dans d’autres domaines.
Vous proposez un changement radical de perspective : au lieu de faire reposer le poids de la conservation sur les classes inférieures et rurales vivant dans ou à proximité des zones de biodiversité, comme l’a fait et le fait encore la conservation dominante, il s’agirait de faire porter ce poids sur les classes supérieures, les grands propriétaires fonciers, etc., pour mieux cibler les causes et les acteurs de la destruction de la nature. Pouvez-vous nous expliciter ce renversement ? Comment peut-il s’opérer concrètement ?
C’est intéressant que tu poses cette question, car nous venons justement de publier un chapitre sur le sujet ! Nous conceptualisons en effet quatre classes principales en relation à la conservation : 1) les classes supérieures ; 2) les classes capitalistes propriétaires de terres ; 3) les classes moyennes et inférieures ; 4) les classes rurales inférieures. Les acteurs au sein de ces 4 catégories ont des types de responsabilités et de rôles (historiques et contemporains) différents dans et pour la conservation.
Les classes rurales inférieures (catégorie 4) sont composées des acteurs qui vivent souvent dans ou avec la biodiversité et qui dépendent (encore) de la terre pour leur subsistance, notamment dans les pays tropicaux. Elles sont souvent (perçus comme) pauvres et ce sont celles qui ont le moins contribué au problème de la perte de biodiversité (historiquement et actuellement), ainsi que celles qui ont le moins de pouvoir pour influencer la manière dont la conservation est mise en œuvre. Pourtant, ce sont celles qui sont le plus souvent la cible des interventions de la conservation et forcées ou « incitées » à changer leur mode de vie pour atteindre les objectifs de biodiversité.
La catégorie 3 est composée des classes moyennes et inférieures d’acteurs urbains, semi-urbains ou semi-ruraux du monde entier, qui ne dépendent pas directement de la terre pour leur subsistance et qui participent et dépendent des marchés du travail et de la consommation locaux et globaux. Par leur consommation et leur place dans les marchés mondiaux, elles influencent fortement la biodiversité en de nombreux endroits, mais ne font souvent pas partie des interventions de conservation ou ne sont pas spécifiquement ciblées par celles-ci, sauf en tant que donatrices potentielles.
Les acteurs de la catégorie 2 sont les classes capitalistes propriétaires de terres tels que les grands agriculteurs capitalistes et/ou les propriétaires fonciers pour l’agro-industrie. Ces classes sont fréquemment ciblées par la conservation, moins dans le cadre d’une conservation communautaire qu’en tant que partenaires dans un projet de conservation, ou par des actions et des formes de résistance de la part des « activistes ». Parce qu’en Indonésie, au Brésil, en Centre Afrique et ailleurs ces classes économiques sont les actrices d’un changement brutal d’affectation des terres – déforester pour faire de la monoculture ou de l’élevage – elles sont difficiles à enrôler dans des initiatives de conservation qui vont à l’encontre de leurs intérêts.

Nous trouvons enfin la catégorie 1, celle des classes supérieures mondiales, qui, d’un point de vue politique, économique, etc., sont à la tête du système capitaliste mondial. Il est intéressant de noter que ces élites sont souvent urbaines et rurales : elles possèdent en effet de multiples propriétés foncières, notamment dans les riches quartiers résidentiels des villes, pour se tenir proches des cercles de l’élite économique et politique ; mais elles possèdent aussi une deuxième, une troisième, voire plus, de propriétés dans des espaces ruraux, semi-ruraux et riches en biodiversité (par exemple des grands domaines et des réserves privées). Les élites des classes supérieures sont généralement recrutées comme pourvoyeuses de fonds, ou intégrées aux conseils d’administration des organisations conservationnistes ; mais elles ne sont que rarement ciblées par les initiatives de conservation visant à transformer les comportements ou les modes de vie. En effet, soit elles sont considérées comme inaccessibles (retranchées derrière des murs, des systèmes de sécurité, ou simplement en des lieux reculés) ; soit comme bienfaitrices de l’environnement, en raison de leur philanthrocapitalisme ou d’autres formes de charité liées à la conservation (via la privatisation de la nature, de certains parcs, etc.). Par conséquent, les classes supérieures jouent un double rôle contradictoire : elles sont à la tête du système qui pressurise intensément la biodiversité, et considérées comme intouchables ou comme des chantres de la conservation grâce à leurs dons massifs aux grandes causes de la conservation, aux ONG ou à d’autres organisations similaires.
L’idée générale est que les paradigmes de la conservation aujourd’hui dominants se concentrent essentiellement sur les classes rurales inférieures lorsqu’il s’agit de savoir qui doit changer de vie, alors qu’à l’inverse ceux qui ont le plus de pouvoir pour influencer les processus globaux et le plus gros impact écologique – les classes supérieures – sont souvent négligés voire ignorés par les conservationnistes – sinon pour courtiser leur argent – car ils sont soit trop éloignés, soit trop puissants.
La conservation conviviale doit changer cette situation et cibler les acteurs en fonction de leurs différentes responsabilités quant aux impacts directs et indirects de leurs actions sur la biodiversité, et en fonction du pouvoir que ces acteurs détiennent au sein des structures de l’accumulation capitaliste.
Quels mécanismes pourraient rendre cela opérationnel ?
Nous avons récemment proposé le concept de chaînes d’impact sur la biodiversité comme une méthodologie politique et comme un mécanisme de gouvernance pour étudier, cartographier et diriger les activités et les interventions économiques et politiques dans des biorégions particulières (à la fois urbaines et rurales, et tout ce qui se situe entre les deux), et pour connaître comment celles-ci sont reliées à des écosystèmes et à une biodiversité spécifiques qui fournissent les matières (premières) de ces activités. Compte tenu de la nature intégralement mondialisée des chaînes de valeur et d’impact actuelles, il est crucial de cartographier et d’étudier également les chaînes mondiales dans le but de mettre plus directement en lumière les implications politiques et les incidences sur la biodiversité des modes de vie des plus riches.
Il existe deux manières de procéder, déjà explorées en pratique par certaines organisations non-gouvernementales (comme le Rainforest Action Network et d’autres) : d’une part, partir d’une espèce ou d’un écosystème particulier et important et remonter aux acteurs principaux et aux secteurs économiques qui les impactent ; ou, d’autre part, partir de certains acteurs et secteurs économiques particuliers pour remonter vers leurs impacts cumulatifs sur différents écosystèmes et biodiversités. L’idée est de politiser les relations de destruction à travers le monde, plutôt que de blâmer uniquement les communautés locales vivant à proximité des zones de biodiversité. Sur cette base, la pression politique peut être exercée là où elle est le plus nécessaire, et nous pouvons aussi demander à d’autres acteurs éloignés des écosystèmes importants de changer leurs modes de vie pour sauver une biodiversité spécifique.
La convivialité, c’est-à-dire la relation de proximité et l’entrelacement radical avec la vie non-humaine, est-elle la solution dans un monde sur-dominé par les activités humaines, leur omniprésence et leur rythme frénétique ? Ne faut-il pas approcher positivement le retrait et le désentrelacement, et mettre en place des espaces de quiétude, où la vie sauvage se repose et se régénère ? Comment la conservation conviviale peut-elle faire place à ces animaux qui ne cohabitent pas nécessairement aisément avec nous ?
C’est exactement ici que le lien entre la conservation et l’économie politique devient si important : la raison pour laquelle il ne reste que si peu d’animaux sauvages s’explique par l’expansion continue du système économique et politique capitaliste qui, de manière structurelle, laisse trop peu de place pour exister aux animaux sauvages, tout en exacerbant le conflit entre eux et les populations humaines locales qui se disputent souvent les mêmes ressources rares et espaces restants. Donc, si nous défendons le fait de vivre avec la vie sauvage et les natures non-humaines (et d’apprendre à le faire), nous ne disons pas que cette cohabitation est identique et d’intensité égale partout dans le monde. En effet, si nous « fermons le robinet » de la pression croissante sur la biodiversité en limitant ou en abolissant la croissance capitaliste, nous sommes convaincus qu’un espace s’ouvrira, au sens propre et au sens figuré, pour de nouvelles relations à la nature, y compris de nouveaux espaces pour les natures sauvages. De même que l’expansion du capitalisme a structurellement diminué les espaces pour la vie sauvage, nous croyons que l’inverse est également vrai : à mesure que l’économie capitaliste se contracte grâce à une stratégie délibérée de décroissance, de nouveaux espaces pour la vie sauvage peuvent s’ouvrir. Cette hypothèse a d’ailleurs été confirmée par des travaux de modélisation réalisés par l’Agence néerlandaise d’évaluation de l’environnement, qui ont montré qu’en réalité la conservation conviviale « infléchit la courbe » de la perte de biodiversité globale plus rapidement qu’une stratégie néo-protectionniste de type Half Earth.

Par conséquent, nous ne sommes pas contre les espaces (ré)ensauvagés, mais nous pensons que se concentrer sur ceux-ci sans porter attention au contexte politico-économique plus large est une stratégie défaitiste, car les élites capitalistes ne cesseront jamais d’essayer de coloniser ces espaces si elles en ont besoin pour leur croissance. Le bref gouvernement Truss au Royaume-Uni [de septembre à octobre 2022, ndlr] illustre parfaitement cette situation, en forçant même les organisations traditionnelles de la conservation de la nature à ouvrir les yeux sur la réalité : le capitalisme ne connaît aucune frontière, et il continuera sans relâche à dévorer les ressources naturelles, quels qu’en soient les effets dévastateurs. Heureusement, les néo-protectionnistes seraient pleinement en accord avec nous ici, donc là n’est pas le problème. Le problème est que les conservationnistes les plus « pragmatiques » continuent de croire que l’on peut ignorer les questions de la croissance et du capitalisme et créer un changement de système – ce que nous appelons « la transformation sans transformation » – par des travaux de modélisations ou de vagues appels à des changements de « gouvernance ».
Le collectif Reprise de terres, dont je fais partie, s’est beaucoup intéressé aux conflits suscités par le réensauvagement en France. Malgré l’enthousiasme soulevé dans une large part du public, celui-ci a rencontré de vives critiques voire de l’hostilité de la part notamment du milieu paysan (voir le conflit entre l’ASPAS et la Confédération paysanne, sur l’acquisition de la « réserve de vie sauvage » dans le Vercors). Ici, comme ailleurs en Europe, les gens sont attachés aux faciès des paysages agricoles, à sa biodiversité spécifique et aux pratiques paysannes (élevages, maintien d’une vie sociale dans la montagne, économie de subsistance voire d’auto-subsistance…). On s’imagine le plus souvent la vie sauvage comme devant être cantonnée dans les parcs nationaux – quand ils sont acceptés. Il y a donc un problème d’acceptabilité par une partie significative des habitant·es. L’enjeu central que nous percevons vient aussi d’un conflit sur le foncier – qui possède la terre, comment et pour quel usage ? La critique est celle d’une acquisition foncière perçue comme injuste car menée par des acteurs puissants et étrangers aux lieux habités, qui ne veulent plus « mettre en valeur » les paysages, voire les abandonner à leur sort (c’est le spectre du retour de la friche improductive, source d’ennuis). Si ces critiques semblent en partie justifiées, nous pensons de notre côté qu’il ne faut pas pour autant renoncer au réensauvagement (ou à la « libre évolution »). L’heure est plutôt à inventer une autre forme de réensauvagement : alliée aux usages paysans soutenables, radicalement décroissante, et surtout associée aux habitants. Une piste de travail serait d’articuler sur un même territoire les « réserves de vie sauvage » (des zones sans exploitation ni usages extractifs) à des usages soutenables des terres, et que ces réserves soient portées par des habitant·es des territoires eux-mêmes (associés à des écologues, naturalistes, paysan·nes, usager·ères des lieux, etc.). Il nous semble donc nécessaire d’assumer la dimension inévitablement sociale et politique du réensauvagement des territoires, pour aller au-delà de ces tensions et blocages. Peut-on défendre le réensauvagement dans le cadre de la conservation conviviale, ou bien ces approches sont-elles définitivement contradictoires ?
Ces stratégies fonctionnent en fait très bien ensemble ! Comme nous l’avons dit, nous ne sommes pas contre le réensauvagement, mais nous pensons que cela doit se faire dans le cadre d’un mouvement plus vaste et structurel pour la transformation, incluant des éléments que Reprise de terres inclut également : construire des passerelles avec des formes agro-écologiques de pratiques agricoles et paysannes ; consulter et construire avec les gens habitants les zones à long terme ; conceptualiser et construire des espaces économiques et des institutions alternatifs qui ne dépendent pas de la croissance. Dans la littérature scientifique, on parle d’espaces interstitiels ou de stratégies qui peuvent fonctionner de manière relativement autonome au sein du capitalisme, mais qui pourraient aussi être les germes d’une transformation systémique, d’une part par la critique du système qui en émane, et d’autre part par la manière dont elles pourraient s’associer pour constituer d’un point de vue matériel un défi au système actuel.
Le cas que tu décris ici est aussi une belle illustration de l’importance de l’attention portée au contexte politico-économique général et à l’histoire pour cultiver une conservation conviviale. Nos propres recherches, notamment dans le réseau CONVIVA, montre clairement que dans de nombreux espaces ruraux où il existe un conflit entre les habitants et la vie sauvage le problème est en partie lié au fait que les populations rurales ressentent que leurs vies et leurs modes de vie ne sont pas très valorisés par la société. Donc, quand ces gens voient arriver les conservationnistes et consacrer beaucoup d’attention et de ressources à la préservation de la vie sauvage tout en les ignorant – ou pire, en les traitant comme une menace pour cette même vie sauvage – ceci renforce le sentiment d’être moins valorisés que les animaux. En ce sens, les perceptions négatives que les gens peuvent avoir de la vie sauvage locale sont souvent moins liées aux animaux eux-mêmes qu’à ce que ces derniers symbolisent quant à la valeur et à l’avenir de leurs propres modes de vie au sein de la société. Et si tel est le cas, la solution ne consiste pas (seulement) à se focaliser sur le contexte et les interactions directes entre les habitants et la vie sauvage, mais à apporter un soutien aux moyens de subsistance ruraux en général, de sorte que les gens puissent non seulement avoir accès à une vie digne dans les espaces qu’ils habitent, dans la mesure où un conflit mineur avec la vie sauvage (par exemple, la déprédation d’un troupeau) n’est pas considérée comme une menace existentielle, mais qu’ils puissent aussi se sentir soutenus et valorisés par la société au sens large, de sorte qu’ils ne perçoivent pas la conservation de la vie sauvage comme un indicateur de leur propre valeur relative inférieure.
Cet article est la version longue de l’entretien paru dans le Hors-série n°15 de Socialter, Ces terres qui se défendent (décembre 2022).

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Ce courant de recherches se situe à la croisée de l’anthropologie écologique, de la géographie, de l’économie politique marxiste, des études post- et décoloniales, etc., et étudie les relations entre les facteurs politiques, sociaux, économiques et les problèmes et changements environnementaux, portant une attention particulière aux relations de pouvoir.[↩]
- The Conservation Revolution: Radical ideas for saving nature beyond the Anthropocene, Verso Books, 2019[↩]
- Collection Mondes sauvages[↩]





