Extrait du livre La condition terrestre, habiter la Terre en communs (éditions du Seuil, collection Anthropocène, octobre 2022) par Sophie Gosselin et David gé Bartoli
Ce livre prend sa source en bord de Loire. Enfants d’exilé·e·s, nous y avons trouvé refuge. Son histoire est devenue la nôtre, sans pour autant effacer la mémoire de tous ces lieux qui, au cours de nos vies et de celles de nos ancêtres, nous ont constitués et continuent à nous habiter.
Ici comme ailleurs, les effets de la catastrophe écologique en cours se font sentir. Sécheresses, réchauffement climatique, irrégularités saisonnières, disparition d’espèces. Vivre auprès de Loire et s’en préoccuper, c’est suivre au quotidien les soubresauts d’une Terre blessée par les attaques d’un système économique, politique et civilisationnel qui s’est érigé en lui tournant le dos. Vivre auprès de Loire et l’écouter, c’est aussi se laisser traverser par les palpitations d’une Terre vivante et résistante, une Terre qui ne demande qu’à persister. Pas besoin de toutes les médiations technologiques inventées par nos sociétés modernisées en panne de relations pour écouter ce que, quotidiennement, Loire nous apporte comme nouvelles du monde. La sterne y revient, chaque année, de ses migrations lointaines en pays africain, et nous dit que là-bas aussi, et peut-être plus encore qu’ici, les choses vont mal. Mais il y a aussi tous ces êtres qui nous parlent par leur silence, parce que, comme l’anguille ou le saumon, ils ne reviennent plus ou de moins en moins.
C’est à toutes ces présences invisibles que ce livre est dédié. C’est pour elles et pour tous ceux qui désirent continuer à habiter la Terre que nous avons entrepris le voyage. Un voyage qui nous a menés dans différents lieux du monde. Ce que nous y avons cherché ? Des espoirs, des désirs, des combats et des réponses pour faire face à l’effondrement en cours. Mais surtout pour imaginer et accompagner l’émergence de mondes naissants.
Car le recommencement des mondes ne se fera pas sans nous. « Nous » renvoyant non pas seulement aux êtres humains mais à l’ensemble des existants avec lesquels ils partagent une commune condition : la condition terrestre. Celle-ci désigne la relation de co-appartenance des humains et des autres qu’humains1 à la Terre et leur capacité à faire advenir des mondes habitables. Or c’est bien la possibilité d’habiter la Terre qui se trouve aujourd’hui mise en péril du fait de la catastrophe écologique, de notre sortie de l’Holocène, ou encore de ce que la philosophe Isabelle Stengers a appelé « l’intrusion de Gaïa2 ». Par là, elle cherche à nommer un événement qui bouleverse les coordonnées qui jusqu’alors structuraient l’horizon de l’agir humain. Gaïa, nom grec de la déesse de la Terre, apparaît ici non comme la nature bienfaitrice des Anciens, ni comme la nature mécanisée et maîtrisable des Modernes, mais comme une puissance réagissant aux assauts répétés d’une civilisation mortifère et destructrice, une civilisation qui depuis des siècles organise le pillage de ses forces vitales transformées en ressources exploitables. Gaïa, c’est le nom donné à ce qui arrive lorsque la Terre se dérobe sous nos pieds, lorsque les ouragans se multiplient, lorsque les grands feux pullulent, lorsque les eaux montent, lorsque les terres deviennent stériles, lorsque les virus prolifèrent, lorsque l’air devient de moins en moins respirable. C’est le nom d’une expérience toute nouvelle pour les membres des sociétés modernisées : celle de leur irréductible vulnérabilité.
C’est en effet contre l’expérience de la vulnérabilité que se sont construits les imaginaires et les institutions politiques de l’époque moderne. Prenant leur source dans ce désir, érigé en mot d’ordre politique, de « se rendre comme maître et possesseur de la nature3 » ils ont, dans les théories du Contrat social, mis en scène une nature humaine violente et égoïste en prise avec l’instabilité d’une nature sauvage dont l’État, ce grand ordonnateur de la « machine » sociale, devait accomplir le dépassement en la soumettant à la rationalité des lois physiques et économiques. Ce fantasme a aussi nourri les projets révolutionnaires modernes et leur volonté de faire advenir un Homme nouveau, un Homme (et non une femme) libéré des « chaînes » de la nature, de ses contraintes et limites, capable de soumettre le réel aux lois de son seul esprit. Cet imaginaire de l’homme nouveau n’est pas étranger au désastre totalitaire et au mot d’ordre qui le sous-tend : « Tout est possible4. »
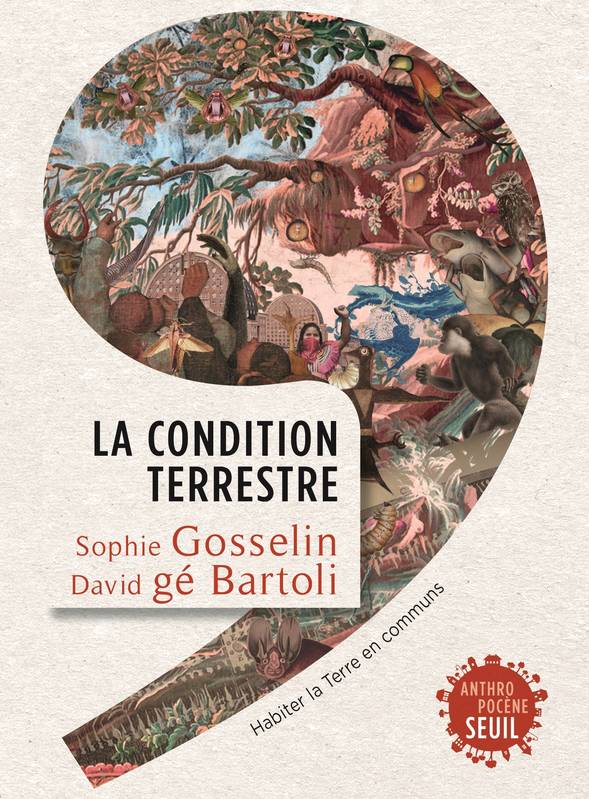
Dans La Condition de l’homme moderne5, la philosophe Hannah Arendt a tenté de répondre à ce fantasme de toute-puissance en resituant l’action humaine dans une condition mortelle indépassable, en la réinscrivant dans une temporalité se déclinant sous la forme de la vita activa articulant les trois activités humaines fondamentales : le travail, l’œuvre, l’action. Arendt avait vu la nécessité d’un ancrage terrestre de l’existence humaine et dénonçait dans l’idée d’une humanité projetée dans l’espace extraterrestre une nouvelle version de ce fantasme. Cependant, en allant chercher dans la polis grecque et dans la Cité romaine les seuls modèles d’une pensée politique capable de répondre à ce « Tout est possible », elle reconduisait le partage nature/culture constitutif de la modernité en séparant l’espace politique de celui où se déterminent et se jouent les conditions de l’habiter et les relations terrestres qu’il actualise. Arendt réservait ainsi au seul être humain la capacité d’initier, de commencer, d’inventer, assimilant la nature au règne du déterminisme, de la nécessité et de la répétition. Elle projetait ainsi dans le monde contemporain un ordre cosmologique définitivement révolu : celui d’un univers stable sur le fond duquel se dérouleraient les actions humaines. Cet univers n’est plus, et peut-être n’a-t-il jamais véritablement été. C’est ce que la crise écologique nous révèle, par l’entrée fracassante et irruptive des autres qu’humains dans l’arène politique moderne, et dans leur sillage, de tous les êtres qu’elle a dû soumettre ou exclure pour s’instituer : les femmes, les ouvriers, les paysans, les peuples indigènes, les racisés.
Cette irruption de la Terre et des existants terrestres dans l’espace politique est devenue ce à partir de quoi nous devons penser et réapprendre à faire communs en tenant compte des différentes manières d’habiter en mondes.
L’enjeu se situe donc bien au-delà d’une interpellation des décideurs politiques à prendre acte de la catastrophe en cours. Dire que le recommencement des mondes ne se fera pas sans « nous », c’est aussi dire qu’il ne suffira pas de s’en remettre au bon vouloir des gouvernants pour procéder à des réformes adaptées. Cela non pas seulement parce qu’ils ne seraient pas capables d’y répondre, soit parce qu’ils sont en prise avec des intérêts contradictoires (intérêt général contre intérêts privés), soit parce que les cadres politiques existants ne leur permettent pas d’y faire face, du fait de leur caractère anthropocentrique et de leur incapacité à se projeter dans des temps longs. Mais surtout parce que l’événement qui nous arrive remet en question les fondements mêmes de la politique moderne, la manière dont elle a pensé et mis en œuvre la capacité collective à décider des formes du vivre ensemble.
Le présupposé moderne de l’agir politique est qu’il est initié par et pour les êtres humains, qui affirment par là leur liberté, c’est-à-dire leur indépendance à l’égard de toute autorité transcendante, que celle-ci soit appelée Dieu ou Nature. Ce n’est plus dans un ordre naturel transcendant mais en eux-mêmes, dans leur conscience et raison, que les êtres humains trouveraient les lois et principes devant régir leurs comportements et définir les conditions de leur commune existence.
Que devient cette liberté lorsqu’elle se confronte à l’intrusion de Gaïa ? Que devient ce pouvoir d’initier lorsqu’il fait face à une puissance d’agir plus grande que lui, qui le précède et le conditionne : celle de la Terre ?
Penser l’agir politique depuis l’irruption de la Terre implique de reposer de manière profonde et radicale la question de l’autorité et de l’institution : qui est autorisé à décider et pour qui ? Depuis quel lieu, depuis quel temps, depuis quelles valeurs, s’autorise-t-on à décider, à agir ? Sur quoi reposent nos institutions ? Peut-on encore concevoir une action politique qui vaille à partir de la métaphysique du « gouvernement », cette prétention à connaître et agir à distance depuis un centre surplombant et hors sol ? Peut-on se contenter de réformer les institutions existantes ou faut-il au contraire donner naissance à de nouvelles institutions plus en phase avec la condition terrestre ? Quelles formes devraient alors prendre ces institutions ? Faut-il pour cela sacrifier la liberté humaine et reconnaître l’existence d’un ordre naturel auquel les êtres humains devraient se soumettre ? Ou faut-il au contraire voir dans la liberté humaine une modalité d’expression d’une puissance d’invention et de génération plus vaste à laquelle elles et ils participent au lieu de la dominer ?
Poser la question de l’institution revient à poser celle de notre capacité collective à inventer les cadres de notre agir commun et les formes de sa perpétuation dans le temps.
Or le risque serait de répondre à ces questions en érigeant Gaïa au statut de nouvelle figure surplombante et tutélaire, de nouvelle autorité transcendante à laquelle les existants terrestres devraient se soumettre. Ce risque se profile déjà dans la transformation des politiques gouvernementales d’inspiration néolibérales et autoritaires. Prenant acte de l’entrée dans l’Anthropocène, elles définissent les cadres d’une gouvernementalité planétaire s’appuyant sur une nouvelle forme de droit naturel pour imposer aux peuples de la Terre des normes génériques et universelles auxquelles ils devraient se conformer afin de maintenir les conditions globales d’une habitabilité planétaire. Ces politiques dessinent les contours d’un nouveau géopouvoir qui prolonge l’ambition moderne de maîtrise de la nature en la réduisant à sa version sécuritaire et économique, abandonnant définitivement l’exigence émancipatrice dont elle était porteuse au profit d’un appel à l’adaptation continue : géo-ingénierie, contrôle des populations via les technologies numériques, modification et artificialisation du vivant. Par là, elles ne dénient pas seulement la capacité des peuples à décider de leur destin et à se réinventer, mais aussi la multiplicité des manières de faire monde et d’habiter la Terre.
Si ces politiques de gouvernement remettent en question le partage entre Société et Nature qui, selon Bruno Latour, définit la « Constitution moderne6 », c’est-à-dire les partages ontologiques qui structurent et configurent les relations entre humains et autres qu’humains au cours de l’époque moderne, elles ne vont pas jusqu’à destituer le fantasme de toute-puissance qui la fonde. Celui-ci trouve actuellement une de ses expressions les plus paradigmatiques dans la foi sans bornes qu’elles accordent au développement technologique pour organiser, modifier voire « améliorer » le contrôle des forces terrestres au profit d’un développement économique inchangé. Ce fantasme révèle la pièce manquante de la « Constitution moderne » décrite par Latour qui, en mettant l’accent sur les modes de représentation (politique vs scientifique), maintient dans l’invisibilité ce sur quoi ils reposent. Entre la Société et la Nature, entre l’État et la Science, se tient le Capital, c’est-à-dire la mise au travail des corps au sein de l’économie pour la production et l’accumulation infinie de valeurs. Les luttes écologistes et terrestres qui aujourd’hui se développent un peu partout ne cessent de buter sur les obstacles que leur imposent les États et l’économie. Elles nous révèlent ainsi que ce qui structure la Constitution moderne consiste d’abord dans la mise en œuvre d’un pouvoir de capture sans précédent des forces terrestres (à la fois humaines et autres qu’humaines) : celui qu’organise le monstre bicéphale de l’État-Capital. L’État et le capitalisme se sont distribués l’exercice de ce pouvoir déléguant à l’un la prise en charge de l’esprit (les valeurs, l’autorité politique, les institutions représentatives censées porter la voix du peuple, les opinions des individus qui le composent) pendant que l’autre s’occupe de l’administration des corps (mis au travail au sein de l’économie). L’État, en tant que théâtre de la représentation opère ainsi la coupure permettant à la fois d’organiser la dépossession des êtres terrestres en livrant leur corps à l’économie et d’invisibiliser cette dépossession par la mise en scène, hors sol, d’un espace isonomique et abstrait.

C’est pourquoi la proposition consistant à transformer les institutions représentatives existantes pour y inclure les voix de ceux et celles qui en ont été exclus nous semble insuffisante pour répondre à la catastrophe écologique provoquée par le développement du capitalisme et l’aliénation radicale à laquelle il soumet l’ensemble des corps, humains et autres qu’humains7. Aussi, loin de remettre en question cette Constitution, le géopouvoir qui semble aujourd’hui prendre forme sous l’égide d’une Terre érigée au statut de figure tutélaire et transcendante (le Système-Terre), pourrait n’en être que la version réactualisée et intégrée, combinant dans un même dispositif de contrôle biotechnologique ces deux aspects que la modernité maintenait séparés. Ce faisant, il poursuit une logique de mise en gouvernement du monde fondée sur la distribution surplombante des places et des temps, sur l’hétéronomie des peuples et leur réduction au statut de populations administrables et exploitables. Ce qui caractérise une politique de gouvernement c’est de systématiser la relation dissymétrique qui fait que celui qui agit n’est jamais lui-même agi en retour et qu’il reste indemne des décisions qu’il prend et des catastrophes qu’il engendre. En ce sens, aucune politique de gouvernement ne peut être véritablement ni écologique ni terrestre. Ce n’est donc pas seulement l’opposition entre nature et culture qu’il s’agit de remettre en question mais aussi et surtout la posture gouvernementale qui structure la conception moderne d’un espace politique adossé à l’État.
Face à ce nouveau pouvoir, les résistances se multiplient déjà qui revendiquent d’autres manières de répondre à la catastrophe écologique. En nous mettant à leur écoute, nous avons tenté de formuler ou de thématiser certains des questionnements et problèmes qui nous semblent s’y poser. Comment poursuivre l’ambition démocratique et émancipatrice d’une certaine modernité tout en tenant compte de l’intrusion de Gaïa ? Comment penser la liberté humaine non plus comme l’affirmation d’une capacité à initier exclusive et opposée à la nature, mais comme un mode d’expression de la puissance génératrice de la Terre8, comme une puissance co-existant et interagissant avec d’autres puissances, celles des autres qu’humains, pour créer les conditions d’une commune habitation terrestre ? Comment mettre en œuvre des processus institutionnels qui, plutôt que de renforcer le pouvoir des États et de l’économie en faisant appel à une nouvelle autorité transcendante, laissent vivre la pluralité des manières de faire monde et d’habiter la Terre ? Quelles institutions seraient les mieux à même d’accompagner les devenirs terrestres en cours et de contribuer à l’émergence de peuples terrestres qui incluent humains et autres qu’humains ?
Ces questions prennent forme à l’aune d’un ensemble de déplacements et de reconfigurations institutionnelles qui ont émergé au début du xxie siècle et qui dessinent des manières de faire communauté non plus depuis les forces productives humaines mais depuis la Terre et les différents mondes qui la composent. C’est, par exemple, la reconnaissance en Bolivie et en Équateur des droits de la Terre-mère ou encore la reconnaissance, en Nouvelle-Zélande, de la rivière Whanganui comme personne juridique. Mais c’est aussi la multiplication de luttes d’émancipation pour réhabiter les milieux de vie en décolonisant les corps et les terres. Au sein des luttes territoriales, s’inventent des « Assemblées des usages9 » où s’expriment d’autres manières de se relier aux milieux de vie, qui en passent par une attention portée aux gestes, aux pratiques et aux coutumes, c’est-à-dire par de nouvelles manières de cohabiter avec les autres qu’humains en renouant le lien à la Terre.
En parallèle de ces processus, nous assistons, d’une manière plus générale, à un désir d’émancipation des corps à travers la remise en question des frontières de genre et d’espèce. Les êtres humains se découvrent constitués par des relations et des identités multiples qui font bouger les catégorisations qui jusqu’alors structuraient l’espace social et politique. Ils ne s’opposent plus aux autres qu’humains comme des sujets à des objets mais les considèrent comme des sujets participant activement à la constitution d’un milieu de vie partagé. Ils se sentent liés à eux par l’expérience d’une continuité vitale et affective que nous qualifions d’« animique ». Les contours de l’espace politique se réinventent donc depuis les corps et leur cohabitation située. Le vivre ensemble prend forme depuis l’habiter, depuis des relations de co-affection reposant sur la confiance forgée au quotidien, depuis l’incorporation subjective et la réactivation du lien animique qui en émerge. Il ne peut plus se concevoir comme le résultat d’un pur acte de volonté, à l’image du théâtre de la représentation de l’espace public.
À la démocratie représentative des institutions politiques modernes, se substituent ainsi, progressivement, des espaces de conflictualité agonistique directement en lien avec des milieux de vie et des manières de l’habiter. Nous qualifions d’« agone » les processus et les scènes d’une conflictualité politique qui se déploient depuis et en lien à l’habiter, et à l’élaboration desquels les exclus et les invisibilisés de la démocratie représentative peuvent directement prendre part en confrontant et échangeant leurs perspectives et leurs manières de faire monde. Les perspectives ne sont pas des points de vue individuels mais des manières de faire monde et de l’habiter. Ainsi l’agone ouvre la pratique de la démocratie directe à des formes d’expression qui n’en passent pas par la seule parole. Grâce à elle, les communautés d’habitants forgent des alliances pour inventer des institutions et constituer des peuples terrestres. La politique devient cosmopolitique puisqu’il s’agit de créer, collectivement, les conditions d’une cohabitation des mondes : entre les mondes humains mais aussi avec les mondes des autres qu’humains.
C’est donc depuis l’habiter que s’inventeront les institutions terrestres permettant aux habitants de réinventer les mondes et de les personnifier, et de dépasser l’horizon mortifère de l’État-Capital. C’est depuis l’habiter et l’ensemble des relations multispécifiques qui s’y nouent qu’émergeront des devenirs terrestres capables de faire advenir les peuples : peuples-rivières, peuples-montagnes, peuples-déserts, peuples-archipels… De même que se redessinent les contours de l’espace politique, de même en va-t-il des peuples qui sortiront de ces devenirs terrestres dont les configurations ne répondront plus aux formations nationales existantes. C’est pourquoi les institutions terrestres qu’ils portent et qui les soutiennent ne peuvent résulter d’une simple réforme des institutions héritées de la modernité mais se développeront d’abord en parallèle avec elles, depuis l’expérience partagée de corps-territoires et des perspectives qui s’y enchevêtrent, pouvant parfois s’y opposer, exigeant petit à petit un partage de la souveraineté.

Il ne faudrait pas confondre ce partage de la souveraineté avec la division des pouvoirs au sein d’un État dont l’unité de principe ne serait jamais questionnée. Il s’agit d’aller au-delà, de diviser l’unité de l’État lui-même, en imaginant les contours d’un triumvirat qui tienne compte des différents niveaux relationnels mis en jeu dans l’habiter : les relations entre humains (cultures, coutumes, histoires), les relations multispécifiques, mais aussi celles en lien avec les différentes temporalités terrestres.
Ce n’est donc plus de la seule conscience et raison humaine que les institutions tiendront leur autorité et légitimité mais de leur capacité à renouveler les cycles et formes de vie terrestres en tenant compte des temps longs de la Terre. Car ce n’est que depuis les temps ancestraux de la géo-mémoire que les mondes peuvent se renouveler. Si cette invention institutionnelle hérite en quelque manière des révolutions politiques qui ont marqué la modernité, ce ne sera donc pas sous la forme d’une création ex nihilo s’érigeant contre le passé, mais au contraire en s’inscrivant dans les dynamiques des révolutions terrestres ouvertes par le Géogène : ce temps des recommencements d’une Terre composée de plusieurs mondes, d’une Terre-mondes.
L’ambition de cet ouvrage est de prendre acte des transformations à l’œuvre qui nous engagent à devenir terrestres et de porter ainsi au grand jour la possibilité sans précédent que nous avons, humains et autres qu’humains, de redessiner de fond en comble l’espace politique tel que les modernes l’ont cristallisé en le coupant des milieux de vie, excluant par là tous ceux et toutes celles pour qui l’existence ne peut se concevoir de manière détachée de la Terre. La dynamique de l’ouvrage tente d’esquisser les nouvelles lignes d’une cosmopolitique à venir, en cours d’élaboration, qui tienne compte des critiques décoloniales et écoféministes. Elle implique de sortir des institutions relatives à la condition de l’homme moderne en ré-inventant d’autres modalités d’agir, d’autres manières de se percevoir, de se sentir appartenir à une communauté de destin, portée par des êtres et des relations multispécifiques, par des identités partagées, par des personnes relationnelles, et nouant les temps historiques aux temps géologiques et mythographiques du Géogène : les temps de notre condition terrestre.
Notes
- Nous préférons l’expression « autres qu’humains » à celle de « non humains », conception qui pense encore les existences terrestres depuis l’axe anthropocentrique.[↩]
- Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, résister à la barbarie qui vient, Paris, La Découverte, 2013.[↩]
- René Descartes, Discours de la Méthode, Paris, Flammarion, 1966.[↩]
- Paul Ricœur, Préface à La Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann Lévy, 1983[↩]
- Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, Paris, CalmannLévy, 1983[↩]
- Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 2006.[↩]
- Silvia Federici, Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Montreuil et Paris, Éditions Entremonde et Éditions Senonevero, 2014 ; Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital, Londres, Verso, 2015.[↩]
- Puissance de génération à laquelle, dans un livre précédent, nous avons donné le nom de « naturer » pour mettre l’accent sur le caractère actif et dynamique de ce que les modernes appelaient « la nature ». Cf. David gé Bartoli et Sophie Gosselin, Le toucher du monde, techniques du naturer, éditions Dehors, 2019.[↩]
- Expression utilisée à la Zad de Notre-Dames-des-Landes pour qualifier l’instance de coordination et de dialogue des habitants de la Zad.[↩]








