« Homo sapiens parcourt la terre depuis environ 300.000 ans. Il a probablement toujours rêvé de « maîtriser » la nature. »
Association française transhumaniste
Repousser continuellement nos limites afin de nous conformer à un monde en constante accélération, tel est l’un des traits marquants des sociétés capitalistes contemporaines1. Des milieux de travail à notre vie quotidienne, l’injonction à « s’adapter2 » se matérialise chaque jour un peu plus dans une culture de l’amélioration, de l’optimisation et du dépassement de soi qui s’immisce dans les moindres recoins de nos existences. « La promesse d’optimisation de soi, observent les sociologues Sébastien Dalgalarrondo et Tristan Fournier, a colonisé notre quotidien. Les individus sont désormais enjoints d’optimiser leur corps, leur alimentation, leur sexualité, leur sommeil, leurs performances physiologiques et cognitives, leur vie biologique et sociale.3 » Omniprésente, cette injonction à constamment maximiser nos performances trouve ces dernières années son expression idéologique la plus radicale et son plus ardent défenseur avec le transhumanisme, mouvement idéologique qui défend et promeut l’amélioration radicale de l’être humain et de ses capacités – physiques, intellectuelles aussi bien qu’émotionnelles – grâce aux avancées technoscientifiques et biomédicales. Longtemps confinés à un petit cercle d’ingénieurs et de futurologues issus de la part la plus technophile de la contre-culture américaine4, le mouvement et ses promesses technologiques d’un humain affranchi de toutes les limites biologiques connaissent depuis plusieurs années une popularité forte.
Appuyés par des centres universitaires importants, tel le Future of Humanity Institute de l’Université d’Oxford, ou des think tanks influents, comme l’Université de la Singularité en Californie, et soutenu par de grandes entreprises qui, de Google à Amazon, investissent et capitalisent abondamment sur les promesses d’augmentation et de vie éternelle, le transhumanisme et l’aspiration à augmenter l’humain s’imposent comme une réalité idéologique, politique autant qu’économique incontournable de notre temps. Regroupant une diversité d’acteurs, parmi lesquels des ingénieurs, des philosophes, des bioéthiciens, des entrepreneurs ou plus largement des membres de la société civile, le mouvement fédère un nombre croissant d’individus, d’associations et même de partis politiques qui militent pour faire de l’augmentation humaine un droit fondamental, voire une obligation morale qui devrait incomber aux collectivités5. « Designer notre propre évolution »; « mettre à mort la mort » ; « devenir plus qu’humain » ; se rendre « maîtres et possesseurs de la vie6 », les qualificatifs et superlatifs abondent pour décrire ce moment historique inédit que nous serions en train de vivre et les opportunités inouïes qui se présenteraient aux êtres humains. Pour les représentants de l’Association française transhumaniste française Didier Coeurnelle et Marc Roux, il ne fait plus aucun doute : « L’humanité se trouve désormais en mesure d’orienter volontairement sa propre évolution biologique7. »
S’il importe de marquer une distance critique à l’égard des promesses mirobolantes qui accompagnent le mouvement, il apparaît tout aussi essentiel de ne pas minorer la puissance évocatrice et performative de cet imaginaire d’un humain augmenté par les technosciences et ce qu’il dit de nos sociétés capitalistes avancées. Centré sur l’idée de changer l’être humain, jugé déficient, plutôt que sur celle de remettre en cause notre modèle de société, le transhumanisme nourrit une profonde négation du politique8. Mais l’ambition d’une « bio-ingénierie de l’être humain » défendue par ses adeptes met aussi en pleine lumière la conception anthropocentrique, artificialiste et prométhéenne de l’émancipation humaine qui anime le mouvement et plus largement le modèle de société capitaliste qui le sous-tend. Inciter au remodelage technoscientifique et biomédical complet des corps et des vies, dans leur matérialité biologique même, afin d’adapter les individus aux flux globalisés de l’accélération et à la destruction de l’environnement que ces derniers provoquent, constitue le nouvel horizon biopolitique du capitalisme. Avec le transhumanisme, il n’est pas tant question de régénérer l’être humain que de perpétuer un système. Une fuite en avant techniciste qui se révèle profondément désastreuse tant politiquement qu’écologiquement.
1. Le transhumanisme et l’aspiration à augmenter l’être humain et ses performances
Né à la fin des années 1980 aux États-Unis, le transhumanisme désigne aujourd’hui un mouvement international dont les adeptes ont en commun de vouloir repousser techniquement toutes les limites humaines afin d’accéder ultimement à un nouveau stade de notre évolution. Toute la pensée transhumaniste promeut et repose à vrai dire sur une véritable conception extra-terrestre de l’être humain ; conception à travers laquelle nos limites, notre matérialité, notre corporéité, notre fragilité, notre vulnérabilité, notre finitude, c’est-à-dire en définitive tout ce qui tient à notre appartenance au monde vivant, au fait que nous soyons des êtres vivants, sont appréhendés comme autant d’obstacles et de freins à notre épanouissement. Cette dénégation des limites et cette volonté anthropocentrique de s’arracher au monde et à l’ensemble de nos dépendances biologiques constituent depuis ses débuts un leitmotiv majeur du mouvement. L’un des pionniers du transhumanisme, le futurologue Fereidoun M. Esfandiary, écrivait déjà en 1989 dans son ouvrage intitulé « Êtes-vous un transhumain ? » : « Quelles limites ? Les seules limites sont dans l’imagination de certaines personnes. Il est ridicule de parler de limites à ce moment même de notre évolution, alors que nous sommes en pleine expansion dans un univers sans limites de ressources illimitées – espace illimité – temps illimité – potentiels illimités – croissance illimitée9. »
C’est également cet appel à s’émanciper de toutes les limites vivantes que l’on retrouve parmi les principes centraux de l’extropianisme, première association officielle transhumaniste fondée à la fin des années 1980 par le philosophe anglais Max More, aujourd’hui à la tête de l’entreprise de cryogénie Alcor basée en Arizona, qui propose la congélation des corps humains dans l’espoir de pouvoir un jour les ressusciter :
« Nous n’acceptons pas les aspects indésirables de la condition humaine. Nous mettons en question les limitations naturelles et traditionnelles de nos possibilités. Nous défendons l’utilisation de la science et de la technologie pour éradiquer les contraintes pesant sur la durée de vie, l’intelligence, la vitalité personnelle et la liberté. Nous reconnaissons l’absurdité qu’il y a à se contenter d’accepter humblement les limites « naturelles » de nos vies dans le temps. Nous prévoyons que la vie s’étendra au-delà des confins de la Terre — le berceau de l’intelligence humaine et transhumaine — pour habiter le cosmos10. »
Une aspiration à repousser toutes les limites humaines et vivantes qui nourrit l’ambition aujourd’hui communément partagée par les transhumanistes d’aller « au-delà de l’humain ». « Les transhumanistes espèrent qu’en utilisant de manière responsable la science, la technologie et d’autres moyens rationnels, nous parviendrons un jour à devenir des êtres post-humains dotés de capacités bien plus importantes que celles des êtres humains actuels11 », pouvait ainsi déclarer en 2003 le philosophe Nick Bostrom, figure importante du mouvement, à la tête aujourd’hui de l’Institut pour le Futur de l’Humanité à l’Université d’Oxford. Une ambition qui culmine dans la volonté de se délivrer de la mort en tant que telle, de s’émanciper de notre propre finitude, qui constitue le point d’horizon ultime du mouvement. Comme l’écrit le transhumaniste français Marc Roux :
« L’une des barrières mentales qu’il peut sembler la plus difficile à renverser est celle de l’idée que l’inéluctabilité d’une mort attendue tout au plus après environ un siècle de vie est une chose normale et bonne. Le transhumanisme propose de se libérer de cette « gestion de la terreur » que nous impose la perspective de notre mort et envisage une amortalité, soit une vie affranchie de l’essentiel des maladies et du vieillissement, susceptible d’atteindre plusieurs siècles et théoriquement d’une durée de vie indéfinie12. »
Reposant sur l’ambition d’améliorer l’être humain et ses performances, aussi bien physiques que psychiques, le transhumanisme et la culture contemporaine de l’optimisation de soi s’inscrivent dans une filiation historique déterminante avec l’« imaginaire de la maîtrise » propre à la civilisation moderne. « Reculer les bornes de l’Empire Humain en vue de réaliser toutes les choses possibles » comme le disait déjà le scientifique et philosophe anglais Francis Bacon au XVIIe siècle, « Oser revoir et corriger l’œuvre de la nature » ou encore se soustraire à toutes les limites naturelles y compris celle de la finitude humaine, comme nous y inviteront Condorcet et Cabanis un siècle plus tard, voilà autant de perspectives constitutives de l’héritage moderne dans lequel le transhumanisme puise aujourd’hui indéniablement ses racines13. Mais le transhumanisme marque tout en même temps une rupture avec la modernité occidentale. Loin d’être univoque, comme a pu le montrer le philosophe Cornélius Castoriadis, la modernité met en effet en tension deux formes distinctes d’imaginaires : d’une part l’imaginaire de la maîtrise technoscientifique, intimement lié au monde capitaliste ; d’autre part l’imaginaire de l’autonomie, qui fonde l’idéal démocratique et notre capacité politique à agir réflexivement sur le monde afin de nous donner, individuellement et collectivement, nos propres normes14. S’il s’inscrit dans l’héritage moderne de la maîtrise qu’il pousse à son paroxysme, le transhumanisme marque le renversement complet de cet imaginaire de l’autonomie.
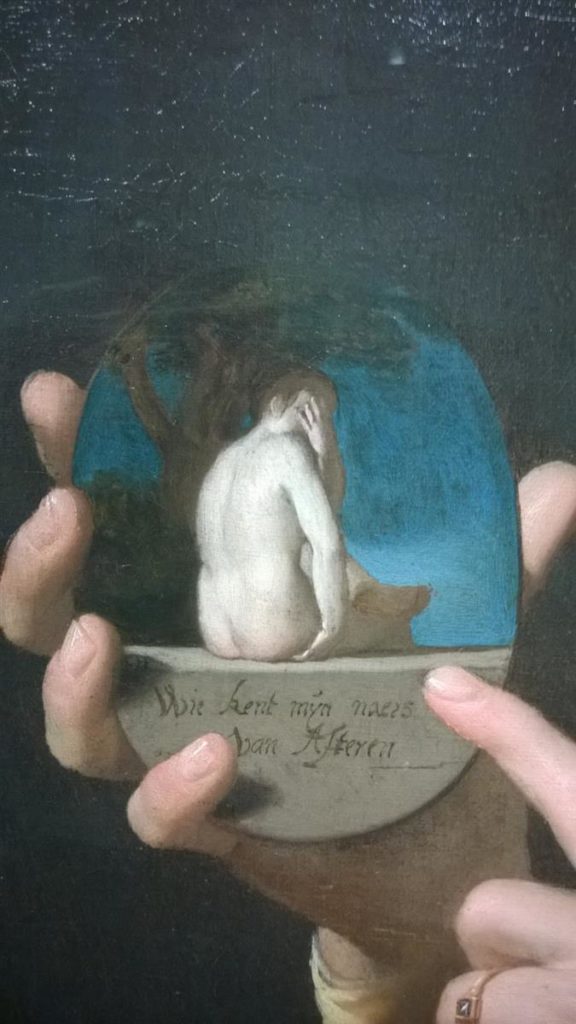
Délaissant l’horizon politique des Lumières, le transhumanisme promeut une conception essentiellement adaptative de la perfectibilité humaine, centrée sur l’idée de modifier techniquement l’humain pour en optimiser les capacités. En cela, si l’idéologie transhumaniste est intimement liée à l’imaginaire de la maîtrise moderne, elle s’inscrit également dans une filiation idéologique déterminante avec le néolibéralisme et la reconfiguration profonde du paysage culturel et biopolitique qui s’opère au tournant du 20ème siècle au sein des sociétés capitalistes occidentales. Améliorer techniquement l’être humain, jugé profondément déficient et incapable de s’adapter « naturellement » aux flux du capitalisme industriel mondialisé, tel est de fait le cap fixé par les penseurs néolibéraux et notamment l’un des pères fondateurs du courant néolibéral, le philosophe Walter Lippmann, ainsi que le rappelle la philosophe Barbara Stiegler15. Si le droit et l’éducation sont des dimensions centrales du nouveau dispositif néolibéral visant à recadrer la conduite des individus, Lippmann appelait toutefois de ses vœux un gouvernement beaucoup plus global devant toucher à la condition biologique même de l’espèce humaine : un fitness technologique de l’espèce humaine pour la réajuster à son environnement capitaliste. « L’économie, écrivait ainsi Lippmann, exige non seulement que la qualité de la souche humaine, l’équipement des hommes pour la vie, soit maintenue à un niveau minimum d’efficacité, mais que cette qualité soit progressivement améliorée16. » Assurément, l’éthique néolibérale est au fondement de l’esprit du transhumanisme.
Mais plus encore, le transhumanisme est indissociable du nouvel âge biopolitique auquel la pensée néolibérale a progressivement donné naissance durant la seconde moitié du XXe. En phase avec les avancées technoscientifiques et biomédicales, ainsi que l’a très bien montré le sociologue Nikolas Rose, une nouvelle forme de biopouvoir s’est instituée, incitant tout un chacun à appréhender son corps et sa vie comme autant de ressources à optimiser via les biotechnologies. Contrairement aux formes classiques du biopouvoir, celle-ci, précise-t-il, « n’est ni délimitée par les pôles de la maladie et de la mort, ni axée sur l’élimination de la pathologie pour protéger le destin de la nation. Elle s’intéresse plutôt à nos capacités croissantes de contrôler, de gérer, d’organiser, de remodeler et de moduler les capacités vitales des êtres humains en tant que créatures vivantes17. » Incluant « le contrôle de la procréation, la performance sexuelle, le modelage de l’apparence physique, les capacités cognitives et la lutte contre le vieillissement18 », la figure de « l’humain augmenté », investissant dans son corps et sa santé comme des capitaux à maximiser, représente l’idéal-type de cette nouvelle forme de biopouvoir. Marquant l’avènement d’« un monde où tous les corps, toutes les vies individuelles se transforment en matière première au service de l’efficacité productive19 », le transhumanisme et la popularité de ses idéaux sont en définitive indissociables de l’avènement d’un biocapitalisme qui se caractérise par une appropriation toujours plus poussée de nos ressources physiques et psychiques.
2. Changer l’être humain pour mieux ne pas changer de monde
Vu sous cet angle, le transhumanisme constitue tout sauf une révolution, ainsi qu’on le présente pourtant si souvent20. Parachevant l’imaginaire moderne de la maîtrise et s’inscrivant dans le cadre de la redéfinition du capitalisme et de l’appropriation biopolitique des corps et de la vie qui l’accompagne au tournant du 20ème siècle, le mouvement et son aspiration à augmenter l’être humain traduisent au contraire une profonde remise en cause du politique et de notre capacité à agir réflexivement sur le monde. Avec le transhumanisme, et cela inclut la branche du mouvement qui se revendique ces dernières années d’une approche plus sociale et progressiste, il n’est pas tant question de transformer politiquement notre monde – en l’occurrence, le monde capitaliste industriel et ses valeurs centrales de croissance et de productivité illimitées – que d’y conformer l’être humain et la vie en soi par les technosciences. Changer l’être humain pour mieux ne pas changer de monde constitue le ressort politique profond du mouvement. Ceci est particulièrement frappant lorsque l’on aborde la question écologique à laquelle s’intéressent un certain nombre de transhumanistes ces dernières années.
L’une des principales revendications portées par le transhumanisme depuis les débuts du mouvement est de faire reculer, voire d’abolir la mort en tant que telle. Vivre plus longtemps en bonne santé, dans une perspective qui ne vise pas tant l’immortalité que l’amortalité – c’est-à-dire la possibilité hautement spéculative de ne plus mourir du vieillissement, les transhumanistes ne pouvant exclure celle de mourir par un accident –, constitue l’ultime horizon transhumaniste. Mais encore faut-il que l’avenir de la planète soit garanti pour que les transhumanistes puissent jouir de cette vie illimitée : « Une vie beaucoup plus longue en bonne santé, premier objectif des techno-progressistes, n’est possible que dans un environnement durablement viable21 », constatent amèrement Didier Coeurnelle et Marc Roux. C’est précisément pour répondre à cet objectif que plusieurs penseurs transhumanistes s’attellent ces dernières années à promouvoir une forme de transhumanisme soutenable ou d’éco-transhumanisme22. Les solutions qu’ils envisagent pour répondre à la crise écologique sont néanmoins symptomatiques du renoncement social et politique qui structure fondamentalement le mouvement. Il n’est en effet pour eux pas tant question d’interroger le bien-fondé de la civilisation industrielle capitaliste que d’adapter techniquement l’humain à la dévastation contemporaine de l’environnement23.
Dans leur ouvrage intitulé « Technoprog. Le transhumanisme au service du progrès social », les représentants de l’Association transhumaniste française Didier Coeurnelle et Marc Roux mettent ainsi de l’avant la nécessité d’intervenir techniquement sur la psychologie humaine afin d’en neutraliser les tendances supposément les plus néfastes :
« Un des espoirs est que la capacité d’intervention sur le cerveau nous permettra un jour d’auto-réguler – chacun en toute liberté et conscience – nos niveaux de sensibilité morale. Il s’agira par exemple d’abaisser le besoin de sécurité matérielle qui peut pousser aux réflexes de consommation et d’accumulation. L’objectif de frugalité mis en avant par les objecteurs de croissance peut être favorisé en modifiant les tendances profondes de la psychologie humaine24. »
Adhérant entièrement à la thèse de l’homo oeconomicus, en vertu de laquelle l’être humain serait par nature un être égoïste et rationnel, les deux auteurs parviennent ainsi à la conclusion que l’augmentation technologique se présente comme l’unique perspective pouvant répondre aux limites d’un être par essence diminué et imparfait. À travers ce raisonnement entièrement réductionniste et biologisant, seule l’intervention biotechnologique peut de fait contribuer à corriger ce qui se présente d’emblée comme une déviance instinctuelle humaine. Faisant fi de tout ce que l’on sait anthropologiquement des sociétés premières, sociétés frugales dans lesquelles l’immense majorité de l’humanité a vécue, les deux auteurs vont même jusqu’à envisager des modifications biotechnologiques du corps humain pour encourager l’avènement d’un être humain qui serait biologiquement moins gourmand et donc moins polluant : « L’idée que les modifications progressives de la biologie de l’humain pourraient nous conduire à disposer de corps énergiquement plus efficaces, moins gourmands en eau ou en calories est encore très spéculative, mais elle pourrait être réalisable un jour25. »
Loin d’être isolée, cette idée de procéder à une réingénierie technoscientifique du corps humain pour faire face au défi climatique est soutenue par plusieurs chercheurs transhumanistes. Dans un article publié en 2012, intitulé L’ingénierie humaine et le changement climatique26, les chercheurs Matthew Liao (philosophe en bioéthique et directeur du Center of Bioethics de l’Université de New York), Anders Sandberg (futurologue et membre du Future of Humanity Institute à l’University d’Oxford) ainsi que Rebecca Roache (philosophe à l’Université de Londres), envisagent ainsi le plus sérieusement du monde de recourir à des formes de modifications technoscientifiques de l’espèce humaine afin de réduire son empreinte écologique. L’idée n’est rien moins que de donner naissance à des êtres génétiquement éco-techno-responsables :
« Dans cet article, écrivent les auteurs, nous explorons un nouveau type de solution au problème du changement climatique. Nous appelons ce genre de solution l’ingénierie humaine. Cela implique la modification biomédicale des humains afin de diminuer leur impact sur le changement climatique. Nous ferons valoir que l’ingénierie humaine offre potentiellement un moyen efficace de lutter contre le changement climatique27. »
Parmi ces modifications, les auteurs envisagent aussi bien l’usage de la pharmacologie pour rendre les êtres humains intolérants à la viande, sachant que l’élevage industriel constitue l’un des facteurs importants de la pollution, que la production génétique d’êtres humains de petite taille :
Un autre exemple frappant d’ingénierie humaine est la possibilité de rendre les humains plus petits. Les empreintes écologiques humaines sont en partie corrélées avec notre taille. Nous avons besoin d’une certaine quantité de nourriture et de nutriments pour maintenir chaque kilogramme de masse corporelle. Cela signifie que, toutes choses étant égales par ailleurs, plus une personne est forte, plus il lui faut de la nourriture et de l’énergie28.
Réduire la taille des êtres humains pour sauver la planète, voilà bien résumée, jusqu’à la caricature, non seulement la négation du politique sur laquelle prospère le mouvement, mais le lien étroit qu’il entretient avec le techno-bio-capitalisme.

En phase avec le nouvel esprit biotechnologique du capitalisme, le transhumanisme aboutit en somme à la pire lecture qui soit de l’Anthropocène, cette période où l’être humain et ses activités s’imposent comme une force géologique déséquilibrant l’ensemble de notre biosphère. Ne s’attaquant jamais aux causes sociales et politiques de la crise écologique, le mouvement nourrit une fuite en avant techniciste qui dédouane la civilisation capitaliste technoscientifique et son idéologie de la croissance infinie de toute responsabilité. De ce point de vue, le transhumanisme et ses projets de bio-ingénierie de l’être humain ne représentent jamais que l’autre face prométhéenne des projets de géo-ingénierie de la planète portés notamment par le courant de l’écomodernisme29. L’éditeur américain Ronald Bailey, l’un des partisans de l’écomodernisme mais aussi des thèses transhumanistes, pouvait ainsi écrire dans un article du New York Times, significativement intitulé « Mieux vaut être puissant que ne pas l’être » : « Avec le temps, nous ne pouvons qu’être de meilleurs dieux gardiens de la Terre30 »
3. Un fantasme au service de la dépossession politique et de la dégradation écologique
Si le projet transhumaniste d’augmenter l’être humain et ses performances par l’usage des biotechnologies doit être critiqué, ce n’est pas parce qu’il pervertirait une soi-disant « nature humaine », comme le soutiennent ces dernières années dans une perspective essentialiste, moralisante et réactionnaire un certain nombre de penseurs31. L’entreprise de domination et d’arrachement à l’humain et au monde prônée par le transhumanisme est en réalité problématique parce qu’elle s’avère profondément néfaste tant politiquement qu’écologiquement. Politiquement, parce qu’elle nourrit une conception technocentrée de l’émancipation humaine qui concourt à tout sauf à notre autonomie politique. Il faut insister sur ce point. L’idéal de la « délivrance32 » technoscientifique sur lequel s’appuie le mouvement transhumaniste ne conduit pas à repousser et supprimer toutes ces limites, humaines et non humaines, auxquelles il prétend nous affranchir. C’est un point sur lequel nombre de penseurs critiques de la technique n’ont eu de cesse de nous alerter33. Les limites naturelles auxquelles on prétend s’arracher grâce aux technosciences ne sont pas supprimées, elles ne font qu’être reconduites, transférées et prises en charge par tout un « macrosystème technique » dont nous devenons en définitive très dépendants et sur lequel nous avons finalement peu de prise politiquement.
Les conquêtes technoscientifiques se payent au prix de notre autonomie politique. Elles nourrissent l’avènement d’une société et d’un humain toujours plus hétéronomes en contribuant à instituer un état général de complète techno-dépendance, où nos moindres faits et gestes, nos moindres rapports à nos corps et à chacune de nos aptitudes physiques et psychiques, apparaissent de plus en plus médiés voire délégués à des dispositifs technoscientifiques et biomédicaux ainsi qu’à des entreprises privées ou publiques. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les thèses transhumanistes en faveur d’un humain augmenté connaissent une telle notoriété au moment où la vie, le vivant, le corps humain et ses différentes composantes font l’objet d’une appropriation et d’une exploitation capitalistes sans précédent. L’augmentation de l’être humain et de ses performances est indissociable de cette appropriation et de cette marchandisation généralisée des corps, de la procréation et de la vie, humaine et non humaine, qui fondent aujourd’hui le biocapitalisme. Tel est le revers de la médaille de cet idéal de la délivrance, comme le souligne à juste titre la sociologue Céline Lafontaine :
« En cherchant à s’affranchir de toutes les entraves sociales et culturelles qui le contraignent, l’individu contemporain vit dans l’illusion de sa toute-puissance. Refoulant jusqu’à la négation le lien qui le rattache à l’ensemble des vivants et des morts, il en vient à oublier que l’autonomie n’est possible que dans la reconnaissance de l’état de dépendance sur lequel repose son existence. L’aveuglement face à cette réalité de la condition humaine favorise un désinvestissement de l’espace politique, chacun remettant sa destinée entre les mains de logiques organisationnelles sur lesquelles il n’a que très peu d’influence. Car il faut bien se rappeler que l’individu contemporain doit sa relative indépendance à un large dispositif technoscientifique qui tend à gommer sa véritable autonomie politique34. »
L’humain augmenté offre à cet égard surtout l’image d’un humain essentiellement dépossédé de sa capacité de faire et d’« agir » sur le monde, au sens politique essentiel que Hannah Arendt conférait à ce terme35. Une perte d’autonomie et une forme de dépossession de notre capacité individuelle et collective à assumer notre propre reproduction sociale et biologique qui démontre aussi et surtout combien cette conception transhumaniste instrumentale et désincarnée de l’émancipation humaine concourt, en dernière instance, à la soumission toujours plus renforcée des êtres humains et de nos sociétés à la norme de vie capitaliste, technoscientifique et industrielle.
Étroitement lié à la réalité du biocapitalisme contemporain, le projet transhumaniste et la conception prométhéenne de l’émancipation qui le porte s’avèrent également, d’un point de vue écologique, profondément destructeurs et nuisibles, non seulement pour notre environnement et nos milieux de vie, mais aussi pour nous-mêmes, en tant que nous constituons des êtres vivants. Loin de conduire nos sociétés à une plus grande maîtrise du monde naturel et des processus vivants, ils concourent en réalité à une situation de non-maîtrise et de perte de contrôle croissante. C’est un point que Cornélius Castoriadis avait déjà lucidement mis en lumière lorsqu’il parlait de l’imaginaire capitaliste moderne de la maîtrise comme étant en réalité l’imaginaire d’une « pseudo-maîtrise, pseudo-rationnelle36 ». Loin de supprimer ou de repousser les limites physiques et vivantes, l’imaginaire anthropocentrique et prométhéen de la maîtrise contribue, en niant ces limites, à les déstabiliser et à les exacerber négativement, celles-ci se rappelant alors à nous sous la forme de monstres, pour reprendre l’expression du sociologue Hartmut Rosa37. Car l’Anthropocène bien compris nous montre que c’est en effet cette prétention à l’arrachement et à la maîtrise technoscientifique qui conduit aujourd’hui à une « immaîtrise généralisée » et engendre des conséquences désastreuses et destructrices sur un plan écologique et vital :
« L’Anthropocène, souligne Christophe Bonneuil, signale […] l’échec de la modernité qui promettait d’arracher l’histoire à la nature, de libérer le devenir humain de tout déterminisme naturel : les dérèglements infligés à la Terre font un retour en tempête dans nos vies, et nous ramènent à la réalité des mille liens d’appartenance et de rétroactions qui attachent nos sociétés aux processus complexes d’une Terre qui n’est ni stable, ni extérieure, ni infinie38. »
Ce qui vaut pour la planète avec les fantasmes de la géo-ingénierie vaut aussi pour l’humain et les fantasmes transhumanistes de la bio-ingénierie. Le transhumanisme et la biopolitique de l’augmentation capitaliste qu’il recouvre contribuent à l’édification d’un monde qui altère et nuit fondamentalement à nos conditions vitales d’existence, instituant pour nos corps et nos psychismes des rythmes de vie et de travail toujours plus insoutenables et inhumains. Le recours croissant aux psychostimulants dans les milieux étudiants et les milieux de travail afin de répondre aux exigences de productivité et tenir la cadence s’avère de ce point de vue très instructif.
Décrivant les répercussions du régime capitaliste de l’accélération sur nos existences, le sociologue Hartmut Rosa évoque à cet égard l’émergence de ce qu’il appelle des « pathologies de l’accélération », pour qualifier l’ensemble de ces phénomènes qui naissent de cette disjonction entre les rythmes effrénés du capitalisme globalisé et les rythmes de notre environnement naturel et de nos propres corps39. À l’ère biocapitaliste de l’humain augmenté, il serait dans cet esprit tout aussi pertinent de parler de l’émergence de véritables « pathologies de l’augmentation », pour renvoyer à ces formes d’épuisement et même d’effondrement physique et psychique qui affectent aujourd’hui nombre de personnes. Comme en réponse à l’accélération, l’augmentation de l’humain nourrit une illusoire fuite en avant biotechnologique et biomédicale qui ne s’attaque jamais aux causes mais toujours aux symptômes et aux conséquences de notre mode de vie productiviste. Fondé sur un véritable déni du vivant, le transhumanisme conduit ni plus ni moins à un Global Burn-Out40, l’autre visage de la crise écologique contemporaine. Car on ne peut optimiser constamment nos capacités intellectuelles, physiques et émotionnelles par le recours aux « innovations » technoscientifiques et biomédicales sans se heurter, irrémédiablement, au mur du réel, c’est-à-dire à la finitude et à la limite de nos propres ressources physiques et psychiques qui nous constituent en tant qu’êtres vivants.

Face à l’ambition prométhéenne et anthropocentrique d’améliorer et d’augmenter l’être humain et ses performances, s’impose le constat d’une maîtrise de nos corps et de nos vies qui nous échappe toujours un peu plus. Le transhumanisme et l’injonction à repousser continuellement nos limites physiques et psychiques manifestent un rapport écologique au monde, à l’humain et au vivant désastreux. La perspective de l’humain augmenté s’avère fondamentalement incompatible, non seulement avec l’institution d’une réelle autonomie humaine, qui ne peut s’établir que sur la base de la reconnaissance de nos multiples liens de dépendance et d’appartenance au monde, mais aussi et surtout avec l’exigence écologique et politique vitale de fonder une société et un monde plus habitables. La véritable prise en compte de l’anthropocène suppose, non pas de redoubler d’effort dans l’entreprise de maîtrise et d’arrachement au monde et au vivant. Elle suppose tout au contraire de se soustraire radicalement de cet imaginaire toxique de la puissance et du contrôle technoscientifique sur la vie et le vivant que portent de manière paroxystique le transhumanisme et le capitalisme-monde qui le soutient. L’épuisement de nos corps et de nos esprits n’est jamais que l’autre face de l’épuisement des ressources vivantes de la planète et de nos écosystèmes. Penser une écologie politique de la vie et du vivant, ainsi que nous y invitent dans la diversité de leurs expressions, les courants de l’écologie politique et en particulier la perspective écoféministe, c’est ainsi l’exigence de défendre le vivant non-humain mais aussi humain. Contre le transhumanisme et son monde, la réappropriation de nos corps et de nos vies41, dans leur matérialité biologique, constitue une lutte politique et écologique de première importance.
Notes
- Cet article est une reprise actualisée d’une partie des thèses développées dans mon dernier livre auquel je renvoie les lecteur.trice.s pour de plus amples développements. Voir Nicolas Le Dévédec, Le mythe de l’humain augmenté. Une critique politique et écologique du transhumanisme, Montréal, Écosociété, 2021.[↩]
- Je renvoie ici à l’ouvrage de la philosophe Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019.[↩]
- Sébastien Dalgalarrondo et Tristan Fournier, « Introduction. Les morales de l’optimisation ou les routes du soi », Ethnologie française, vol. vol. 49, no. 4, 2019, pp. 639-651.[↩]
- Voir notamment Rémi Sussan, Les utopies posthumaines : contre-culture, cyberculture, culture du chaos, Paris, Omniscience, 2005. Pour un aperçu historique plus général du mouvement, on pourra consulter l’article de Franck Damour, « Le mouvement transhumaniste. Approches historiques d’une utopie technologique contemporaine », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 138, no 2, 2018, p. 143-156.[↩]
- Depuis 2014, le transhumanisme compte aux États-Unis un parti politique officiel, le Parti Transhumaniste, créé par le journaliste et entrepreneur Zoltan Istvan, qui s’est présenté aux élections présidentielles américaines de 2016 et de 2020.[↩]
- Je reprends ici les titres de plusieurs ouvrages transhumanistes : Simon Young, Designer Evolution: A Transhumanist Manifesto, New York, Prometheus Books, 2005; Laurent Alexandre, La mort de la mort. Comment la technomédecine va bouleverser l’humanité, Paris, JC Lattès, 2011 ; Naam Ramez, More than Human: Embracing the Promise of Biological Enhancement, New York, Broadway Books, 2005; Yuval Harari, Homo Deus. Une brève histoire de l’avenir, Paris, Albin Michel, 2017.[↩]
- Didier Coeurnelle et Marc Roux, Technoprog. Le transhumanisme au service du progrès social, Limoges, FYP Éditions, 2016, p. 13.[↩]
- Nicolas Le Dévédec, « La grande adaptation. Le transhumanisme ou l’élusion du politique », Raisons politiques, vol. 74, no. 2, 2019, pp. 83-97, https://doi.org/10.3917/rai.074.0083[↩]
- FM-2030 (Fereidoun M. Esfandiary), Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing World, New York, NY, Warner Books, 1989, p. 126.[↩]
- Max More, Principes extropiens 3.0., 2003[↩]
- Nick Bostrom, « Human genetic enhancements: A transhumanist perspective », Journal of Value Inquiry, vol. 37, no 4, 2003, p. 493-506[↩]
- Marc Roux, « Technoprogressisme et frontières de l’humain : au-delà de l’horizon », dans Franck Damour, Stanislas Deprez et David Doat (sous la dir.), Généalogies et nature du transhumanisme, Montréal, Liber, 2018.[↩]
- Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide [1627], Paris, Flammarion, 2000, p. 119. Pierre-Jean-George Cabanis, Rapports du physique et du moral de l’homme [1802], Paris, Baillière, 1844, p. 298. Pour une analyse plus approfondie de ces liens entre le transhumanisme et la modernité, je renvoie à mon ouvrage précédent La société de l’amélioration. La perfectibilité humaine des Lumières au transhumanisme, Montréal, Liber, 2015.[↩]
- Cornélius Castoriadis, La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV, Paris, Éditions du Seuil, 1996, p. 125-139. Voir aussi Arnaud Tomès et Philippe Caumières, Cornélius Castoriadis. Réinventer la politique après Marx, Paris, PUF, 2011, p. 73-80.[↩]
- Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter », op. cit.[↩]
- Walter Lippmann cité par Barbara Stiegler, op. cit., p. 258.[↩]
- Nikolas Rose, The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First-Century, Princeton, Princeton University Press, 2007.[↩]
- Céline Lafontaine, Le Corps-Marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie, Paris, Seuil, 2014, p. 60.[↩]
- Ibid., p. 245.[↩]
- L’ouvrage que le philosophe français Luc Ferry a consacré au mouvement en 2016 apparaît de ce point de vue emblématique. Voir Luc Ferry, La révolution transhumaniste. Comment les technosciences et l’ubérisation de la société bouleversent nos existences, Paris, Plon, 2016.[↩]
- Didier Coeurnelle et Marc Roux, op. cit., p. 186.[↩]
- Sur cette question du transhumanisme écologique, on trouvera une forme de synthèse dans l’article de Gabriel Dorthe et Johann Roduit, « Modifier l’espèce humaine ou l’environnement? Les transhumanistes face à la crise écologique », Bioethica Forum, vol. 7, no 3, 2014, p. 79-86.[↩]
- Le sens de la critique que je développe ici rejoint à plusieurs égards celle exprimée par TomJo dans l’article intitulé « Écologisme et transhumanisme. Des connexions contre-nature »[↩]
- Didier Coeurnelle et Marc Roux, op. cit., p. 218.[↩]
- Ibid.., p. 189.[↩]
- Ibid., p. 190.[↩]
- Matthew Liao, Anders Sandberg et Rebecca Roache, « Human Engineering and Climate Change », Ethics, Policy & Environment, vol. 15, no 2, 2012, p. 206–221.[↩]
- Ibid., p. 207.[↩]
- Ibid., p. 208.[↩]
- Ronald Bailey cité dans Alexander Federau, Pour une philosophie de l’anthropocène, Paris, PUF, coll. « L’écologie en questions », 2017, p. 226.[↩]
- Les travaux du politologue Francis Fukuyama et ceux du philosophe Leon Kass sont emblématiques de cette perspective. Voir Francis Fukuyama, La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution biotechnologique, traduit de l’anglais par Denis-Armand Canal, Paris, La Table Ronde, 2002 ; Leon Kass, Life, Liberty, and the Defense of Dignity : The Challenge for Bioethics, San Francisco, Encounter Books, 2002. Ces dernières années, les critiques religieuses du mouvement transhumaniste se sont aussi multipliées, en particulier en France. L’ouvrage du physicien et théologien Thierry Magnin, Penser l’humain au temps de l’homme augmenté, Paris, Albin Michel, 2017, en constitue un bon exemple. Pour une critique de ces perspectives que l’on peut qualifier de « bioconservatrices », je renvoie aux articles suivants : Miguel Benasayag et Léo Coutellec, « Nos limites ne sont pas les leurs. De la nécessité d’une approche critique de la notion de limite », Écologie & politique, vol. 57, no. 2, 2018, pp. 117-132 ; Nicolas le Dévédec, « Entre la sacralisation de la vie et l’essentialisation de la nature humaine : un examen critique du bioconservatisme », Politique et sociétés, Volume 36, Numéro 1, 2017, p. 47–63[↩]
- J’emprunte le terme de « délivrance » au philosophe Aurélien Berlan, qui, dans la continuité de la pensée de Castoriadis, le distingue judicieusement de la notion d’autonomie, les deux renvoyant, montre-t-il, à deux conceptions très différentes de la liberté humaine : « […] dans le premier cas [délivrance], elle consiste pour l’individu à être délivré des limites et nécessités imposées par la nature et les formes de vie communautaire ; en ce sens, tout ce qui permet de dépasser ou repousser ces contraintes favorise la liberté comme absence de limites, comme délivrance. Dans le second cas [autonomie], la liberté suppose au contraire de reprendre en main sa vie et ses activités plutôt que s’en décharger au profit d’institutions ou de médiations qui nous dépassent et finissent par nous imposer leurs exigences – et ici, il s’agit de les prendre en main afin de pouvoir en déterminer le contenu et les limites : c’est la liberté comme autonomie, comme autodétermination. Dans un cas, c’est être délivré d’une charge, déchargé d’une nécessité ; dans l’autre, c’est au contraire reprendre quelque chose en main ou en charge, se charger soi-même de la chose en question. » Aurélien Berlan, « Autonomie et délivrance. Repenser l’émancipation à l’ère des dominations impersonnelles », Revue du MAUSS, 2016, n° 48, p. 63.[↩]
- On se reportera aux ouvrages classiques de Jacques Ellul, en particulier Le bluff technologique [1988], Paris, Hachette, 2012 ; mais également à l’ouvrage de Alain Gras, Fragilité de la puissance. Se libérer de l’emprise technologique, Paris, Fayard, 2003.[↩]
- Céline Lafontaine, La société post-mortelle. La mort, l’individu et le lien social à l’ère des technosciences, Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 226.[↩]
- Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1994.[↩]
- Voir Cornélius Castoriadis, La montée de l’insignifiance, op. cit.[↩]
- Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible, Paris, La Découverte, 2020,p. 133.[↩]
- Christophe Bonneuil, « Capitalocène. Réflexions sur l’échange écologique inégal et le crime climatique à l’âge de l’Anthropocène », EcoRev’, vol. 44, no 1, 2017.[↩]
- Hartmut Rosa, « La logique d’escalade de la modernité », Libération, 20 novembre 2014.[↩]
- Pascal, Chabot, Global burn-out, Paris, PUF, coll. « Perspectives critiques », 2013.[↩]
- Voir notamment Silvia Federici, Par-delà les frontières du corps. Repenser, refaire et revendiquer le corps dans le capitalisme tardif, traduit de l’anglais par Léa Nicolas-Teboul, préface de Jules Falquet, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2020.[↩]








