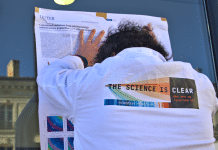Un point de prudence avant de commencer…
La pandémie de Covid-19 et sa gestion, à la croisée des sciences et de la politique, ont suscité des débats nombreux, parfois violents. Nous connaissons tou·tes des groupes, des familles, des collectifs qui ont été déchirés par ces désaccords, aboutissant à une fragmentation toujours plus nette du tissu social en France. Tout cela est la conséquence directe de la politique d’un gouvernement qui fabrique le séparatisme comme l’envers stratégique du consentement, rendant encore plus difficile toute tentative de penser la situation autrement que sur le mode du clash.
Au sein du collectif de rédaction de Terrestres, ces désaccords existent aussi et ils ont donné lieu à des discussions parfois vives entre nous. Pour autant, nous avons toujours tenté de faire vivre ces dissensus, en les envisageant non pas comme des motifs de scission, mais plutôt comme les signes d’une vie intellectuelle et démocratique intense, dont nous essayons aussi de témoigner dans nos colonnes.
Revendiquer la fécondité de ces dissensus pour mieux faire émerger une description juste et plurielle de la situation contemporaine, voilà aussi le signe d’un attachement à ce qu’Isabelle Stengers appelle l’irréduction, c’est-à-dire la méfiance à l’égard de toutes les thèses qui impliquent, plus ou moins explicitement, « le passage de “ ceci est cela ” à “ ceci n’est que cela ” ou “ est seulement cela1 ” ».
Tenir ainsi à l’irréduction contre la réduction d’une situation à une explication définitive, c’est aussi résister à tout ce qui cherche à se draper dans la pureté de l’évidence, c’est-à-dire d’une vérité dévoilée. Ainsi, examiner la manière dont une thèse peut en faire balbutier une autre, la compléter, l’infléchir ou en renforcer la pertinence, voilà une toute autre affaire que de chercher une thèse officielle ou alternative qui révèlerait enfin le vrai d’une situation — et de préférence tout le vrai.
C’est pour ces raisons que nous avons collectivement décidé de continuer à publier une variété de textes sur la situation pandémique. Des textes qui ne reflètent pas forcément le point de vue de l’ensemble des membres du collectif de rédaction. Des textes avec lesquels certain·es d’entre nous sont même parfois en franc désaccord. Mais des textes qui nous semblent à même, par leur diversité et les rencontres qui en procèdent, d’esquisser ensemble un tableau analytique de la situation pandémique et politique.
La tâche n’est pas facile, mais nous essayons de faire de notre mieux, en respectant la temporalité qui est celle de la revue : celle du recul et de la réflexion, plutôt que celle de la réaction et de la polémique. Aussi, n’hésitez pas à nous suggérer des textes qui pourraient contribuer à ce travail lent et patient de description et d’éclairage du présent.
Bonnes lectures dans les méandres !
Le collectif de rédaction de Terrestres
Le débat au sein de la gauche radicale (politique et universitaire) sur les modèles de gestion de la crise pandémique a été caractérisé par une polarisation de plus en plus marquée. Un premier groupe d’interprètes a vu dans la pandémie avant tout une inflation exorbitante des dispositifs de contrôle des populations et des sujets, une très grave érosion des libertés, des droits individuels, des espaces de discussion et de décision démocratiques. Un second groupe y a vu plutôt le signe de l’inadéquation manifeste des systèmes occidentaux de santé publique et de la contradiction évidente entre les besoins du profit économique et le droit à la santé. Alors que les premiers ont eu tendance à considérer la crise comme un problème de pouvoir et ont appelé à un assouplissement des interdictions et des restrictions, les seconds la voient comme un problème lié à l’État providence, affirmant la nécessité de le renforcer. Là où les premiers s’élèvent contre l’interventionnisme de l’État au nom de la liberté, les seconds appellent à une plus grande intervention de l’État contre les dysfonctionnements générés par l’économie capitaliste sur la santé.
Parmi les différents champs de bataille théoriques et politiques qui divisent ces deux positions, la pensée de Michel Foucault a joué un rôle important. Depuis près de deux ans, une intense bataille d’idées s’est engagée autour de cette dernière et des outils qu’elle fournit pour interpréter la pandémie actuelle, une bataille qui a sans doute constitué l’un des plus importants vecteurs de polarisation du débat actuel.
En effet, au sein des positions que j’ai résumées, les références aux catégories foucaldiennes sont, sans surprises, opposées. Les premières, en effet, utilisent Foucault pour décrire la gestion de la crise pandémique comme une forme de biopolitique agressive et liberticide1 ; les secondes, au contraire, invoquent une biopolitique vertueuse, une biopolitique du soin capable de prendre en charge le droit à la santé contre ses restrictions causées par les multiples effets pervers du système capitaliste sur la santé publique2.

La distance entre ces deux positions, déjà considérable, s’est exacerbée et les a transformées souvent en des versions particulièrement extrêmes d’elles-mêmes. Les premiers ont de plus en plus eu la tendance à nier l’existence même de l’urgence médicale, voyant dans la crise pandémique un simple prétexte pour accroître le contrôle biopolitique sur la vie des sujets ; les seconds sont allés jusqu’à nier le fait même d’une restriction des libertés individuelles, accusant quiconque s’en réclame de soutenir simplement une conception de droite de la liberté, et ont affiché une posture scientiste, une attitude que l’on pourrait qualifier d’épistocratique faisant appel à un gouvernement d’experts, véritable concept-symbole de ces types de positions. Un exemple très significatif de cette opposition exaspérée est la querelle entre Giorgio Agamben – qui dans ses écrits sur la pandémie a défendu à plusieurs reprises la thèse de l’inexistence d’une urgence médicale, et qui est sans doute le représentant principal de la première dérive – , et les signataires d’une lettre regroupant un nombre important de personnalités de l’académie philosophique italienne, qui lui répondait en soutenant que « la mise en place du pass sanitaire n’engendre aucune limitation de la liberté individuelle » et que « soutenir le contraire serait […] comme dire que l’adoption des règles de la circulation routières nuirait à la liberté individuelle de mouvement ».
L’aggravation de cette polarisation a eu pour effet de déformer, de manière implicite ou explicite, les références à Foucault. Il devient, en effet, tour à tour le philosophe qui dénonce rigoureusement le chevauchement entre le pouvoir et la science et invoque la nécessité d’une lutte sans fin pour une liberté indéterminée contre toute forme de coercition, ou un libertarien relativiste et, en dernière analyse, « réactionnaire ».
Or, l’objet de cet article n’est pas de régler la question des usages pandémiques de Foucault : je ne proposerai pas une analyse des usages opposés de ses concepts afin de distinguer, sur des bases philologiques, les bons des mauvais. Je partirai plutôt de l’hypothèse selon laquelle la référence à Foucault constitue, au sein de cet affrontement exacerbé, un symptôme ; et, plus précisément, le symptôme d’une crise qui le dépasse largement, et dont son nom constitue un signifiant particulièrement chargé. Cette hypothèse me permettra de proposer une certaine lecture de l’affrontement théorico-politique en cours, sur la base de laquelle je pourrai enfin poser à nouveau et de manière différente la question de l’actualité de la pensée de Foucault dans la conjoncture actuelle.
Une tradition en crise
Cette crise est celle de la tradition de la gauche libertaire d’après 1968, celle des diverses tendances du poststructuralisme ou, pour employer un terme impropre, celle du postmodernisme. Dans la polarisation du débat que nous étudions, elle se manifeste en particulier dans la suspicion implicite envers son culturalisme extrême, c’est-à-dire envers la possibilité d’une réduction totale de la réalité à des dynamiques purement sociales et linguistiques dans lesquelles le caractère concret de la réalité semble disparaître sans laisser de trace. C’est la suspicion à l’égard de cette position ontologique qui semble constituer le fondement inavoué de toutes les autres accusations portées contre cette tradition de pensée, et notamment celles d’antiscientisme relativiste (nier tout simplement la vérité des savoirs scientifiques et/ou leur prééminence vis-à-vis d’autres formes de savoir) et de libertarianisme réactionnaire (défendre n’importe quelle forme de liberté, même si elle aura un effet nuisible sur les autres).
Comprendre l’origine de cette suspicion n’est pas difficile. La crise pandémique n’est en effet que la manifestation dramatiquement concrète d’un réel qui échappe sans cesse à sa réduction linguistique et culturelle, d’un dynamisme et d’une agency radicalement non-humains. Elle nous a rappelé, de manière violente, la présence d’un monde non humain qui agit de manière incontrôlable, souvent en réponse à notre action sur la planète et ses équilibres complexes. C’est en ce sens, bien sûr, que la crise pandémique doit être aussi considérée comme un épisode – probablement pas le plus catastrophique – de la crise écologique en cours3.
En d’autres termes, il s’agit de la révolution copernicienne que le facteur écologique produit sur la pensée politique – ou plutôt, de la révolution qu’il doit nécessairement produire pour qu’il entre effectivement dans la réflexion théorico-politique, sans être réduit au rang d’une variable parmi d’autres dans un cadre analytique qui reste par ailleurs inchangé. Cette polarisation est donc – c’est ma thèse – l’un des effets de l’impact de l’Anthropocène sur la pensée de la gauche critique. Plus précisément, elle est le signe de la crise théorique que l’Anthropocène y produit. Foucault est un de ses noms, peut-être le nom le plus intensément surchargé.

Cette conclusion nous permet donc tout d’abord de souligner l’asymétrie de cette polarisation théorique, une asymétrie qui n’était pas évidente jusqu’à présent. Bien que les deux positions en cause soient des déformations des analyses théorico-politiques dont elles sont issues, elles ne sont pas également perverses.
En effet, la tradition de pensée d’inspiration libertaire s’inverse en son contraire en devenant une dérive négationniste et réactionnaire : elle atteint ainsi des résultats théoriques et politiques non seulement radicalement inacceptables, mais qui réalisent aussi le rêve/cauchemar libéral d’un postmodernisme de droite au service du fascisme dans le monde entier4. En ce sens, il faut vraiment reconnaître à Giorgio Agamben le mérite d’être plus royaliste que le roi : son usage de Foucault est peut-être la seule véritable utilisation de droite qui ait jamais été faite.
A l’inverse, une autre tradition de gauche soucieuse de dépasser l’ontologie culturaliste dont Foucault serait le paradigme, prend la forme d’une dérive scientiste et anti-libertaire. Au nom d’un nouveau réalisme, capable enfin de rendre visible la crise écologique dans sa concrétude, ce courant philosophique et politique comporte des angles-morts sur la science et le pouvoir qui dénature ce qui reste un besoin réel : abandonner un paradigme culturaliste incapable de rendre compte de la nature de l’événement anthropocène. En somme, elle pose la question fondamentale de l’actualité de Foucault, et par extension celle de toute une tradition de pensée critique radicale : que faire de tout ce matériel dans le contexte de la crise pandémique, et par extension de la crise écologique ?
La réponse que ces positions apportent semble de plus en plus claire : absolument rien. La pandémie et plus généralement la crise écologique posent la question d’un réel non réductible, et nous obligent à modifier nos références en conséquence. Dans cette opération de restructuration théorique et politique, la première victime semble destinée à être précisément Foucault. De la nécessité de diverses formes d’interventionnisme étatique contre les pandémies et le changement climatique à la nécessité conséquente de réattribuer une légitimité absolue aux connaissances scientifiques qui nous éclairent sur leur nature, tout semble converger vers l’abandon définitif de cette tradition de gauche qui posait la nécessité d’une suspicion de principe à l’égard de toutes les formes de pouvoir, et cherchait à étudier les relations qui lient le pouvoir à la science et au savoir. Le culturalisme desdits « postmodernes », prétendument incarné par Foucault, dégénèrerait en un libertarisme réactionnaire et un antiscientisme relativiste : précisément les ennemis les plus dangereux pour ceux qui luttent, à gauche, pour arrêter l’effondrement écologique et ses pandémies.
Revenir à Foucault
Les risques théoriques et politiques encourus par ces positions laissent toutefois penser que ce discours ne peut s’arrêter là. Il n’est peut-être pas encore temps d’abandonner définitivement Foucault. Peut-être, en effet, l’utilité de la pensée de Foucault dans la conjoncture historique est-elle précisément de prévenir de tels risques, c’est-à-dire de répondre à la nécessité théorique et politique de creuser un profond sillon entre l’exigence légitime que ces positions incarnent et les dérives dangereuses auxquelles elles sont vulnérables.
Si la nécessité, posée par la crise pandémique et écologique, de dépasser certains héritages postmodernes ne fait aucun doute, certains des enseignements de cette tradition, et de Foucault en particulier, restent une arme fondamentale pour éviter ces dérives indésirables. Pour comprendre comment, il est temps de revenir – enfin – à Foucault.
Les dérives auxquelles sont soumises les revendications théorico-politiques articulées par la gauche critique en réponse aux crises pandémique et écologique sont, comme nous l’avons vu, essentiellement au nombre de deux : a) le passage de la critique du libertarisme réactionnaire à des formes d’autoritarisme politique ; b) le passage de la critique de l’antiscientisme relativiste à des postures épistocratiques. Il s’agit en fait d’un seul et même dispositif théorique et politique, dont le fonctionnement peut être décrit de la manière suivante : il tend à déduire directement de la nécessité (vertueuse et partageable) de dépasser une ontologie culturaliste dans laquelle les crises pandémique et écologique sont invisibles, une vision neutre de la science, qui met entre parenthèses l’étude des rapports entre science et pouvoir afin de rejeter le risque d’antiscientisme relativiste et de libertarisme réactionnaire qu’incarnerait la tradition de la gauche « postmoderne ». C’est précisément cette vision neutre de la science qui entraîne le risque de postures épistocratiques et autoritaires.
Or, l’importance de la pensée de Foucault réside précisément dans sa capacité à désactiver ce dispositif : cette désactivation est, à notre avis, le seul moyen dont nous disposons pour opérer un dépassement vertueux d’un certain postmodernisme, capable de préserver un rapport non naïf avec la science et d’arrêter les dérives épistocratiques et autoritaires.

Indépendamment de la légitimité de la thèse selon laquelle l’ontologie foucaldienne constitue une forme extrême de culturalisme, il ne fait aucun doute que l’étude des rapports entre science et pouvoir chez Foucault s’est toujours tenue à l’écart tant du risque du relativisme antiscientifique que du libertarisme réactionnaire. En fait, ce que Foucault n’a cessé d’étudier tout au long de sa carrière, c’est l’ensemble complexe des relations qui lie l’émergence du savoir au développement des formes de pouvoir, sans que la différence entre les deux ne s’effondre jamais dans l’indistinction. Il a montré comment de nouveaux dispositifs de pouvoir – l’asile psychiatrique étudié dans Histoire de la folie, l’armée, l’usine et l’école qui font l’objet de Surveiller et punir – constituaient autant de conditions de possibilité pour la naissance de nouveaux savoirs, à leur tour capables de perfectionner et de renforcer l’action de ces dispositifs, sans jamais théoriser une relation de déduction directe entre les deux pôles. Son but n’a jamais été, en effet, de voir du simple pouvoir derrière n’importe quelle forme de savoir, mais de montrer comment les deux constituent l’épaisseur matérielle et concrète de chaque moment historique contingent – les relations de pouvoir qui le traversent, les discours qui y sont possibles. Et cela afin de fournir une cartographie nécessairement provisoire des possibilités d’une libre construction de soi dans le présent, c’est-à-dire de création des formes de vie qui articulent le travail infini de l’émancipation politique et qui restent historiquement situées, contre toute forme de téléologie révolutionnaire et d’idéalisme.
Il a, en d’autres termes, essayé de développer une ontologie de l’actualité au service de pratiques historiques de la liberté. Pratiques qui ne cherchent pas un dehors absolu du pouvoir, dans un libertarisme stérile qui tend à devenir réactionnaire. Pratiques qui ne soient pas davantage sceptiques à l’égard de toutes les formes de savoir, attitude qui déboucherait sur un relativisme absolu et finalement anti-scientifique. Ce chemin de crête entre plusieurs écueils cherche à relancer le projet d’une libre construction de soi dans l’histoire. Une liberté qui, étant immergée dans l’histoire, reconnaît profondément, avec une posture qui n’est en rien « libertarienne » ou « relativiste », la matérialité à laquelle elle fait face et qui constitue son présent, ainsi que les pouvoirs et les savoirs qui la constituent. Que l’on songe par exemple ici aux pratiques de subjectivation stoïciennes ou épicuriennes, mais aussi aux communautés gays californiennes, analysées par Foucault dans les volumes de l’Histoire de la sexualité ainsi que dans ses derniers écrits et ses cours au Collège de France.
Pour une biopolitique écologique et radicalement démocratique
Que faire alors, face aux crises pandémique et écologique, de cette conception non naïve de la relation entre pouvoir et savoir ? Il ne sert absolument pas à répandre le relativisme à l’égard de la science du changement climatique ou de l’épidémiologie, et par conséquent à justifier les revendications réactionnaires fondées sur des formes rudimentaires d’antiscientisme. Au contraire, elle permet de creuser un sillon entre les besoins théoriques et politiques exprimés par la crise pandémique et écologique et les dérives auxquelles ces besoins peuvent être exposés, puisqu’elle nous pousse à poser de manière nouvelle et radicale la question du rapport entre science et démocratie. En effet, elle constitue un outil fondamental pour dénoncer le caractère inévitablement idéologique d’une vision neutre de la connaissance scientifique, permettant d’éviter les tentations autoritaires et les attitudes épistocratiques par une démocratisation puissante et vertueuse de la science.
Il ne s’agit pas du tout de faire des conclusions scientifiques l’objet d’un débat démocratique, comme si une assemblée démocratique devait se prononcer sur la véracité des données relatives au changement climatique ou à la propagation d’un virus. Cela signifie, au contraire, penser à des espaces et des institutions démocratiques qui peuvent jouer un nouveau rôle de médiation entre la science et l’opinion publique démocratique ; cela signifie abandonner les postures épistocratiques et élitistes, revenir à la distinction entre l’ignorance avec ses causes sociales, économiques, politiques et son exploitation par les droites populistes et fascistes, et au contraire créer des espaces capillaires de débat et de discussion qui peuvent tuer dans l’œuf le conspirationnisme et le négationnisme ; cela signifie relancer de nouvelles formes de participation démocratique active et de responsabilité collective comme antidote à toute tentation autoritaire ; cela signifie, en somme, poser la nécessité de formes d’expérimentations institutionnelles démocratiques radicales en tant qu’incontournable réponse politique de gauche à la crise pandémique et écologique.

Pour en suggérer un exemple, j’aimerais bien faire référence ici à une autre contribution majeure dans le débat philosophique et politique sur la pandémie, à savoir le pamphlet Santé publique année zéro signé par Barbara Stiegler et François Alla, et en particulier à leurs réflexions autour de l’épidémie de SIDA. Les auteurs soulignent le rôle central joué à l’époque par les associations et les collectifs issus de la communauté homosexuelle, qui grâce à leur activisme arrivèrent jusqu’à s’inviter « dans la détermination des mesures de santé publique » et à devenir « des acteurs à part entière du système sanitaire », tout en imposant au monde médical « l’idée d’un nécessaire partage épistémique des connaissances entre soignants et patients »5. Ces pratiques d’activisme démocratique, très proches d’ailleurs des mouvements féministes actuels en Italie et en France pour la reconnaissance et la prise en charge de l’endométriose et d’autres maladies gynécologiques sous-diagnostiquées, représentent bien ce qu’on entend par expérimentations démocratiques. La biopolitique dont il est question ici envisage leur généralisation radicale, jusqu’à inclure notamment questions écologiques : une généralisation capable de transformer en profondeur nos communautés politiques.
En somme, une biopolitique du soin et écologique est nécessairement aussi une biopolitique radicalement démocratique. D’ailleurs, c’est précisément la dernière réflexion que nous a laissé Foucault, il y a maintenant presque quarante ans. Dans ses derniers cours consacrés à la parrêsia6 – terme grec qui désigne le dire-vrai et franc adressé au pouvoir –, il posait rigoureusement le problème du rapport constitutivement fragile entre vérité et démocratie, en montrant la possibilité d’un usage – la parrêsia – de la vérité qui n’aspire pas à engloutir la démocratie, mais au contraire à la remettre en marche et à la repenser à ses racines. Ou bien, encore mieux, à la remettre en marche en la ramenant à ses racines, à travers une attaque féroce contre le conformisme capable de rouvrir cette discussion horizontale, participative et libre qui en est le seul principe. Comme l’a suggéré Balibar, la parrêsia n’est rien d’autre qu’une « intervention perturbatrice » visant à rétablir la démocratie dans son « principe », une « figure de « contre-démocratie » qui représente néanmoins l’action démocratique par excellence »7. Dans la parrêsia, la vérité revitalise la démocratie d’une manière si radicale qu’elle remet tout – mais d’abord elle-même – en question. Une régénération qui est précisément ce que les crises pandémique et écologique devraient susciter dans nos démocraties.
Conclusion
Foucault est donc, en dernière analyse, le nom, cette fois non pas vide mais extrêmement concret, d’une série d’outils essentiels pour construire une réponse radicale de gauche aux crises qui marquent et continueront de marquer notre époque. Revenir à son œuvre dans cette optique et sur la base de ces urgences – plutôt que de l’abandonner définitivement – est, selon nous, une façon de sortir vivants du conflit actuel.
Une tâche ardue, pourrait-on dire. Peut-être, mais cela nous réconfortera au moins de savoir que nous ne devons pas repartir de zéro. La nécessité de dépasser le culturalisme post-moderne et son oubli de la réalité non-humaine par une réflexion radicalement nouvelle sur la matière, capable à la fois de poser la question écologique et de rejeter une vision naïve et positiviste de la science, est ce à quoi réfléchit depuis des décennies toute une école de la pensée féministe, inaugurée notamment par Haraway et poursuivie par des penseuses tels que Braidotti, Alaimo et Barad. Pour la philosophie politique après la pandémie il s’agit alors, peut-être, de prendre le relais de cette tradition, qui a toujours essayé de transformer réellement le monde en apprenant à le voir d’un point de vue situé mais non irrationnel, et d’articuler à partir de là une politique radicale capable de combiner le besoin de soin – pour les autres et pour le monde – et celui de la liberté.
Notes
- Voir par exemple B. McQuade, M. Neocleous, Beware: medical police, Radical Philosophy 11, 8 (2020), pp. 3-9.[↩]
- Voir A. Sotiris, Thinking beyond the lockdown : on the possibility of a democratic biopolitics, Historical Materialism 28, 3 (2020), pp. 3-38, mais aussi le concept de biopouvoir dual développé par Toscano : A. Toscano, The state of the pandemic, Historical Materialism 28,4 (2020), pp. 3-23. Ces deux interventions sont également attentives à la question de l’autoritarisme inhérent à certaines mesures de gestion de la pandémie comme le confinement, mais en partant précisément de la nécessité de développer des formes de (bio)politique du care par le bas, montrant ainsi des diagnostics théoriques et des besoins politiques profondément différents de ceux incarnés, par exemple, par McQuade et Neocleous.[↩]
- La présentation la plus rigoureuse et organique de cette thèse est sans doute celle proposée par Malm : voir A. Malm, La chauve-souris et le capital. Stratégie pour l’urgence chronique, La fabrique, Paris 2020.[↩]
- La thèse déjà habermassienne de la nature réactionnaire des penseurs dits postmodernes a été récemment ravivée dans le contexte de ce que l’on peut appeler une offensive idéologique de grande envergure de la gauche libérale, notamment anglo-saxonne, contre les populismes de droite. Selon ce type de discours, qui constitue une intéressante actualisation de positions déjà présentes dans le débat académique et politique en Occident depuis les années 1980, Foucault et les autres postmodernes seraient coupables d’avoir légitimé un relativisme absolu à l’égard de toute forme de vérité et d’objectivité, qui a en fait favorisé la naissance du phénomène de la post-vérité (fake news, conspirationnisme, etc.) et la montée conséquente des populistes de droite dans les années 2010 : cette faute constituerait la preuve ultime de la nature essentiellement réactionnaire de tous ces penseurs. Ce sont des discours que l’on retrouve facilement dans le débat public. Un exemple particulièrement significatif est un article du New York Times de mai 2021, signé par l’éditorialiste Ross Douthat, et significativement intitulé How Foucault lost the left and won the right (https://www.nytimes.com/2021/05/25/opinion/michel-foucault.html), mais aussi les prises de position de Michiko Kakutani, célèbre critique littéraire de la gauche libérale, publiées dans le Guardian dans un article intitulé The death of truth : how we gave up on facts and ended up with Trump (https://www. The Guardian. com/books/2018/jul/14/the-death-of-truth-how-we-gave-up-on-facts-and-ended-up-with-trump). Ces thèses sont aussi des plus en plus populaires au sein de publications scientifiques : tant McIntyre que D’Ancona, parmi les principaux philosophes politiques à avoir traité le sujet de la post-vérité, comptent explicitement Foucault et les postmodernes parmi les causes de cette dernière ; au postmodernisme dit de droite ou conservateur, McManus a consacré, en 2020, une monographie entière, intitulée précisément The rise of post-modern conservatism ; dans le débat francophone, ces arguments ont été discuté par Renaud Garcia dans son livre Le désert de la critique. Déconstruction et politique, Paris, L’Échappée, 2015.[↩]
- B. Stiegler, F. Alla, Santé publique année zéro, Gallimard, Paris 2022, p. 18.[↩]
- Voir notamment M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France (1983-1984), Gallimard-Seuil, Paris 2008; Le courage de la vérité. Cours au Collège de France (1984), Gallimard-Seuil, Paris 2009.[↩]
- É. Balibar, Sulle parrhèsia(e) di Foucault, Materiali Foucaultiani, VI, 11-12 (2017), p. 81.[↩]