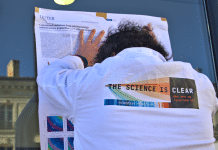Philosophe des sciences, Isabelle Stengers s’est faite connaître dès la parution en 1979 de La Nouvelle Alliance coécrit avec le prix Nobel de chimie Ilya Prigogine. Entre les années 1980 et 2000, elle publie de nombreux ouvrages qui renouvellent la façon dont on comprend l’activité scientifique et la place des sciences, libérées du grand récit scientiste. Un de ses apports a été de désactiver deux manières de comprendre le travail scientifique qui trop souvent s’opposent de manière caricaturale. D’un côté on trouve la figure Science ayant par principe toujours-déjà raison, se contentant de dévoiler la vérité que la nature nous aurait cachée. De l’autre apparaissent des sciences humaines, trop humaines, et, partant, aussi vraies et relatives que n’importe quelle autre forme discours (romanesque, historique, religieux, etc.). Isabelle Stengers s’emploie dès les années 1990 à penser les sciences comme activité pratique – ce qui recouvre aussi le travail conceptuel – avec cette double exigence : qu’elle soit dépourvue d’une autorité de principe mais qu’elle ne soit pas pour autant réduite à un pur discours ou à une pure construction sociale.
Dans L’Invention des sciences modernes (1993), elle cherche à saisir le geste fondateur de Galilée comme initiateur d’un mode d’énonciation propre aux sciences. Les sciences modernes posent alors comme exigence de produire un type particulier de fictions, qui soit précisément capable de faire valoir qu’elles ne sont pas « que de la ficton », ou qu’elles ne sont pas réductibles à une fabrication arbitraire1. Le « pouvoir de la fiction » des sciences, qui est celui de l’invention créative qui leur est propre2, repose sur l’intervention d’un tiers, d’un témoin extérieur qui les rend irréductibles à des opinions, notamment par l’entremise de dispositifs expérimentaux3.
En 1997, Isabelle Stengers publie une série sept petits volumes à La Découverte, intitulée Cosmopolitiques. Réédités en deux tomes en 2003, il s’agit d’une reprise et une poursuite de cette double exigence à travers une philosophie de la physique tournée vers l’histoire des inventions – souvent conceptuelles, mais toujours saisies comme des pratiques situées – de cette discipline allant de la mécanique à la thermodynamique, en passant par la physique quantique.
Ainsi, les Cosmopolitiques envisagent les sciences de la nature communément considérées comme les plus « dures » (les physiques fondamentales) non plus sur un mode de la découverte évidente, mettant en œuvre un même modèle rationnel universel, et pour ainsi dire « tout-terrain », exportable partout, y compris en politique. Outre ce déplacement de perspective, les Cosmopolitiques réalisent le tour de force de maintenir l’originalité des sciences (les deux derniers volumes s’intéressent à la biologie et aux sciences humaines) tout en la pensant comme ensemble de pratiques situées. Ces dernières entretiennent une relation à certains êtres toujours particuliers (atomes, particules, fluides, etc.) et ces êtres obligent les scientifiques, en tant que praticiens et praticiennes. En effet, ils imposent un certain nombre de contraintes, mais qui ne sont jamais séparables des pratiques qui les font exister : il n’y a pas de déconnexion possible entre le pouvoir d’invention humain, et le pouvoir que ces êtres ont sur ces humains, c’est un co-devenir4.
Une spécialiste du Boson de Higgs n’est pas une représentante de la Vérité et de la Raison avançant dans l’histoire, pas plus qu’elle ne peut appliquer son savoir très exigent et particulier par exemple à la chimie atmosphérique ou à la mécanique des fluide (elle ne peut exporter partout son savoir-faire et son savoir-savoir singulier). En revanche, pour rester spécialiste du Boson de Higgs, elle possède certaines obligations : elle ne peut pas dire n’importe quoi et renouvelle sans cesse des moyens (expérimentaux, mathématiques, conceptuels, ou un mélange) afin de se lier de manière toujours plus intime avec le fameux Boson.
Le texte qui suit est une préface inédite à la réédition des Cosmopolitiques datant d’avril 2022. Isabelle Stengers revient sur le parcours qui a mené aux principaux concepts des Cosmopolitiques, en présentant ses principaux concepts et en discutant cette œuvre à la lumière l’actualité.

Vingt-cinq ans après, sept petits livres sont donc réunis en un seul volume. À cette occasion je revis cette aventure d’écriture qui m’a menée à emprunter les chemins d’une pensée spéculative au sens que je lui donne désormais, celui d’une lutte contre les probabilités, pour un possible qui insiste et dont il s’agit de faire passer l’insistance.
Il y a vingt-cinq ans, la « guerre des sciences » dont j’avais, aux premières lignes de L’Invention des sciences modernes, annoncé la probabilité, était en passe de s’achever, sans vainqueurs ni vaincus, tout le répertoire des insultes et des accusations ayant été épuisé. Mais pour certains, il s’est alors agi de donner un sens à la réaction furieuse de certains scientifiques contre les études critiques qui prétendaient faire de la science une pratique humaine « comme les autres », sans accès privilégié à la réalité. Non plus se défendre mais chercher à comprendre cette fureur.
Nul n’a ressenti avec plus d’intensité que Bruno Latour la nécessité d’apprendre de cette réaction – aussi caricaturale que soit la manière dont elle s’est formulée. Il a qualifié de « faute heureuse » le fait que les sociologues critiques aient cru pouvoir faire porter aux scientifiques la responsabilité effective de l’accord qu’ils prétendent devoir à ce qu’ils interrogent. La sociologie croit pouvoir se donner le droit d’expliquer de manière critique ce à quoi tiennent les groupes auxquels elle s’adresse, de les comprendre mieux qu’ils ne le font eux-mêmes. Telle est sa faute ! Mais cette fois, elle a eu affaire à des récalcitrants, qui refusaient une explication qui renverrait leur accord à des croyances et les phénomènes à leur mutité. Les scientifiques ont objecté passionnément. Et, à la différence de tant d’autres dont les protestations éventuelles ont été actées mais interprétées, ils avaient les moyens de se faire entendre. La faute est heureuse si elle réussit à inciter les sociologues à ne pas profiter de la faiblesse « sociale » de ceux dont ils prétendent pouvoir expliquer les attachements.
Cependant, je ne suis pas sociologue et j’avais été frappée par un autre aspect de la confrontation. Les sociologues n’étaient pas les seuls à profiter d’une position socialement « forte » face à ceux qu’ils expliquent. Les principaux ténors de la « guerre des sciences » avaient été des physiciens. Et ces physiciens auraient sans trop de problème abandonné les autres sciences à leurs efforts humains, trop humains de se tailler des objets dans le tissu confus de la réalité commune. Elles font ce qu’elles peuvent, mais ce qu’ils défendaient quant à eux avec virulence était la « réalité physique », une réalité à laquelle les autres sciences doivent allégeance. Finalement, le pouvoir dont se targue la sociologie selon Latour était le reflet symétrique inverse du pouvoir dont se targue la physique, et c’est à partir des questions posées par ce type de conflit de pouvoir que se situe Cosmopolitiques. Et cela sans prendre appui sur le pouvoir de la critique.
Cosmopolitiques est un travail spéculatif en ce qu’il met à l’œuvre des concepts opérants, qui s’adressent à l’imagination et tentent de la mettre en branle sur un mode qui vide de toute grandeur tragique l’alternative qui nous empoisonne : ou bien les sciences sont les pratiques grâce auxquelles les humains découvrent progressivement ce que demande l’intelligibilité du monde, ou bien leur savoir est une simple fabrication humaine. Mais cela non pas au nom d’une conception apaisée des sciences – conception qui ambitionnerait de devenir consensuelle –, mais en interrogeant ce que peut signifier une pratique, en prenant au sérieux ce terme, en intensifiant donc le contraste entre « pratique » et « simple fabrication ». Ce contraste n’est pas propre aux sciences, bien au contraire, mais il ne s’agira jamais d’affirmer que les sciences sont des pratiques « comme » les autres. Chaque pratique pose la question de savoir à quoi elle oblige ses praticiens.
Depuis Cosmopolitiques, le concept d’obligation ne m’a jamais quittée. Il est inséparable de ce que j’ai appelé l’écologie des pratiques, la possibilité d’une culture d’interdépendance entre pratiques obligées sur des modes divergents, dont la condition est que les praticiens sachent se présenter sur ce mode, et non armés de mots d’ordre universels, qui, chaque fois, impliquent une promotion de l’exceptionnalité humaine.
En revanche, un autre opérateur apparaît dans ces pages qui, lui, n’a pas survécu. En 1996, au moment où je commençais l’écriture de Cosmopolitiques, Latour avait publié Sur le culte moderne des dieux faitiches5 qui situait la guerre des sciences comme une tragi-comédie, répétant la véritable tragédie qu’a constituée la destruction des cultures fétichistes par ceux qui, de fait, sont alors devenus des « Blancs ». Ceux qui découvraient chez les peuples « colorés » des cultes adressés à des « objets » tout à la fois présentés comme fabriqués et comme de véritables divinités ne pouvaient même pas penser ces cultes comme hérétiques. Il ne s’agissait que de superstitions à détruire. Les Blancs brisent les fétiches ou alors les mettent au musée. Et ils rapportent en Europe la notion polémique de fétichisme que la critique utilisera chaque fois qu’elle accuse un adversaire de « croire » au pouvoir autonome de ce qui n’est, de fait, qu’une fabrication. Vous croyez que la réalité a le pouvoir de vous mettre d’accord mais ce que vous appelé réalité, de fait, a été fabriqué par votre accord.
Les « faitiches » de Bruno Latour, comme leur nom l’indique, sont directement liés aux pratiques scientifiques, à ces praticiens qui, tout à la fois, construisent des faits et prétendent que ces faits ont le pouvoir de rendre intelligible ce à quoi eux-mêmes s’adressent. Mais, contrairement aux fétichistes, ces faitichistes ne pouvaient répondre avec tranquillité à ceux qui prétendaient expliquer en termes sociaux leurs constructions : « Bien sûr nos faits sont construits et nous consacrons toute notre attention à “bien” les construire, de sorte que l’intelligibilité qu’ils rendent possible, c’est à eux que nous la devions. »

Dans Cosmopolitiques, j’ai fait le choix de caractériser ce qui fait penser et travailler les scientifiques comme des « faitiches », terme que Latour lui-même a très vite abandonné6. Les faitiches habitent le paysage exploré par ce livre car ils différencient les pratiques scientifiques de toute démarche se prévalant d’une méthode générale, exportable partout. Les faitiches situent et sont situés, ce qui n’est pas le cas de « faits » produits par des sciences qui se donnent le droit de soumettre unilatéralement ce à quoi elles s’adressent à une méthode garantissant leur objectivité. Aujourd’hui de telles sciences dominent le paysage, notamment lorsque les « faits » se réduisent à des données qu’il faut pouvoir extraire d’une situation pour répondre à une question, que celle-ci soit d’ordre scientifique, commercial ou politique. Ces sciences, aussi outillées soient-elles, ne sont pas ce que j’appelle des pratiques : elles ne confèrent pas à ce à quoi elles s’adressent le pouvoir de les obliger, de les faire diverger d’autres modes de pensée sans pour autant prétendre les disqualifier.
Cosmopolitiques se concentre sur les sciences en tant que pratiques scientifiques parce que celles-ci posent des questions telles que : comment l’appartenance à cette pratique fait-elle imaginer, agir ou penser ? À quoi oblige-t-elle ses praticiens ? Mais aussi qu’exige-t-elle du milieu dont elle dépend ? Et ce sont de telles questions qui ouvrent à un possible spéculatif. Si, au lieu de se présenter armés de ces mots d’ordre que sont la rationalité, l’objectivité, la méthode ou les données, les scientifiques qui le peuvent avaient su se présenter en praticiens, la guerre des sciences n’aurait pas eu lieu. Mais d’autre part la référence à « la Science » n’aurait pu jouer le rôle antipolitique d’autorité exigeant le respect du public. Une autorité qui entend bien se conserver alors même que, aujourd’hui, ses institutions sont devenues un milieu hostile à ce qu’exigent les pratiques scientifiques.
La notion de pratique, telle que je la propose, a ceci de particulier qu’elle affirme la possibilité de leur destruction. Les pratiques sont mortelles. Si leur milieu devient hostile à leurs exigences, ou si les praticiens eux-mêmes trahissent leurs obligations, elles peuvent être détruites. À la fin de Cosmopolitiques résonne un cri : si vous décidez ceci, vous nous détruirez. Ce cri, on peut l’entendre désormais partout, et non plus seulement dans les terres de colonisation. Et peut-être les pratiques dites modernes sont-elles plus vulnérables à la destruction que celles qui ont été la cible des briseurs de fétiches d’antan. Car si elles ont survécu, c’est parce qu’elles ont pu déguiser leurs obligations en prétentions respectables et consensuelles, devenir parties prenantes de la conception du progrès au nom de laquelle d’autres, innombrables, ont été détruites.
C’est après Cosmopolitiques, notamment dans La Vierge et le Neutrino, puis dans Une autre science est possible !, que j’ai exploré les conséquences, pour les sciences, de cette transformation du milieu que l’on appelle moderne7. Avec ce qu’on appelle l’économie de la connaissance, la redéfinition de la Science comme devant servir la croissance, ce qui était, pour les praticiens, des obligations à respecter est devenu privilège à démanteler. Pour eux, comme pour beaucoup d’autres, « la fête était finie. » Ils allaient devoir se soumettre aux impératifs de la flexibilité et de la disponibilité. Et ce qui leur a été demandé peut, pour le coup, être soupçonné de n’être « que » des fabrications », y compris, d’ailleurs, de plus en plus souvent, des fabrications douteuses, voire frauduleuses. C’est l’ironie de l’histoire que les analyses critiques qui ont suscité la « guerre des sciences » aient quitté la sphère des publications académiques mais soient devenues matière à scandale public. Hier les scientifiques accusaient les critiques d’empoisonner la confiance d’un public défini comme « vulnérable à l’irrationalité ». Mais ce poison, dont on peut mesurer aujourd’hui le caractère redoutable, n’a-t-il pas été généré d’abord par la manière dont les scientifiques se sont soumis, de manière plaintive, certes, mais paralysées par les mots d’ordre qui fabriquent une Science consensuelle, apolitique ?
La question « De quoi leur appartenance à une pratique peut-elle rendre les praticiens “modernes” capables ? » a également changé de sens. Les pratiques modernes telles que nous les connaissons ne peuvent être dissociées du milieu désertifié où leurs seuls interlocuteurs effectifs ont été l’État et les entreprises. Les praticiens modernes, lorsqu’ils se présentent à un public dit « non compétent », le font aujourd’hui encore avec les mots d’ordre qui ont assuré leur survie : rationalité, objectivité, méthode, en tant que clef de tout progrès. Ils se présentent comme représentant la Science, qui n’est pas une pratique car elle n’oblige à rien mais permet de revendiquer le respect d’un public appelé à honorer ce progrès dont, qu’il le veuille ou non, il est le bénéficiaire. La question posée par Cosmopolitiques était : les praticiens scientifiques pourraient-ils devenir capables de se débarrasser des mots d’ordre, de se présenter avec ce qui les oblige ? Elle est désormais : peuvent-ils se joindre à l’ensemble de ceux qui, aujourd’hui, vivent la destruction de leurs pratiques ? C’est-à-dire aussi : peuvent-ils se débarrasser de la référence à la cause qui leur a fait accepter de se présenter au nom du progrès ? Beaucoup aujourd’hui pourraient reconnaître que le progrès promis est tout sauf assuré, mais, diront-ils, cela nous donne les moyens d’accomplir ce qui importe vraiment, faire avancer la connaissance. Et c’est peut-être là le prix dont doit se payer la possibilité de ce que Bruno Latour a appelé un « devenir terrestre » des sciences : rompre le lien entre connaissance et avancée. Devenir terrestre, c’est ne plus considérer la Terre comme le site contingent donné à l’Homme pour entreprendre ce qui serait sa véritable vocation, comme un terrain de conquête pour un savoir qui la transcende. Elle demande des praticiens qui se laissent obliger, avec d’autres, au risque des autres, à « ravauder » ce qui a été saccagé8. Et c’est la pluralité intrinsèque des pratiques scientifiques qui serait alors ce dont la culture s’impose, et cela sur un mode activement situé, qui donne à toute situation problématique le pouvoir de faire penser ensemble tous les protagonistes que concerne ce ravaudage, ce retissage de liens qui aient une chance d’avenir. Leur pratique rendra-t-elle les scientifiques capables d’apprendre à se laisser obliger par une situation, c’est-à-dire aussi à entrer en rapport pertinent avec des partenaires, humains ou non humains, exigeants, demandant de voir respecté ce qui leur importe, la manière dont ils font ou peuvent faire monde les uns avec les autres ? C’est cette question que j’ai mise sous le signe de ce terme, volé à Kant, de « cosmopolitique ».
Rétroactivement, Cosmopolitiques fait charnière entre les questions qui se posent aujourd’hui et l’expérience passée de ma collaboration avec le physicien Ilya Prigogine, qui a abouti à l’écriture de La Nouvelle Alliance où, déjà, la question de la pluralité des savoirs était en jeu. Cette collaboration a été possible parce que les deux coauteurs ont respecté la distinction entre pratiques, la divergence de ce que j’ai depuis nommé leurs obligations. Prigogine pouvait être passionné par la temporalité irréductible des vivants mais son travail était celui d’un physicien, hérétique aux yeux de la plupart de ses collègues car son ambition était de rouvrir un dossier triomphalement clos, qui a fait de la physique la science des lois auxquelles la nature est soumise. Mais pour cela – pour « ramener la physique sur terre » –, il devait en passer par les obligations de sa science, et tenter de montrer qu’elles pouvaient être reformulées. Quant à moi, en tant que philosophe, j’ai appris à reconnaître la force de ces obligations mais à ne pas leur donner le pouvoir d’expliquer une histoire qui n’a cessé de réinventer passionnément sa propre continuité. J’apprenais à m’étonner de l’histoire qui, oubliée des physiciens, a fait d’eux ce qu’ils sont devenus. On pourrait dire que, pour les physiciens de notre époque, cette histoire elle-même a pris le pouvoir d’un faitiche, les obligeant à ne pas trahir la quête, commencée avec Newton, de lois qui définissent la réalité – non pas seulement la réalité telle que l’interrogent les physiciens dans leurs laboratoires ou leurs observatoires, mais celle en général de tout ce qui existe, au-delà des apparences.

Quatre des sept volumes (désormais des parties) de Cosmopolitiques mettent en scène des manières de raconter certains moments de cette histoire sur un mode qui n’a pas pour but de démystifier la quête des physiciens mais de la caractériser dans sa singularité propre. Il ne s’agit donc pas de « briser » le faitiche qu’est désormais cette quête, d’expliquer leur ambition en des termes qui insulteraient les physiciens. Il s’agit de leur proposer d’accepter ce que savent les fétichistes : nous fabriquons nos fétiches et ils nous donnent ce que nous n’aurions pas, et ne serions pas, sans eux. La continuité de la quête est une fabrication, sans cesse reprise à nouveaux frais par ceux qui la réinventent et en font argument, y compris Ilya Prigogine, et cela sur des modes chaque fois différents, mais jamais réductibles à un ordre de causalité générale, qu’elle soit rationnelle ou sociale. Cette continuité n’est pas arbitraire mais contingente, comme toute histoire. Et comme cette histoire associe indissociablement « réalité physique » et intelligibilité physico-mathématique, elle sera scandée par des « faitiches physico-mathématiques » : faitiche galiléen, faitiche énigmatique, faitiche divinatoire, faitiche problématique…
Faire mémoire de cette histoire, raviver son caractère événementiel mais aussi la manière dont elle a fait penser et travailler les physiciens, c’est aussi résister à la manière dont la « réalité physique » qu’elle promeut peut devenir une référence s’imposant à tous, ou faisant autorité en droit. Des notions qui ont été un enjeu pour les physiciens deviennent alors d’usage libre et gratuit, dotées d’une évidence pseudo-intuitive, qui n’engage ni n’oblige à rien. On le verra dans la deuxième partie de ce livre, c’est le cas en particulier pour la notion d’« état », devenue notion tout terrain. Si nous pouvions connaître l’« état » du système nerveux central, nous pourrions… », peut-on entendre à l’occasion, et il ne s’agit pas d’un rêve irréalisable mais avant tout d’une bêtise assez monstrueuse. Les notions issues de la physique voyagent à travers le paysage des sciences mais à la manière d’abstractions prédatrices, inoculant à leurs proies des poisons paralysant leurs capacités à apprendre à quoi oblige ce à quoi s’adressent ces sciences.
C’est pourquoi Cosmopolitiques diffère de La Nouvelle Alliance : le passé n’est pas là pour mettre en scène la nouvelle pertinence de la physique devenue capable de ne plus nier ce que requièrent les sciences terrestres : non des lois mais des histoires génératrices de nouveauté. La « nouvelle alliance » n’est pas annoncée par « le physicien », s’engageant, tel Yahvé après le déluge, à ne plus détruire ce qui se rebelle à Ses lois et faisant de l’arc-en-ciel le signe de Son alliance avec la terre (Genèse 9, 8-13). Cosmopolitiques tente de faire exister sur un mode spéculatif ce que demanderait une pluralité positive des pratiques scientifiques, capables en elles-mêmes et par elles-mêmes, de ne pas se laisser nier. Et cela non pas au nom d’une forme d’autarcie méthodologique permettant à chacune de prétendre à une intelligibilité enfin scientifique, mais parce que chacune aurait donné à ce à quoi elle a affaire le pouvoir de l’obliger, et aurait reçu en retour la capacité de devenir elle-même, c’est-à-dire aussi de se lier à d’autres sans subordination, selon ses contraintes propres. Non plus une hiérarchie des sciences, ou des faits, mais une écologie de pratiques qui, sachant se situer, sachant ce qui les nourrit et ce qui les empoisonne, savent aussi entrer en rapport les unes avec les autres, chacune capable de donner un sens propre à ce rapport.
Les faitiches expérimentaux ont fait des expérimentateurs des praticiens. Ils sont issus de réussites singulières, l’invention de dispositifs conférant à « ce qui est interrogé le pouvoir de conférer à l’expérimentateur le pouvoir de parler en son nom9 ». Et c’est ce type de réussite qui oblige l’expérimentateur, lui interdit de soumettre ce qu’il interroge à une méthode générale : c’est ce qu’il interroge qui lui a conféré le pouvoir de le définir ainsi et pas autrement. Mais tenter de penser ce que demande une pluralité positive des pratiques scientifiques, c’est refuser de généraliser la réussite expérimentale. Et un cas très particulier ici est celui de la biologie du xxe siècle, car elle a semblé prendre la voie royale qui articule définition et explication. Elle a cru pouvoir définir son objet sur le mode d’un faitiche expérimental, qui attribuait aux gènes le pouvoir d’expliquer l’organisme, la sélection ayant, elle, le pouvoir d’expliquer l’équipage génétique des lignées vivantes. Cependant plus leur appareillage expérimental s’est sophistiqué, plus leurs faits se sont affinés, plus les biologistes ont dû prendre acte du divorce entre décrire et expliquer. Toute explication était circonstancielle. Rien de ce que le laboratoire a pu caractériser comme participant activement à un fonctionnement vivant ne pouvait expliquer par lui-même comment il remplit la fonction qu’on lui attribue, car l’explication était toujours relative à une situation impliquant d’autres participants. Rien ne pouvait donc être défini par sa fonction ou son rôle. Aujourd’hui, ce qui explique n’est plus le génome, ni non plus le protéome. On parle désormais de métabolome et de la multiomique qui articulerait tout cela. Bref, comment un vivant réussit à « tenir ensemble » est devenu une question ouverte.
La sixième partie de Cosmopolitiques cherche à caractériser ce qui pourrait permettre aux biologistes d’accepter positivement la déception que les vivants n’ont cessé d’imposer à leurs ambitions explicatives. Que le biologiste soit obligé par le vivant pourrait signifier que la réussite, dans ce cas, ne désigne plus d’abord le biologiste qui aurait réussi à expliquer mais renvoie au vivant lui-même. Jamais le biologiste ne fera du vivant un objet qu’il aurait le pouvoir de définir, car ses définitions présupposent l’événement « ça tient ». Il apprendra plutôt à rendre intelligible l’émergence contingente de manières de tenir, ce qui signifie aussi à la mettre en histoire. Une histoire intelligible n’explique pas l’événement mais elle peut caractériser ce qui pouvait être un terrain prometteur, rendant possible ce type d’événement. Et si les faitiches propres à une biologie qui apprend à raconter étaient des faitiches non pas expérimentaux mais « prometteurs », suscitant l’appétit pour une exploration des réussites du vivant qui ne seraient ni explicables ni miraculeuses, mais peuvent devenir intelligibles ?
La biologie qui s’est développée au cours des deux dernières décennies pourrait bien donner un sens à cette hypothèse. Elle met en effet les événements de mise en relation multispécifique d’interdépendances, de mutualisme, de symbiose au cœur de l’intelligibilité que réclame la vie. Lorsque le biologiste Scott F. Gilbert écrit, « La nature pourrait sélectionner des “liens” plutôt que des individus ou des génomes. Ce que nous avons l’habitude de considérer comme un “individu” pourrait être un groupe multispécifique soumis à la sélection10 », le « pourrait » est crucial. Il n’est pas synonyme d’ignorance mais transforme en question la réponse monotone expliquant l’émergence d’un trait par sa sélection. La sélection importe mais elle ne permet pas de définir « comment » elle importe, ce qu’elle fait compter. Et ce faisant elle demande au biologiste l’appétit d’un enquêteur pour qui chaque terrain est promesse d’une nouvelle intrigue. Les biologistes d’aujourd’hui sont obligés à penser par ce à quoi ils ont affaire sur un mode propre, irréductible à l’idéal expérimental. Ils n’ont pas besoin de lutter pour une autonomie « méthodologique », ils reçoivent cette autonomie des questions que les vivants les obligent à poser.
Le problème posé par la septième (et dernière) partie de Cosmopolitiques est sans doute ce qui tout à la fois boucle la série et l’ouvre sur des questions dont je ne prévoyais pas, à l’époque, qu’elles allaient trouver des échos dans des mondes qui m’étaient peu familiers. J’avais appris de Tobie Nathan à affirmer la divergence entre les pratiques des thérapeutes et les pratiques scientifiques – quelles qu’elles soient –, et il était tout aussi clair pour moi que passer de la biologie aux sciences dites humaines et sociales, ce n’était pas passer de la « nature » à la « culture ». Mais ce qui m’intéressait avec ces dernières étaient qu’elles ne sont que très rarement mises en difficulté par ce à quoi elles s’adressent. Plus précisément, lorsqu’elles le sont, c’est dans la mesure où ceux et celles à qui elles s’adressent ont changé, n’acceptent plus les questions qui leur sont posées. La psychiatrie et la psychanalyse ont été mises en question par les mouvements homosexuels puis transgenres, comme aussi par les associations d’autistes. Certains aspects des tests cliniques censés produire des faits qui font la différence entre efficacité thérapeutique « objective » d’une molécule et simple « effet placebo » ont été contestés par les associations de malades du sida, et aujourd’hui ce type de test suscite des protestations vigoureuses venues notamment des groupes de personnes affectées par une hypersensibilité aux ondes. Et bien sûr le mouvement féministe a fait basculer dans le passé d’innombrables pseudo-évidences. Sans oublier, comme on l’a vu, la « faute heureuse », selon l’expression de Bruno Latour, des sciences sociales forcées à constater que les faits et preuves grâce auxquels elles pouvaient impunément expliquer les valeurs et attachements de n’importe quel groupe social ne suffisaient pas face à des scientifiques furieux.
En d’autres termes, ce qui met en difficulté ces sciences est l’adresse à des groupes qui ont gagné, ou sont en train de gagner la capacité de refuser de se taire ou de contester la manière dont on les a fait taire. La singularité commune des pratiques scientifiques telles que j’ai tenté de les caractériser est que le pouvoir de faire taire ce qu’elles interrogent est un danger reconnu. Comment elles comprennent les réponses qu’elles obtiennent est une autre histoire, mais elles ont pour obligation de réussir à donner à ce à quoi elles s’adressent le pouvoir de compliquer leurs jugements sur ce qui compte et ne compte pas. Mais, dans notre cas, ce sont des conflits de type politique et non leurs obligations propres qui forcent les scientifiques à apprendre à revoir leurs jugements.
Que les sciences sociales et humaines soient ainsi exposées à des dynamiques conflictuelles ne devrait pas être une surprise. C’est plutôt l’impunité qu’elles revendiquent qui doit nous rappeler leur contemporanéité avec une modernité qui a défini les attachements et les obligations pratiques comme foncièrement irrationnels, à considérer dans le meilleur des cas avec tolérance, mais sans se priver du droit de savoir mieux qu’ils ne le font ce qui fait sentir, agir et penser ceux et celles à qui elles ont affaire. C’est en ce sens que j’ai associé une obligation générique à la possibilité de pratiques dignes du qualificatif « scientifique » pour les scientifiques appartenant à ces champs : définir comme un piège la tentation d’adopter une position de tolérance à l’égard de ce que font importer ceux et celles à qui ils s’adressent.

 Douze graines d’espèces différentes, porteuses d’un élaïosome. Ces graines sont dispersées par les fourmis (myrmécochorie). Source : Wikimedia
Douze graines d’espèces différentes, porteuses d’un élaïosome. Ces graines sont dispersées par les fourmis (myrmécochorie). Source : WikimediaCertes la tolérance peut être considérée comme un « progrès » par rapport à la soumission extorquée ou la violence éradicatrice, mais c’est un progrès misérable. Ceux qui tolèrent ne demandent en général pas qu’on les tolère. Ils sont ceux qui peuvent « tout comprendre » mais ne peuvent être mis en question par rien. Et ce faisant, la tolérance participe d’un milieu où ne peut se poser la question qui devrait prévaloir lorsqu’il est question de pratiques, quelles qu’elles soient, c’est-à-dire d’appartenance à des collectifs faisant importer ce qui pour d’autres ne compte pas, la question qui donne sa dimension spéculative à Cosmopolitiques : « De quoi son appartenance à une pratique peut-elle rendre un praticien capable ? » Car un milieu « tolérant » ne peut percevoir le danger de trahison auquel expose cette question. Il y verra les symptômes d’une identité close, refusant le changement. Seuls d’autres praticiens peuvent sentir le risque existentiel pour des praticiens de rejouer le rapport entre ce que leur pratique exige et ce qui l’oblige, c’est-à-dire de donner à une situation questionnante le pouvoir de les faire hésiter quant à ce qu’impliquent leurs obligations.
C’est le sens même d’une écologie des pratiques que la culture de ce mode d’hésitation – et elle prend un sens éminemment concret en ces temps où le ravage social et écologique fait balbutier tous les savoirs et où la question posée partout est celle de la manière de partager une perplexité inquiète et attentive – de ne pas rêver de solution mais d’apprendre, selon les mots de Donna Haraway, à « vivre avec le trouble ». La Science ne nous sauvera certainement pas, mais les pratiques scientifiques elles-mêmes, afin de partager cette perplexité, auront à défaire le lien entre leurs obligations et le business as usual de l’« avancée de la connaissance » au nom de laquelle elles font le tri entre les questions qui comptent « vraiment » et les autres. En d’autres termes, elles auront à apprendre à se laisser affecter par ce que leurs pratiques les ont autorisées à négliger afin de devenir capables de présenter des propositions sur un mode que Haraway nomme « respons(h)able11 », la capacité de répondre d’une proposition, avec ses choix et ses enjeux, devant ceux qu’elle concerne, ne pas « tolérer » les objections mais de participer à une mise en commun qui lui donnera une signification, quitte à ce qu’elle soit modifiée, métamorphosée ou rejetée.
Cependant, et c’est ici que, enfin, le terme « cosmopolitiques » prend sens, tout n’est pas négociable entre « humains ». Ce que, répondant au « Parlement des choses » proposé par Bruno Latour12, j’ai appelé Parlement cosmopolitique implique de résister à l’idée grecque de la politique, qui ne met en scène que des savoirs, des intérêts et des passions humaines. Car même le Parlement des choses de Latour, peuplé de médiateurs s’activant à construire des liens explicites et négociés entre les exigences humaines et celles dont sont porteurs les non-humains, me semblait vulnérable à une soif des possibles à réaliser. La tolérance pouvait resurgir car l’approche d’un accord suscite la tentation de balayer les oppositions dites « non constructives ». « Cosmo » impliquait la nécessité d’une force de « rappel » destinée à freiner ce tri entre ceux qui font l’effort de s’entendre et ceux qui s’opposent de manière « stérile ». Tous ceux qui sont concernés par un possible n’en partagent pas la soif et la tentation est grande de rester sourds au cri : « Ce possible que vous négociez menace de nous détruire. »
Pour ne pas balayer avec une aimable tolérance des oppositions jugées « déraisonnables », le Parlement « cosmopolitique » doit entendre des « diplomates » qui se fassent la voix de ceux qui ne peuvent participer à une négociation où serait mis en jeu ce qui les oblige, ce qui fait d’eux ce qu’ils sont. Peut-être la décision sera-t-elle prise néanmoins, mais cela non avec la bonne conscience qui ajoute l’insulte à la souffrance. À cette époque je n’allais pas plus loin, mais ce qui est arrivé depuis répond un peu à l’expérience que décrit Leibniz : « Je me croyais arrivée au port, et me trouvais rejetée en pleine mer. » Le terme cosmopolitique a largué les amarres des rives modernes qui le situaient, vers les régions de la terre où il n’est plus seulement une force de rappel mais traduit la revendication d’une politique qui ne serait pas dérivée de ce qui s’est inventé en Grèce. Ceux que j’avais appelés diplomates ne portent plus alors la voix des victimes potentielles mais celle des Autres-qu’humains et de leurs peuples qui résistent à la destruction. Et cette pratique scientifique qu’est l’anthropologie suscite désormais des chercheurs qui savent que cette voix les requiert de prendre parti dans ce qui est désormais un combat « cosmopolitique », un combat où des mondes sont en jeu. Ils savent au demeurant que ceux à propos desquels ils étaient censés apprendre ne les accepteront que s’ils se rendent capables de rapports véritables, qui les exposent à la rencontre de forces qui les obligent à mettre en question leur propre savoir, les catégories qui leur permettaient d’interpréter le monde.
Cosmopolitiques répondait sur un mode spéculatif à une situation qui peut sembler désormais lointaine. Le possible qui me faisait penser – celui de praticiens sachant se présenter avec ce qui les oblige – pourrait apparaître une aimable plaisanterie, une conception « romantique » propre à faire ricaner ceux qui aujourd’hui sont formatés par des procédures de sélection et d’évaluation destinées à leur donner des habitudes de docilité et de disponibilité. Mais ce qui a surtout changé est que ce livre sait désormais à qui il s’adressait. Le pari de la spéculation ne s’adresse pas d’abord aux protagonistes anciens s’affrontant dans un paysage désertifié, mais à ceux qui, à l’époque, avaient assisté à un combat dont ils n’étaient que les spectateurs. Les praticiens dont je disais la possibilité ont besoin pour exister que le paysage se repeuple, comme il est en train de le faire. Notre époque brouille désormais les frontières qui séparaient la spéculation de la pensée dite sérieuse. Les gens sérieux aujourd’hui mentent ou se voilent la face. Ce qui hier était spéculation fait aujourd’hui partie de pratiques de type nouveau, engagées dans des luttes minoritaires, certes, mais qui, face au ravage écologique et social dont nous héritons, se sont mises en branle, sachant qu’elles doivent apprendre à sentir, à imaginer et agir les unes avec les autres, par les autres, au risque des autres. Seuls ceux qui « croient » au progrès font du passé ce dont on peut et doit faire table rase. Ceux et celles qui apprennent à résister ont besoin de penser et sentir que ce passé peut être rejoué, retissé avec un présent ouvrant sur d’autres possibles. Re-raconter un peu autrement, c’est raconter des histoires passées qui puissent, peut-être, participer à l’avenir.
Bruxelles, janvier 2022.
Notes
- Isabelle Stengers (1995 [1993]), L’Invention des sciences modernes, Paris, Flammarion coll. Champs p. 94[↩]
- Ce que Deleuze et Guattari défendent aussi à leur sujet dans les années 1990 dans Qu’est-ce que la philosophie ?, Minuit, Paris, 1991[↩]
- Isabelle Stengers (1995 [1993]), L’Invention des sciences modernes, Paris, Flammarion coll. Champs, p. 151[↩]
- Ce qu’à la suite de Deleuze et Guattari, Stengers nomme une « entre-capture ».[↩]
- Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux faitiches, suivi de Iconoclash, La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », Paris, 2009 (1996).[↩]
- Cet abandon marque notamment le fait que, pour Latour, la « guerre des sciences » a basculé dans le passé. Les faitiches sont devenus un cas particulier marquant la nécessité de sortir de la binarité générale sujet actif/objet passif qui affecte les théories de l’action. Celui qui agit, celui que nous appelons le sujet, n’est pas le maître de l’action, il agit mais est tout aussi bien et indissociablement agi, pris ou surpris, en tout cas dépassé par ce qu’il fait. Ce faisant il m’a d’ailleurs mise sur le chemin de l’« éloge de la voix moyenne » dans Réactiver le sens commun. Lecture de Whitehead en temps de débâcle (La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », Paris, 2020). Latour abandonnera d’autre part le terme de « construction », trop vulnérable à l’accusation polémique « ce n’est qu’une construction », pour celui, dû au philosophe Étienne Souriau, d’« instauration ». Souriau ouvre la porte à une ontologie pratique radicalement pluraliste. L’agent instaurateur ne crée pas, il est mis à l’œuvre par l’insistance de ce que nous appellerions aujourd’hui un « autre qu’humain », qui demande réalisation. Apprendre à bien parler des manières distinctes dont sont instaurés les êtres auxquels nous tenons et qui font de nous qui nous sommes est ce que Latour a proposé dans son Enquête sur les modes d’existence (La Découverte, Paris, 2012).[↩]
- Isabelle Stengers, La Vierge et le Neutrino. Les scientifiques dans la tourmente, Seuil, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2006. Isabelle Stengers et Thierry Drumm, Une autre science est possible !, La Découverte, coll. « Poche », 2017 (2013).[↩]
- Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », Paris, 2022.[↩]
- Isabelle Stengers, L’Invention des sciences modernes, Flammarion, coll. « Champs », Paris, 1995 (1993), p. 102.[↩]
- Voir Scott F. Gilbertet al., « Symbiosis as a Source of Selectable Epigenetic Variation : Taking the Heat for the Big Guy », Philosophical Transactions of the Royal Society B, vol. 365, 2010, p. 671-678, cit. p. 673.[↩]
- Voir Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Les Éditions des mondes à faire, Vaulx-en-Velin, 2020, notamment p. 65-67.[↩]
- Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La Découverte, Paris, 1991. Il faut rappeler que la figure du Parlement, dans les deux cas, n’est pas celle, moderne, où des représentants expriment leur version de l’intérêt général, et prennent des décisions en son nom, qui seront mises en œuvre par l’appareil d’État, mais convient à toute assemblée appelée à construire un problème, et qui, pour ce faire, réunit les voix divergentes nécessaires à l’exploration de ses tenants et aboutissants.[↩]