A propos de Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre, La perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire, Paris, La Découverte, collection « L’horizon des possibles », 2022, 325 p.
Proposer une notion rigoureusement construite du possible, qui puisse contribuer à la fois au renforcement des savoirs critiques et à la vitalité des aspirations à une transformation émancipatrice, telle est l’ambition forte, indissociablement épistémique et politique, du livre de Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre. Par l’ampleur des analyses, des enquêtes rassemblées et des propositions, voilà un ouvrage important, qui devrait contribuer au renouvellement de nos manières de penser et d’agir et qui, à ce titre, mérite d’être amplement discuté.
La « perspective du possible » que les deux auteurs s’efforcent de construire, à partir d’un point de vue situé mais néanmoins ouvert à une indispensable pluralité, suppose une lutte à double front. D’un côté, il s’agit, contre les injonctions d’un réalisme qui prône la soumission à l’état de fait, d’assumer résolument la notion de possible et d’en faire une arme critique pour rompre l’apparente fatalité du réel et la naturalisation du monde social. Alors que toute forme de domination fait de l’ordre existant l’expression de la nature des choses ou l’effet d’une nature humaine supposée, la notion de possible est au cœur de l’attitude critique qui y décèle une réalité historique et contingente, ainsi arrachée au registre de la nécessité : « le possible (…) se caractérise par l’idée d’un pouvoir-être-autrement » et « d’une transformabilité de l’objet soumis à la critique » (p. 13).
Mais, d’un autre côté, il s’agit de tenir à distance une conception sous-déterminée du possible qui en atténuerait la portée – autrement dit, un possible étendu à tout ce qui est pensable et imaginable, sans être nécessairement réellement possible. D’où l’effort pour assumer pleinement la notion de possible, tout en se démarquant des formes abstraites de l’imagination utopique (fort pertinentes et objets d’enquêtes nécessaires, mais qui doivent être tenues à distance de la perspective critique qu’il s’agit ici d’élaborer). Assumer l’utopie comme ouverture des possibles face à la clôture qu’entend produire l’ordre social et politique, tout en revendiquant l’attention aux conditions de réalisation de ces possibles et la nécessité d’enquêtes empiriques susceptibles d’éclairer ces conditions, voilà ce que tentent Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre. En quête de ce que l’on pourrait appeler un utopisme réaliste, ils tracent le cap des possibles dans un entre-deux, toujours attentifs à éviter les écueils aussi bien à bâbord qu’à tribord. Ainsi, « les possibles en quête desquels nous partons n’ont rien de ces possibilités abstraites ou de ces probabilités réelles. La perspective du possible, telle que nous entendons ici la construire, se loge au contraire dans un espace situé entre la normativité affichée des utopies théoriques et la modélisation purifiée des projections savantes » (p. 19).

Cette dernière mention renvoie au fait que le possible n’est pas intrinsèquement un concept critique et émancipatoire. Comme tous les concepts, il est un champ de bataille. Ainsi, en définissant la politique comme « l’art du possible », Bismarck embarquait le possible du côté du pur pragmatisme – à quoi Karl Liebknecht répondit, dans ses notes de prison (1916-1918), en qualifiant la politique d’« art de l’impossible » et en affirmant, de manière plus frappante encore, que c’est seulement en aspirant à l’impossible que l’on peut atteindre « la réalisation de l’extrême possible ». Il est donc très salutaire que le premier chapitre du livre rappelle les usages du possible dans le cadre des techniques de gouvernement (de soi et des populations). Sur le premier versant, la notion de « potentiel humain », qui remonte à la fondation de l’Institut Esalen aux États-Unis, en 1962, joue un rôle central dans la diffusion de modes de subjectivation calés sur les logiques économiques de la performance et sur les idéaux de dépassement de soi et d’illimitation, qu’on retrouve aussi bien dans les méthodes de management que dans la littérature de développement personnel. S’agissant du gouvernement des possibles, on peut noter que la belle époque de la planification, entre 1945 et les années 1970 a laissé place ensuite à une crise de la prévision (laquelle supposait une stabilité et un degré de certitude qui s’éloignent de plus en plus) et à une relève par la prospective, centrée sur la pluralité des scénarios. Mais, dans le même temps, l’essor de l’informatisation et bientôt des algorithmes a conduit à une amplification des formes d’anticipation, par lesquelles on cherche à « modéliser, anticiper et affecter par avance les comportements possibles », y compris par le profilage préventif des individus. Ainsi, la projection dans l’avenir et la volonté de maîtrise des possibles tiennent une place importante dans l’exercice du gouvernement, qui a aussi ses « experts de l’avenir », dont les travaux, cependant, entretiennent le sentiment d’incertitude plutôt qu’ils ne le réduisent. Au total, on observe une « situation contradictoire qui place les individus des sociétés contemporaines face à un double bind, dans l’obligation de se réaliser pleinement en restant privés de capacité d’agir, contraints de parier sur l’avenir en l’observant leur échapper » (p. 59).
A partir de là, et afin d’arracher la notion de possible à sa gestion par les algorithmes et les experts de la gouvernementalité, le livre se déploie en deux volets articulés par un interlude : le premier est consacré à l’archéologie philosophique du possible comme notion critique et émancipatoire ; le second esquisse les différents champs d’enquête d’une science sociale des possibles.
Archéologie philosophique du possible
Les premiers chapitres situent au début du 20e siècle l’émergence d’un concept critique et émancipatoire du possible. Cela suppose de remonter à Karl Marx et à Max Weber (chapitres 2 et 3), pour saisir comment Georg Lukács (chapitre 4) et Ernst Bloch (chapitre 5), élaborent, à partir d’eux, une pensée du possible.
La pensée du possible, chez Marx, est marquée par la référence à Hegel et à l’usage que celui-ci fait de la distinction entre possibilité abstraite (étendue au pensable, indépendamment de ses conditions de réalisation) et possibilité concrète (attentive aux conditions de sa réalisation). Dans L’Idéologie allemande, le communisme est défini comme le « mouvement réel qui abolit l’état de choses actuel » et non comme un « idéal sur lequel la réalité devra se régler », ce qui invite à partir de la connaissance du présent pour dégager les possibilités concrètes inscrites dans le réel, plutôt que de postuler un plan idéal et abstraitement établi. S’esquisse ici la posture de Marx (et Engels) envers la tradition utopique, récusée par une approche qualifiée de scientifique. Il faut pourtant reconnaître, ainsi que l’a montré notamment Miguel Abensour, tout ce que Marx doit à cette tradition, dont la critique est menée moins de l’extérieur que de l’intérieur. Marx en assume l’orientation vers un futur émancipateur, mais critique son manque d’ancrage dans l’histoire – à quoi il oppose une approche des possibilités immanentes, inscrites dans les tendances du présent lui-même. Mais toute la difficulté est que ces possibilités immanentes situées dans le réel risquent de se transformer en une nécessité, portée par le sens de l’histoire.
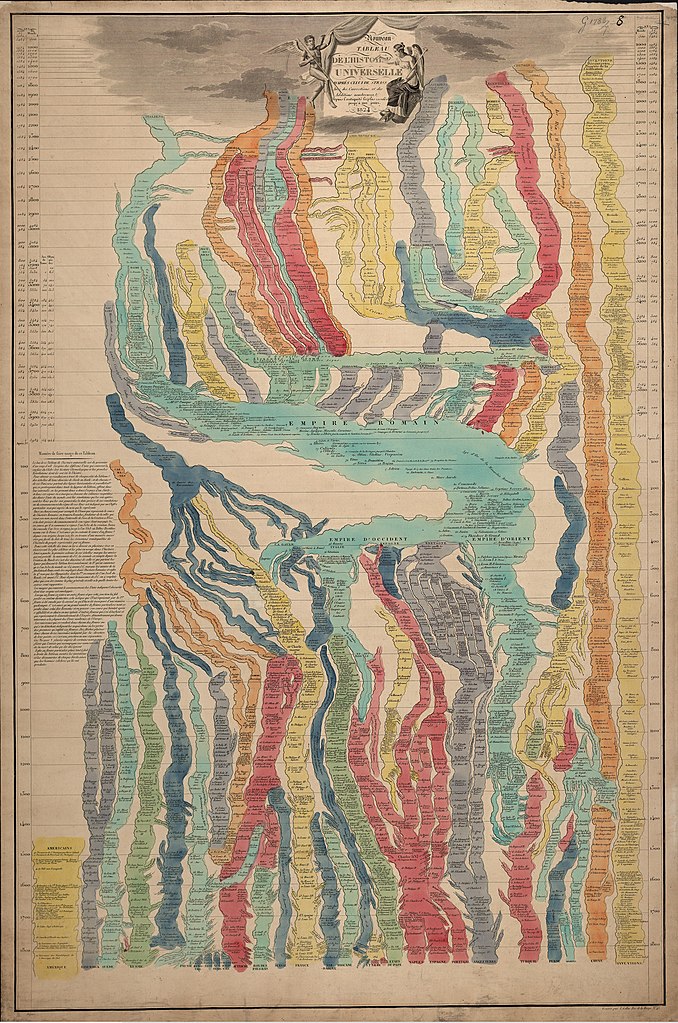
Max Weber, quant à lui, élabore la catégorie de « possibilité objective » – laquelle doit être comprise au sein de sa théorie de l’idéal-type. Elle implique de faire une place à ce qui n’a pas eu lieu, mais « aurait pu arriver » si les conditions avaient été différentes. Il s’agit là du raisonnement contrefactuel, qui fait place aux possibles non advenus et que Weber tient pour indispensable à la formation d’un véritable savoir scientifique, capable d’identifier des déterminations causales et d’en mesurer le poids. Il existe donc chez Weber une priorité du possible sur le réel, mais il faut bien voir que les « possibilités objectives » doivent être situées dans le registre de la connaissance et non dans le réel lui-même. Elles relèvent d’une construction propre à l’analyse et à l’élaboration idéal-typique qui la sous-tend.
C’est par le nouage qu’il opère entre Marx et Weber que le philosophe hongrois Georg Lukács produit, dans Histoire et conscience de classe (1923), « la première élaboration » d’un « concept critique et émancipatoire du possible » (p. 124). Initialement disciple de Weber, il insère la notion de possibilité objective au sein de la théorie marxiste, afin notamment de penser la conscience de classe, négligée par Marx. De fait, le concept que Lukács en produit n’est pas de l’ordre de la conscience empirique attribuable à la somme ou à la moyenne des individus qui composent le prolétariat. Relevant plutôt de l’idéal-type, elle est une « conscience imputée », correspondant à ce que serait la pleine conscience d’une situation objective et des intérêts qui en découlent. Comme le soulignent les auteurs, cette démarche est un « coup de force », car elle transpose Weber dans un cadre de pensée hégélien auquel le sociologue était radicalement opposé. Elle n’est pas non plus dépourvue d’ambiguïtés et de risques. En effet, le primat de la conscience imputée sur la conscience empirique ouvre la voie à une prérogative du théoricien ou de l’avant-garde, capables de déterminer cette conscience imputée dont la plénitude demeure inaccessible aux prolétaires eux-mêmes. Cela paraît préfigurer le ralliement de Lukács aux conceptions centralistes de Lénine, alors qu’il était initialement proche de celles de Rosa Luxembourg. Par ailleurs, Lukács maintient la position anti-utopiste de Marx et Engels, de sorte que le possible est pour lui un contre-concept de l’utopie.
Bien qu’ayant également appartenu au Cercle Max Weber de Heidelberg, Ernst Bloch prend un chemin radicalement différent. Il est l’un des premiers au sein de la tradition marxiste à restituer une dimension positive à l’utopie. Il le fait en assumant la dimension utopique du marxisme lui-même, entendu comme « utopie concrète », inscrite dans l’analyse immanente de la réalité, par opposition aux « utopies abstraites », détachées du réel et réduites à des vœux pieux (« wishful thinking »). Bloch entend privilégier ce qu’il appelle le « possible objectivement réel », c’est-à-dire un possible inscrit dans les tendances de la réalité présente, sans pour autant être (encore) réalisé. Pour l’auteur du Principe Espérance, œuvre monumentale en quête des aspirations non accomplies du passé, le possible objectivement réel est ce qui est présent dans le réel, sous l’espèce d’un Pas-Encore : sans être encore advenu, il se trouve contenu dans les « propriétés utopiques, chargées de futur, de la réalité », et notamment dans les aspirations utopiques à une vie meilleure. Ainsi, loin d’opposer possible et utopie, Bloch fait du possible l’autre nom de l’utopie : chez lui, « l’utopie n’est plus un contre-concept du possible qui, de son côté, ne revêt plus de ‘fonction anti-utopique’ » (p. 136). Possible et utopie sont au contraire des concepts corrélés permettant de penser, selon une formule de Bloch, la « nature fondamentalement utopique du possible ». Le concept du possible et l’ontologie du Pas-Encore-Advenu apparaissent ainsi comme le fondement de « la transformabilité du monde, ce qui seul autorise une pensée de la révolution et de l’espérance » (p. 137).
Le possible comme concept philosophique à vocation critique apparaît donc au début du 20e siècle, sous la plume de Lukács et, sous une forme très différente et sans doute chargée d’une fécondité plus actuelle, chez Bloch. Cette archéologie philosophique est complétée, dans l’interlude de l’ouvrage, par un autre fil qui court à travers l’histoire des sciences sociales. On y repère une tradition possibiliste en grande partie oubliée, qui va de Gabriel Tarde (dont Les possibles affirment déjà, en 1874, que « le possible fait partie intime du réel » et que «l’intelligence des faits exige la connaissance des possibles ») à Luc Boltanski, en passant par de nombreux auteurs comme Lucien Goldmann, Henri Lefebvre, Charles Wright Mills, Charles Tilly ou Immanuel Wallerstein qui, tous, entendent élargir l’objet des sciences sociales aux potentialités du réel, voire se soucient, comme Albert Hirschman, d’une attention aux mécanismes sociaux concrets qui tendent à infléchir le cours attendu des processus historiques pour faire advenir des possibilités inattendues.
Les possibles comme terrains d’enquête
Quatre chapitres explorent différents champs d’enquête, tout en s’appuyant, à chaque fois, sur l’œuvre marquante d’un sociologue. Dans le chapitre 6, sont esquissées les variations historiques des imaginaires utopiques, avec notamment le fort essor des dystopies dans la première moitié du 20e siècle, puis la reprise du genre proprement utopique à partir des années 1960. Et tandis que persistent les critiques adressées à l’utopie, en raison de son caractère de perfection idéalisée, d’élaboration a-historique ou de modèle uniforme conduisant à l’autoritarisme, un « nouvel esprit utopique » (Miguel Abensour) s’emploie alors à lui rendre sa vitalité en la démarquant du mythe d’une société parfaite et en acceptant une forte indétermination de ses contours. Il s’agit, par ailleurs, d’assumer le réel des utopies, en considérant leurs aspirations comme un élément déterminant de la réalité sociale, comme les travaux de Michèle Riot-Sarcey l’ont montré pour le 19e siècle. Plus que comme un corpus de théories, l’utopie doit être considérée comme un ensemble de faits sociaux bien tangibles, comme « une virtualité nouvelle de la politique et de l’histoire, une ressource latente à la disposition des révoltés d’hier et de demain » (p. 183). D’où l’importance accordée ici à l’œuvre du sociologue hongrois Karl Mannheim1, l’un des premiers à proposer, dès 1929, des hypothèses encore pertinentes sur la mentalité utopique et son histoire. Pour lui, l’esprit utopique (ou « utopisme ») est bien davantage que le genre littéraire inauguré par Thomas More. C’est tout ce qui s’oppose à l’ordre existant ou ne coïncide pas avec lui, faisant de cette non-congruence le point de départ d’un « passage à l’agir » qui, comme le dit Mannheim, « dévaste partiellement ou entièrement le régime ontique du moment », c’est-à-dire la configuration de l’existant. Il distingue au sein de l’utopisme contemporain quatre formes principales (millénariste ou chiliaste, par la recherche d’une conversion immédiate et extatique de l’expérience ; libérale, escomptant des transformations qui s’accomplissent sous l’effet du Progrès ; conservatrice, ancrée dans un contre-projet refusant la modernisation ; socialiste-communiste, promue par l’activité stratégique et trouvant son aboutissement dans le bolchévisme) ; et il en étudie les fluctuations historiques, décelant le risque d’un affaiblissement de l’esprit utopique par stérilisation, fragmentation et auto-destruction, ainsi que par l’effet d’un renforcement tendanciel du réalisme politique. C’est ce type de diagnostic sur l’état de l’esprit utopique et la diversité de ses formes que la perspective du possible se doit d’actualiser en permanence.

Un autre champ d’enquête (chapitre 7) concerne les utopies réelles, « ces pratiques très variées qui incarnent déjà, en un temps et un lieu donnés, les alternatives aux organisations sociales dominantes et les expériences collectives préfigurant un monde désirable ». Quoi que différemment de l’imaginaire utopique, elles font indéniablement partie des possibles du présent, tout particulièrement dans le moment actuel qui paraît « à nouveau favorable à l’essor des utopies réelles » (p. 212). Mais l’enquête sur ces utopies doit aller plus loin que le simple constat de leur existence réelle, pour se demander dans quelle mesure elles peuvent perdurer, voire s’imposer face aux réalités dominantes, et quelles relations elles entretiennent avec le changement historique. Cette fois, c’est l’œuvre d’Erik Olin Wright qui est convoquée comme appui principal2. On y retrouve la combinaison – propre à la perspective du possible – entre une pleine acceptation de la vertu politique de l’utopie et une volonté d’arrimer cette dernière à une prise en compte des conditions de sa mise en œuvre et à l’approche empirique de ses manifestations. Sans revenir ici sur les débats auxquels peuvent donner lieu les propositions d’Olin Wright, on dira que les diverses critiques qui lui ont été adressées sont largement prises en compte ici, afin de contribuer à une reformulation partielle de l’étude des utopies réelles. Relevons seulement qu’Olin Wright concentre son attention sur les utopies réelles dotées d’un potentiel socialiste (celles qui, selon sa définition – discutable – du socialisme, augmentent le pouvoir d’agir des acteurs sociaux) ; mais surtout, il s’intéresse pour l’essentiel à celles qui sont fonctionnellement compatibles avec le capitalisme, car il considère que celles qui ne le sont pas « tendent à être neutralisées », d’où son choix d’exemples comme Wikipédia, les expériences de budget participatif ou la coopérative basque Mondragon. Il importe, enfin, de souligner l’insistance sur deux critères importants dans l’analyse des utopies réelles. Le premier tient à leur « viabilité », c’est-à-dire de leur capacité à durer en restant fidèles aux valeurs défendues, malgré les dysfonctionnements et les tensions éventuelles entre leurs différentes aspirations. Cela suppose des interrogations sur les conditions de possibilité, de persistance et de déploiement de ces expériences, avec notamment, au titre des facteurs limitatifs, la dépendance à l’égard d’un contexte spécifique ou le rôle d’une personnalité singulière – ce qui pose la question de la reproductibilité et de la transférabilité de l’expérience. Le second est celui de la « faisabilité » des utopies réelles, ce qui suppose d’analyser les résistances prévisibles, le pouvoir relatif des acteurs sociaux qui les soutiennent et de ceux qui s’y opposent, les stratégies permettant de contrer ces derniers et les conditions structurelles qui affectent les chances de succès de ces stratégies. Au total, « étudier les réalités des utopies ouvre ainsi une vue plus nette sur les possibles imaginés et vécus, de même qu’elle doit permettre de mieux apprécier leurs possibilités réelles et, en définitive, d’élargir les définitions du possible. En fonction des méthodes qu’elle déploie et de l’engagement du chercheur, l’enquête sur la réalité des utopies peut aussi servir directement la réalisation utopique et l’extension des possibles » (p. 228).
Le troisième domaine d’enquête (chapitre 8) conduit à s’interroger sur la différenciation sociologique des capacités d’anticipation et de projection vers le futur. En effet, si les sociétés humaines ont des rapports très diversifiés au futur, il faut souligner aussi que, dans le monde moderne, la capacité à espérer et l’accès au possible ne sont pas également partagés dans tous les milieux sociaux. C’est Pierre Bourdieu qui est ici convoqué, ce qui pourra surprendre, tant son œuvre est généralement associée à une insistance sur les déterminismes sociaux et les mécanismes de reproduction sociale. Pourtant, la question du rapport différencié à l’avenir est au point de départ de son œuvre, dans ses enquêtes algériennes, et la traverse tout entière. Ainsi, il décrit les sous-prolétaires algériens comme des « hommes sans avenir », condamnés à vivre dans les urgences de la survie, n’imaginant qu’un avenir déconnecté du présent, qui les voue à l’impuissance et au fatalisme3. A mesure qu’on s’élève dans la hiérarchie sociale, le lien entre avenir et présent se fait moins discontinu, et permet la formation d’un projet et une certaine liberté. L’ampleur du champ des possibles est donc corrélée à la position sociale, ce que confirme Les Héritiers, où l’ethos des classes populaires est décrit comme une forme d’auto-censure qui conduit à ajuster les espérances subjectives à un probable sociologiquement accessible4. Ce que Bourdieu appelle la « causalité du probable » relève d’une loi tendancielle des conduites humaines, selon laquelle « les espérances tendent universellement à s’accorder à peu près aux chances objectives ». Ainsi, les possibles ne sont pas également accessibles à tous – ni dans la réalité, ni même sur le plan des aspirations. Prendre en compte cette dimension pourrait être précieux, sans quoi on risquerait d’amplifier involontairement les inégalités dans le rapport au possible. En tout cas, il y a là une contribution majeure qui fait de l’accès au possible l’un des traits caractéristiques du pouvoir social et qui invite à considérer l’amplification de cet accès comme un objet central des luttes à mener. On notera à cet égard que le dernier Bourdieu, évoqué dans l’épilogue, fait place à une marge de liberté qui ne tient plus seulement à la connaissance des déterminismes sociaux, mais aussi à un certain jeu dans la correspondance entre espérances subjectives et chances objectives, dès lors qu’une capacité à s’emparer des possibles, favorisée par l’accès à l’éducation, peut mobiliser les énergies et conduire à faire advenir ce que la pure logique des probabilités tiendrait pour exclu.
Enfin, le dernier chapitre s’interroge sur les effets que l’actuelle poussée d’un sentiment apocalyptique, attisé par la catastrophe écologique, peut avoir sur les anticipations du futur. S’il est indéniable que l’époque est hantée par un nouveau possible, celui d’une fin des possibles, l’enquête s’emploie à montrer les formes multiples de l’inquiétude apocalyptique et des réactions qu’elle suscite. Il n’y a pas qu’une seule fin des temps et, dans le temps de la fin que nous vivons, où les crises deviennent quasi-permanentes, les comportements se déploient en une gamme éminemment diverse, sans dépolitisation unilatérale, ce qui, suggèrent les auteurs, contribue à une plus grande ouverture des possibles. Dans un tel contexte, « la perspective du possible consiste à faire voir, si elles existent, des possibilités neuves et réelles face à un horizon clos qui semble se rapprocher inéluctablement » (p. 256). Parmi les facteurs qui favorisent la relative créativité d’une époque marquée par la pesanteur des catastrophes, il faut considérer le fait que celles-ci créent plutôt « un temps dilaté », qui s’écoule lentement et « ne se matérialise pas en une synchronisation des temps vécus, comme c’est le cas dans les crises d’ampleur » (p. 268). Parmi la diversité des réactions, celles qui conduisent à la mobilisation et à l’action sont abordées à travers de nombreux exemples, comme dans les villes en transition, les luttes contre l’exploitation minière ou le renouveau des expériences néo-rurales qualifiées de millénaristes (au sens de Mannheim) – lesquelles sont repensées ici dans une perspective moins privative, comme sentiment de perte, que positive, par l’effervescence pratique qu’elles provoquent et par leur « force de reconfiguration des possibles ». Au total, malgré la menace d’une fin des possibles, l’horizon de la catastrophe donne plutôt lieu à une réouverture des imaginations, des scénarios et des possibilités concrètes. Le possible reste un front de lutte qui tend à s’amplifier, sous l’effet de l’hypothèse eschatologique et du recul de l’idéologie du progrès qui permet de démultiplier les rapports à l’avenir, tandis que la recherche d’autres relations au monde vivant invite à sortir des limites ontologiques du monde moderne. Plutôt qu’un facteur de dépolitisation, la menace de la catastrophe apparaît comme un opérateur de mobilisation et d’engagement, dont la perspective du possible se doit d’explorer la diversité des modalités.
Aux frontières du possible et de l’impossible : une question ouverte
Au total, c’est en rassemblant de multiples domaines d’enquête, depuis les utopies réelles jusqu’aux sentiments néo-apocalyptiques d’aujourd’hui, et en s’appuyant sur quelques auteurs privilégiés qu’Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre tracent leur perspective du possible. Celle-ci construit une notion solidement charpentée du possible et dessine un vaste champ de recherches empiriques, déjà engagées et, surtout, à mener. Tout au long de l’ouvrage, s’entrelacent le souci d’élaboration d’un savoir critique et la quête des chemins de l’émancipation. Contre tout relativisme, est réaffirmée la pertinence d’une science sociale critique, invitée à poursuivre l’exploration de rapports plus horizontaux que surplombants entre chercheurs et acteurs sociaux. Les auteurs indiquent d’ailleurs que la perspective du possible appelle des méthodologies et des formes d’écritures singulières encore à inventer et, de fait, sans doute trop peu explorées ici. Surtout, une telle science sociale critique se doit d’assumer son articulation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une perspective d’émancipation. L’activité théorique ne doit pas être conçue comme une simple contemplation, car il s’agit bien plutôt de « faire varier ses conditions de vie, [d’]expérimenter des vies possibles, [de] participer à la transformation plutôt qu’à la reproduction des structures sociales et politiques ». Comme l’indiquent Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre, « toute perspective procède d’un point de fuite. Pour la perspective du possible, c’est l’expérimentation d’une vie meilleure ».
On pourra bien sûr débattre de nombreuses questions et on se demandera, par exemple, si les auteurs ne privilégient pas les possibles du futur, plutôt que l’approche contrefactuelle tant des possibles non advenus du passé que des potentialités du présent5. On pourrait aussi s’interroger sur un risque de dilution de l’esprit utopique, dès lors que l’accent serait mis trop unilatéralement sur l’étude d’utopies réelles fonctionnellement compatibles avec le capitalisme, comme chez Olin Wright. Il pourrait en découler une banalisation de l’utopie réelle, dans laquelle le Déjà-là de la réalisation présente prendrait le pas sur le Pas-Encore de l’aspiration émancipatrice. Mais La perspective du possible s’ouvre assez à la diversité des types d’expérience et des stratégies de transformation pour qu’un tel péril puisse être évité. Enfin, il pourrait être pertinent d’amplifier la réflexion sur la mutation actuelle des régimes d’historicité. En effet, il n’est pas trop hasardeux de penser que la crise du régime moderne d’historicité, qui avait noué les aspirations émancipatrices à un très haut degré de prétention à la certitude prédictive, est l’un des paramètres du renouveau présent de la notion de possible. Et c’est sans doute en lien avec de nouveaux régimes d’historicité émergents, capables d’arracher l’anticipation à sa forme planificatrice, qu’une reformulation des modalités de l’utopie est envisageable, de sorte que les aspirations émancipatrices puissent être repensées dans le registre de l’incertain et du possible.

Surtout, je voudrais attirer l’attention sur une question destinée très probablement à demeurer ouverte. Elle tient à la difficulté qu’il y a – à la fois pour les sciences critiques et pour les luttes sociales – à tenir pleinement l’équilibre que suppose la perspective du possible définie ici. En effet, celle-ci implique, d’un côté, de faire droit à la volonté d’élargir les possibles (contre la fatalité supposée de l’ordre existant, contre le refus de l’esprit utopique ou contre les inégalités sociologiques dans l’accès au futur) et, de l’autre, de tenir au réel (par l’attention aux conditions de réalisation du possible et grâce à des enquêtes empiriques permettant d’éclairer ces conditions). Cela suppose de voir le réel du point de vue du possible, mais aussi de voir le possible du point de vue du réel. Le chemin est étroit entre deux écueils symétriques : sous-estimer les possibles par excès d’objectivisme ou les surestimer par excès de subjectivisme. Mais comment définir les critères qui permettent d’établir que l’on tient à la fois – et également – le point de vue du possible sur le réel et le point de vue du réel sur le possible ? Et de tels critères peuvent-ils être établis de façon univoque ou doit-on admettre une part d’incertitude ?
L’appel à un utopisme raisonné et réaliste suppose de faire la part entre des possibles possibles et des possibles impossibles (même si cette distinction ne s’applique pas à l’enquête sur les imaginaires utopiques, dont l’étude doit se départir de toute approche normative, afin de cerner dans toute leur ampleur les aspirations et les attentes d’une époque, comme force collective inscrite dans le réel). Tracer une telle frontière est fort délicat. S’agissant des possibles du présent, la chose est déjà difficile, même si l’existence des utopies réelles est un premier point d’appui, sans pour autant qu’on puisse postuler que les possibles du présent se limitent aux utopies réellement existantes. Mais elle l’est plus encore s’agissant des possibles du futur, car si certains possibles peuvent être jugés impossibles dans les coordonnées du présent, que peut-on savoir au juste de la délimitation du possible et de l’impossible dans les coordonnées d’un réel futur, nécessairement différent, voire très différent, du réel présent ? Et comment construire l’ancrage de l’utopie dans le réel sans réduire celui-ci au réel présent – ce qui reviendrait à nier l’utopie comme Pas-Encore-Advenu ?
Ce qui est sûr, c’est que toute perspective de lutte et d’émancipation devrait prêter autant d’attention au risque de surévaluer les possibles (par exemple, par une attention trop exclusive à leur part désirable ou par une excessive extrapolation d’utopies réelles particulières) qu’à celui de leur sous-évaluation (par un enfermement excessif dans les limites du réel présent, par un excès de prudence tendant à minorer les potentialités de basculements accélérés ou encore par une prise en compte trop restrictive du caractère performatif des énoncés utopiques). A cet égard, les années récentes – notamment avec la séquence Gilets Jaunes, cycle planétaire de soulèvements populaires en 2019, pandémie mondiale de Covid-19, puis guerre en Ukraine – suggèrent une imprévisibilité événementielle en hausse accélérée, qu’il est permis de rattacher à une situation générale d’instabilité croissante, sinon de crise systémique6. Dans un tel contexte, nous pourrions être amenés à constater que la propension de l’impossible à devenir possible s’accroît plus vite qu’on ne pouvait l’imaginer. Dès lors, le spectre des possibles pourrait s’élargir de façon imprévue, ce qui inviterait à modifier les paramètres relatifs au risque de surestimation des possibles, tout en ouvrant des espaces insoupçonnés au déploiement des luttes contre l’actuelle domination capitaliste, patriarcale et coloniale.Si l’on doit savoir gré à Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre d’avoir donné à la notion de possible une assise solide et neuve, susceptible à la fois d’inspirer un renouvellement des enquêtes dans le champ des savoirs critiques et de fournir une base commune à la pluralité des approches d’une émancipation possible, ils se gardent bien de prétendre apporter une réponse définitive à la question de la délimitation du possible et de l’impossible. Au demeurant, cette frontière ne saurait être tracée par la seule vertu des sciences sociales, fussent-elles critiques. Nécessairement mouvante, elle est vouée à demeurer un objet de luttes et de débats, pris dans l’entrelacement des savoirs critiques et des luttes sociales. On peut même supposer que c’est la controverse permanente entre les approches tendant à la sous-évaluation des possibles et celles qui courent le risque de les surévaluer qui permettra d’affiner, au sein d’une cartographie générale des possibles, les chevauchements toujours instables du possible et de l’impossible. Les unes se targuent d’une prudence plus à même d’éviter les déconvenues et d’élaborer des stratégies ajustées ; les autres d’un enthousiasme davantage porteur d’énergie transformatrice. Mais il ne s’agit de nier ni les unes ni les autres. En même temps qu’ils entendent fourbir des armes permettant d’échapper au sentiment mélancolique d’une aspiration émancipatrice toujours défaite, Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre n’entendent pas assécher l’enthousiasme, mais bien plutôt « l’aiguiser ». C’est sans doute bien de cela qu’il s’agit : de rendre notre sens du possible plus aigu, à la fois plus ouvert à l’impossible et plus soucieux du devenir réel des possibles.
Notes
- Idéologie et utopie, Paris, EHESS, 2006 [1929][↩]
- Utopies réelles, Paris, La Découverte, 2017.[↩]
- Algérie 60, Paris, Minuit, 1977[↩]
- Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964.[↩]
- Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Le Seuil, 2016[↩]
- Jérôme Baschet, Basculements. Mondes émergents, possibles désirables, Paris, La Découverte, 2021[↩]





