Une lecture de Bernadette Bensaude-Vincent, Temps-Paysage, édition du Pommier, 2020
Rares sont les partitions qui s’ouvrent sur une cadence. C’est pourtant sur un point d’orgue, qui met en sourdine les clameurs de l’urgence, que Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe et historienne des sciences1, ouvre son essai, « Temps-Paysages » : une respiration. Dans un paysage médiatique plus souvent axé sur le thème, hérité de Hans Jonas, des « générations futures », c’est plutôt l’héritage de Michel Serres que Bernadette Bensaude-Vincent assume et active dès l’exergue et les premières références de son essai. C’est lui qui, en 1990, avait mis le doigt sur l’intrigante polysémie du mot « temps » dans notre langue, désignant à la fois le temps qu’il fait, et celui qui passe, que l’autrice prend comme un point de départ de sa réflexion : « Quel peut être le lien entre ces deux temps simultanément déréglés ? »
Prenant acte des travaux envisageant les dérèglements temporels en termes d’accélération, Bernadette Bensaude-Vincent positionne sa réflexion en deçà : c’est la conception même du temps qu’elle vient ici questionner. Comme elle le montre à propos du terme d’Anthropocène, si de nombreux néologismes ont été proposés pour se substituer à l’anthropos qui caractériserait la « nouvelle ère », (par exemple, Capitalocène d’Andreas Malm et de Jason Moore, Plantationocène d’Anna Tsing et de Malcom Ferdinand) le suffixe –cène, quant à lui, n’a pas été remis en question. Kainos : le nouveau, ce qui advient – le discret préfixe latin prolonge l’abscisse que le suffixe grec traçait. Or, c’est cette conception d’un temps séquentiel, c’est-à-dire d’un temps linéaire constitué de l’enchaînement d’ères successives, inquestionnée par les changements de tempo et d’époques, que l’essai de Bernadette Bensaude-Vincent se donne comme objectif de reconceptualiser. Pour ce faire, elle propose de tourner son regard vers les choses pour « faire attention à leur altérité », et en particulier, à leurs manières de dérouler leurs temps propres. Il s’agit de diversifier notre temps singulier en des temps pluriels, pour ouvrir la possibilité de les composer, c’est-à-dire de prêter attention aux agencements de temps disparates, plutôt que d’en dérouler un unique.
« Composer un paysage de temps relève donc de l’art musical et des règles de la polyphonie » (p. 186) : suivant l’invitation musicale qui court du prélude à la coda, dans le livre de Bernadette Bensaude-Vincent, on en propose ici une interprétation, un arrangement, joignant les voix de personnages conceptuels dont les échos habitent l’essai, à d’autres éclats de voix contemporains. Après avoir restitué l’essai de l’autrice, on s’interrogera sur la portée pratique et politique de sa proposition spéculative, à l’aune des luttes contemporaines autour de la question des déchets nucléaires.
Suspendre la cadence
Suivre cette piste d’une polychronie, d’un agencement de temporalités plurielles exige d’abord de déconstruire les métaphores qui corroborent, dans nos esprits, la conception du temps héritée de la modernité. C’est ce que Bernadette Bensaude-Vincent entreprend dans une première partie consacrée au « temps de l’urgence ». Elle commence par montrer que notre expérience du temps, comme « flèche du progrès », est elle-même historique, empruntant à François Hartog son concept de régime d’historicité. Caractérisé par contraste avec le temps antique, où le passé guide le présent, et le temps de la culture chrétienne « scandé par les travaux et les jours, enraciné dans une localité », le temps moderne est orienté, tendu vers un futur anticipé et calculé, dans une vision progressiste. Cette conception du temps comme une flèche du progrès ne va pas sans conséquences pratiques : elle est mobilisatrice, un terme dont l’auteure souligne la dimension militaire, qui oriente tout un chacun dans la même direction, à un même rythme, et fait « marcher au pas ».
Cette critique du temps moderne s’étend par la suite aux nouvelles figures du progrès « essoufflé » que forment l’impératif d’innovation et la perspective, à première vue opposée, de l’effondrement. Toutes deux sont en effet sous-tendues, dans leurs différentes versions, par ce temps uniforme et orienté. Qu’il s’agisse d’anticipations techno-progressistes ou effondristes, dans les deux cas, un futur impose sa loi au présent, prescrit des actions contemporaines, et pèse sur l’aujourd’hui : le temps presse. Un scénario d’anticipation unique dicte ce qu’il convient de faire. Comment comprendre la robustesse de cette pesante flèche contemporaine ?
Sonder l’ostinato
La partie l’« Empire de Chronos », qui suit, s’ouvre sur un rappel de figures temporelles alternatives à Chronos, issues de la culture grecque ancienne, comme Aion et Kairos, mais aussi de la culture chinoise. Il s’agit de desserrer l’étau de la conception contemporaine du temps, dont les effets d’urgence ont été diagnostiqués en première partie, en faisant la généalogie, par strates successives, des processus épistémologiques et des infrastructures qui ont assis le temps du métronome qui est le nôtre.
L’autrice analyse notamment la construction du « temps profond », c’est-à-dire les conditions de possibilité de la mise sur une échelle commune, de l’homogénéisation des temps propres aux phénomènes géologiques, vivants et civilisationnels. Ces conditions de possibilités sont techniques (les techniques de datation et celles de la stratigraphie), mais relèvent aussi de présupposés ontologiques qui sous-tendent l’usage de ces techniques : postulats d’un temps continu, uniforme, commensurable, qui orientent l’interprétation et portent à négliger l’éventualité d’une diversité de régimes temporels. Au-delà d’une critique de la part de conventionnalité dans cette homogénéisation temporelle, il s’agit de montrer que la « construction d’une échelle des temps, avec l’Anthropocène en bout d’échelle, présuppose qu’on se place à l’extérieur du temps, en position de surplomb, qu’on dispose d’une vue d’ailleurs », une « vue de nul temps », qui va de pair avec une illusion de maîtrise. L’argumentation n’est alors pas sans rappeler celle utilisée par Donna Haraway, dans sa version spatiale, pour critiquer le « point de vue de nulle part », ce « truc divin » qui offre en un coup d’œil la cartographie planétaire, adossé lui aussi à des infrastructures militaires2. Déconstruire la transcendance des cadres chronologiques dominants va permettre d’y substituer une multitude de processus immanents, parmi lesquels nous vivons et agissons (p. 21). Cette proposition théorique débute avec la partie suivante du livre, « le monde en polychronie ».

Orchestrer les temporalités
Si le concept de temps-paysage, timescape, entendu comme agencement de temporalités multiples ou hétérogènes, par opposition au timescale (échelle de temps), est emprunté à Barbara Adam3, il fait l’objet d’une réélaboration. Quatre sources d’inspiration accompagnent Bernadette Bensaude-Vincent dans son travail de reconceptualisation : la conception chinoise du paysage comme milieu de vie, plutôt que comme vis-à-vis, qu’elle emprunte aux travaux de François Jullien4 ; la notion de paysage propre à l’écologie scientifique (en tant que mosaïque, dynamique5) ; les moments d’être (moments of being) de Virginia Woolf, qui figurent une expérience du temps immergée, nébuleuse6 ; et la cosmogonie de Lucrèce lue par Michel Serres7. De chacune, elle retient et formalise un aspect, une orientation, qui colore le projet de composition que les temps-paysages mettent en œuvre.
Quels sont ces temps qu’il s’agit de composer, c’est-à-dire qu’il s’agit d’écouter en multipliant les perspective locales plutôt qu’en adoptant une perspective surplombante, ou encore d’agencer en respectant leur multiplicité ? Il y a, d’abord, des temps vivants – tout à la fois vivants individuels, populations et lignes évolutives, qui bousculent nos notions temporelles unilinéaires. On croise ici, à côté de « temps de microbes » notamment évoqués à travers les travaux de Marc André Sélosse8, la célèbre tique du biologiste Jacob Von Uexküll, dont la temporalité de vie est indexée aux signes lui permettant de déterminer le moment propice de sa chute et de ses actions, plutôt qu’aux années. Une réflexion évolutionniste permet ensuite à l’autrice de souligner des polychronies jusqu’en chacun de nous, constitué de traces d’ancêtres, de symbioses bactériennes, de processus disparates et contagieux.
L’évolutionnisme que Bernadette Bensaude-Vincent convoque pour sa réflexion, se référant aux travaux de Lynn Margulis et de Donna Haraway, pourrait être rapproché de celui d’Elisabeth Grosz. Théoricienne féministe attachée à conceptualiser une nature qui ne soit pas le pôle inversé, passif, de la culture, mais parcourue de forces et de transformations, de processus, Grosz explore, dans Time Travels9, la portée de nouvelles compréhensions du temps à partir de références communes à celles de Bernadette Bensaude-Vincent : Darwin, et ses réceptions bergsoniennes et deleuziennes. Le chapitre 2 des Time Travels, en particulier, gagne à être rapproché des Temps-Paysages. Par contraste avec le temps unilinéaire, les deux autrices mettent en évidence la forme spécifique du temps de l’évolution darwinienne, aux ramifications multiples, et aux embranchements multiformes, et sa force inspiratrice. Grosz le fait en s’interrogeant sur les apports possibles de la temporalité évolutionniste de Darwin pour la métaphysique. Cela l’amène à comparer cette temporalité à celle de Newton, comme Bernadette Bensaude-Vincent, mais aussi à en interroger directement la force de suggestion métaphysique : « Darwin fait de la temporalité, la poussée vers le futur, un élément irréductible de la rencontre entre la variation individuelle et la sélection naturelle, les deux principes qui, en interaction, produisent les riches résonances temporelles de la vie, ses possibilités futures, son évolution au-delà de ses formes passées et présentes »10. La vision darwinienne est, sous la plume de Grosz, une « prodigieuse machine temporelle », dans laquelle la part historique est irréductible, mais qui n’en permet pas moins des « histoires inattendues », des variations contingentes. C’est pour sa part, sur les aspects d’échanges horizontaux (de gènes) et de ramifications non linéaires qu’insiste Bensaude-Vincent pour évoquer le temps évolutif, mais il y aurait eu, chez Grosz, matière à dialoguer, pour contrer le temps orienté vers un futur unique de la modernité.
Donner le « là »
Le développement de l’idée originale de « temps de pays » constitue à mon sens le cœur du livre, conçu sous forme d’itinéraire : d’abord, passer de la chronologie à la chronographie, pour se trouver in medias res, au milieu des choses et non plus dans la position d’extériorité problématique. Puis, reconnaître la pluralité des trajectoires des cohabitants, leur hétérogénéité – entre temps cycliques, linéaires, feuilletés, spiralés – en accordant à toutes une égale importance. Enfin, promouvoir des temps locaux, attachés à un lieu, qui seraient donc des temps de pays, réintriqués aux lieux, à cet autre cadre positionné par notre modernité comme une condition a priori de perception, qu’est l’espace.
C’est bien ici que les échos du Contrat Naturel sont les plus audibles. « Je me souviens, pour y avoir vu le jour et assimilé une culture, de cet ancien monde sans monde où nous n’étions que localement liés, sans responsabilité aucune au-delà de nos étroites frontières. D’où les guerres étrangères et mondiales dont les libres ravages et les atrocités ont fait de nous une génération de citoyens du monde (…) L’effacement progressif des événements locaux constitue le plus grand événement contemporain global », écrivait Michel Serres11. Mais alors, s’agit-il de revenir à cet ancien monde ? La similitude du temps de pays avec le temps chrétien décrit en début d’ouvrage, « enraciné dans une localité », lui donne quelques instants l’allure d’une valse mélancolique. Toutefois, le temps catholique est associé à des prétentions universalistes et à l’homogénéisation de la matière et du temps. C’est donc au contraire un temps païen (de pagus, pays), qui attache ses divinités aux lieux en empêchant leur homogénéisation, que Bernadette Bensaude-Vincent promeut en modèle de ses temps de pays. À titre d’exemple, le dioxyde de carbone se trouve dépeint en génie local, déesse romaine associée aux émanations d’air « méphitique », contrastant avec sa forme chimisée moderne. Cette densification des temps disparates, associés aux lieux, se nourrit de travaux anthropologiques, pour mettre en valeur « la solidarité entre la manière d’habiter l’espace et celle de penser le temps ».
Le temps de pays trouve des exemples paradigmatiques chez les zapatistes et les maoris, dont les victoires juridiques de personnalisation du fleuve Wanghanui peuvent se lire dans la lignée des idées de Michel Serres. Ses variations d’un lieu à l’autre permettent en outre de reconnaître l’inégalité des peuples face aux dérèglements climatiques. Après l’exposition de temps de vivants tangents, contagieux, du chapitre précédent, le temps de pays donne donc le « là », en nouant les temporalités aux lieux, et le temps qui passe à celui qu’il fait. Il donne le La, sans donner le bourdon, parce que de Serres, l’essai de Bensaude-Vincent garde aussi la tonalité, à distance de l’esprit de sérieux, par ces propositions qui ressemblent parfois à une spéculation qui s’assume. C’est pourtant la même inquiétude vis-à-vis des puissances techniques, la même intuition originelle qu’était Hiroshima, pour la philosophie de Michel Serres, qui habite le livre et soutient l’ultime partie de l’essai.

Deux matériaux de concert
« D’âges en paysage », au terme du livre, déplace l’attention de la temporalité propre des trajectoires qui composent et intriquent les temps-paysages vers les durées de vie de deux matériaux, pour tester le pouvoir heuristique des temps-paysages en tant que « grille d’évaluation des choix ». Ce sont deux matériaux phares de notre condition contemporaine : ceux qui sous-tendent la production nucléaire et les plastiques. Rejoignant ici les travaux de Jean-Baptiste Fressoz12, déconstruisant les discours de « transition » énergétique, qui cultivent la vision linéaire des substitutions d’une énergie à une autre, Bernadette Bensaude-Vincent achoppe sur le fait que les usages énergétiques relèvent de l’accumulation, et que c’est précisément cet effet cumulatif qui est à l’origine de l’Anthropocène. Aussi convient-il de se pencher sur ce que pourraient être des compositions réussies avec ces matériaux, compagnons de route de nos histoires humaines.
Quels « paysages nucléaires » peut-on alors imaginer ? L’autrice développe l’exemple du plutonium, issu d’une culture militaire, matériau que sa demi-vie fera perdurer au moins 100 000 ans et que sa toxicité ne dispose pas à forger des histoires avec les vivants, avec sa « lente violence » sur les irradiés. Les éléments radioactifs, toujours en devenir, en émission de particules, portent un temps « inexorable ». Comment composer avec ? Reprenant la réflexion de Yannick Barthe13 elle s’intéresse à la question du stockage des déchets nucléaires en exposant, pour chacune des trois options considérées à leur sujet, sur lesquelles nous reviendrons, la figure temporelle qu’elle dessine, sans trancher, avant de suggérer une dernière option qui serait la patrimonialisation, la mise en tourisme.
Tout différents sont les « paysages carbonés » explorés par la suite, où les plastiques font d’abord leur entrée en scène en pollutions émiettées, diffuses et intraçables, puis sont explorés dans leurs aspects culturels et sémiotiques (en dialogue avec la formidable plume de Barthe, et ses descriptions de la magie de la plasticité). La durée de vie, ici, semble hâtée, se donne en présent perpétuel ou renouvellement constant, conforme à un esprit de flexibilité qui ne s’encombre pas longtemps d’objets jetables, ou renouvelés aux rythmes de l’obsolescence programmée. L’approche par temps-paysage détricote cette illusion présentiste en liant ce matériau à l’allure éphémère aux infrastructures lourdes et aux temps troubles du pétrocapitalisme, de l’extraction, de la transformation et du transport des matériaux dérivés. Comme les radionucléides, les plastiques ont un mode d’existence singulier, persistant. Toutefois, le problème n’est pas le même : « à la différence des radionucléides, ce n’est pas leur altérité qui pose un problème, c’est plutôt leur similarité avec les vivants », c’est-à-dire leur capacité à se faire ingérer et à remonter la chaîne trophique des océans. Que faire, alors, de ces résidus planétarisés, à l’ « insoutenable légèreté » ? La question ouverte par les paysages carbonés donne lieu à une double critique, de l’économie circulaire, et du mouvement biomimétique du cradle to cradle14. Leurs démarcations d’avec l’économie linéaire sont saluées, mais leurs effets pervers possibles et leurs penchants mythologiques sont également pointés : en somme, « il s’agit moins de prétendre boucler les cycles – ce qui revient à dénier la mort et l’entropie – que de chercher à composer avec les diverses temporalités en jeu » (p. 268). La partie s’achève sur l’éloge d’une figure ménagère, qui fait du neuf avec du vieux, une figure de frugalité et de bricolage, plutôt qu’une figure régisseuse et innovatrice. L’autrice insiste également sur l’importance d’une technodiversité à maintenir.
Moduler les héritages
Les gestes théoriques de Bernadette Bensaude-Vincent sont sûrs : identification de présupposés, distinctions de figures et de cultures techniques, rejet conjoint de positions apparemment opposées, son érudition et l’audace de son éclectisme font de son essai une lecture captivante. Rythment ce livre quelques mesures de ritournelle : refrains repris, reprisés, comme cités, aspects critiques déjà entendus mais dont le refrain vaut d’être remémoré, et mis au diapason de la réflexion principale. Un bémol facile, obligé par la métaphore musicale à la clef, pourrait être la question suivante : s’il s’agit de composition, faut-il chercher un·e chef·fe d’orchestre derrière ces temps-paysages ?
La profusion des références, mais surtout la manière qu’a l’autrice d’assumer ses stratifications de compagnons théoriques, explicités dans la « coda » de l’ouvrage qui détaille les inspirations principales, lui permet à mon sens de se tenir à l’abri de l’objection, d’abord par sa cohérence entre forme et fond. Temps-paysages est en effet précisément un grand travail de composition, articulant héritages réinterprétés et travaux récents, où se glissent en outre de savoureuses allusions aux temps ultracontemporains. C’est encore ce parti pris d’une polyphonie radicale qui revient, dans la discussion des idées politiques de Bruno Latour (p. 192-193), auxquelles l’autrice reproche d’être inspirées du modèle schmittien de l’opposition ami-ennemi, de n’être pas assez tentaculaires, pas assez enchevêtrées, d’être trop binaires. « On ne saurait parler d’un état de guerre au sein d’une multiplicité indéfinie qui est contrainte de composer pour vivre et survivre. ».
Ces influences sont combinées : celle d’Henri Bergson est bien présente, à travers la critique d’un temps spatialisé15 et pourtant, loin de prôner comme lui une approche intuitive par contraste avec l’analyse scientifique, Bernadette Bensaude-Vincent n’hésite pas à combiner les médiations analytiques et les prismes disciplinaires pour mettre au jour les temps des choses. C’est bien lovés au plus profond des êtres qui les portent, que l’autrice débusque ces temps-paysages. Ce faisant, elle module donc doublement l’héritage de Bergson, en prenant le parti des choses, et en recourant aux travaux scientifiques les plus analytiques et variés pour mettre au jour ces temps attachés aux choses, d’ordre tour à tour sémiotique, géologique, physiologique, culturel et politique. Par ce réalisme de principe, paradoxalement appuyé sur la pléthore des médiations savantes, c’est bien l’influence de Michel Serres que Temps-Paysages déploie le plus nettement – à la manière du Contrat Naturel qui faisait de la figure de Galilée l’invocateur des choses elles-mêmes, du « mondial », face aux magistrats religieux du « mondain », de l’univers des conventions humaines.
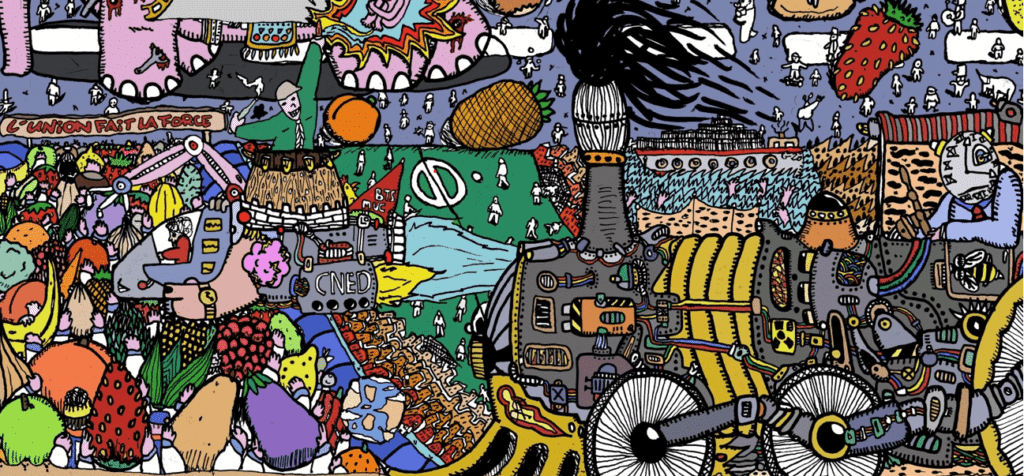
(Dé)battre la mesure
Mais en deçà de la composition théorique exemplaire, la question de la composition demeure, car on peut se demander si ce parti pris ne prend pas le risque d’iréniser un exercice nécessairement politique. De fait, écarter un futur monolithique, déterminé, pesant sur le présent, ouvre un espace peut-être cacophonique. La composition se fait-elle spontanément ? Ou implique-t-elle des dispositifs de débats, des modalités d’expressions de rapports de force, – et alors lesquels ? C’est ici que le pluralisme ontologique, ce choix que l’essai met en œuvre en attachant la réflexion aux choses elles-mêmes, plutôt qu’aux acteurs sociaux et aux rapports de pouvoir, court peut-être le risque d’une certaine dépolitisation. L’essai de Bernadette Bensaude-Vincent y échappe-t-il ?
Malgré son positionnement critique vis-à-vis de Bruno Latour, Bernadette Bensaude-Vincent adopte bien une perspective ontologique avant tout, en s’intéressant par exemple à la question nucléaire du point de vue des matériaux : c’est « leur incapacité à nouer des alliances », leur « extrême difficulté à forger des liens et à faire monde », qui pose problème, dans l’essai, plutôt que les rapports de force sociaux en jeu. C’est ce parti pris qui permet à l’autrice d’explorer, du point de vue des matériaux, les trois options techno-scientifiques – 1/ enfouissement définitif, 2/ stockage réversible et 3/ entreposage en surface –, relatives aux déchets nucléaires, d’identifier leurs présupposés et de dessiner les cultures temporelles associées, et leurs difficultés. Mais c’est sans doute ce même parti pris qui fait que les rapports de force en jeu derrière les trois options sont négligés par l’analyse.
Retraçons brièvement l’argument : pour chaque option techno-scientifique, l’autrice met au jour la temporalité associée. Ainsi l’enfouissement définitif, qui mise sur l’irréversibilité, « ferme »-t-il l’avenir, mais n’est pas moins une « attitude responsable à l’égard des générations futures à qui on ne veut pas léguer en héritage des déchets dangereux ». Par contraste, le choix du stockage réversible s’appuie sur un optimisme technologique et ne prend pas en compte la temporalité irréversible qui traverse les matériaux nucléaires. Enfin, l’entreposage en surface met en scène un temps réversible, procrastinant, « pérennisant les dispositifs d’attente ». Si elles sont brillamment exposées et interprétées dans la perspective de temps-paysages, on peut regretter que ces trois options soient considérées indépendamment des efforts qui sont effectivement consacrés à chacune d’elles : de fait, en dépit de la loi relative aux recherches de l’ANDRA, dans les années qui suivirent 2006, « la recherche sur la transmutation n’avançait pas tandis que la recherche de l’entreposage en surface était négligée. Tout l’effort se plaça sur l’option d’enfouissement profond ». Les options – et avec elles, les cultures temporelles – sont-elles alors réellement plurielles ? Et si non, quelles sont les conditions de possibilités de la technodiversité prônée par l’autrice ? N’impliquent-elles pas précisément l’abandon du nucléaire, dont le développement étouffe l’essor d’autres possibilités ?
Cette question, relative aux limites du pluralisme ontologique, peut somme toute se reformuler simplement : est-il possible de prêter attention aux choses, sans penser les rapports de force politiques dans le même mouvement ? A l’heure où se réactivent les luttes de Bure contre le projet CIGEO, suite à l’ouverture, en juin dernier, du procès de militants poursuivis pour l’organisation d’une manifestation non déclarée en 2017, la question semble devoir être tranchée par la négative. On peut regretter que ces luttes politiques ne soient pas davantage évoquées, en particulier lorsque l’autrice se demande qui fait parler ces matériaux, « qui se préoccupe de donner la parole aux isotopes radioactifs créés par nos bombes et nos centrales ». C’est précisément afin que l’on se penche sur les (im)possibilités de faire monde de ces matériaux nucléaires, qu’en septembre 2005, une marche avait réuni près de 6000 personnes à Bar-Le-Duc. Il s’agissait alors d’exiger un référendum local à propos du projet d’enfouissement, conformément à la loi du 13 août 2004 selon laquelle un dixième des électeurs peuvent demander l’organisation d’une consultation par un département, ce que les élus refusèrent, malgré un nombre d’électeurs le demandant supérieur au quota fixé par la loi. En s’interrogeant avant tout sur les capacités à composer de ces matériaux, sans doute l’autrice éclipse-t-elle l’asymétrie des rapports de force. Ce parti pris appauvrit peut-être l’analyse sur le plan théorique, parce que la diversité des voix humaines et de leurs velléités de compositions temporelles vient redoubler la diversité des possibilités portées par les matériaux. Ce parti pris lui ôte par ailleurs une certaine efficacité politique, car ces rapports de pouvoir conditionnent la prise en compte des matériaux. Si l’analyse des options à l’aune des temps-paysages convainc, quels sont les dispositifs ou les principes permettant d’en débattre, et de remettre en question la « raison d’état nucléaire » pour l’instant dominante ?
La conclusion de l’autrice, suite à l’exposition des trois options techniques, bascule vers l’éthique du care, en déplaçant le problème politique vers une considération éthique des matériaux. La proposition d’une patrimonialisation du nucléaire porte indéniablement aussi un sens politique, sur un autre plan : peut-on imaginer un « tourisme nucléaire », des manières collectives d’entretenir la mémoire de ces matériaux plutôt que de les passer sous silence ? Le « parti pris des choses » suivi par l’autrice ouvre ici une perspective temporelle élargie, inspirée par ces matériaux à la temporalité exorbitante. Cette proposition, surtout envisagée dans ses aspects éthiques, est intéressante sur le plan d’une réflexion de fond, celui d’une mise en histoires du présent, de l’imagination de paysages autres. Mais on peut douter qu’elle suffise ; d’une part, parce que la patrimonialisation, ici présentée comme une nouvelle option éthique, appartient en fait depuis des décennies à l’argumentaire institutionnel utilisé pour l’installation de centrales auprès de populations qui les refusent16, et d’autre part parce que cette proposition se formule « dans l’hypothèse où la France renoncerait à l’énergie nucléaire » – hypothèse reconnue fort improbable.
Notes
- Temps Paysage est loin d’être le premier essai de Bernadette Bensaude Vincent, qui poursuit depuis plusieurs années une réflexion sur les sciences, tout particulièrement la chimie, et les relations entre sciences et sociétés. On peut mentionner l’ouvrage, paru en 2018 chez Seuil, coécrit avec Sacha Loève : Carbone, sa vie, ses œuvres. Elle a été l’élève de Michel Serres.[↩]
- Donna Haraway, “Situated Knowledges : The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, Feminist Studies, 14(3), 575–599 (1988). Traduction en français dans Le Manifeste cyborg et autres essais. Sciences – Fictions – Féminismes, éds. Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Exils, Paris, 2007.[↩]
- Barbara Adam, Timescapes of modernity. The environment and Invisible Hazards, Londres/New York, Routledge, 1998.[↩]
- Philosophe et sinologue, François Jullien est notamment cité pour son livre Vivre de paysage ou L’impensé de la raison, Paris, Gallimard, 2014.[↩]
- Zev Naveh et Arthur Lieberman, Landscape Ecology. Theory and Application, Springer, 1984.[↩]
- Virginia Woolf, Moments of Being, San Diego, Harcourt, 1985.[↩]
- La lecture de Michel Serres insite tout particulièrement la conception des atomes comme îlots d’être pris dans le courant du devenir, chez Lucrèce. Michel Serres, La Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences, Paris, Editions de Minuit, 1977.[↩]
- Marc-André Sélosse, Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, Arles, Actes sud, 2017.[↩]
- Elizabeth Grosz, Time Travels. Feminism, Nature, Power, Allen and Unwin, 2005.[↩]
- Ibidem, p. 38.[↩]
- Michel Serres, Le Contrat Naturel, Flammarion, 2009, p. 170.[↩]
- Jean-Baptiste Fressoz, « Pour une histoire désorientée de l’énergie », 25èmes journées scientifiques de l’Environnement – l’économie verte en question, 2014, Créteil, France.[↩]
- Yannick Barthe, « Les qualités politiques dans les technologies. Irréversibilité et réversibilité dans la gestion des déchets nucléaires », Tracés, 16, 2011, p. 119 -137.[↩]
- Précepte d’écoconception théorisé par M. Braungart et W. McDonough qui se fonde sur l’absence de pollution et la réutilisation.[↩]
- Quoique le syntagme « temps-paysage » porte aussi une image spatiale, Bernadette Bensaude Vincent reprend la critique de la spatialisation du temps, de sa mise en une abscisse unique, initialement développée par Bergson, dans La pensée et le mouvant, Paris, PUF, Quadrige, 2013 [1934].[↩]
- La dimension attractive, notamment la possibilité d’une mise en tourisme du nucléaire, fait partie des discours des agents officiels au moment des installations de centrales, reportés par Gabrielle Hecht, Le rayonnement de la France, éditions Amsterdam, 2004, en particulier chapitre 1 et 6.[↩]








