Bonnes feuilles extraites de Aurélien Berlan, Terre et Liberté, la quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, Editions La Lenteur, 2021.
Sur une planète finie, il n’est pas possible d’échapper à la nécessité. Conquérir la liberté n’exige pas de triompher du « domaine de la nécessité » ou de le transcender, il s’agit plutôt de s’efforcer d’élaborer une vision de la liberté, du bonheur, de la « vie bonne » dans les limites de la nécessité, de la nature. C’est cette vision que nous appelons perspective de subsistance, parce qu’on ne peut plus s’autoriser à « transcender » la nature, et parce qu’il s’agit au contraire de conserver et d’entretenir le potentiel de subsistance qu’elle nous offre dans toutes ses dimensions et dans toutes ses manifestations. La liberté à l’intérieur du domaine de la nécessité peut être universalisée pour tout le monde ; la liberté en échappant à la nécessité n’est accessible qu’à une minorité.
Maria Mies et Vandana Shiva, écoféminisme (1993)
La vraie liberté est là où un homme trouve sa nourriture et sa subsistance, c’est-à-dire dans l’usage de la terre […]. Mieux vaudrait pour un homme n’avoir point de corps que de n’avoir pas de nourriture à lui offrir.
Gerrard Winstanley (1652)
Dans son essai Terre et liberté, Aurélien Berlan s’interroge sur ce qui, dans la conception moderne de la liberté, a contribué à nous mettre sur les rails du désastre socio-écologique actuel. Dans un premier chapitre, il montre que derrière la conception libérale de la liberté, il y a le désir d’être déchargé, délivré, de certaines activités relatives à la dimension politique et matérielle de la vie quotidienne. Et dans le deuxième chapitre, il élargit la focale de son enquête pour mettre en évidence que ce désir de délivrance, notamment dans sa dimension matérielle, s’enracine très profondément dans les imaginaires et les pratiques sociales – et qu’il est devenu hégémonique à l’âge moderne, traversant la plupart des conceptions socialistes de la liberté. Nous vous proposons le début du chapitre 3 où Aurélien Berlan analyse une autre conception de la liberté, diamétralement opposée puisqu’elle n’invite pas à se décharger des nécessités de la vie, mais à les prendre en charge nous-mêmes.
En dépit de sa force presque universelle et de son hégémonie actuelle, il serait faux de considérer que la quête de délivrance soit la seule conception possible de la liberté et encore moins l’aboutissement logique de sa recherche. L’histoire de la liberté n’est pas un long fleuve tranquille qui s’élargit peu à peu, mais une arène où s’affrontent diverses aspirations, portées par des groupes distincts. Même en Occident, la problématique de la liberté ne se réduit pas à celle de la délivrance. Cette conception de privilégiés s’est imposée contre les aspirations des classes populaires. Les luttes de celles-ci visaient des objectifs variés, en fonction des contextes et des formes de domination dont elles cherchaient à s’émanciper ; mais il est clair qu’avant l’entrée dans l’ère industrielle elles ne se battaient pas pour être déchargées des nécessités de la vie, au sens de l’idéal de loisir qui ressort de certains textes marxistes. Le Droit à la paresse publié par le gendre de Marx en 1880 illustre bien ce décalage : c’est contre le droit au travail revendiqué en 1848 par une partie des insurgés, et plus largement contre l’idéal artisanal de Proudhon, que Paul Lafargue y formule son idéal de délivrance à l’égard du travail, basé sur le postulat industrialiste selon lequel « la machine est le rédempteur de l’humanité […], le Dieu qui lui donnera des loisirs et la liberté1».
Les classes populaires ne voulaient pas tant être délivrées du travail que de l’oppression et du surtravail que les puissants leur imposaient pour se décharger, eux, des « basses tâches matérielles ». À cette fin, elles exigeaient le libre accès aux moyens de subsistance permettant d’assurer leurs besoins. Les « douze articles » mis au point par les insurgés allemands en mars 1525, alors que la « guerre des paysans » fait rage, l’illustrent parfaitement : leurs revendications portaient sur l’abolition de certaines formes de domination (sacerdotale, féodale, judiciaire) et de certaines taxes, ainsi que sur la liberté de chasse et de pêche et la restitution à la communauté des forêts et des communaux2. S’émanciper, pour les classes populaires, ce n’est donc pas être libéré des tâches liées à la vie quotidienne, mais abolir les rapports de domination. C’est ce que confirment leurs luttes récurrentes pour la défense des biens communs et le droit à la terre, ou encore leurs tentatives pour aller chercher ailleurs ces conditions de la liberté.
Les luttes pour défendre les communaux dont les classes populaires tirent une part de leurs ressources (forêts, rivières, pacages, etc.) témoignent de leur volonté de continuer à assurer leur subsistance de manière autonome. Un bon exemple en est la guerre des Demoiselles qui éclata en 1829 et secoua l’Ariège tout au long du xixe siècle : les paysans s’insurgeaient contre l’État qui les privait, par un nouveau Code forestier, de leurs anciens droits d’usage comme la collecte du bois ou le pâturage des bêtes – ce qui revenait à les empêcher de continuer à vivre par leurs propres moyens, sur la base des ressources locales. Les luttes des peuples du Sud contre le développement capitaliste illustrent de nos jours la même logique. Au début des années 1990, alors que les femmes chipko protégeaient en Inde leurs forêts à leur corps défendant, les villageoises de Maishahati (Bangladesh) formulaient leurs revendications ainsi : outre d’être libérées de l’oppression patriarcale, elles voulaient « une vache, des enfants et une source de revenus propre ». Ce qu’elles réclamaient au fond, comme l’expliquent les écoféministes Veronika Bennholdt-Thomsen et Maria Mies qui rapportent leur propos, c’est « la possibilité matérielle de produire et reproduire leur vie, leur nourriture, leur subsistance par leurs propres forces, indépendamment du salariat et du marché capitaliste3». Contre l’idéal de délivrance par l’« abondance », elles exigent l’autonomie par l’autosuffisance et l’accès aux ressources locales qui en est la condition première.
Cette revendication est au cœur des luttes paysannes pour le foncier, de l’Antiquité jusqu’aux récents mouvements des « sans-terre ». Leur slogan récurrent, « Terre et liberté ! », exprime en condensé le lien entre l’autonomie et l’accès aux moyens de subsistance. À la fin de la révolution qui secoua l’Angleterre au milieu du xviie siècle, les Diggers (les « bêcheux ») estimaient, contre les niveleurs, que l’égalité réelle suppose de dépasser la propriété privée de la terre, car elle force les uns à se vendre aux autres. Leur acte fondateur fut de squatter en 1649 des terres communales encloses afin d’y cultiver de quoi se nourrir. Peu après, une quinzaine d’entre eux publiaient un manifeste qui invitait à partager le pain et la peine qu’il en coûte pour l’obtenir : « Travaillez ensemble – Mangez votre pain ensemble4 ! »

Quand il semble impossible de secouer le joug de la domination, la seule solution reste la fuite, le marronnage : se soustraire au pouvoir en s’échappant. En Asie, des foules de gens ont quitté les plaines quadrillées par les États pour se réfugier dans une région escarpée (Zomia) où les terres étaient moins riches, mais libres5. Dans l’Europe d’Ancien Régime, dissidents et réfractaires allaient s’installer sur les terres délaissées (marais, landes, montagnes, etc.) ou se mettaient sur la voie de l’exil, à la recherche de terres vacantes et non soumises à redevances.
Ces luttes et ces exodes témoignent d’un désir de vivre sans maître, non d’être déchargé de la « nécessité ». À rebours du fantasme moderniste d’alléger, jusqu’à l’apesanteur, nos conditions de vie, il s’agit d’accéder aux moyens de subsistance afin de les prendre en charge. Terme révélateur : mêlant les idées de poids et de responsabilité, la notion de charge est tendue entre la vision du fardeau qui écrase et celle de la mission qui élève. Elle implique d’abord l’idée de pesanteur matérielle : une charge est une cargaison si pénible à porter qu’il faut pour ce faire un moyen spécial (« charge » vient du latin carrus, le chariot). En ce sens, la première des charges, c’est la vie matérielle et la « charge de travail » qu’elle implique : le labeur (labor désignait d’abord, en latin, la « charge sous laquelle on ploie »). Mais le mot « charge » désigne aussi une responsabilité, c’est-à-dire une fonction importante qu’il faut bien que quelqu’un endosse, ce qui suppose un contexte collectif de répartition des tâches. Celles-ci peuvent être laborieuses ou organisationnelles, auquel cas elles ne sont pas physiquement pénibles. Les charges liées à la coordination des efforts peuvent même être gratifiantes dans la mesure où elles mettent au cœur de la vie collective. De la Rome républicaine aux communautés zapatistes des années 2000, les charges politiques élèvent celles et ceux qui les assument. Mais comme ces responsabilités impliquent de se frotter aux conflits que la répartition des tâches et la coordination des efforts suscitent sans cesse, elles peuvent peser sur l’esprit de qui les prend en charge – si lourdement qu’on préfère souvent s’en défausser sur les autres.
Comment nommer cette conception de la liberté qui, contrairement à la délivrance, passe par la prise en charge du quotidien ? Longtemps, elle est restée anonyme puisqu’il s’agissait du lot commun des gens qui n’avaient pas voix au chapitre. Et comme ils étaient dominés, voire asservis par des oligarchies en quête de délivrance, elle ne pouvait même pas être associée à l’idée de liberté que les puissants avaient accaparée. La donne a changé au xxe siècle, à la fois parce que les subalternes sont en partie sortis de l’obscurité dans laquelle ils avaient été relégués, et parce que la massification de la délivrance par l’industrie n’est pas allée sans susciter un certain malaise. Dans les années 1960-1970, une partie des classes moyennes qui en bénéficiaient a fini par se révolter contre cette conception de la liberté débilitante pour celles et ceux censés en jouir, et destructrice pour tout le monde. Car si l’industrie libère les consommateurs de l’effort de fabriquer les biens dont elle leur attribue le besoin (ou de l’effort de se passer de ces biens), son développement se traduit par la surexploitation de toutes les ressources (humaines, animales, minérales, etc.).
Pour nommer l’alternative qui se cherchait confusément, le terme « autonomie » a fini par s’imposer. Car qu’est-ce que cette autonomie alimentaire ou énergétique à laquelle de plus en plus de gens aspirent aujourd’hui, si ce n’est la volonté de reprendre en charge une part de leur subsistance ? Derrière ce terme, il y a le désir de reconquérir une liberté que l’on a perdue en devenant dépendant du système industriel, donc de l’argent qui permet d’acheter les marchandises qu’il produit, donc (pour la plupart des gens) du salariat qui procure cet argent à condition de se soumettre aux emplois disponibles sur le marché du travail.
Dans le lexique politique actuel, le terme « autonomie » est toutefois clivé entre deux acceptions qui sont souvent pensées l’une sans l’autre, voire l’une contre l’autre : d’un côté, l’autonomie matérielle qui vient d’être évoquée, souvent associée aux écologistes soucieux de construire des formes de vie alternatives ; de l’autre, l’autonomie politique des militants qui luttent à couteaux tirés contre l’existant. Cette dissociation est le fruit pourri de l’échec de la révolte de 1968 et de la contre-révolution qui l’a suivie. Le fossé d’emblée présent entre les deux versants du projet d’autonomie n’a cessé de se creuser au point d’en faire deux options inconciliables, toutes deux aussi vaines et illusoires l’une que l’autre : celle des écocitoyens en quête de niches au sein du système, qui ont délaissé le combat ; et celle des partisans de la lutte contre le système, qui ont renoncé à créer d’autres formes de vie. Comme s’il était possible de construire un autre monde sans lutter contre l’existant ; comme s’il était pensable de saper les bases de la domination sociale sans élaborer des formes de vie qui en soient moins tributaires.
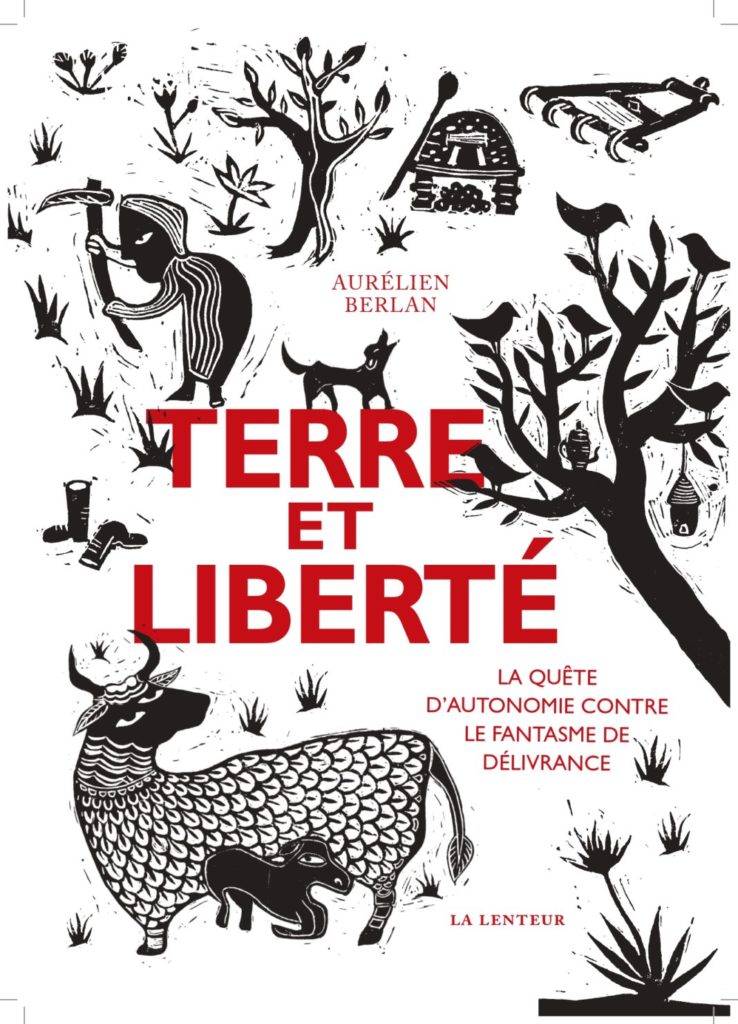
Depuis son renouveau à la fin des années 1990, le mouvement anticapitaliste a de plus en plus pris conscience qu’il fallait réarticuler les deux versants de l’autonomie, qui sont en fait les deux jambes de la révolution nécessaire pour éviter que le désastre socio-écologique vire au carnage. C’est ce qu’ont déjà fait les zapatistes à partir de 1994, en combinant lutte d’autodéfense et construction de l’autonomie au Chiapas6. Dans un tout autre contexte, c’est aussi ce qu’a su faire le mouvement des Zad, et cette mise en œuvre de l’idéal d’autonomie contribue sans doute à expliquer qu’il ait suscité un intérêt bien au-delà du « milieu autonome », et ait pu contraindre l’oligarchie à abandonner certains de ses projets mortifères.
Pourquoi le terme « autonomie » est-il approprié pour désigner cette vision de la liberté associée à la prise en charge de la nécessité, plutôt qu’à son dépassement fantasmatique ? Quels sont les tenants et aboutissants, philosophiques et politiques, des pratiques de subsistance qui formaient la trame de la vie quotidienne des classes populaires occidentales il y a encore un siècle – et encore aujourd’hui dans de nombreuses régions du monde ? En proposant, dans ce chapitre, des éléments de réponse à ces questions, je ne prétends pas défendre un nouvel idéal de liberté, mais seulement remettre au jour une conception éprouvée de la liberté, en libérant certaines évidences des oubliettes dans lesquelles la pensée dominante, même prétendument radicale, les a laissées croupir.
La sémantique de l’autonomie
Si le sens du mot « liberté » s’est obscurci à tel point qu’une partie de la gauche consente à son annexion par la droite soi-disant « libérale », l’idéal de non-domination qu’il a véhiculé est aujourd’hui repris en charge, dans le lexique politique, par le terme d’autonomie. À peine usité avant le xixe siècle, il est devenu un mantra de la contestation depuis les années 1970, en dépit des tirs de barrage qu’il a suscités de la part des industrialistes, et des tentatives des pouvoirs établis pour le récupérer et le dévoyer.
Anarchisme, régionalisme, écologie politique : histoire des usages politiques du terme
Le substantif d’inspiration grecque « autonomie » apparaît tard dans la langue française. La première occurrence, qui date de la fin du xvie siècle, fait référence à la démocratie grecque antique. Mais son usage historique premier renvoie aux cités médiévales qui se sont, au cours de la « révolution communale » qui a agité l’Europe aux xie et xiie siècles, affranchies des autorités féodales7. Au xixe siècle, il est introduit en philosophie, sous l’influence de Kant, pour thématiser la liberté morale de la volonté. Et dans la seconde moitié du siècle, il sort du langage savant pour devenir l’un des étendards de l’aile anarchiste du mouvement socialiste, ce qui lui vaut une critique féroce et acharnée de la part des marxistes.
En 1872, Engels invite les ouvriers à abandonner l’idéal libertaire d’autonomie au travail, incompatible avec la discipline industrielle des fabriques sur les portes desquelles est écrit, comme il le dit : « Renoncez à toute autonomie8 ! » Car le cadre de l’usine, si infernal et autoritaire soit-il, est censé libérer les forces productives et permettre ainsi une émancipation radicale de l’humanité. Un peu plus tard, Lafargue croise le fer avec les « autonomistes » français. À ses yeux, l’autonomie matérielle des communes paysannes qui, sur la base de la propriété collective de la terre, en répartissaient l’usage entre leurs membres, serait un facteur de division du genre humain, donc de faiblesse : telle serait la source du despotisme féodal et, pire encore, du « despotisme le plus absolu, le plus incontrôlable, tel qu’on le trouve en Russie ». Quant à l’autonomie municipale (celle des cités médiévales dites « franches » ou « libres »), elle aurait fait le lit du « despotisme des aristocraties corporatives et patriciennes » qui ont monopolisé les pouvoirs et les richesses des cités9. Bien sûr, ce raisonnement est biaisé par l’a priori industrialiste de Lafargue que, selon certains commentateurs, Marx aurait alors remis en cause sous l’impulsion des populistes russes, qui voyaient dans l’organisation villageoise (le mir) le ferment d’un communisme paysan10. Dans les faits que Lafargue rapporte, rien ne montre que l’autonomie serait la cause du despotisme, puisque ce dernier sévissait aussi dans les villes et les villages privés du droit de s’administrer.
Malgré ce procès, la notion d’autonomie se diffuse au xxe siècle. Dans le sillage de son usage historique premier, elle est appropriée par les régionalistes et les indépendantistes, au sens d’autogouvernement. Désormais, les « autonomistes » ne désignent plus les libertaires communalistes, mais les partisans de l’indépendance nationale ou de l’autonomie régionale. C’est pour cette raison que les fractions libertaires du mouvement social vont s’appeler, à partir des années 1970, « les autonomes », en référence au rejet des syndicats et des partis, mais aussi à la lutte contre la colonisation capitaliste de la vie quotidienne11. Ce faisant, la notion prend un sens matériel qui est au cœur de son usage par la branche non technocratique de la mouvance écologiste : elle cristallise alors le désir de sortir de la dépendance à l’égard d’un « système technico-productif 12 » qui nuit à toutes les formes de vie. Dans cette conjoncture où se croisent les luttes régionalistes et anticoloniales, le renouveau libertaire et l’essor de l’écologie politique, la notion d’autonomie est sur les lèvres de tous les contestataires. Les managers se sont ensuite empressés de récupérer cette valeur devenue centrale dans l’après-1968, en promettant aux salariés (et aux consommateurs) un peu plus d’« autonomie », du moins sous une forme compatible avec la poursuite du développement capitaliste13.
Autonomie collective, individuelle et matérielle : histoire des sens de la notion
Le terme « autonomie » étant revendiqué par des courants politiques divers et attribué à des entités différentes (de la personne à la nation), sa signification varie. Comme le suggère son étymologie, il signifie d’abord que la loi (nomos) est référée à soi-même (autos) : « se donner sa propre loi » ou « se régir par ses propres lois ». Comme la loi suppose une multitude dont elle est censée régler les rapports, il s’agit d’abord d’un concept collectif, politique, de liberté : le « soi » en question renvoie à un groupe, une communauté, une cité. En ce sens, l’idée d’autonomie (mais pas le terme) est au cœur de la pensée de Rousseau pour désigner la liberté en tant qu’elle ne se réduit pas au libre arbitre ou à la licence individuelle, mais repose sur des règles que l’on se donne collectivement : « Car l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » (Du Contrat social, I, chap. 8). La liberté n’est pas l’anomie (l’absence de règles), mais l’autonomie (respecter les règles sur lesquelles on s’est mis d’accord).
Si le sens originel du terme est collectif, la philosophie lui a fait subir une inflexion décisive dès qu’elle s’en est emparée. En parlant d’autonomie de la volonté, Kant déplace l’idée de Rousseau vers la morale. Ce faisant, il individualise la notion qui désigne désormais la capacité qu’une personne a de se conduire en suivant les maximes morales que la raison lui révèle, ce qui suppose de mettre de côté sa part sensible : ses impulsions et ses intérêts14. Depuis, le concept d’autonomie a perdu, dans la philosophie académique, son sens collectif et politique, sauf chez Castoriadis. Il n’a plus qu’un sens individuel qui, depuis la psychologie morale, a été transposé vers le champ politique, notamment dans la pensée anglo-saxonne. C’est la raison pour laquelle Crawford développe sa critique de la vie abstraite, délivrée du travail manuel, sous la forme d’une critique de l’autonomy au nom de l’idée moins autocentrée de self-reliance15.
Cette individualisation du concept d’autonomie n’est pas seulement à l’œuvre dans la pensée universitaire, mais aussi dans les éléments de langage du pouvoir. Les autorités publiques multiplient les injonctions à l’autonomie, au sens de se débrouiller tout seul. Pour pousser les bénéficiaires des minima sociaux à renoncer à leurs droits, elles les invitent à « développer leur autonomie » – une autre manière, apparemment moins violente, de poursuivre la croisade libérale contre la solidarité sociale. C’est également ce que sont priés de faire les usagers des services publics, qui se retrouvent seuls face à des automates. Dans la même veine, le développement de la silver economy (qui exploite le pouvoir d’achat des retraités aisés) s’accompagne d’un discours sur « l’autonomie » des personnes âgées et/ou dépendantes, par quoi il faut entendre le fait d’être équipé de toute une série d’appareils permettant de rester chez soi sans la sollicitude de ses proches. Dans ce cas, l’autonomie désigne le contraire de ce à quoi aspirait Illich : un monde plus humain et convivial où l’on serait moins dépendant de l’appareillage industriel.
La langue politique et le sens commun résistent en partie à cette individualisation. Parler de l’autonomie des villes et des régions (par rapport à l’État), des ouvriers et de leurs syndicats (par rapport aux partis politiques bourgeois – c’est l’un des usages de la notion à la fin du xixe siècle16, puis des groupes militants (par rapport aux partis et aux syndicats), c’est toujours parler du désir d’être collectivement libérés du carcan imposé par l’intégration dans des entités surplombantes qui dépossèdent les communautés de base de leurs capacités.
Plus profondément, tous ces usages manifestent une autre idée : la défense des échelons inférieurs ou intermédiaires. La notion d’autonomie témoigne d’une mise en cause des échelles de production, d’organisation et d’interaction dans le monde moderne. C’est ce qui ressort aussi de la signification matérielle qu’elle a dans l’usage actuel : vouloir plus d’autonomie (sur le plan de la construction ou de la santé), c’est aspirer à s’affranchir de la dépendance envers un système industriel mondialisé, oppressant dans sa démesure.
Dans ses usages les plus anciens et les plus récents, l’idée d’autonomie est liée à la critique de la concentration du pouvoir dans de lointaines instances de décision sur lesquelles les individus comme les communautés n’ont plus de prise. Ce qui importe dans la notion, ce n’est donc pas seulement sa dimension collective, mais l’idée que le collectif doit rester « à taille humaine ». Elle se nourrit de la conscience que les changements d’échelle, au-delà de certains seuils, ne sont pas quantitatifs mais qualitatifs : les activités concernées changent de nature et posent des problèmes nouveaux17. Comme le dit Weber au sujet de la démocratie :
Les conditions de l’administration des formations de masse sont radicalement différentes de celles qui prévalent pour de petits groupements fondés sur les relations de voisinage ou les rapports personnels. Lorsqu’on a affaire à une administration de masse, la signification sociologique de la notion de « démocratie » change à tel point qu’il est absurde de penser que ce nom générique puisse recouvrir un type unique18.
Ce qui est vrai dans le domaine politique l’est aussi dans le champ économique et technique : un élevage en batterie n’est pas une grande basse-cour, les éoliennes industrielles ne sont pas des moulins à vent plus puissants. Plus la production augmente et plus elle suppose d’organisation hiérarchique et engendre de nuisances écologiques inédites, liées notamment aux quantités de ressources et de déchets qu’elle entraîne, qui rompent les équilibres locaux (puis globaux).
Ces questions de taille ont pris une importance croissante avec l’essor du capitalisme. Investir dans une activité, c’est la redimensionner à l’échelle supérieure. Le capitalisme, c’est le commerce au long cours par opposition au petit commerce, les « cultures à grande échelle » par opposition à l’agriculture paysanne (avant de caractériser l’agriculture industrielle, les « grandes cultures » ont été développées dans les plantations esclavagistes, pilier du capitalisme antique et du premier capitalisme colonial). Et depuis le passage à la production de masse, ce système est caractérisé par la recherche des « économies d’échelle », ce qui entraîne une fuite en avant dans le gigantisme économique, technologique et politique dont la mondialisation n’est qu’un des aspects. À mesure que la production s’accroît, nos activités sont organisées à des échelles qui dépassent nos capacités de maîtrise et de représentation19, elles dépendent désormais de macrostructures sociales et technologiques destructrices.
On comprend ainsi que la notion ait pris une importance croissante dans la contestation du capitalisme et qu’elle soit devenue centrale chez les alternatifs. Elle cristallise l’aspiration à revenir, là où c’est possible et pertinent, à des échelles plus réduites, locales ou régionales, de production et d’organisation sociales, où la démocratie directe puisse avoir du sens. Tout cela ressort clairement des pratiques et du lexique de l’écologie politique : les circuits courts et le communalisme, la critique des « grands projets » et du productivisme, la méfiance envers les panacées technologiques au profit des techniques « intermédiaires » ou « appropriées », c’est-à-dire décentralisées et adaptées aux conditions locales. On comprend dès lors pourquoi l’autonomie est si souvent opposée à la liberté : une fois capturée par le libéralisme, celle-ci a été associée à l’arrachement aux communautés locales, alors que celle-là invite à la relocalisation des instances de décision et de production. Alors que la liberté individuelle est le corollaire de l’État (central) et du marché (mondial), l’autonomie est leur ennemie.
Autarcie et autonomie : l’étroite imbrication de l’autosuffisance et de la liberté
Prise au sens matériel, la notion s’est éloignée de son étymologie : quand on parle d’autonomie alimentaire ou médicinale, il ne s’agit pas d’abord de se donner ses propres lois, mais de pourvoir à ses propres besoins. Dans ces usages-là, la notion désigne l’autosuffisance en tant qu’elle conditionne la capacité à se fixer les fins et les moyens de son action.
Cette inflexion matérialiste de la notion d’autonomie ne doit pas être vue comme une trahison de son sens originel, centré sur la question juridico-politique de la loi. C’est plutôt un retour aux sources. Car pour parler de la capacité d’un ensemble de citoyens (une cité) à se donner des lois, les Grecs ne parlaient pas, à l’époque de la démocratie, d’autonomia : ce substantif a été forgé plus tard pour évoquer le droit limité à s’administrer elles-mêmes que leurs cités ont parfois pu conserver, une fois phagocytées par des empires20. Ils parlaient d’autarkeia (autarcie), au sens de la capacité d’une cité à se suffire à elle-même (« Tout avoir et ne manquer de rien21 »). Or, ce terme manifeste la même idée d’un lien entre l’autosuffisance matérielle et l’autodétermination politique que nous avons mise en évidence à propos de l’autonomie dans ses usages actuels, puisqu’il désigne l’autosuffisance (c’est son sens premier) en parlant d’autogouvernement (autos = soi-même ; arkeia = gouvernement).

Nous avons recours aujourd’hui au terme « autonomie » pour évoquer cette idée parce que la notion d’autarcie a perdu son sens positif. Après avoir été fortement valorisée dans l’Antiquité, tant sur le plan politique qu’individuel (l’autarcie caractérisait aussi le sage), elle a été discréditée par les partisans modernes du « libre échange » comme un appel à l’isolationnisme, un signe de xénophobie. Et suite à la crise de 1929, elle le fut encore plus par les mouvements fascistes qui la remirent en valeur pour justifier, en lien avec l’idée d’espace vital, leurs politiques d’annexion : les pays industriels étant tributaires de matières premières importées, viser l’autarcie supposait de s’en approprier les gisements à l’étranger.
Pourtant, l’apologie libérale du « doux commerce » est liée à l’essor du capitalisme moderne, indissociable du colonialisme22. En 1604, l’un des fondateurs de la théorie politique moderne commence un traité commandité par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (la première société par actions et « compagnie coloniale » européenne, célèbre pour les génocides qu’elle a perpétrés en Indonésie23 en expliquant que toute nation a le droit de commercer avec les autres en vertu de la volonté de Dieu, qui redoute « que quelques-uns, pensant se suffire à eux-mêmes, ne devinssent par là même insociables24 ». Vivre en autarcie connote désormais, de manière irrémédiable, le repli sur soi. Voilà pourquoi les pays qui ont cherché à se développer autrement qu’en se soumettant au « marché mondial » (c’est-à-dire aux puissances industrielles qui le dominent) n’ont pas recouru à la notion d’autarcie, mais à celle d’autonomie ou à son équivalent anglais, self-reliance, comme la Tanzanie à l’époque du socialisme ujamaa (qui signifie en swahili « coopérative », « vivre et travailler ensemble »)25.
Assurer sa subsistance : une conception populaire de la liberté
Si la notion d’autonomie est récente, au sens où elle articule la liberté à ses conditions matérielles (l’accès aux moyens de subsistance permettant l’autosuffisance), ce n’est pas le cas des pratiques et des aspirations correspondantes, diffuses tout au long de l’histoire. C’est ce que suggère une étonnante convergence de vue entre citoyens romains et états-uniens.
Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, la première distinction juridique romaine classait les choses en deux catégories. D’un côté, il y avait les res mancipi que l’on ne pouvait céder sans passer par une cérémonie publique devant témoins ou magistrats (la mancipation) : les fonds de terre et les maisons situées sur le territoire romain, ainsi que les esclaves et les animaux domestiques « recevant le joug sur le col ou sur le dos », c’est-à-dire les bêtes de trait. De l’autre, il y avait les res nec mancipi qui pouvaient être aliénées sans autre formalité : les autres animaux (la basse-cour, les animaux de compagnie, les bêtes féroces, etc.), l’or et l’argent, les terres et les maisons non romaines. Quelle est la logique de cet inventaire à la Prévert ? Malgré tout le pouvoir que lui accordait le droit romain, le pater familias n’avait pas le droit de céder à sa guise les biens assurant l’autonomie matérielle de ses descendants et leur accès à la citoyenneté (maisons et terres romaines, ainsi que bêtes de trait). En bref, il ne pouvait pas les priver des conditions de la liberté.
Plus de deux mille ans plus tard, lors de la guerre de Sécession aux États-Unis, un certain nombre d’abolitionnistes ont critiqué l’idée qu’il suffirait d’accorder la liberté juridique formelle aux esclaves : si on ne leur donnait pas les bases matérielles de la liberté, c’est-à-dire les moyens de subvenir à leurs besoins, ils seraient contraints de se vendre à leurs anciens propriétaires et leur affranchissement ne serait qu’un leurre. Un général ordonna ainsi le 16 janvier 1865 d’attribuer aux familles libérées « 40 acres and a mule » – quelques hectares de terre et une bête de trait pour les travailler, comme chez les Romains. Mais peu de temps après, le président de l’Union révoqua cet « ordre spécial » et les esclaves durent vendre leur force de travail à leurs anciens maîtres, auxquels les terres redistribuées furent restituées26. Les Noirs formellement affranchis n’eurent alors d’autre choix que d’endurer un nouveau siècle d’exploitation et de ségrégation raciale dans les États du Sud, ou de migrer vers le Nord où les industriels les attendaient à bras ouverts, pour les exploiter dans leurs usines.
On pourrait multiplier les références historiques témoignant de la conscience diffuse, dans la plupart des cultures, du lien intrinsèque entre la liberté et l’autonomie matérielle. Parmi les piliers de la pensée politique de Gandhi, qui s’inspirait des traditions populaires indiennes, il y avait le swaraj (autogestion) et le swadeshi, qu’on pourrait traduire par « autosuffisance villageoise » ou « économie locale » : chaque niveau d’organisation sociale (famille, village, région) doit s’efforcer de satisfaire ses besoins par ses propres moyens, quitte à se fournir auprès du niveau supérieur pour pallier ce qu’il n’a pu produire. Dans la culture chinoise, on en retrouve des éléments dans le nongjia (« l’école agricole » ou « agrarienne »), ancienne tradition de pensée qui s’inspirait du sage Shennong, le « Divin Fermier27 ». Prônant l’autosuffisance communautaire, cette philosophie égalitaire estimait qu’« un dirigeant sage cultive la terre avec son peuple pour produire sa subsistance. Il gouverne tout en cuisinant ses propres repas28. »
Toutefois, l’affinité entre le désir de délivrance et la condition intellectuelle fait que c’est moins dans les textes théoriques classiques qu’on trouvera l’idée d’autonomie que dans la texture même des modes de vie des classes populaires et les luttes qu’elles ont menées pour leur liberté. Cette proposition doit être doublement nuancée. D’une part, l’idéal d’autonomie a été largement refoulé au xxe siècle dans la culture populaire ou plutôt dans ce qu’elle est devenue, une fois prise en main par l’industrie médiatique : la culture de masse29. Aujourd’hui, il n’est plus au cœur des modes de vie populaires, même à la campagne où certaines pratiques de subsistance persistent tout de même. D’autre part, si l’hégémonie culturelle du rêve de délivrance a jeté l’idéal d’autonomie aux oubliettes de la pensée politique, c’est que ce dernier n’y avait pas toujours croupi. On peut en trouver des traces dans la pensée antique, avec sa valorisation de l’autarcie et de la frugalité, ainsi que dans le républicanisme classique, jusqu’à Rousseau qui estimait, en parlant de la Corse : « Quiconque dépend d’autrui et n’a pas ses ressources en lui-même ne saurait être libre30. » Ensuite, l’autonomie n’est plus valorisée que par des autrices et des penseurs en marge de leur courant de pensée : des socialistes non marxistes, des écologistes non technocrates et des féministes non modernistes.
Mieux encore qu’Illich, ce sont les écoféministes de la « perspective de la subsistance31 » qui ont formulé la conception la plus aboutie de la liberté comme autonomie. En revalorisant les activités de subsistance (la production locale de biens destinés à satisfaire les besoins de celles et ceux qui les produisent, par opposition à la fabrication industrielle de marchandises), elles rompent avec le désir de délivrance, qui aboutit à faire faire à des salariés, des femmes ou des esclaves ce que l’on veut avoir sans se donner la peine de le faire soi-même. Car leur propos est de penser et dépasser ensemble ces divers rapports de domination (dirigeants/exécutants, hommes/femmes, Nord/Sud), ce qui implique de repenser la liberté « à l’intérieur du “domaine de la nécessité” » (voir la citation en exergue de ce chapitre).
En affirmant cela, elles se démarquent des féministes modernistes pour qui les activités de subsistance, associées aux sociétés traditionnelles et à leurs rapports personnels de domination, notamment de genre, sont incompatibles avec l’émancipation. La prise de conscience du caractère fallacieux des formes d’émancipation que propose le monde industriel, qui se caractérise par une expansion inouïe des rapports de domination, mais sous une forme impersonnelle, les a conduites à faire l’hypothèse inverse : à l’heure du désastre socio-écologique provoqué par le capitalisme industriel, l’émancipation des femmes, comme celles des hommes, suppose de réinventer la subsistance en dehors des rapports traditionnels de domination personnelle32. C’est ce pari que font toutes celles et ceux qui, aujourd’hui, tentent de se réapproprier leurs conditions de vie au sein de petites structures collectives, où l’on cherche à répartir équitablement les tâches en fonction des préférences, des capacités et des situations des unes et des autres, plutôt que des sexes.
Cette liberté dans la nécessité, les écoféministes la nomment « autonomie », dans un tout autre sens que Kant. Car il ne s’agit pas de s’arracher au monde sensible. Au contraire, il s’agit d’assumer notre part sensible en assurant notre subsistance. C’est l’autonomie au sens de la Selbstständigkeit allemande33 (littéralement : se tenir debout par soi-même) et de la self-reliance anglaise (s’appuyer sur soi-même, compter sur ses propres forces), termes qui ne font pas référence à la loi, mais à la vie physique et matérielle. Ce faisant, elles étendent la portée d’une idée qui est bien présente chez Kant, mais n’est pas rattachée au terme « autonomie ». Contre la propension paresseuse à déléguer à d’autres (intellectuels, directeurs de conscience, médecins, etc.) la « fastidieuse besogne » de penser par soi-même, et d’en faire ainsi nos « tuteurs », Kant donne aux Lumières la devise suivante : « Ose te servir de ton propre entendement34. » En quelque sorte, il s’agit aujourd’hui d’étendre cette idée au-delà du champ intellectuel, vu que la mise sous tutelle matérielle des populations est le fondement d’un nouvel obscurantisme, manifeste dans le déni de la gravité de la situation socio-écologique. Au xxie siècle, les Lumières exigent de nous sortir de la tutelle industrielle : « Osez-vous servir de vos propres capacités intellectuelles et physiques, osez faire par vous-mêmes ! »

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Paul Lafargue, Le Droit à la paresse [1880], Paris, Maspero, 1970, p. 125 et 153.[↩]
- Voir Maurice Pianzola, Thomas Munzer ou la guerre des paysans [1958], Genève, Héros-Limite, 2015, p. 237-238.[↩]
- Veronika Bennholdt-Thomsen & Maria Mies, Eine Kuh für Hillary. Die Subsistenzperspektive, Munich, Frauenoffensive, 1997, p. 7-9. Voir aussi Vandana Shiva, « Le concept de liberté des femmes Chipko », dans Maria Mies & Vandana Shiva, Écoféminisme [1993], Paris, L’Harmattan, 1999, p. 273-277.[↩]
- Gerrard Winstanley, L’Étendard déployé des vrais niveleurs ou l’état de communisme exposé et offert aux fils des hommes [1649], Paris, Allia, 2007, p. 36. Voir aussi Christopher Hill, Le Monde à l’envers. Les idées radicales au cours de la révolution anglaise, Paris, Payot, 1977, chap. 7 dont est tirée la citation en exergue de ce chapitre.[↩]
- Voir James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, Paris, Le Seuil, 2013 ; ainsi que Dénètem Touam Bona, Fugitif, où cours-tu ? Paris, PUF, 2016.[↩]
- Voir Jérôme Baschet, La Rébellion zapatiste. Insurrection indienne et résistance planétaire, Paris, Flammarion, 2005 ; et Raúl Ornelas Bernal, L’Autonomie, axe de la résistance zapatiste. Du soulèvement armé à la naissance des « caracoles », Paris, Rue des cascades, 2007.[↩]
- Voir Max Weber, La Ville, Paris, La Découverte, 2014, notamment p. 73-107 et 178-193 ; en ce qui concerne la France, où le mouvement communal a été moins fort qu’ailleurs, voir André Chédeville, Jacques Le Goff & Jacques Rossiaud, La Ville en France au Moyen Âge, des Carolingiens à la Renaissance, Paris, Le Seuil, 1998, p. 163-165.[↩]
- Friedrich Engels, « De l’autorité », réédité dans le no 12 de la revue Notes & Morceaux choisis, op. cit, p. 124-125. Cette formule en italien dans le texte d’Engels fait allusion à l’inscription que Dante a mise au-dessus de la porte de l’enfer, dans la Divine Comédie : « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. »[↩]
- Voir la série d’articles diffamatoires contre « l’autonomie, le communalisme, le fédéralisme et le libertairisme » que publie Paul Lafargue dans le journal L’égalité : « Au nom de l’autonomie » (18 décembre 1881) et « L’autonomie » (du 25 décembre 1881 au 15 janvier 1882).[↩]
- C’est sa correspondance avec Véra Zassoulitch qui a suggéré l’idée que Marx, en 1881, était prêt à relativiser son postulat industrialiste selon lequel le capitalisme (c’est-à-dire le développement industriel) était la condition du communisme (donc de la liberté). Voir Teodor Shanin (éd.), Late Marx and the Russian Road. Marx and the « peripheries of capitalism », New York, Monthly Review Press, 1983.[↩]
- Voir Georgy Katsiaficas, The Subversion of Politics. European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life, Oakland, AK Press, 2006.[↩]
- Comme l’explique Cornelius Castoriadis au cours d’un débat avec Daniel Cohn-Bendit, De l’écologie à l’autonomie [1980], Lormont, Le Bord de l’eau, 2014, p. 31.[↩]
- Sur la récupération de la notion d’autonomie dans les années 1980-1990, voir Luc Boltanski & Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, notamment p. 266-290 et 509-528.[↩]
- Immanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs [1785], troisième section.[↩]
- Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur, op. cit., p. 77-83 et 236-239.[↩]
- Voir Jacques Julliard, Autonomie ouvrière. Études sur le syndicalisme d’action directe, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1988. Cette idée remonte à Proudhon qui voulait que les ouvriers aient une conscience, un discours et une pratique propres : De la capacité politique des classes ouvrières [1865], Paris, Le Trident, 1989, p. 56.[↩]
- Voir Olivier Rey, Une question de taille, Paris, Stock, 2014.[↩]
- Max Weber, La Domination, Paris, La Découverte, 2013, p. 57.[↩]
- Sur le « décalage prométhéen » entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes capables de nous représenter, voir Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle [1956], Paris, L’Encyclopédie des nuisances – Ivrea, 2002, p. 294-327.[↩]
- Voir Jacqueline de Romilly, La Grèce antique à la découverte de la liberté, Paris, Fallois, 1989, p. 109-120.[↩]
- Aristote, Les Politiques, l. I, chap. 2 et l. VII, chap. 4 et 5 (citation 1326 b 29). [↩]
- Voir Albert O. Hirschman, Les Passions et les intérêts. Justifications politiques du capitalisme avant son apogée [1977], Paris, PUF, 2014.[↩]
- Sur cette « multinationale » avant la lettre, voir Fabian Scheidler, La Fin de la mégamachine, op. cit., p. 200-203.[↩]
- Grotius, La Liberté des mers [1609], Paris, Panthéon-Assas, 2013, p. 47. [↩]
- À propos du socialisme ujamaa promu par le président Julius K. Nyerere (auteur de Liberté et Socialisme, Yaoundé, CLE, 1972), lire Gilbert Rist, Le Développement, op. cit., p. 227-241.[↩]
- Voir l’article « Forty acres and a mule » de l’encyclopédie en ligne wikipedia, version anglaise.[↩]
- À ce propos, lire Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Points, 2014, p. 166-167.[↩]
- Formule de Xu Xing, penseur agrarien du ive siècle av. J.-C., cité par Wiebke Denecke, The Dynamics of Masters Literature. Early Chinese Thought from Confucius to Han Feizi, Cambridge-Londres, Harvard University Press, 2010, p. 37.[↩]
- Voir Christopher Lasch, Culture de masse ou culture populaire ? [1981], Castelnau-le-Lez, Climats, 2001.[↩]
- Jean-Jacques Rousseau, Projet de constitution pour la Corse [1765], Paris, Nautilus, 2000, p. 28.[↩]
- C’est le sous-titre du livre déjà cité de Veronika Bennholdt-Thomsen & Maria Mies, Eine Kuh für Hillary (en cours de traduction à La Lenteur). Cette catégorie implique d’autres autrices, notamment Vandana Shiva, qui a coécrit avec Mies un autre grand livre : Écoféminisme, op. cit. [↩]
- Voir Veronika Bennholdt-Thomsen & Maria Mies, Eine Kuh für Hillary, op. cit., chap. 8.[↩]
- Ibid., p. 27.[↩]
- Immanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? [1784].[↩]







