À propos de : Karl Jocoby, Crimes contre la nature, voleurs, squatters et braconniers : l’histoire cachée de la conservation de la nature aux Etats-Unis, Anacharsis, 2021 ; Des ombres à l’aube : Un massacre d’Apaches et la violence de l’histoire, Anacharsis, 2013.
En 2013, les éditions Anacharsis ont fait paraître la traduction en français de Des Ombres à l’Aube de Karl Jacoby, historien états-unien spécialiste des borderlands. Le succès rencontré vaut sans doute que paraisse aujourd’hui son premier opus, Crimes contre la nature. Des Ombres à l’Aube retraçait l’histoire d’un massacre en Arizona en 1871. Crimes contre la nature évoque le braconnage, le vol et les destructions commis dans trois parcs nationaux américains, pendant les premières décennies de leur existence, entre 1870 et 1910. Écrits à dix ans de distance, les deux livres traitent de manière différente de sujets sans rapport entre eux. Ils sont pourtant issus de la même matrice : la Nouvelle histoire de l’Ouest, un effort collectif des historiens de la partie des États-Unis située à l’ouest du Mississippi pour rendre au passé américain sa diversité, son incertitude, et sa grande dépendance à l’environnement.
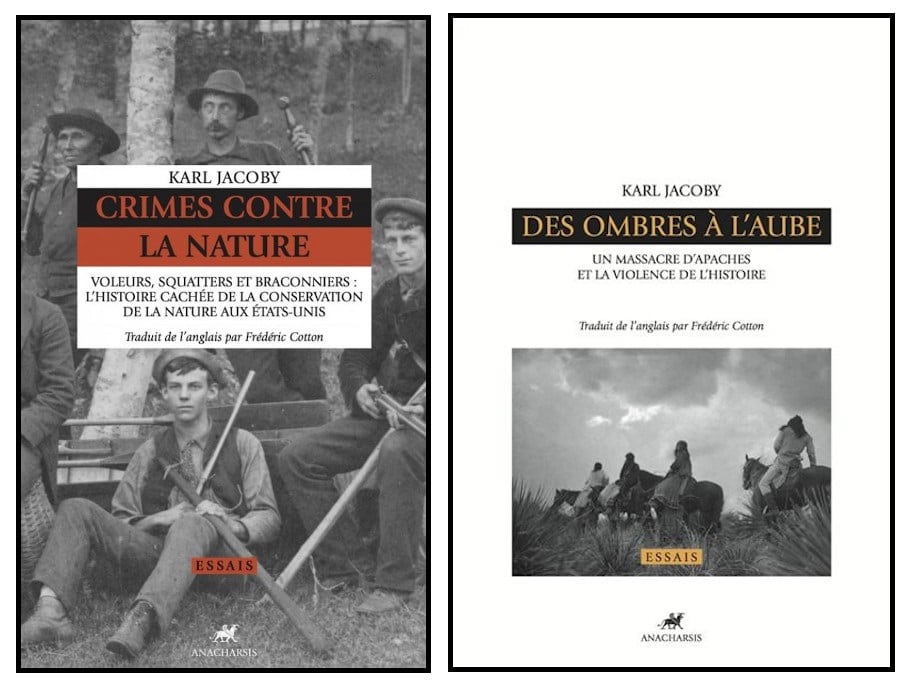
Repenser l’histoire de la Frontière
D’une certaine manière, l’histoire de ces deux livres commence, comme leurs sujets, à la fin du 19ème siècle. À l’exposition universelle de Chicago, en 1893, les visiteurs purent admirer des plantes et des machines, des Indiens, et des théories. Celle avancée par Frederick Jackson Turner était particulièrement séduisante. Contredisant radicalement la thèse alors en vogue des origines germaniques de la démocratie américaine, ce jeune et ambitieux historien du Wisconsin proposait de repenser entièrement les origines du pays. Pour lui, les États-Unis étaient nés sur la ligne mobile et invisible marquant la limite entre peuplement européen et « Pays indien ». Là se serait forgée l’Amérique, dans la confrontation avec la sauvagerie de la Nature et des premiers habitants du continent. L’abondance de terres libres (entendre: non exploitées) y aurait permis à tout immigrant de devenir propriétaire et brisé ainsi l’ordre artificiel des sociétés hiérarchiques européennes. Esprit d’entreprise, individualisme, démocratie : en attribuant à la Frontière l’origine de valeurs américaines par excellence, Turner présentait un récit de la Conquête qui allait rapidement dominer l’écriture de l’histoire nationale. Une image cartographique résumait mieux que tout autre cette approche, celle d’un front progressant d’est en ouest, derrière lequel des territoires devenaient peu à peu, et de plus en plus rapidement, des États américains. Jusqu’au moment où il devenait impossible de distinguer, entre le Pacifique et l’Atlantique, un seul morceau de territoire où les Euro-Américains ne fussent pas les plus nombreux. Ce moment, Turner le situait en 1890, en s’appuyant sur recensement décennal qui, cette année-là, faisait le point sur la population d’un pays s’étendant alors d’une côte à l’autre.

En 1932 déjà, Herbert Eugene Bolton, un historien de Californie, contestait que l’histoire du continent ait pu se jouer de manière si simple. Bolton invitait ses collègues à considérer le continent dans son ensemble, plutôt que les seules colonies anglophones, et mettait en avant le rôle des Espagnols dans ce qui devait devenir le Sud et l’Ouest des États-Unis. De cette attention émergeait le rôle décisif d’espaces intermédiaires, riches, violents, confus, les borderlands, au sein desquels Bolton distinguait particulièrement les territoires du nord de la Nouvelle-Espagne, devenus ensuite parties du Mexique, avant d’être arrachés à celui-ci par les États-Unis1. Mais il fallut attendre les grandes mobilisations indiennes des années 1960 et 1970, et la lutte contre la guerre du Vietnam, pour que le besoin d’autres récits se fasse pleinement entendre et que l’hypothèse des borderlands fût véritablement explorée par les historiens états-uniens. Dès la fin des années 1970, Patricia Limerick, Donald Worster, Richard White s’appuyaient sur l’anthropologie culturelle, l’histoire environnementale, ou encore l’histoire du droit, pour démontrer la fausseté du paradigme proposé par Turner. Ils y donnaient à voir une Amérique plus diverse, où les cowboys et les Indiens continuaient de se tirer dessus, mais faisaient bien d’autres choses ensemble, avec bien d’autres gens, avec des animaux aussi et des acteurs plus étranges encore, comme le feu2.
Ces efforts pour « réviser » l’histoire donnaient à voir un Ouest divers dans ses milieux et ses populations, à la fois insulaire et connecté au reste du monde. Attachés à dénoncer des mythes américains, les représentants de la Nouvelle histoire de l’Ouest (NHO) ne firent pas l’unanimité. Surtout dans le grand public, plongé dans les culture wars qui opposaient à la fin des années 1980 conservateurs et tenants d’un activisme sans remords en faveur des minorités et des femmes3. Ils réussirent néanmoins à fixer un nouveau standard dans l’écriture scientifique de l’histoire nationale : finies les dichotomies à la serpe entre Sauvagerie et Civilisation, Nature et Culture; oubliées les lignes de front ; bienvenue zones-frontières et compromis4, pluralisme, sources en plusieurs langues, attention au plus grand nombre de « voix » possible, fusion harmonieuse des aspects les plus techniques et les plus culturels, bref : complexité et nouveaux récits. Cette richesse, et le talent des grands noms du mouvement attirèrent de nouveau les étudiants vers un champ de l’histoire et une région, l’Ouest du Mississippi, qui avait nettement perdu de son attrait après la Deuxième Guerre mondiale.
« Écologies morales » ou crimes contre la nature dans les premiers parcs nationaux
Karl Jacoby est de cette deuxième génération, ces élèves des maîtres, Patricia N. Limerick, William Cronon, Richard White ou encore Donald Worster. Son premier livre est d’ailleurs la réponse à une demande faite par eux : écrire l’histoire des parcs nationaux, ces temples de l’idéologie de la wilderness, une des idoles de Turner et une des cible de la NHO. Cronon, directeur de thèse de Jacoby, le disait dès 1996 : les partisans d’une préservation de la Nature se trompaient d’objectif ; il n’y avait jamais eu, en Amérique du Nord, de Nature sauvage et inviolée, distincte de l’humanité ; les parcs nationaux ne préservaient rien : ils créaient un espace mythique pour une Amérique amoureuse de l’idée de « sauvagerie ». Au moment même où s’accumulaient, dans les recherches sur l’Afrique et l’Asie, les preuves que ce modèle de protection de la nature avait été un pilier de la domination coloniale5, les origines américaines de l’institution ne pouvaient être ignorées. Une série de publications s’en suivit à la fin des années 19906.
Crimes contre la nature s’inscrit donc dans un mouvement de longue haleine. Il s’en distingue cependant par sa facture. Le livre est ramassé, formé en courts chapitres portant sur les « crimes contre la nature » commis dans les parcs nationaux des Adirondacks, dans le New York ; de Yellowstone, dans le Wyoming ; et du Grand Canyon, en Arizona. À partir de ces cas, Jacoby ne signe pas une somme dénonciatrice sur les opposants ou les partisans de la préservation de l’environnement (conservation) aux États-Unis. Il cherche plutôt à faire émerger des images frappantes, à faire ce que la NHO encourage à faire depuis plusieurs décennies : compliquer le récit. Sous sa plume, à travers l’angle du braconnage, du vol et de l’incendie, l’histoire des premières années des parcs nationaux américains n’est ni le début d’un retour difficile de la nature, ni celui d’une dépossession sans nuances des premiers habitants du lieu. Bien que le premier parc soit créé dans le Wyoming en 1872, c’est en réalité dans l’État de New York, explique Jacoby, que sont élaborées les savoirs qui vont permettre de transformer des territoires en réserves naturelles puis en parcs nationaux. L’attention à la classe, à la race, au genre, aux questions de géographie, de milieu et d’écologie guide son interprétation d’archives administratives, de journaux, de mémoire. Mais bien que l’injustice soit présente à chaque étape de cette histoire, le ton de Jacoby n’est jamais dénonciateur, même quand il s’agit de mettre en évidence le rôle des parcs dans la dépossession des Amérindiens.
En mettant en avant, comme son camarade Louis Warren, les conflits de classe autour du braconnage dans les parcs, en examinant aussi le vol de bois et les incendies criminels de forêts, Jacoby rattache également l’histoire environnementale, si brillamment illustrée dans l’Ouest, à une histoire sociale d’inspiration européenne, attentive aux classes populaires, aux immigrants, aux pauvres, aux marginaux. La figure tutélaire est ici Edward P. Thompson, historien de la classe ouvrière anglaise et inventeur de la notion d’économie morale.
Plusieurs fois redéfinie, cette notion a servi à mettre en avant la rationalité morale d’actions collectives criminalisées. Pour Thompson et ses émules, émeutes frumentaires et prélèvements non-autorisés dans les forêts ne sont pas un basculement incontrôlé dans la violence et le vol, mais le fruit d’une mise en œuvre collective de règles concernant le juste et le tolérable. En disant pour sa part étudier des « écologies morales » sans vraiment préciser ce qu’il entend par là, Jacoby esquive le débat sur la notion, mais le geste compte. Tout le livre veut révéler la signification que donnent à leurs actes illégaux les acteurs des histoires que Jacoby débusque dans les parcs, les intentions et les principes qui guident l’action des habitants des parcs, bientôt expulsés, et de sociétés des villages et bourgades établies à proximité. Dans ces petits mondes qui correspondent presque trait pour trait à la Frontière décrite par Turner, Jacoby nous fait entendre une multiplicité de points de vue. Dans l’acte illégal il identifie non un attachement à une liberté débridée, mais le souhait contraire : que ne soit pas détruit un mode de vie de pionniers réglé par la coutume sinon toujours par le droit.
Car les parcs nationaux, associés à l’idée de protection de la nature par la puissance publique, sont avant tout un territoire où l’État impose un droit nouveau face à des pratiques d’exploitation de l’environnement déjà existantes qui sont loin d’être anarchiques ou… sauvages. Du jour au lendemain, poussé par des partisans de la préservation de l’environnement au nom de son exploitation pérenne, et par des élites désireuses de préserver une Nature investie de pouvoirs régénérateurs mythiques, l’État fédéral surgit là où il était jusque-là invisible. Il impose des restrictions, tente de faire respecter des frontières, entre en conflit avec ceux qui se retrouvent contre leur gré à l’intérieur des limites du parc alors qu’ils se pensaient surtout aux limites du peuplement humain de leurs régions.

Rebelles des Adirondacks
En la matière, le cas des Adirondacks abonde en exemples frappants. Ce territoire laissé à l’écart du développement spectaculaire que connaît le reste du New York, peuplé de chasseurs, de bûcherons, et de petits exploitants agricoles, est transformé en réserve en 1885 et en parc en 1892, pour en protéger la forêt. Le projet se heurte vite à un territoire fragmenté, dans lequel la colonisation du territoire a créé une mosaïque de propriétés et d’usages. Il n’est pas jusqu’aux entreprises d’exploitation forestière qui n’entretiennent alors un rapport pour le moins coulant avec leur propre droit de propriété. Comme l’explique Jacoby,
Le plus souvent, elles abattaient les arbres les plus commercialisables puis, au lieu de conserver les terrains durant les une ou deux décennies nécessaires à la repousse d’une nouvelle génération d’arbres à exploiter, elles abandonnaient leur propriété, finalement saisie par l’État pour défaut de paiement des taxes afférentes. Même si cette pratique légua à la région un héritage complexe de droits de propriété que la Commission forestière devait mettre des années à dénouer, l’exercice restreint des compagnies forestières de leur droit de propriété signifiait également que leurs activités empiétaient fort peu sur les usages que les Adirondackers faisaient traditionnellement de la forêt. (p. 59)
Face à cette apparente négligence qui garantissait une certaine coexistence entre les différents groupes vivant de la forêt, l’action de l’État pouvait être pensée par ses fonctionnaires comme une rationalisation. Elle était, en réalité, comme l’explique Jacoby en empruntant l’expression à James C. Scott, une simplification. Contre elle se rebellèrent des gens qui n’étaient ni tous pauvres, ni tous délinquants, mais qui réagissaient presque tous en habitants, en gens du cru. Face à des étrangers au nombre desquels ils comptaient l’État fédéral, ses agents, ses parcs, mais aussi les riches propriétaires qui s’accaparèrent à la fin du 19ème siècle des morceaux entiers de la forêt pour s’y reposer, s’y régénérer, ou y chasser, ils se serraient les coudes, tenant à l’œil le riche intrus et le garde-chasse, entourant de secret leur propre usage des lieux, risquant le procès et le conflit physique. Parfois aussi ils s’appropriaient le discours de l’État en se présentant eux-mêmes comme protecteurs de la nature.
Au début de l’année 1883 par exemple, un certain nombre d’habitants de Boonville, outrés par ces « bouchers sans scrupules déguisés en chasseurs [qui] ont massacré sans pitié des centaines de cerfs dans cette partie du pays», constituèrent une association afin de surveiller leurs forêts. Les membres de cette association réunirent des fonds pour rémunérer « deux guides capables et efficaces, […] en charge de réunir des preuves contre les groupes qui se livrent à la chasse illégale de cerfs ». Trois ans plus tard, une entreprise similaire se mit en place dans la région de la Keene Valley. (p. 131)
Aux gardes-chasse de l’État fédéral, les villages des Adirondacks opposèrent ainsi leur association de guides pour chasseurs, un quasi-syndicat répartissant équitablement la manne touristique entre professionnels locaux et présentant ceux-ci comme « les véritables protecteurs du gibier de ce parc magnifique où ils avaient passé la plus grande partie de leur vie ». Les idéologies dont se revendiquaient braconniers, notables, professionnels, n’étaient d’ailleurs pas révolutionnaires : une des justifications les plus courantes de l’opposition aux règles imposées par l’État était un droit d’usage prioritaire face au reste du pays, un droit revendiqué au nom du homesteading (appropriation de la terre qu’on exploite), du libre accès aux ressources de la Nature de citoyens égaux entre eux, ou du devoir d’un père de famille de nourrir ses enfants.
Lorsqu’ils justifiaient leurs actes, les ennemis de l’État-en-protecteur-de-la-Nature inventaient-ils après coup un code local ou formulaient-ils des évidences que seuls l’État et les élites des grandes villes agissant au nom de la préservation de la faune et des forêts étaient assez dogmatiques pour ignorer ? Jacoby résiste à la tentation de regrouper ces délinquants sous un label unique. Leur action est souvent enveloppée de secret et ne permet pas toujours de faire plus que des hypothèses sur leur identité. Ce qui importe à ses yeux est que ces rebelles à la « mise en parc » de la nature sont nombreux, de statuts sociaux très variés, qu’ils ne sont pas les victimes passives de la « simplification ». Mais aussi qu’ils placent souvent des limites strictes à l’exploitation commerciale, en s’élevant par exemple contre les destructions opérées par des braconniers quasi-professionnels. Pas précisément des partisans des communs, mais pas non plus les capitalistes sauvages de la légende de l’Ouest, donc.
C’est par là, finalement, que l’État gagne. À Yellowstone, dans le Grand Canyon ou dans les Adirondacks, l’épreuve de force tourne partout à l’avantage des « préservationnistes ». Partout, contre les Indiens ou les chasseurs qui persistent à fréquenter les parcs, l’armée est appelée en renfort. Mais c’est le retournement des populations locales qui stabilise en fin de compte la frontière tracée par l’État entre ce qui est parc et ce qui ne l’est pas. On ne se pense pas en gardien de la nature impunément, semble dire Jacoby : en voulant se justifier, en prêchant les bonnes pratiques et la modération, au nom aussi d’un intérêt touristique bien compris, les « locaux » passent insensiblement du côté du droit et se retournent contre « leurs » braconniers. Les arrangements qu’ils réussissent un temps à imposer à l’État finissent par céder, parce qu’eux-mêmes se résignent ou parce qu’ils subissent une pression que leurs droits ne suffisent pas à détourner. C’est tout particulièrement le cas des Amérindiens. Pour ceux-là qui subissent de concert la mise en réserve et l’exclusion des parcs, les parcs nationaux enfoncent le clou d’une dépossession paradoxale : l’État fédéral leur ôte des ressources, mais il leur impose aussi la propriété, et le droit qui va avec. Par des effets en cascade, la délimitation sur une carte d’un nouveau territoire à protéger participe finalement bien de l’expansion des États-Unis sur le continent nord-américain. Elle ne préserve pas la nature, mais parachève son passage dans un nouveau régime, où l’État et le droit ne peuvent être ignorés.
La Nouvelle histoire de l’Ouest et les spécialistes de l’histoire de l’État en Amérique ont beaucoup fait pour mettre en évidence le rôle des administrations fédérales dans les immenses régions non dominées par les Euro-américains. Ils y ont notamment montré la précocité du rôle régulateur de l’État fédéral. Ils ont aussi mis en évidence qu’avant même l’arrivée de l’État s’y déployaient déjà des codes variés. Ce pluralisme légal, Crimes contre la Nature le rappelle, se jouait dans une certaine tolérance envers l’autre, au nom d’un intérêt mutuel bien compris. Il était aussi caractérisé par des affrontements meurtriers, qui étaient loin d’être des incidents isolés.

Histoire d’un massacre
C’est le sujet que Jacoby aborde dans Des ombres à l’aube. Le livre, paru en anglais en 2008, et accompagné d’un site web, est une relecture magistrale des acquis de la NHO sur le rôle d’une violence routinisée, loin d’être anarchique, dans le façonnement des borderlands auxquels l’expansion des États-Unis vient mettre fin au cours du 19ème siècle. L’historien exploite ici un incident aperçu dans sa précédente recherche : en avril 1871, un groupe indigène est assassiné dans le canyon d’Arvaipa, en Arizona. Les victimes, au nombre de 144 au moins, sont surtout des femmes et des enfants, en théorie sous la protection de l’armée américaine, cantonnée tout près, à Camp Grant. Elles sont désignées par leurs assassins sous le nom d’Apaches, d’Indiens. Parmi les perpétrateurs, aux côtés de notables américains et mexicano-arizoniens de la toute proche Tucson, il est aussi d’autres Indiens, O’odham, peut-être même également d’autres Apaches. Face à cette configuration singulière mais loin d’être unique dans l’histoire du continent nord-américain, le livre s’énonce comme un pari: reconstituer pour chaque groupe, parmi les bourreaux et les victimes, et avec un souci tout particulier de l’équilibre, l’histoire d’une « intime inimitié » qui, tout autant que les liens pacifiques, a tissé les relations entre les groupes et les individus dans ce borderland jadis révélé par Herbert Eugene Bolton. Avec à la clé plus qu’un récit bien fait : une tentative de faire de l’histoire comme pratique d’écriture, une force de vérité et peut-être de réparation.
Pari tenu ? Comme dans Crimes contre la nature, Jacoby déploie dans Des Ombres un art précis de l’écriture historique. Deux fois plus gros que son premier essai, le volume mobilise toute la littérature disponible sur chaque groupe ethnique pour tenter de rendre compte de son point de vue particulier, sans oublier non plus les sous-groupes qui s’en détachent ou ne se conforment pas au schéma commun. Les contraintes respectées donnent envie de reconnaître à Jacoby sa place dans un Oulipo des historiens américains : il consacre un chapitre pour chaque groupe, dont il retrace l’itinéraire jusqu’au massacre, à chaque fois ré-évoqué à nouveaux frais, puis, après un court intermède relatant le procès qui suit l’événement, quatre nouveaux chapitres, plus courts, qui s’interrogent sur sa mémoire parmi les protagonistes. Chaque chapitre emploie pour désigner les parties en présence les termes revendiqués par le groupe auquel il est consacré: les Apaches ne sont ainsi Apaches que pour les Hispano-mexicains (les vecinos) et les Américains. Dans leur chapitre, ils sont les Nṉēē (le peuple), dans celui des O’odham (ou Pima et Papago), les ’O:b (les ennemis). En forçant le lecteur à une gymnastique exigeante, Jacoby respecte assurément une certaine forme de politesse à l’égard de populations opprimées. Il lui fait aussi goûter au jeu de l’incompréhension et de la reconnaissance qui occupe une place si grande dans l’histoire qu’il écrit. Qui parle ? À qui ? Avec quelles intentions ? Ces questions que les acteurs se posent et auxquelles ils répondent par l’action, parfois violente et parfois pacifique, Jacoby nous force à nous les poser à notre tour. La leçon d’histoire échappe alors au didactisme qui la guette, et s’anime. La proposition qu’il y a plusieurs passés américains, qui se sont dits et se disent encore en plusieurs langues, ne paraît plus si rhétorique.
L’accumulation de chapitres, elle aussi, porte ses fruits. Le massacre devient à la fois plus compréhensible, parce que nullement surprenant, et plus confus, parce que les récits des assassins, seuls à parler, l’embrouillent à force de mensonges et d’omissions. Plus compréhensible : dans le récit que fait Jacoby, le massacre n’est ni plus ni moins que la répétition de procédures violentes, apprises de longue date, bien comprises par toutes les parties qui se connaissent à gros traits sans jamais renoncer à la haine et à la méfiance. L’inimitié entre O’ohdam et Nṉēē, entre vecinos et Nṉēē, leurs alliances et leurs paix temporaires avant que n’arrivent les Américains, répondent à des schémas sans cesse répétés : vengeance et vol de bétail, pillages, rançons, réduction en esclavage et adoption forcée, meurtres, commerce, trêve avec tel groupe, guerre à outrance avec tel autre, sans qu’on sache toujours exactement si on a devant soi ami ou ennemi. Dans ce qui est malgré tout un chaos ordonné, des groupes intermédiaires naissent : les apaches de paz, par exemple, qui acceptent une alliance fragile avec les Espagnols, puis les Mexicains, et s’établissent dans le canyon d’Aravaipa, près de Tucson. À leurs risques et périls : c’est là qu’a lieu le massacre, en 1871. Dans cette histoire pluri-centenaire, les Étatsuniens arrivent avec leurs propres préjugés, mais ne détonnent pas particulièrement. D’abord ultra-minoritaires, ils s’efforcent d’ailleurs de se marier aux femmes de l’élite vecina, et de se faire des partenaires de commerce et de guerre de ces Mexicains qui, de leur côté, vont bientôt devoir trouver leur place dans l’État d’Arizona. Il faut finalement attendre la Guerre de Sécession pour que l’hostilité des Américains envers les Apaches, assimilés à une sous-humanité de brutes sauvages, donne lieu à une multiplication de discours génocidaires. Jacoby refuse de faire du terme le résumé de cette histoire. Il ne rend pas assez compte, selon lui, de la confusion, de l’écheveau extraordinairement emmêlé des responsabilités meurtrières.

N’ayant pas craint de raconter depuis les commencements, c’est-à-dire le 17ème siècle, ce qui est malgré tout une histoire partagée, Jacoby n’hésite pas non plus à la poursuivre en aval, jusqu’à nos jours. Mis en musée dans la réserve apache de San Carlos, le massacre est objet d’histoire aujourd’hui chez les Nṉēē, après un long silence. Les O’odham, auxiliaires du massacre qui avaient voulu se venger d’ennemis qu’il faut bien appeler héréditaires, se retrouvent presqu’à les envier : leur résistance aux Américains leur aurait valu plus de concessions de la part des Milg:an, les Américains. Et ils paraissent plus proches aujourd’hui que par le passé. Les vecinos eux aussi ont pris leur distance avec le nouveau groupe dominant et chanté les exploits de Joaquín Murietta, bandit d’honneur tueur de los americanos. Quant à ces derniers, c’est l’insistance de leurs « pionniers » à justifier leur violence devant les tribunaux de l’Arizona et de l’histoire qui vaut qu’on puisse y consacrer un livre entier. La société historique de l’État est fondée par les massacreurs eux-mêmes afin que leur contribution à la civilisation de la région ne soit pas oubliée !
Dans un lieu rattrapé par l’urbanisation où il ne reste aucune trace de l’événement, Jacoby veut voir des traces malgré tout. Comme il le dit dans l’épilogue du livre,
Même si ces lieux peuvent sembler constituer des monuments dédiés à l’amnésie – à l’effacement d’une histoire souvent embarrassante de violence et de dépossession – il est peut-être plus facile de les interpréter selon la métaphore du palimpseste : un artefact qui sous son texte explicite conserve d’autres formes d’expression moins patentes. Malgré l’image aujourd’hui largement partagée du canyon d’Aravaipa comme étant une aire naturelle immaculée, par exemple, le canyon est en fait le témoin des nombreux efforts apaches pour rappeler son histoire humaine, même s’il s’avère que la plupart sont dissimulés aux regards. (p. 474)
Quelques pages plus loin, il revient à cette idée:
Finalement, donc, le massacre de Camp Grant, comme de nombreux événements du passé, doit davantage se lire comme un palimpseste mêlant de nombreuses histoires. Une multitude de récits se déversent dans les événements du 30 avril 1871, et d’autres en découlent : des récits de génocide, des récits du Nord mexicain et de l’Ouest américain, des territoires tohono o’odham et nnēē, des récits de survie, d’adaptation et de réinvention culturelle. (p. 478)

À dire vrai, la métaphore textuelle convainc moins que la construction très architecturale du livre qu’elle vient conclure un peu maladroitement. D’écrits, Jacoby en trouve excessivement peu qui soient de la main de non-Euro-américains. Les voix indigènes se devinent souvent plus qu’elles ne se font entendre. Jacoby parle à ce sujet de « recréations imaginatives ». Il faudrait ici dire tout le volontarisme de la démarche. Tenter de donner une place équivalente à des groupes qui n’ont pas tous laissé autant de traces, ni d’ailleurs souhaité forcément le faire, réunir dans un seul livre des populations habituellement laissées chacune à l’expertise de ses spécialistes était bien un pari risqué. Mais bénéficiant de la masse critique acquise depuis les années 1980 par les Nouveaux Historiens de l’Ouest, et d’un indéniable talent d’écrivain, Jacoby le gagne à l’endurance. La somme qu’il évitait de produire dans son premier livre, il la publie avec Des ombres à l’aube, autour d’un seul événement.
Le tour de force a beaucoup fait parler de lui, et été imité7. À part cet effet de mode, et cette insistance réussie sur la déstabilisation et le décentrement, il n’est pas sûr pourtant que Jacoby ait réellement fait bouger les lignes. L’histoire du Sud-Ouest, avec ses luttes à plusieurs bandes, avait déjà accouché de récits faisant entendre d’autres voix que les dominantes, y compris sur le massacre de Camp Grant, certes jamais avec un tel art de la composition8. Pas sûr non plus que Jacoby, pris dans cette masse d’informations déjà très travaillée avant lui, soit parvenu à mettre au jour les pépites qu’il faisait surgir lorsqu’il creusait l’histoire des Adirondacks ou du Yellowstone dans des dossiers documentaires qu’il connaissait mieux que quiconque. Fidèle à son approche par cas, il a depuis narré le destin hors du commun d’un ancien esclave afro-américain qui avait réussi, en se faisant passer pour Mexicain au Texas, à devenir millionnaire. Turnerienne ou pas, académique ou populaire, l’histoire de l’Ouest et des borderlands, avec ses chevauchements incroyables, ses retournements de veste et ses incessants passages de frontière, n’a jamais cessé d’être une irrésistible matière à récit. En la redisant, c’est à chaque fois le pouvoir narratif de l’histoire que Jacoby a voulu illustrer. Ses livres bien écrits, bien construits et incarnés sans cacher le « peut-être » contre lequel s’appuient leurs reconstitutions, pourront agacer par leur habileté même. Jacoby travaille dans une situation tout aussi complexe que celle que connaissent ses sujets : il doit écrire une histoire lisible mais nuancée, dire les crimes du passé sans en rouvrir les blessures, parler de victimes et de bourreaux, alors que leurs descendants sont parfois aujourd’hui dans des situations très différentes de leurs ancêtres, et que les victimes d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui. Dans ce contexte, le bien-écrire est plus qu’un talent d’exposition et de construction. C’est une diplomatie de tous les instants pour dire une histoire féroce et incorrecte sans faire de faux pas; satisfaire collègues historiens et anthropologues, indigènes ou d’ascendance européenne, étudiants, grand public américain. Une tâche d’équilibriste dont Jacoby, de l’avis de tous, se sort avec brio.


SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Jeremy Adelman et Stephen Aron, « From Borderlands to Borders: Empires, Nation-States, and the Peoples in-between in North-American History », American Historical Review, 104, 3, June 1999, p. 814-84 ; et Pekka Hämäläinen et Elliott Truett, « On Borderlands », Journal of American History, 98, 2 (September 2011), p. 338-361.[↩]
- Patricia N. Limerick, The Legacy of Conquest: The Unbroken past of the American West, New York, Norton, 1987 ; William Cronon, Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West, W. W. Norton, 1991; Richard White, “It’s your misfortune and none of my own”: A new history of the American West, Norman, University of Oklahoma Press, 1991; Richard White, Le Middle Ground : Indiens, empires et républiques dans la région des Grands Lacs, 1650-1815, Toulouse, Anacharsis, 2009 [1991]; Donald Worster, An Unsettled Country: Changing Landscapes of the American West, University of New Mexico Press, 1994; Stephen J. Pyne, Fire in America: A Cultural History of Wildland and Rural Fire de Pyne, University of Washington Press, 1982.[↩]
- Nathalie Massip, « When Western History Tried to Reinvent Itself: Revisionism, Controversy, and the Reception of the New Western History », Western Historical Quarterly, Volume 52, Issue 1, Spring 2021, p. 59–85.[↩]
- Forum ‘The Middle Ground revisited’, William & Mary Quarterly, 3rd series, 63, 1, January 2006, p. 3-96.[↩]
- David Anderson and Richard Grove (dir.), Conservation in Africa: People, policies and practice, Cambridge and New York, Cambridge University Press, 1987; John M. Mac Kenzie, The empire of nature. Hunting, conservation and British colonialism, Manchester, Manchester University Press, 1988; Jane Carruthers, « Creating a National Park, 1910 to 1926 », Journal of Southern African Studies Vol. 15, No. 2, Special Issue on The Politics of Conservation in Southern Africa (Jan., 1989), p. 188-216.[↩]
- Richard White, “The New Western History and the National Parks.” The George Wright Forum, vol. 13, no. 3, 1996, pp. 29–36; William Cronon, « The Trouble with Wilderness, or, Getting Back to the Wrong Nature, » Environmental History, 1 (Jan. 1996), 7-28; James A. Pritchard, Preserving Yellowstone’s Natural Conditions : Science and the Perception of Nature, Lincoln, University of Nebraska Press, 1999; Robert H. Keller et Michael F. Turek, American Indians and National Parks, Tucson, University of Arizona Press, 1998; Louis Warren, The Hunter’s Game: Poachers and Conservationists in Twentieth-Century America, New Haven, 1999; Mark David Spence, Dispossessing the Wilderness: Indian Removal and the Making of the National Parks, New York, 2000; Jez Alborough et Philip Burnham, Indian Country, God’s Country Native Americans And The National Parks, University of Minnesota, 2000.[↩]
- Voir par exemple James F. Brooks, et son Awat’ovi : L’histoire et les fantômes du passé en pays hopi, trad. de l’anglais par Frantz Olivié, Anacharsis, 2018 ; il est vrai que Brooks avait précédé Jacoby sur ce terrain, avec son livre maintes fois primé, Captives and Cousins: Slavery, Kinship, and Community in the Southwest Borderlands, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002.[↩]
- Voir par example, Chip Colwell-Chanthaphonh, « Western Apache Oral Histories and Traditions of the Camp Grant Massacre ». American Indian Quarterly 27 2003(3&4), p. 639-666.[↩]








