Ce texte est le chapitre 14 de Gérard Dubey et Alain Gras, La Servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, Paris, Seuil, 2021, pp. 215-228.
Nous serions entrés, avec l’électronique et le numérique, le traitement de l’information et du signal, dans une autre ère, celle de la décomposition de chaque élément de réalité (sons, images, mots…) en unités ou en paquets d’unités discrètes interchangeables, en Shannons ou en bits. Ainsi l’électricité ne serait ≪ plus qu’une commodité de transport de l’information1 ≫. La réalité est tout autre et s’il y a bien transformation des usages, l’ère du numérique désigne avant tout une nouvelle phase d’expansion du modèle électrique.
Premièrement, parce que, comme une évidence qu’il devient inutile d’interroger, tous nos gadgets électroniques fonctionnent à l’électricité. L’empreinte énergétique directe (calculée à partir de la seule consommation finale) du numérique progresse ainsi d’environ 9 % chaque année2 et consomme déjà 10 % de la production électrique mondiale (et 4 % de la consommation d’énergie primaire mondiale)3. Ces besoins énergétiques sont bien sûr dus à l’explosion du nombre d’internautes dans le monde qui a atteint les 4,54 milliards en 2020, soit une augmentation de 7 % (298 millions de nouveaux utilisateurs) depuis janvier 2019. L’idée couramment avancée selon laquelle le bilan carbone d’un usage régulier du numérique (1 heure de vidéo par jour pendant un an représenterait 48 kg équivalent CO2) serait incomparablement inférieur à celui d’un vol transatlantique aller-retour (3 000 kg équivalent CO2) se révèle par exemple parfaitement spécieuse. D’abord parce que ces deux pratiques, mesurées séparément, s’additionnent dans la réalité. Ensuite et surtout parce que cette façon d’évaluer ne prend en compte que les pratiques individuelles et non leur effet d’agrégation. Or la consommation d’objets issus du numérique – les quelques chiffres cites en témoignent – est un phénomène de masse (il se vend environ chaque année dans le monde 130 millions de smartphones – même si ces chiffres sont en baisse. En 2019 leur nombre a atteint 1,4 milliard, pour 700 millions en 2012) ! Encore ces chiffres nécessitent-ils d’être constamment révisés, notamment en raison de l’essor spectaculaire des usages de la vidéo (le streaming, Skype…)4, de l’arrivée de la 5G ou encore des perspectives ouvertes par la voiture autonome, les smart city et l’IOT… Avec 1 gigabit de données par seconde (et bientôt 10), la 5G est 100 fois plus rapide que la 4G actuelle. Elle devrait permettre, nous promet-on, de télécharger un film en ultra haute définition en 10 secondes, mais démultiplie d’autant la quantité de données à stocker et conserver (données qui devraient passer de 15 zettaoctets en 2017 à 40 en 2020)5.
Si le cout unitaire moyen des objets numériques diminue, celui-ci est en fait de plus en plus déconnecté de son cout de revient réel, à savoir celui des ressources en énergie et en intrants matériels (combustibles fossiles, produits chimiques, métaux, terres rares, eau, gaz, etc.) impliqués dans la chaine complète de fabrication6. Le seul visionnage de vidéos en ligne a généré dans le monde en 2018 une quantité de gaz à effet de serre équivalent à ce qu’émet un pays comme l’Espagne7. Le développement d’un programme d’apprentissage automatique standard, symbole du ≪ miracle de nouvelle intelligence artificielle ≫ (Machine Learning), produit 284 tonnes d’équivalent CO2 (soit cinq fois ce qu’émet tout le cycle de production-destruction d’une automobile)8. L’effet rebond, auquel nous nous sommes déjà plusieurs fois référés, s’applique ici plus que jamais. Ce que ces données quantitatives tendent toutefois à occulter est la question existentielle sous-jacente à ce consumérisme compulsif. Si la demande en produits numériques progresse plus vite que les efforts entrepris pour en réduire l’empreinte énergétique, c’est que le rapport au monde productiviste sur lequel elle repose s’est diffusé sur toute la planète. La réduction de l’existence à une succession d’instants déliés les uns des autres a notamment fait de la consommation (l’instant compulsif de l’achat) le geste par lequel l’individu se donne l’illusion d’être présent à lui-même. Tant que la perte de sens n’aura pas été clairement identifiée comme ce qui confère à la consommation cette valeur compensatoire, il y a peu d’espoir que les choses changent en profondeur.
La filiation de l’électrique et du numérique se manifeste enfin au niveau structurel. La logique de branchement propre au macro-système technique se prolonge aujourd’hui dans la toile du grand réseau mondial. L’ère du sans-fil (wifi), ou l’asservissement de l’atmosphère à la circulation de l’information, n’est qu’un leurre de plus au service de la fiction d’une dématérialisation du monde industriel alors même que l’essentiel de l’information transite plus que jamais par des câbles bien physiques, pour être ensuite relayées localement par des antennes relais, et que toute information a pour point de départ une impulsion électrique. Le cyberespace est bien le clone en même temps que le perfectionnement du réseau télégraphique d’hier. 99 % du trafic mondial d’internet, 90 % des appels téléphoniques9 et l’équivalent de 10 billions de dollars d’opérations financières quotidiennes transitent ainsi par des câbles sous-marins et non par voie satellitaire (déjà très encombrée)10.
Aux premières lignes télégraphiques terrestres et transatlantiques qui relient les places financières dans l’objectif d’accélérer les transactions (ligne télégraphique reliant la bourse de Paris à celle de Lille en 1849 puis première ligne transatlantique en 185811) fait aujourd’hui écho le réseau mondial de la City of London Telecommunications12. Avec déjà 6,4 milliards d’objets connectés dans le monde en 2016 et 20,4 milliards estimés en 2020, une consommation de données mobiles en croissance rapide de 15 exaoctets en 2017 à 107 exaoctets prévus en 202613, le câblage des continents ainsi que la lutte pour le contrôle de ces flux ont de beaux jours devant eux. Actuellement, 430 câbles sous-marins sont déployés sur plus de 550 000 miles soit presque un million de kilomètres14.
Impérialisme numérique : l’expansion de la logique de branchement
Tout cela suscite des convoitises et déchaine l’appétit des grands opérateurs du numérique (GAFA, Yahoo, Alibaba, ebay…), les seuls avec les grands États nationaux à pouvoir financer l’installation et l’entretien de tels réseaux. Ils sont aujourd’hui présents dans au moins 22 consortiums d’exploitation des câbles sous-marins (Google est à lui seul présent dans 11 d’entre eux). Le moteur de recherche a investi 30 milliards de dollars (25,7 milliards d’euros) entre 2015 et 2017 dans son infrastructure globale sur laquelle passe 25 % du trafic internet mondial. Le contrôle de ces infrastructures ≪ invisibles ≫ est ainsi devenu l’enjeu de vives tensions internationales. La Federal Communications Commission (FCC) américaine oblige toute entreprise étrangère souhaitant acheter une structure de ce type à mettre en place un ≪ Network Operations Center ≫ sur le sol américain (capables de répondre dans un délai de 30 minutes aux requêtes des autorités)15. C’est la raison pour laquelle l’entreprise chinoise Huawei a dû renoncer à construire son propre câble entre l’Europe et les Etats-Unis. Et cela ne fait sans doute que commencer.
Un monde, enfin, pas si global qu’il en a l’air si l’on considère la distribution des flux et des câbles à travers le monde. À l’exception de la zone Asie, la carte des flux d’informations réplique celle des échanges commerciaux depuis la constitution des premiers grands empires coloniaux. En 1913, le Royaume-Uni disposait du plus grand réseau mondial de câbles télégraphiques (à l’image de son empire, avec 330 000 km). Si les États-Unis ont depuis longtemps pris le relais, le déséquilibre avec le continent africain ou sud-américain demeure criant. La nouveauté réside cette fois dans la prise de contrôle progressive des réseaux optiques par les grands opérateurs du numérique (nord-américains et chinois pour l’essentiel) et notamment des zones d’atterrissage. Les datas centers, au nombre de 338 en 2016 constituent désormais les principaux points de chute des câbles sous-marins. Le câble Marea mis en service par Microsoft et Facebook et qui relie Bilbao et Virginia Beach (6 600 km pour 160 térabits) est ainsi considéré comme le plus puissant du monde16… Les enjeux nationaux et étatiques ne sont évidemment jamais bien loin et ne font en somme que changer d’apparence. Le projet d’installation de datacenters chinois en Islande montre que le programme des routes de la soie vise à contrôler les flux d’information mondiaux en prenant le contrôle de lieux stratégiques. En plus de raisons géostratégiques, le projet des « routes polaires de la soie » présente un intérêt énergétique évident, celui de bénéficier de conditions climatiques très favorables au refroidissement à moindre coût de ces installations énergivores17. La guerre de l’information est une lutte à mort pour le contrôle des signes, des choses et des êtres.
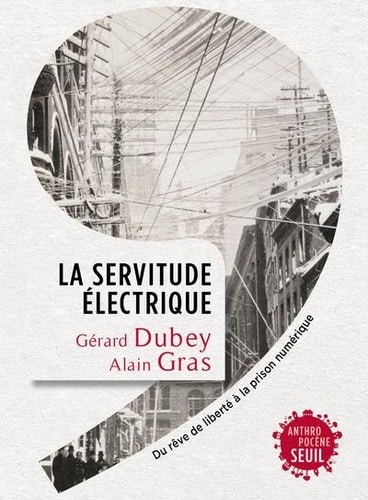
Nous savons que l’industrie du numérique consomme pour la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs 19 % de la production de métaux rares dans le monde et 33 % de la production de cobalt et que l’exploitation de ces matières premières passe par l’exploitation brutale de centaines de milliers de travailleurs-esclaves par l’industrie minière18, dont un nombre important d’enfants (cas de la République démocratique du Congo)19. L’instabilité politique des pays producteurs est entretenue pour assurer la pérennité des affaires dans un contexte de non-droit. Trafic d’armes, corruption et exacerbation des tensions ethniques contribuent ainsi à garantir l’approvisionnement des grands industriels du numérique.
Mais cette prédation est multiforme et les infrastructures numériques servent aussi à dissimuler une division internationale du travail qui laisse de moins en moins d’espace aux luttes sociales. De ce point de vue les fantasmagories de ce début de xxie siècle ressemblent à s’y méprendre à celles du xixe finissant évoquée au deuxième chapitre, masquant la brutalité des réalités sociales d’alors comme d’aujourd’hui. La fée électricité devait réenchanter le monde du travail, le nettoyer des souillures de la matière et de l’atmosphère délétère de l’usine. La numérisation propose aujourd’hui de rendre au travailleur l’autonomie perdue en le libérant des oppressions de l’ère industrielle taylorienne-fordiste. Les apôtres de la « transition numérique » ne manquent pas une occasion d’expliquer de quelle manière le numérique libère le travail, en faisant exploser l’enceinte disciplinaire de l’entreprise ainsi que les rapports de subordination qui s’y rattachent. Le travail renouerait par ce biais avec les anciennes vertus du « travail vivant » : autonomie, maîtrise et surtout priorité donnée au sens. Tous auto-entrepreneurs « peer-to-peer », « gagnant-gagnant » sont ses cache-misères et ses mots d’ordre. Mais, de même que la lampe à arc avait surtout permis d’allonger la journée de travail (chapitre premier), ces promesses d’émancipation sont pour la plupart déjà mort-nées. La phase électronumérique d’organisation du travail fait plus vraisemblablement écho à une nouvelle phase d’expansion du capitalisme20, celle de la marchandisation des relations sociales primaires jusqu’à présent épargnées. Pour André Gorz les technologies numériques, « technologies de la relation et de l’immatériel », devaient revaloriser les activités et les échanges non marchands à l’instar des activités relationnelles d’aide à la personne21. Mais l’économie des « plateformes » (mot délibérément neutre et anodin qui désigne au sens propre un espace physique de transit des marchandises) reflète plutôt la diffusion de la rationalité techno-industrielle à tous les aspects de la vie sociale. Les relations de solidarité intrafamiliales, les tâches domestiques ou les liens commensaux22 constituent ainsi le nouvel Eldorado des plateformes de « services ». Celles-ci sous-traitent à une multitude de prestataires-prolétaires dispersés et isolés à l’échelle de la planète une multitude de micro-tâches insignifiantes, en déjouant les règles élémentaires du droit du travail23. Ce que l’on qualifie par un bel euphémisme de crowdsourcing (« ressources de la foule ») n’est rien d’autre que la forme prise par cette nouvelle économie de prédation à laquelle l’alliance de l’électrique et du numérique confère une efficacité inégalée.
Écologie numérique : le retour de la fée prodigieuse
La promesse d’une « écologie numérique », autrement dit, l’idée selon laquelle nous pourrions renouer une relation amicale avec la Terre depuis ce qui symbolise au plus haut point son artificialisation, part au fond du même principe que celui d’une réconciliation du capital et du travail par la grâce du numérique. Pour Philippe Monloubou, président d’Enedis, la vraie révolution réside ainsi dans l’architecture et l’organisation des réseaux intelligents (smartgrid). L’internet des objets devrait notamment permettre, via les compteurs Linky par exemple, de relier grands et petits producteurs d’énergie24, consommateurs et producteurs (on parle à cette occasion de « prosumers », néologisme de producer et consumer), production fossile et non fossile sur la base d’une information distribuée en temps réel et accessible à tous.
Nous passerions ainsi – pour reprendre une terminologie en vogue dans la novlangue managériale – d’une organisation verticale (top down) à une organisation horizontale (bottom up), rhizomique, ou encore personnalisée de l’énergie, supposément plus proche des besoins réels, donc plus efficiente25. La même logique techno-managériale que celle qui prévaut dans l’économie des plateformes (le prosumer remplaçant ici le « consom’acteur ») se trouve mobilisée ici dans le domaine de l’énergie. Et, surprise, engendre les mêmes effets. Au lieu de la décentralisation-relocalisation promise, d’importants mouvements de concentration ont déjà lieu comme ceux que l’on observe aujourd’hui entre les grands acteurs du monde industriel. La voiture électrique (chapitre 12), bientôt semi-autonome, avec ses batteries rechargeables est, par exemple, déjà pensée et présentée par les constructeurs automobiles comme une unité de production énergétique. Connectées aux réseaux, les batteries seront déchargées aux heures creuses et leur électricité réinjectée sur le réseau afin de compenser les variations de production. Toute cette hypercomplexité débouche très logiquement sur des alliances historiques entre les grands acteurs de l’automobile et ceux de l’énergie (Nissan-Renault/Enedis, ERDF…)26. Notons toutefois que si l’augmentation capacitaire des réseaux « intelligents » s’inscrit bien dans la logique classique de contrôle et de gestion des flux propre aux macro-systèmes techniques, elle vise d’abord à neutraliser ce qui est pressenti comme un obstacle majeur à leur expansion. Il s’agit, nous explique-t-on, de mieux réguler pour mieux consommer, plus sobrement et plus intelligemment. Mais il s’agit surtout de lisser (joli mot pour dire éliminer) les phénomènes de baisse de tension liés à l’intermittence (du photovoltaïque ou de l’éolien), en jouant en temps réel sur l’ensemble des points du réseau connecté (cela se pratique déjà à l’échelle des grands réseaux mais risque de devenir la norme pour l’ensemble des acteurs). On espère ainsi, d’une part faire entrer les renouvelables dans le régime de prédictibilité propre au capitalisme, d’autre part faire revenir dans l’enclos les brebis égarées, c’est-à-dire les sources de production locales et autonomes qui menaçaient d’en sortir. L’internet des objets, la 5G, les smartgrids et les compteurs Linky interviennent ainsi pour interdire ou retarder des changements d’ordre qualitatifs, énergétiques mais surtout politiques, comme celui qui aboutirait par exemple à libérer le travail des contraintes du productivisme27. La cible a bien été identifiée : le temps discontinu, reflet des pulsations de la terre et du monde de la vie.

Un autre argument en faveur d’une « écologie numérique » serait de rendre visible (tangible, palpable) l’invisible, à savoir la dépense énergétique et l’énergie elles-mêmes, bref de responsabiliser le consommateur pour en faire un écocitoyen. Les compteurs « communicants » Linky intégrés à l’internet des objets devraient, selon cette hypothèse, non seulement permettre à chacun de visualiser instantanément sa consommation mais également de mettre cette dernière en rapport avec l’état global de la production. « On peut imaginer – commente ainsi Éric Vidalenc –, un voyant vert qui donnerait un signal (voire piloterait directement l’activation, selon des règles prédéfinies par l’utilisateur) lorsque la production d’énergie solaire ou éolienne bat son plein et qu’il est donc pertinent de recharger sa voiture28… » L’idée ne manque pas de piquant, lorsque l’on sait tout ce que le régime de surconsommation en produits numériques et électriques doit à l’image d’« immatérialité » qu’ils véhiculent. Plus surprenante encore est l’idée selon laquelle cette écoréflexivité citoyenne (la possibilité de connaître sa consommation individuelle) générerait presque automatiquement des comportements énergétiques plus sobres et vertueux. Il est bien difficile d’imaginer comment un système technique aussi normatif pourrait inciter les individus à devenir plus autonomes et réceptifs aux intérêts collectifs. Pour reprendre l’analyse de René Riesel et Jaime Semprun, il n’est pas dans ce projet gestionnaire de fabrication de la nature « une manifestation spontanée de la vie qui ne soit ravalée au rang d’objet passif à organiser, […] il faut combattre et supprimer tout ce qui existe de façon autonome, sans les secours de la technologie, et qui ne saurait donc être qu’irrationnel29 ». La même critique que celle qui vaut pour l’écocitoyen vaut ici pour le sujet de l’écologie numérique. Véritable incarnation du géopouvoir, celui-ci n’est qu’un sujet passif soumis aux solutions des experts géocrates30. Tous ces dispositifs ont finalement pour conséquence de nous enfermer un peu plus dans une normativité propice au déploiement des grands systèmes techniques. En règle générale, lorsqu’elle se coule dans le moule de l’approche systémique, la « pensée » écologique se transforme aussitôt en auxiliaire de la rationalité gestionnaire. La réflexivité attendue de l’écocitoyen, pour de « bonnes pratiques » réellement « vertueuses », n’est en réalité, nous le verrons, que le pendant de l’autocontrôle propre aux systèmes autorégulés de la cybernétique. Elle appelle à perfectionner et à diversifier toujours plus les moyens de contrôle et de monitoring.
Par la grâce de l’intelligence artificielle, du numérique et des réseaux se trouve ainsi renouvelée la promesse que tout pourra continuer comme avant. Le même fantasme d’un usage à volonté de la force survit aux désastres qu’il engendre. L’écologie numérique rejoue la fiction de l’énergie pure et immaculée que jouait au xixe siècle l’électricité. Elle permet surtout d’éluder la question décisive que nous adressent les énergies naturelles : celle du caractère mortifère de la temporalité secrétée par le monde industriel. Il y a au moins un point avec lequel nous pouvons en apparence tomber d’accord avec les promoteurs du tout numérique : la « révolution numérique » est bien la quatrième révolution industrielle après celle de la vapeur, de l’électricité et de l’automatisation. Mais au sens où elle prolonge, cumule et potentialise les trois précédentes et constitue la dernière étape du processus d’industrialisation amorcé il y a deux siècles. Comment s’extraire de ce cercle vicieux ? Peut-être en convenant que le point à partir duquel nous pouvons imaginer sortir du cercle se trouve sous nos yeux, dans la conscience grandissante de l’enfermement auquel aboutit une puissance technologique indifférente à l’expérience ordinaire comme au besoin de présence des êtres humains.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute.
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Tristan Garcia, La Vie intense, Autrement, 2016,[↩]
- Françoise Berthoud et al., « Lean ICT : pour une sobriété numérique », rapport du groupe The Shift Project, octobre 2018[↩]
- Frédéric Bordage (dir.), « Empreinte environnementale du numérique mondial », GreenIT.fr, octobre 2019. Voir aussi : Fabrice Flipo, « La face cachée du numérique », Notes de la FEP, juillet 2020[↩]
- Voir par exemple, « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne », rapport piloté par Maxime Efoui-Hess pour le think tank The Shift Project, juillet 2019.[↩]
- Philippe Bihouix, Le bonheur était pour demain, Seuil, 2019[↩]
- Sacha Loeve. « La Loi de Moore : enquête critique sur l’économie d’une promesse », p. 13, postprint généré par l’auteur. Publié dans le volume collectif : Marc Audétat (dir.), Sciences et technologies émergentes : pourquoi tant de promesses ?, Paris, Hermann, 2015, p. 91‑113[↩]
- Maxime Efoui-Hess (dir.),[↩]
- Sébastien Broca, « Le numérique carbure au charbon », Le Monde diplomatique, mars 2020[↩]
- Propos recueillis de Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux d’Orange, par le journal Le Monde, dossier « Internet, la bataille du réseau », 26 juin 2018[↩]
- 30 000 objets de 10 cm et plus (dont 1 400 satellites actifs), auxquels s’ajoutent 750 000 objets de 1 cm et plus, 135 millions de 1 mm ou plus, qui évoluent à très grande vitesse (un objet de 1 cm de diamètre aura la même énergie qu’une berline lancée à 130 km/h environ) et dont 10 à 20 % retombent sur Terre. Source CNES : https://cnes.fr/fr/dossier-debris-spatiaux-ou-en-est[↩]
- Pascal Griset, « Un fil de cuivre entre deux mondes : les premières liaisons télégraphiques transatlantiques », Quaderni, n° 27, 1995, p. 97‑114[↩]
- « L’opérateur de réseau fibre optique Colt – dont le nom vient de City of London Telecommunications – est né pour répondre aux besoins de fiabilité et de temps d’accès hypercourts de la finance londonienne à l’heure du trading haute fréquence. Colt a tissé son propre réseau mondial de 187 000 km de fibre optique, qu’il revend en gros aux opérateurs ou aux entreprises », in « Internet, la bataille du réseau », Le Monde, art. cité[↩]
- Source Gartner, « Internet, la bataille du réseau », Le Monde, art. cité[↩]
- Alexandre Laparra, « Les câbles sous-marins : la guerre invisible de l’information », Geolinks, Observatoire en géostratégie de Lyon, http://www.geolinks.fr/les-cables-sous-marins-la-guerre-invisible-de-linformation/[↩]
- Alexandre Laparra, « Les câbles sous-marins… », art. cité[↩]
- Le groupe français Naval Group (ex DCN, aux activités militaires et civiles) travaille, au large de l’Écosse, à un projet de data centers immergés et encapsulés pouvant contenir jusqu’à 864 serveurs. L’objectif est toujours de raccourcir le temps d’accès aux données… et de se rapprocher des grands centres urbains pour la plupart situés en bord de mer[↩]
- Charlie Osborne, « Does China’s Route to Infrastructure Control Run Through Iceland’s Data Centers ? », 4 juin 2019, Sur la course technologique entre États-Unis et Chine, voir Jean-Michel Valantin, L’Aigle, le Dragon et la Crise planétaire, Paris, Seuil, « Anthropocène », 2020.[↩]
- Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les liens qui libèrent, Paris, 2018[↩]
- En décembre 2019, le collectif International Rights Advocates (IRAdvocates) a déposé plainte devant la justice fédérale américaine contre les principaux représentants de l’industrie du numérique. « USA : Apple, Google, Dell, Microsoft et Tesla poursuivis pour exploitation d’enfants dans les mines de cobalt de la RD Congo », 16 décembre 2019[↩]
- Voir par exemple sur ce thème, Branko Milanovic, Capitalism, Alone, Harvard University Press, 2019[↩]
- André Gorz, L’Immatériel, Paris, Galilée, 2003[↩]
- Blablacar est par exemple une forme de marchandisation de l’auto-stop. Voir Dominique Desjeux et Philippe Moati (dir.), Consommations émergentes. La fin d’une société de consommation ?, Lormont, Le Bord de l’eau, « Mondes marchands », 2016.[↩]
- Antonio Casilli, « De la classe virtuelle aux ouvriers du clic. La servicialisation du travail à l’heure des plateformes numériques », Esprit, n° 454, mai 2019, p. 79‑89 et En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 2018. Pour une synthèse des principaux travaux réalisés depuis une dizaine d’années sur l’envers de la nouvelle économie, voir Sarah Abdenour et Dominique Méda, Les Nouveaux Travailleurs des applis, PUF, Paris, 2019.[↩]
- Ils seraient de l’ordre de 400 000 aujourd’hui en France.[↩]
- Philippe Malabou, propos recueillis lors de l’émission « L’ubérisation de l’énergie », LCP, 15 septembre 2019.[↩]
- Ces rapprochements ont été précédés, dans le domaine des industries de l’informatique, par le consortium industriel GreenGrid. Imaginé en 2006, entre autres par Dell, Hewlett Packard et IBM, pour mettre en place un programme de « verdissement » des réseaux informatiques, sa création officielle remonte à 2015. Il rassemble aujourd’hui plus de 500 grands acteurs du domaine.[↩]
- Sur cet aspect de la question, voir Gérard Dubey et Pierre de Jouvancourt, Mauvais temps. Anthropocène et numérisation du monde, Paris, Éditions Dehors, 2018.[↩]
- Éric Vidalenc, Pour une écologie numérique, Paris, Les petits matins/Institut Veblen, 2019, p. 99. Des thèses semblables sont naturellement développées par Jeremy Rifkin.[↩]
- René Riesel et Jaime Semprun, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, L’encyclopédie des nuisances, 2008, p. 70[↩]
- « C’est un être branché sur des flux de services écosystémiques que lui prodiguent les différents compartiments du système terre », in C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, L’Événement Anthropocène, op. cit., p. 112.[↩]






