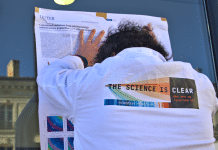Cette fois c’est promis juré, le gouvernement agit pour l’écologie. Il prend en main le sort du climat planétaire (finance-pour-le-climat en spectacle au One Planet Summit1, convention citoyenne pour le climat), propose un referendum pour intégrer la préservation de l’environnement et de la biodiversité dans la Constitution, etc. Postulant que l’écologie se mesure à une liste d’actions explicites, quelques fact-checkers zélés vont sans doute évaluer le bilan de la présidence Macron à l’occasion de la prochaine élection présidentielle : gommette rouge unanime, par exemple, pour les néonicotinoïdes ou la Montagne d’Or en Guyane. Leur critère favori reste cependant la courbe des émissions de gaz à effet de serre (GES) : gommette verte si elle baisse. Cette vision techniciste de l’écologie qui présente la crise environnementale, dont nous serions tous responsables, comme problème d’optimisation à résoudre – comment demeurer sous les « limites planétaires », des 2°C par exemple ? – domine les débats publics. Cette écologie-des-limites est concurrencée par une écologie-des-empreintes, qui juge les politiques à partir de l’espace des (inégales) empreintes écologiques. Celles-ci évaluent le « vrai » poids des objets en tenant compte de toute la matière et de l’énergie nécessaire à leur production et transport : le téléphone intelligent de 120 grammes pèse en réalité 70 kg, un pot de yaourt ou une crevette voyage en moyenne des milliers de kilomètres avant d’atteindre un estomac humain, la voiture électrique émet autant de GES qu’une voiture traditionnelle, etc. Cette écologie, très critique du gouvernement, disserte périodiquement dans des « festivals d’idées » où les protagonistes (médias, universitaires, think tank et ONG) regrettent que le pouvoir n’investisse pas des milliers de milliards dans la transition vers une économie des services, circulaire, numérique, régénérative, et surtout zéro carbone2.
Si les empreintes peuvent utilement informer des destructions en cours, puisqu’elles révèlent des flux biophysiques cachés par les marchandises, leur éparpillement et l’absence des questions de pouvoir et de rapports de forces peuvent s’avérer fort dépolitisants et conduire à des mesures qui n’ont aucune chance de déranger quiconque. Au diagnostic radical (en ce sens que lesdites limites/empreintes, qui synthétisent pour eux l’« environnement », sont pour la plupart déjà dépassées) viennent en effet répondre des « solutions » qui, même chiffrées en trillions de dollars, restent de l’ordre des petits pas3. C’est que le pouvoir est toujours un effet des structures sociales : une analyse qui les néglige, quand bien même elle intègre d’inégales empreintes, ne peut mener qu’à une nouvelle variante du capitalisme.
Désenfumage, façon écologie-des-empreintes
Aujourd’hui, au contraire d’autres pays riches (Australie, États-Unis, mais aussi Allemagne ou Suède), la France n’extrait quasiment plus aucun métal ni énergies fossiles du sol métropolitain et la matière extraite en masse (sable et gravier) conduit à des dégâts en apparence moins élevés (comparés à l’extraction de minerai métallique, par exemple). Le pays se dématérialiserait et se décarbonerait : succès de l’éco-modernisation à la française (sauce nucléaire). L’écologie-des-empreintes ne boit pas cette soupe de fake news, dont elle met fièrement en évidence les ingrédients trompeurs. La baisse apparente des consommations a été compensée par la hausse des flux incorporés : les émissions de CO2 associées aux importations en France ont quasiment doublé entre 1995 et 20144 ; la moitié de la matière réellement consommée par habitant est également cachée (c’est le double des États-Unis). Il n’y a pas eu désindustrialisation de l’économie française puisque celle-ci dépend largement d’industries extraterritoriales. Si l’extraction nationale de charbon cesse, les importations officielles avoisinent 15 millions de tonnes (Mt) en 2017 – et les marchandises importées de l’UE en provenance de la seule Chine en incorporent, puisque le charbon sert à la production d’énergie, en 2011 environ 400 Mt. Entre 1995 et 2011, la part des matières premières extraites au sein de l’UE dans son empreinte matérielle totale passe de 68% à 35%, autrement dit les 2/3 de la matière réellement consommée se trouve désormais à l’étranger. L’extraction de matières en Chine destinée à servir l’UE atteint celle que l’UE réalise pour elle-même. Les services, ces activités réputées « immatérielles », représentent 25% du total de l’empreinte matérielle de l’UE en 20115. L’économie numérique est un désastre : internet consomme 10% de l’énergie mondiale et l’empreinte carbone des objets (routeurs, data centers, etc.) et des pratiques (davantage d’applications et de streaming) est supérieure à celle du transport aérien6. Enfin, il faut dévaster des zones entières pour extraire et traiter les métaux rares indispensables à la production d’énergie « verte ».
Cette mise au point est salutaire. L’écologie-des-empreintes offre un petit bol d’air par rapport aux fumées de l’écologie-des-limites. Toutefois, manier les empreintes sans précaution est périlleux puisqu’elles cadrent les débats et mènent implicitement à des responsables. Que l’on utilise la consommation officielle ou l’empreinte cachée, l’échelle de l’État-nation est admise comme unité pertinente d’analyse. Ce nationalisme méthodologique a ses raisons (statistiques meilleures et accessibles), mais manque de subtilité : toute la responsabilité va au pays extractif d’un côté, au pays consommateur de l’autre (sans envisager que la responsabilité puisse être partagée… ou attribuée à autre chose qu’un pays). Un autre défaut du calcul des empreintes consiste en la moyennisation de données très dispersées (« un Allemand » consomme trois planètes). Or les moyennes effacent les extrêmes – ce qui, dans des sociétés justement caractérisées par les extrêmes (pauvreté et richesse), est un sacré inconvénient (« un Allemand », ça n’existe pas). L’hétérogénéité entre classes sociales (mais aussi des inégalités en termes de genre, race) au sein d’un État est totalement escamotée. S’appuyant sur de nombreuses études, les plus critiques dans l’écologie-des-empreintes l’affirment désormais : puisque l’empreinte environnementale augmente avec le revenu (surtout pour les dépenses de transport et loisirs), nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Par conséquent, il faut tenir compte de ces « inégalités écologiques » – réduites par ce cadrage aux écarts significatifs entre les empreintes – pour respecter les limites.
Si l’exigence semble aller de soi, il est risqué politiquement de se contenter d’affirmer : « les riches consomment plus, à eux de payer ». Expliquons : c’est adhérer au mythe libéral de la responsabilité individuelle ; c’est leur donner l’opportunité de se rattraper sans changer les structures de pouvoir (compensations écologiques) ; c’est négliger les questions d’idéologie. Regardons les choses par le bas : les études sur la consommation des ménages les plus pauvres des pays riches révèlent que celle-ci (pourtant réduite) est déjà très élevée. Si les 10% des citoyens européens les plus riches ont une empreinte carbone de 27%, le rapport Oxfam de septembre 20207 affirme aussi que l’empreinte des 50% d’Européens les plus pauvres reste « trop élevée » et doit être réduite de moitié d’ici 2030. De plus, l’immense écart de revenus ne se traduit pas dans l’espace des empreintes8(un ménage 1000 fois plus riche qu’un autre n’a pas une empreinte 1000 fois plus grande). Il existe en effet un seuil minimal de consommations (nourriture, logement) qui est peu compressible du fait des infrastructures actuelles (énergie, transport) sur lesquelles elles reposent9. Ce dernier résultat doit être pris avec des pincettes au vu des difficultés pour mesurer avec exactitude le poids des très riches10. Si on veut rigoureusement distribuer les responsabilités sur seule base de l’empreinte selon les revenus, alors il faut aussi dire, comme Macron aux Gilets Jaunes, « les pauvres, vous polluez encore trop, réduisez aussi vos consommations ou payez une éco-taxe ». Que peuvent les classes populaires au sujet des traités de libre-échange, des marchandises importées bon marché à des milliers de kilomètres, des immenses infrastructures qui permettent leur circulation, de la périurbanisation qui leur impose de prendre la voiture pour aller vendre leur force de travail ? L’écologie-des-empreintes repose le plus souvent sur des fondements trop instables et se contente d’être une extension « critique » de l’écologie-des-limites, dont elle ne conteste pas radicalement le cadrage mais simplement son point de vue trop restrictif. Comme pour les inégalités (ou « injustices ») économiques, les inégalités écologiques doivent être intégrées dans l’histoire du capitalisme, c’est-à-dire solidement rattachées à des structures, pour être utiles à la réflexion et l’action politique.
Le doux commerce capitaliste
La logique immanente du capital consiste en la production de marchandises en vue de plus d’argent (la marchandise est à peine un moyen en vue de cette fin). Elle exige, entre autres, un accroissement permanent de la sphère marchande. Que la naissance historique du capitalisme date du XVe ou du XVIIIe siècle, en Italie ou en Angleterre, les recherches marxistes s’accordent sur le fait que sa logique a imposé, dans l’espace et dans le temps, l’appropriation croissante des corps et des milieux, jusque-là non intégrés aux rapports sociaux capitalistes. Au niveau conceptuel, la production concrète est sans importance – on produit n’importe quoi dans n’importe quelles conditions n’importe où – tant qu’il y a profit à la fin. Le concret du monde est soumis à l’abstraction de la valeur d’échange. Cette conceptualisation est non seulement logique, mais largement vérifiée empiriquement.
Une riche littérature a démontré qu’au-delà du travail forcé, le développement des nations au centre de la dynamique capitaliste tenait pour beaucoup à l’appropriation de matières, d’énergie et de terres des zones périphériques. L’industrie textile anglaise, un des moteurs du capitalisme européen dans la première moitié du XIXe siècle, n’aurait pu se développer sans le travail esclave dans les millions d’hectares « fantômes » que symbolisent les champs de coton aux Etats-Unis11. L’Angleterre n’aurait tout simplement pas eu assez d’espace sur son territoire pour son processus d’industrialisation. Le même dispositif se reproduit de façon fractale – un pays périphérique a lui-même sa périphérie – et à d’autres échelles (villes, régions). Alors que ce schéma théorique n’est pas vérifié pour toutes les périodes pour d’autres pays riches, la France en constitue un prototype exemplaire12. Ces échanges inégaux du si mal nommé libre-échange, cachés par l’apparente neutralité des valeurs monétaires, se répètent année après année, alimentent et structurent le capitalisme mondial. Le développement des pays riches se fait aux dépens des autres qui sont structurellement contraints d’exploiter jusqu’au bout leurs forêts, leurs sous-sols et leurs terres, de se vider de leur matière, de soumettre leurs populations dépossédées à des conditions de vie misérables et au salariat – et de rester « sous-développés ». L’échange écologiquement inégal consiste donc en rapport social de domination, reconduit dans le temps, qui a pour effet des flux biophysiques asymétriques : dit autrement, les empreintes et les inégalités socio-écologiques sont le reflet de structures objectives du capitalisme. L’existence de territoires (milieux et habitants) objectivement soumis à d’autres, dans un rapport de domination qui va souvent en s’accentuant, constitue la norme géohistorique du système capitaliste. Il est bien établi que les marchandises du doux commerce, ou le libre-échange tant promu par certains depuis Ricardo, voilent une violence insoupçonnée à l’encontre des corps et des milieux, et ce depuis les premières entreprises de colonisation. La crise environnementale, qui inquiète quelques penseurs de l’écologie-des-limites dès lors qu’elle pourrait les concerner au travers du climat, est inscrite dans la structure du capitalisme depuis son origine. C’est parce qu’elle se trouve à la racine du système qu’elle est radicale, et c’est pourquoi elle est irréductible aux limites ou aux empreintes.
Heureuse mondialisation
Ce mouvement historique se poursuit et s’accélère après la Seconde Guerre mondiale : le volume du commerce mondial a été multiplié par 27 entre 1950 et 2006, contre un facteur huit pour le PIB mondial. Le changement drastique d’échelle vient avec la révolution néolibérale des années 1970, et un sprint a même été lancé en 2002 avec la croissance économique en Chine et son adhésion à l’OMC. L’extraction mondiale de matières a plus que triplé depuis 1970, et 1000 milliards de tonnes (Gt) ont été extraites des sols entre 2002 et 2015, contre 2400 Gt pour la période 1900-200213. Cette accélération s’observe, sans surprise, dans les empreintes cachées. Entre 1990 et 2015, en pleine « mondialisation heureuse », les pays riches ont extorqué au reste du monde plus de 200 Gt de matières incorporées, des dizaines de milliards d’heures de travail, et 30 milliards d’hectares, tout en accumulant un surplus commercial de 1200 billions (trillions en anglais) de dollars. En 2015, la valeur ajoutée par tonne de matière première incorporée dans les exportations est 11 fois supérieure dans les pays à revenu élevé par rapport à ceux qui ont les revenus les plus faibles, et 28 fois plus grande par unité de travail incorporé. Ces chiffres n’ont cessé de croître entre 1990 à 201514. Le commerce international est loin d’être seul responsable du Capitalocène, et l’accumulation du capital ne se base pas uniquement sur lui, mais il est une courroie de transmission de dégâts de grande intensité. En 2016, sont incorporés dans les flux de marchandises du commerce mondial15 : 17 à 30% de la perte de biodiversité ; 13% des eaux polluées ; 20 à 33% des émissions de CO2 ; 21 à 37% des utilisations de terre ; 22% des morts prématurées dues à la pollution aux particules fines ; 29 à 35% de l’utilisation d’énergie ; 70% de l’exploitation de charbon ; etc.
Ce processus pluriséculaire d’extorsion organisée est porté à son acmé par le capitalisme néolibéral. Cette accélération ne tombe pas de nulle part. En France comme ailleurs, l’Etat se met explicitement au service de la recherche de profits élevés par les capitalistes : il promeut globalisation marchande et financière, libre circulation des marchandises et capitaux, via la construction européenne et les traités de libre-échange, et impose, avec d’autres institutions internationales, les politiques néolibérales aux pays périphériques (privatisations, ouverture aux investissements étrangers, etc.). Le régime néolibéral des pays riches consiste en une appropriation apparemment sans limite de force de travail, de matières et d’espaces extraterritoriaux accompagnée d’une délocalisation toujours plus poussée des dégâts et conflits socio-environnementaux. Ainsi, les rapports de domination sont toujours plus disséminés spatialement : les habitants des territoires objectivement dominés et exploités ne perçoivent plus les dominants, et réciproquement. Ce processus ne s’est pas déployé sans laisser des traces profondes et différenciées (selon des grilles de classe, race et genre) sur les milieux et les corps périphériques (prolétarisation forcée, déforestation massive, bétonisation, destruction d’écosystèmes et de moyens de subsistance, extermination d’espèces, etc.). Des traces, donc, et des résistances : des conflits socio-environnementaux sont apparus un peu partout, des lieux d’exploitation (mines, forêts, usines, etc.) aux infrastructures de transport et d’énergie, en passant par les villes radicalement transformées pour attirer un tourisme de masse16. En Europe, les oppositions aux traités de libre-échange ont permis un arrêt temporaire du TAFTA et du traité UE-Mercosur (gommette orange ?) – ailleurs, leurs acronymes pullulent (TPP, RCEP, ZLECA).
L’empreinte idéologique
Les empreintes écologiques autorisent une lecture politique toute autre lorsqu’elles sont mobilisées dans un cadre théorique solide – multiplier les calculs d’apothicaire, y compris sur les « inégalités », sans jamais questionner les causes n’a rien à voir avec la perspective de l’échange écologique inégal dont se déduisent les empreintes. La pertinence de leur usage reste toutefois hasardeuse dans un paysage causal devenu infiniment complexe avec le néolibéralisme. Illustrons par une chaîne de causalités un fonds de pension de retraités californiens exige des rendements importants, les entreprises dans lesquelles il est actionnaire vont faire de l’optimisation fiscale et ajuster leur production en délocalisant, les sous-traitants vont pressurer au maximum des travailleurs (ici et là-bas) obligés de vendre leur force de travail et de planter du soja génétiquement modifié, les forêts tropicales sont détruites pour laisser place à d’immenses monocultures, le soja transporté par camions va nourrir les bœufs en France, etc. La faute aux travailleurs retraités, aux multinationales, aux infrastructures de transport, aux boîtes aux lettres des Îles Caïmans, aux camionneurs ou aux carnivores ? Si des calculs sophistiqués permettent des approches nouvelles (empreinte selon la valeur ajoutée ou l’investissement des multinationales) on est tout de même reconduit au même écueil : les empreintes ne mesurent que des micro-segments ou des parties du système (en général les plus facilement mesurables) ; aucune empreinte ne mesure le poids des structures, au mieux elle en capte quelques effets. Les empreintes voilent donc autant qu’elles dévoilent.
Réduire la crise environnementale aux inégalités écologiques, c’est faire la même erreur que ramener le capitalisme aux inégalités de richesses : négliger la question du pouvoir des classes dominantes, donc se contenter de corriger ou d’atténuer les « injustices ». Que les très riches pèsent mille ou dix fois plus que les plus précaires est secondaire au regard de leur pouvoir de contrôle économique et politique sur toute la société17. Non seulement les classes bourgeoises peuvent se livrer à la consommation luxueuse et ostentatoire, mais surtout elles organisent les rapports de production et définissent et imposent l’idéologie qui justifie leur domination. Il faut en effet tenir compte de l’idéologie pour saisir la permanence dans le temps d’un système qui produit autant de violence que le néolibéralisme. Outre l’externalisation concrète d’une part importante des conflits, on assiste, à partir des années 1990, à la dissimulation des rapports de domination dans les discours (néo-) libéraux – illustrée par la fameuse « fin de l’Histoire ». Ces deux mouvements, matériel et idéel, ont sans doute contribué à la viabilité du régime néolibéral. Ce constat amène une interrogation : quelle est l’empreinte de l’hégémonie de la pensée libérale sur le terrain idéologique, en particulier le renoncement à l’analyse du conflit social (dans sa diversité) et de ses déterminants ? Quelle est l’empreinte idéologique du FMI, des écoles de commerce, du journal Le Monde, de TF1, de Terra Nova ou de l’ENA ?
La marque sur les écologies des-limites-et-des-empreintes est indélébile. Face à la violence déchaînée et illimitée du capitalisme néolibéral, ces écologies baignent dans un rêve éveillé saisissant. Ainsi, le One Planet Summit doit favoriser « une réorientation de la finance vers des objectifs de durabilité et d’inclusivité, contribuant à faire advenir l’économie bas-carbone du futur » (sic). L’écologie-des-empreintes, qui s’amuse parfois de la logorrhée start-upeuse des techno-béats et des fanatiques du marché carbone de la présidence Macron, n’est pas plus convaincante. Le rapport d’Oxfam susmentionné, prototypique de l’écologie-des-empreintes, insiste sur le fait que « la réduction des émissions contribuera à la construction de sociétés européennes plus justes, plus saines et plus résistantes ». Ce prêchi-prêcha de belles paroles, qui ne coûtent rien et rapportent beaucoup en gains symboliques, découle de leur cadre d’analyse. Comme ces approches refusent de penser les structures de l’économie capitaliste – notez qu’elles n’ont objectivement pas intérêt à le faire pour garder leur rôle de nouvelle orthodoxie critique – et décident d’abstraire la production de dégâts et de GES des rapports sociaux dans lesquels elle est enchâssée, comme elles minimisent les rapports conflictuels entre groupes sociaux aux intérêts antagonistes, elles se focalisent sur les aspects techniques et se contentent de prôner une lutte contre les injustices. Qui peut croire à des transformations sans conflits, ou penser que les principaux bénéficiaires des structures ne vont pas s’opposer à toute mesure qui irait contre leurs intérêts ? Qui peut croire que les États néolibéraux qui les biberonnent depuis au moins quarante ans vont les contraindre à quoi que ce soit ? La radicalité des propositions d’Oxfam – « mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles », « améliorer l’efficacité énergétique de l’habitat » et introduire des taxes sur la consommation carbone dans le secteur du luxe – fournit une explication : lutter contre les « inégalités des émissions18 » (sic) ne sera pas, à les lire, conflictuel. Pas question de toucher, au hasard, au processus de marchandisation du monde, à la propriété lucrative ou au rapport de domination salarial. Larmes de crocodile chez les partisans de cette écologie-des-empreintes : « si seulement » le gouvernement avait de la volonté, il agirait dans le sens de l’« intérêt général », on réduirait les inégalités environnementales, et on aurait déjà un Green New Deal dans une Europe sociale. L’inconséquence de ces propositions, qui jamais ne touchent aux rapports matériels de production, est stupéfiante.
Maintenant
Nous espérons avoir fourni quelques outils pour déjouer le gloubi-boulga de la Lingua Capitalismi Neoliberalis, et lutter contre la réduction dépolitisante de l’écologie à des limites (asociales) ou, extension louable mais qui ne marque pas de rupture, à des empreintes (astructurelles). Le choc de la Covid (virus qui pourrait être une production endogène du néolibéralisme tant les zoonoses en sont le fruit) va pousser les classes dominantes à promouvoir une transition vers un capitalisme vert (qui n’est pas totalement oxymorique puisqu’il s’agit du vert-des-limites/empreintes), avec une relocalisation de certaines industries, des data centers et de la 5G qui carburent au renouvelable, et l’Etat en soutien. Le nouveau régime cherchera à se rendre désirable par les joies des marchandises intelligentes et numériques. Il peut recevoir le soutien des écologies des-limites-et-des-empreintes, séduire les classes bourgeoises urbaines (qui maintiendraient leur hégémonie culturelle) et une part importante des classes moyennes. Ce projet bénéficierait objectivement du niveau inouï des dégâts, de l’affect climatique grandissant, et l’injonction à agir (« vous ne voulez quand même pas que les limites soient dépassées »). Pourtant, quand bien même quelques limites/empreintes seraient respectées (hallelujah, gommette verte) avec une base matérielle moins fossile, il est en l’état certain que ce capitalisme amènera d’autres exploitations et dégâts dans les milieux et les corps des travailleurs (sans parler des dangers de la surveillance de masse, y compris sous couvert d’optimisation des empreintes). Prendre au sérieux le diagnostic radical du Capitalocène, c’est réfléchir aux transformations de même ampleur et ne pas se contenter de le réformer ou d’atténuer les dégâts qu’il produit nécessairement : les partisans de l’écologie-des-empreintes ne semblent pas prêts à franchir le pas. Au-delà du néolibéralisme, dont nous avons rappelé l’ignominie, c’est la logique du capital qui doit être radicalement combattue, sous peine de simplement promouvoir un alter-capitalisme.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Pour avoir organisé ce sommet fin 2017 – auquel participent milliardaires, vedettes de cinéma et fonds de pension -, Emmanuel Macron s’est vu consacré « champion de la Terre » (sic) en 2018 par l’ONU.[↩]
- Maxime Royoux, « Portrait du capitalisme en économie régénérative », Terrestres. Revue des livres, des idées et des écologies, 17, 2020.[↩]
- Nelo Magalhães, « Combien pour sauver la Planète ? La fuite en avant des investissements verts », Terrestres. Revue des livres, des idées et des écologies, 11, 2020.[↩]
- Commissariat général au développement durable, L’empreinte carbone des Français reste stable, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire,2020.[↩]
- Stefan Giljum et al., « Identifying priority areas for European resource policies: a MRIO-based material footprint assessment », Journal of Economic Structures, 5, 2016/1.[↩]
- https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique[↩]
- Rapport disponible ici : https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/09/Resume-Rapport-Oxfam-Combattre-Inegalites-Emissions-CO2.pdf[↩]
- Pour l’Allemagne, l’écart des empreintes carbones entre le premier quartile en termes de dépenses et le dernier quartile (qui dépense le moins) est de 1 à 3. Voir : Frank Pothen, Miguel Angel Tovar Reaños, “The Distribution of Material Footprints in Germany”, Ecological Economics, 153, 2018.[↩]
- Nelo Magalhães, « Accumuler de la matière, laisser des traces », Terrestres. Revue des livres, des idées et des écologies, 7, 2019.[↩]
- Voir une bonne discussion à ce sujet et une critique argumentée de l’attribution de la responsabilité aux ménages, dans le cas de l’empreinte carbone en France, dans Antonin Pottier et al., « Qui émet du CO2? Panorama critique des inégalités écologiques en France », FAERE Working Paper, 2020.[↩]
- Alf Hornborg, Nature, Society, and Justice in the Anthropocene: Unraveling the Money-Energy-Technology Complex, Cambridge University Press, 2019.[↩]
- Nelo Magalhães et al., « The Physical Economy of France (1830–2015). The History of a Parasite? », Ecological Economics, 157, 2019.[↩]
- Pour saisir la différence d’échelle entre 1 Mt et 1 Gt : un million de secondes, c’est environ 11 jours, un milliard de secondes, c’est 31 ans.[↩]
- Christian Dorninger et al., « Global Patterns of Ecologically Unequal Exchange: Implications for Sustainability in the 21st Century », Ecological Economics, 179, 2021.[↩]
- Chiffres rapportés au total mondial. Thomas Wiedmann, Manfred Lenzen, « Environmental and Social Footprints of International Trade », Nature Geoscience, 11, 2018/5.[↩]
- Voir l’atlas pour la justice environnementale : http://ejatlas.org/[↩]
- Cet argument est analogue à celui avancé par Alain Bihr et Michel Husson contre les travaux de Thomas Piketty.[↩]
- Son titre résume le programme : « Combattre les inégalités des émissions de CO2 dans l’Union Européenne. Pourquoi le « Green Deal » de l’UE doit réduire les émissions sans oublier de lutter contre les inégalités ».[↩]