La notion de droit, mise au centre des conflits sociaux, y rend impossible de part et d’autre toute nuance de charité. Il est impossible, lorsqu’on en fait un usage presque exclusif, de garder le regard fixé sur le vrai problème.
Simone Weil, La Personne et le sacré
Aussi notre société n’est-elle pas menacée par la mise en place d’un système de surveillance coercitif et sans faille qui laisserait planer sur tous l’ombre d’une répression policière « à l’ancienne ». Elle est avant tout sinistrée par une conception étriquée de la liberté selon laquelle l’organisation moderne de la vie matérielle serait porteuse d’émancipation.
Groupe Marcuse, La liberté dans le coma
Le projet de loi sécurité globale a provoqué une levée de bouclier à gauche et dans les syndicats (dont ceux de journalistes, mais largement au-delà). Au cœur de cette contestation figure le fameux (feu) article 24 et la tentative mal dissimulée du gouvernement de décourager les témoignages sur les violences policières par des arguties peu convaincantes. Cette mobilisation s’est ainsi très rapidement concentrée autour de l’ éventuelle interdiction qui nous serait faite de diffuser des vidéos d’agissements de la police, notamment lors des manifestations. Il serait trop fastidieux de faire un inventaire exhaustif des textes, banderoles, prises de paroles, bombages et slogans plaçant au centre de la mobilisation contre cette loi, la liberté de filmer et son corollaire, celui d’alimenter internet, ses réseaux dits sociaux, ses infrastructures, et bien sûr ceux qui s’en nourrissent : multinationales et… police. Considérée comme un supplément d’âme à ne cultiver qu’une fois les questions prioritaires réglées, la critique des technologies reste hélas de l’ordre de la coquetterie pour une gauche, très majoritairement productiviste1, qui a d’autres chats à fouetter actuellement. Logiquement, les analyses et réponses à ce projet de loi, pour nombre d’entre elles, en sont l’ illustration et si « le monde est flou », les slogans sont parfois explicites.
Le site d’information Lundi Matin, par exemple, se réjouit du succès de bombages réalisés à Bordeaux le 24 novembre. Sur les murs de l’École Nationale de la Magistrature, l’un d’eux proclame sans trembler : « Pas de vidéos, Pas de justice ». Un autre : « Sous les pavés, la carte SD », assez révélateur de l’imaginaire technophile de certains héritiers de 68. Les animateurs du site (habituellement attentifs à la question des flux dans leur critique du capitalisme), sans doute galvanisés à leur tour par la puissance du récit et des slogans associant justice, révolte et vidéo, n’ont pas jugé utile de souligner un éventuel lien entre flux informatiques et destruction du monde. Dommage. L’auteur de l’article, finalement pris d’un doute, estime cependant qu’il est un peu tôt pour affirmer que ce genre de manifestation inaugure « le début d’une série de protestations à la hauteur des enjeux. »2 C’est peu de le dire.
La manifestation parisienne du 21 novembre3 avait déjà laissé poindre, derrière des mots d’ordre liés à la sauvegarde des libertés fondamentales, la relation que tout un chacun entretient désormais avec son smartphone4 – puisque c’est à celui-ci qu’on doit l’immense majorité des vidéos réalisées en manifestation – et ce qu’il en attend. On pardonnerait presque, tant il fallait l’oser, le courageux « Police partout, images nulle part » destiné à pointer, on imagine, le risque (de premier ordre ?) qui plane d’un accès raréfié aux images de violences policières sur Youtube. On peut cependant objecter que cette menace apparaît très relative dans une société aussi connectée que la nôtre où, précisément, les images sont partout, ce à quoi – et malgré ses efforts – la police ne peut encore prétendre. Et alors que le risque de croiser un gestionnaire qui vous oblige à filmer (votre poste de travail, un cours, un entretien, etc.) est incontestablement plus élevé que celui de tomber sur un policier qui vous en empêche5, on s’explique mal que des slogans tels que « gestionnaires partout, liberté nulle part » soient absents des murs de nos villes comme des tracts syndicaux. Cette comparaison n’invalide en rien le constat selon lequel ce projet de loi vise à interdire de filmer la police mais elle peut permettre de remettre cette tentation liberticide (ce qu’elle est) en perspective avec toutes celles que nous subissons au quotidien – en manifestant ou pas – et à propos desquelles nous restons plus discrets. D’où la nécessité, notamment pour Simone Weil ou Jacques Ellul6, de faire preuve de plus de discernement dans les priorités accordées à telle ou telle de nos préoccupations. Mais voilà, la mesure et la lucidité n’étant visiblement pas plus à l’ordre du jour sur certains murs que sur Twitter, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur les formes parfois trop courtes que prennent les messages militants pour atteindre leur cible.
Plus honnête sans doute, quoique pas plus rassurant sur l’état des forces en présence, la pancarte « Vos armes contre nos caméras … plus rien » confirme ce que l’on craignait : sans smartphone, nous ne sommes plus rien. Ce terrible aveu révèle et prend acte d’une forme d’impuissance grandissante (d’un manque d’imagination ?), dans le camp progressiste7 – mais pas seulement, à esquisser un monde plus vivable, ou a minima une résistance, en l’absence de l’appareillage technologique que la société industrielle nous a collé dans les mains. Il trahit donc le sentiment dégradé que nous avons de nous-mêmes et de nos capacités à agir. Ce n’est malheureusement pas la perspective de ne bientôt plus pouvoir se passer de smartphone pour effectuer la moindre démarche administrative (consulter son compte en banque, s’inscrire à l’université, acheter un billet de train, régler ses achats, etc.) qui viendra contrer ce sentiment et cette dépossession qui nous gagnent. Une journaliste, détournant Albert Londres, enfonce le clou : « notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire tort, il est de porter la plume – et moi je rajoute l’image – dans la plaie », car, assène-t-elle pour conclure : « sans image, vous ne savez rien. » A la même tribune, une élue communiste de Paris, déplore quant à elle la surveillance constante de caméras et drones et, sans quitter des yeux le mouchard numérique sur lequel elle lit sa bafouille, dénonce « deux poids, deux mesures » en matière de droit à filmer… A sa suite, la porte parole d’Amnesty International voit dans la « surveillance généralisée couplée à la reconnaissance faciale, une forme de surveillance de masse » et proteste à son tour : « d’un côté on ne pourra plus surveiller la police et de l’autre, la police pourra nous surveiller partout ».
Bien entendu, il y a du vrai dans tout cela. Mais ces déclarations masquent mal le caractère un peu paradoxal, ou à tout le moins ambigu de nombre de revendications : s’agit-il de récuser la société de surveillance ou d’y occuper la place à laquelle on a droit ? Il ne semble question, au chapitre des libertés publiques, que d’ assurer celle de filmer un pouvoir et ses policiers à qui on reproche dans le même temps de truffer l’espace public d’innombrables dispositifs de surveillance (caméras de vidéosurveillance, reconnaissance faciale, drones, hélicoptères, etc.). Ce souci premier de réciprocité dans la surveillance est-il vraiment de nature à nous mobiliser ? On peut à juste titre contester cette énième tentative de fonder en droit une inégalité de traitement entre policiers et citoyens (assez ancienne au demeurant) mais ça n’a finalement que peu à voir avec un questionnement sur le fond d’une société qui consent à ce que tout le monde filme et surveille tout le monde.
En cela, cette mobilisation s’inscrit d’ailleurs dans un corpus pas si récent de revendications du même tonneau : après avoir exigé qu’on oblige les policiers à filmer les interpellations dans la rue, une grande partie de la gauche avait réclamé l’enregistrement vidéo des interrogatoires dans les commissariats. Il est donc cohérent qu’elle se batte maintenant pour ce qu’elle considère comme un droit fondamental dans l’exercice de nos libertés : brandir son smartphone et filmer. Après tout, rétorquent certains, pourquoi ne pas se saisir des moyens dont on dispose ? Peut-être parce que ce sont ces moyens qui disposent généralement de nous. Que les fonctions « surveiller la police » et « renseigner la police » figurent toutes deux au menu de ces appareils devrait nous mettre la puce à l’oreille… Rappelons également pour les étourdis qu’un smartphone sert indifféremment à se passer de sa secrétaire et à lui envoyer son mail de licenciement, à enrichir Tim Cook ou Mark Zuckerberg, à télécharger l’application Stop covid, à tracer des malades et localiser des manifestants, à participer au déploiement de la 5G et, c’est vrai, à témoigner des violences policières.
On est cependant obligé de constater que la défense de notre liberté est devenue progressivement compatible puis indissociable de l’utilisation des gadgets qui nous en éloignent pourtant chaque jour davantage, et pas seulement au contact des forces de l’ordre (mais encore au travail, dans les services publiques, chez soi, etc.)8.
Passons à la question de l’efficacité des moyens, qui semble primer pour les défenseurs des libertés et nous ramener à la nécessité, pour prouver les violences policières, de les filmer. L’avènement et l’utilisation massive des ordiphones comme autant de caméras braquées sur le pouvoir et sa police ont-ils fait baisser le niveau de surveillance et de répression des mobilisations sociales en France ? La circulation sur les réseaux sociaux des images qui en sont extraites a-t-elle, si peu que ce soit, modifié les rapports de force entre Etat et contestation ? Et si oui, au profit de qui ? Souvenons-nous d’une époque, non pas bénie, loin de là, mais où personne n’avait de smartphone et où le niveau de tension et de violence policière était assurément moins élevé qu’il ne l’est depuis 10 ou 15 ans en manifestation. Depuis l’apparition des cortèges connectés, c’est un « usage bien établi » : les policiers filment les manifestants, et réciproquement. Cette mise en abyme a-t-elle vraiment pesé favorablement sur l’issue des luttes sociales ? Rien n’est moins sûr.
Elle contribue en tout cas à mettre en doute, avec l’assentiment du mouvement social, l’idée qu’on peut accorder au témoignage humain, sans médiation technologique, un crédit suffisant pour compter vraiment. C’est aussi contre cela que Jacques Ellul, évoquant la parole humiliée, avait tenté de mettre en garde. Le recours à ces appareillages ne nous protège de rien mais nous confisque la parole et fragilise sa légitimité en lui préférant implicitement une preuve par l’image, censément plus délicate à contester. Si c’est bien à cette idée que se rangent les slogans évoqués plus haut, le pouvoir et ses conseillers en numérisation peuvent se féliciter d’avoir convaincu très au-delà de leur cercle d’influence.
Comment, par ailleurs, oublier que notre liberté de filmer lors des manifestations et les moyens qui s’y rapportent sont adossés en amont (production) et en aval (recyclage) à une exploitation forcenée de la nature et des êtres humains ? Célia Izoard faisait part récemment de sa consternation à l’idée qu’on puisse « défendre la production électronique de masse aujourd’hui alors que notre équipement actuel est déjà intenable du point de vue des ressources »9. Villages du cancer, pollution des nappes phréatiques, raréfaction de l’eau potable et des sols encore cultivables, suicides et exploitation au sud, remplacement des humains par des robots au nord, consommation énergétique effrénée et aliénation partout : l’industrie du numérique a fait ses preuves et ses états de service sont bien documentés. N’est-ce pas pourtant à cette dernière que s’en remettent ceux qui revendiquent le droit de chacun à filmer avec un smartphone, sans autre considération pour ce qui précède ? Devons-nous, au nom du droit, nous accommoder de ces menus détails ? Notre liberté peut-elle se défendre valablement au détriment de celle, parmi d’autres, des adolescents esclavagisés dans les usines Foxconn en Chine10 ?
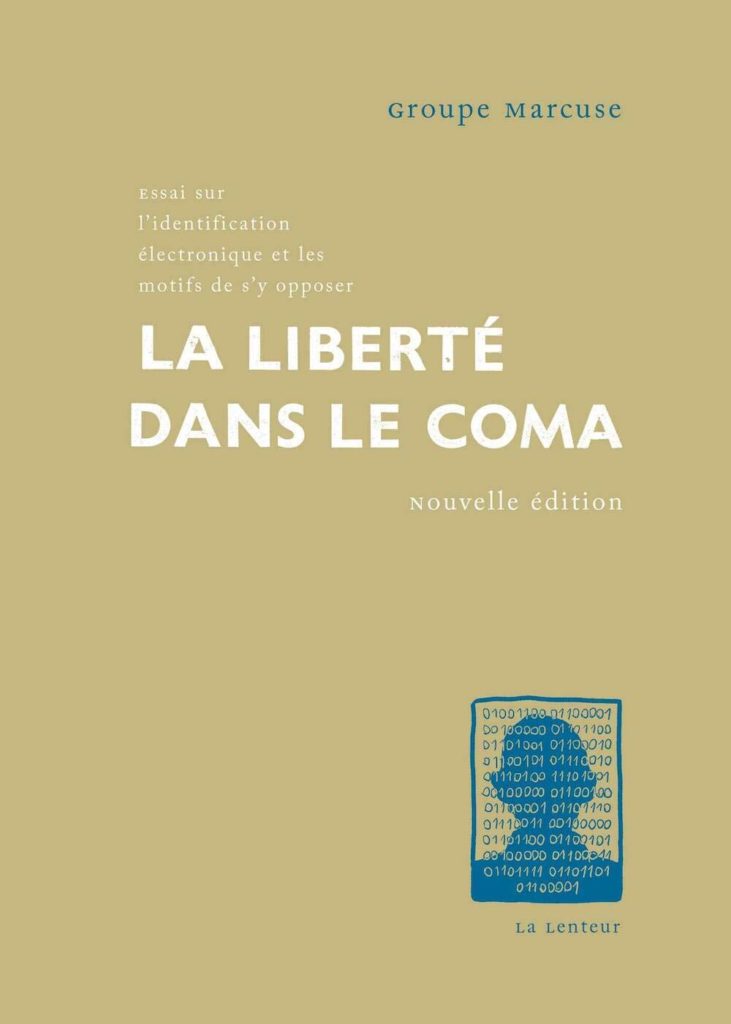
Au-delà de ces considérations morales et sans trop s’appesantir sur les conséquences écologiques, sociales ou sanitaires que la production et l’utilisation de ces instruments engendrent, n’est-il plus possible d’imaginer préserver des libertés publiques sans avoir recours à un « smartphone », à une caméra et à toute l’infrastructure numérique que cette quincaillerie alimente et génère ? N’est-il pas contradictoire et singulièrement imprudent d’attribuer à un instrument symbolique de la start-up nation, un rôle central dans le combat pour la liberté ?
Geoffroy de Lagasnerie, philosophe et inspirateur de la gauche radicale, répond à sa façon au journaliste du site Reporterre :
« J’ai beaucoup de mal à penser la technique du point de vue du pouvoir. La technique, on peut toujours s’en retirer. Je ne vois aucun effet de pouvoir de Facebook, de Twitter ou d’Instagram parce que je peux les fermer. Le seul pouvoir dont je ne peux me retirer, c’est l’État. Mais Facebook ne me met pas en prison. Instagram ne me met pas en prison. Mon Iphone ne me met pas en prison. »
Pourtant mis par son interlocuteur sur la piste des conséquences écologiques désastreuses imputables à l’omniprésence des technologies, il ne voit décidément pas matière à s’attarder sur ce point. Tout porte à croire que, pour lui, la « cage d’acier » – pour le dire à la manière de Max Weber – reste ouverte : « je n’appellerai pas cela des effets de pouvoir ou de contrainte. Ce sont des choix de société, des choix éthiques, des manières différentes d’organiser la vie sociale. »11
D’où peut-être notre difficulté à distinguer, à propos du smartphone, le bon usage prescrit aux manifestants par ce Geoffroy (de Lagasnerie), du mauvais usage imposé aux ouvriers d’Amazon par cet autre Geoffroy (Roux de Bézieux12. Bien qu’elle n’en ait pas l’exclusivité, cette cécité assumée est emblématique d’une gauche qui semble ne répondre qu’à des stimuli que la sphère universitaire et culturelle prémâche puis lui sert sur un plateau (de télé ou de radio en général). Il ne faut pas s’étonner que, puisant à de telle sources, elle peine à penser la liberté hors de ses thèmes de prédilection : focalisation sur le seul caractère inégalitaire de la répartition des richesses produites, sur les dominations (de genre, de race, etc.) et sur les sales manières de l’Etat policier. Rien d’étonnant non plus à ce qu’elle accepte sans sourciller l’idée de confier à un iPhone le soin de la défendre face à l’Etat.
Il n’est pas question de relativiser ici la nécessité de protester contre les politiques et les pratiques autoritaires de l’Etat quand elles se manifestent – et qu’un arsenal juridique et techno-scientifique soutient toujours plus efficacement au fil du temps – mais plutôt de débusquer ce qui, dans la contestation actuelle, procède parfois des mêmes logiques que celles de l’arsenal tant honni. Tous utilisateurs ou presque, et même à notre corps défendant ou à des degrés divers, il nous paraît désormais de plus en plus ardu de suggérer une autre manière de penser et d’agir, ne serait-ce que pour se défendre. Ceci d’autant plus que « l’actualité » suscite l’indignation et incite à y répondre vite et sans y regarder de trop près, au besoin par des moyens douteux. Ces objets sont désormais considérés par ceux qui les utilisent comme critiquables à maints égards mais toujours pratiques et, toute honte bue, finalement indispensables au moment de défendre notre liberté.
Nous en sommes alors réduits à réclamer comme un droit, un partage à parts égales des usages qui nous dégradent. Nous sommes coincés. Ce n’est donc peut-être pas tant à l’assurance d’un véritable droit à filmer (puis à sa mise en ligne) qu’on reconnaît l’expression de notre liberté, qu’à la possibilité de questionner notre fascination collective, parfois au nom de l’émancipation, pour les instruments et les faux outils de la société industrielle. Le groupe Marcuse avançait en 2012 que « les phénomènes de fichage et de surveillance ne sont que le corollaire d’une organisation de l’existence qui a privé les foyers et les communautés de base de toute prérogative directe sur leurs moyens de subsistance » ajoutant que « le problème principal est moins de savoir si la surveillance électronique laissera des marges concrètes de liberté, que de savoir si des individus et des groupes auront encore les ressources morales et l’envie d’élaborer et de défendre d’autres manières de vivre échappant au rouleau compresseur de l’Etat et du marché »13. Voilà sans doute du grain à moudre pour une mobilisation qui tiendrait la liberté pour une priorité. On pourrait suggérer qu’elle accorde aux moyens qu’elle utilise une place moins systématiquement secondaire qu’actuellement par rapport aux fins qu’elle se donne. Elle aurait en tout cas le mérite d’ouvrir des perspectives sans doute plus solides que celle de rendre à la police la monnaie de sa pièce. Sans doute plus exigeante mais aussi plus conséquente sur ce qui nous menace et nous libère vraiment, elle mériterait, elle aussi, de remplir l’esplanade des « droits de l’Homme ».
Notes
- François Jarrige rappelle qu’ il y a évidemment une tension et des luttes depuis longtemps au sein de la « gauche » qui compte des auteurs et mouvements technocritiques dont il ne faudrait pas laisser penser qu’ils n’existent pas. Voir l’entretien qu’il a accordé à Ballast sur le sujet : https://www.cairn.info/revue-ballast-2019-2-page-44.htm. Ce jugement sur la gauche productiviste serait donc à nuancer et affiner en fonction des périodes de l’histoire et des influences multiples qui ont traversées le mouvement ouvrier (Voir aussi Serge Audier, La société écologique et ses ennemis, pour une histoire alternative de l’émancipation, Paris, La découverte, 2017). Malgré tout, du PS au NPA en passant par la France Insoumise ou le PC, nombre de ces officines restent fortement marquées par l’héritage saint-simonien et industrialiste notamment parmi celles qui s’opposent à ce projet de loi. Bien que plus récente, la conversion d’Europe Ecologie Les Verts aux thèses de l’innovation technoscientifique semble elle aussi acquise : l’exemple lillois est édifiant (lire Tomjo, L’Enfer Vert, L’échappée, Paris, 2013) tout comme l’abondante littérature consacrée à cette mue par le collectif Pièces et Main d’œuvre à Grenoble. Enfin, au sein des mouvements libertaires, le tableau est à peine plus contrasté et force est de constater que le souvenir de Blanqui y paraît plus vivace que celui de Landauer ou Morris… J’ai donc utilisé ici ce raccourci car c’est bien cette « gauche » qui est la plus présente dans l’opposition au projet de loi sécurité globale. Rien n’est cependant figé ou monolithique pour peu qu’on ait le souci de réconcilier liberté et limites, question sociale et question écologique. Lire à ce sujet José Ardillo, La liberté dans un monde fragile, paru en 2018 aux éditions l’Echappée.[↩]
- « Bordeaux : Une étincelle dans le brouillard », Lundi Matin, 30/11/2020.[↩]
- Média 25[↩]
- Avec près de 65 millions d’utilisateurs, soit plus de 95% de sa population équipée, la France fait pâle figure par rapport à ses voisins européens où ce chiffre atteint jusqu’à 130 % (soit plusieurs téléphones par personne). Parmi les personnes équipées, 77% le sont désormais d’un smartphone contre 17% en 2011. https://www.vie-publique.fr/en-bref/272039-barometre-du-numerique-95-des-francais-disposent-dun-telephone-mobile.[↩]
- Continuité pédagogique pour les enseignants, télémédecine, accompagnement psychique ou social proposé en « visio » et, partout où c’est possible, télétravail et réunions filmées : les exemples ne manquent pas et ne relèvent plus de la crainte mais de l’expérience quotidienne. Exemples auxquels s’ajoutent les usages imposés par les gestionnaires, via le smartphone, dans le cadre de la numérisation du travail comme de la sphère privée.Voir l’article sur Terrestres.org « Ne laissons pas s’installer le monde sans contact ».[↩]
- Voir la revue l’Inventaire, n°9, pp. 20-21[↩]
- L’emploi du terme « camp progressiste », que la gauche brandit comme un étendard, est discutable. Il faudrait assurément dissocier cette catégorie trop floue et donc piégée (le Progrès) de l’innovation technoscientifique à laquelle elle est immanquablement associée pour que cette idée puisse avoir quelque chance de servir dans un sens émancipateur. Certains estiment cependant que ce « progrès », dont le dicton affirme qu’on ne l’arrête pas, est désormais trop lié au désastre écologique pour tenter de se le réapproprier. Quoi qu’il en soit, le collectif Ecran Total pointait du doigt en 2016 les effets catastrophiques de la déferlante technologique dont le discours dominant assène « qu’il s’agit là d’un progrès » et rappelait qu’en réalité « pour les humains que nous sommes encore, loin de mettre un terme aux travaux pénibles, ce processus est le progrès de notre dépossession ». Ce peut être une manière d’utiliser ce terme en précisant ce qu’on lui reproche. Voir la plateforme Ecran Total, Résister à la gestion et l’informatisation de nos vies.[↩]
- Pièces et main d’œuvre, Le téléphone portable, gadget de destruction massive, éditions l’Echappée, Paris, 2008.[↩]
- Célia Izoard, Lettres aux humains qui robotisent le monde : merci de changer de métier, Montreuil, éditions de la dernière lettre, 2020.[↩]
- Yang, Jenny Chan, Xu lizhi, La machine est ton seigneur et ton maître, éditions Agone, Marseille, 2015.[↩]
- Geoffroy de Lagasnerie : « Guérilla juridique, infiltration, action directe… Il faut déployer un autre imaginaire de l’action », Reporterre.net, 28/11/2020.[↩]
- Actuel président du Medef.[↩]
- Groupe Marcuse, La liberté dans le coma, essai sur l’identification électronique et les motifs de s’y opposer, Paris, La Lenteur, 2012, pp. 147-148.[↩]







