Ce texte est une traduction du chapitre 7 de l’ouvrage de théorie politique Lavoro – Natura – Valore, André Gorz tra marxismo e decrescita, écrit par Emanuele Leonardi et paru en 2018 aux éditions Orthotes1. L’auteur y met au jour l’émergence d’une nouvelle génération dans le courant de la décroissance, initié par Serge Latouche, défini ici comme la « voie Catalane ». Marquée par la crise des marchés financiers, la précarisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, les politiques publiques d’austérité, particulièrement sévères dans le Sud et l’Est de l’Europe, cette génération de chercheurs et militants radicalement écologistes majoritairement issus de ces pays a pour caractéristique principale de remettre la question sociale et la question du travail au cœur de la réflexion sur les dégradations environnementales. Ce second temps de la décroissance est présenté ici comme l’instigateur d’une véritable école, avec des espaces universitaires et militants, des réseaux tels que la Degrowth society, des ouvrages inscrits dans l’héritage de Serge Latouche et Joan Martinez Allier.
Cet approfondissement des questions relatives au capitalisme dans l’écologie radicale invite à de nouvelles lectures du marxisme et des thèmes qu’il aborde dans toutes ses nuances. Parmi celles-ci, le néo-opéraïsme italien comporte des points de jonction particulièrement nombreux et fertiles pour mettre en œuvre un dialogue, voire une intersectionnalité entre décroissance et marxisme. Le mouvement No Tav, par exemple, pionnier des luttes contre les Grands Projets Inutiles et Imposés et de l’européanisation des luttes, est emblématique de ces croisements entre écologie radicale, néo-opéraïsme et mouvement autonome.
Les réflexions sur l’auto-limitation et les modes de gouvernement, la place du care et des rapports de genre dans la tension entre reproduction et expansion du capitalisme ou encore les dépenses et les ressources, constituent autant d’entrées permettant de renouveler les cadres intellectuels de la décroissance. Elles engendrent des points de rencontre fertiles avec des éléments fondamentaux du néo-opéraïsme marxiste, parmi lesquels la centralité du travail, l’accumulation et la croissance, développés ici par Emanuele Leonardi.
Anahita Grisoni
∞
Cette nouvelle génération, que je définis comme la voie catalane, est fortement liée à la décroissance, et ce d’autant plus si l’on considère son contexte d’émergence très particulier, dans la ville de Barcelone ; on peut retenir l’année 2014 comme la date de lancement symbolique de cette transition2. Cette année-là, la quatrième conférence internationale de la décroissance s’est tenue à Leipzig 3. La Voie catalane (qui deviendra mondiale en très peu de temps)4 est avant tout liée au nom de Joan Martinez-Alier, l’auteur de l’essentiel Ecologisme des pauvres5, mais depuis quelques années, elle s’attache aussi et surtout aux trois coordonnateurs de Degrowth. A Vocabulary for a New Era, c’est-à-dire Giacomo D’Alisa, Federico Demaria et Giorgos Kallis6.
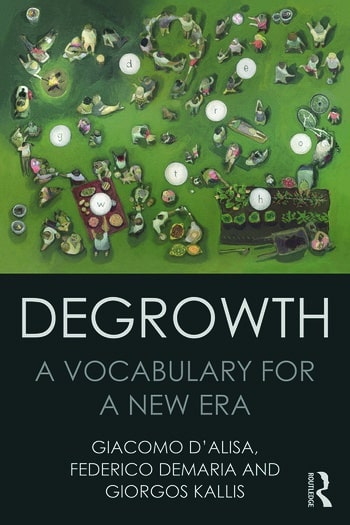
Les réflexions de ces auteurs s’inspirent de travaux portant sur le « métabolisme social » (soit le rapport entre la quantité de ressources et d’énergie utilisées par le système de production et les institutions qui en régulent le fonctionnement), menés par plusieurs économistes de l’environnement à partir de la fin des années 1980 et dont ils portent les conclusions sur un plan plus clairement politique. Par exemple, si en 2010 la définition de la décroissance faisait encore référence à une réduction équivalente de la production et de la consommation7, on parle davantage, depuis quelques années, d’une écologie sociale alternative. L’insistance sur le « moins » est passée à un accent porté sur le « différemment » (qui vient enrichir le point de départ sans pour autant le renier) :
« La décroissance désigne une société dont le métabolisme social diminue, mais, de manière plus fondamentale, une société dont la structure métabolique est différente, car orientée vers de nouvelles fonctions. Décroître ne veut pas dire faire les mêmes choses qu’aujourd’hui, en quantité réduite […]. Dans une société décroissante, tout sera différent : les activités, les formes et l’usage de l’énergie, les relations, les rapports de genre, la division du temps entre travail salarié et non salarié, les rapports avec le monde non-humain8 ».
Deux conséquences découlent de cette nouvelle définition de la décroissance. La première renvoie à un intérêt renouvelé pour les traditions conflictuelles du mouvement ouvrier : ainsi, on trouve, dans le dictionnaire, de nombreuses références, non seulement à Marx mais également à des intellectuels de grande envergure issus de la tradition marxienne (par exemple, Silvia Federici, Massimo De Angelis, David Harvey et Jason Moore) ; cela permet d’ouvrir une nouvelle voie de dialogue entre le marxisme et la décroissance9. La seconde conséquence est l’émergence d’une certaine plasticité lexicale : aujourd’hui, certains éléments fondamentaux de la mosaïque décroissante font référence à des concepts tels que Postwachstum10, en allemand, ou postgrowth11, en anglais, soit littéralement à la « post-croissance ».
Dans cette perspective, la réorganisation de la société mise en lumière par les théoriciens « catalans » de la décroissance se construit autour de trois axes : les limites, le care [ndlr : soin], les dépenses (ce dernier faisant référence au concept de « dépense » tel qu’il est développé chez Georges Bataille).
En ce qui concerne les limites, Kallis s’exprime ainsi :
« Les propositions de la décroissance intègrent la question des limites collectives, comme par exemple un plafond aux émissions de dioxyde de carbone, semblable à celui des quotas imposés. Ces limites sont comprises comme autant de mesures « d’auto-limitation12 », soit comme des décisions collectives visant à ne pas exploiter la totalité de ce qui peut être exploité. En outre, seuls les systèmes sociaux de taille et de complexité limitées peuvent être gouvernés directement, et non par des élites technocratiques qui agissent pour le compte de la population. Les ressources fossiles et le nucléaire ne sont pas dangereux seulement parce qu’ils polluent, mais aussi parce qu’une société reposant sur l’usage d’une grande quantité d’énergie [energy-intensive], sur des systèmes technologiques toujours plus sophistiqués et gérés par des bureaucrates tend à réduire à la fois la démocratie et l’égalité. Par conséquent, la décroissance s’oppose également à des méga-projets faussement « verts » tels que les lignes ferroviaires à grande vitesse et les parcs éoliens à échelle industrielle13. »
Par rapport à la centralité de la question du soin :
« Le soin peut devenir crucial dans une économie basée sur la reproduction plutôt que sur l’expansion. La reproduction renvoie aux activités qui alimentent le cycle de la vie, comme celles, typiquement, menées au sein de la famille. Plus généralement, elle contient tous les processus de soutien et de régénération. Dans l’économie actuelle, le travail lié au soin reste genré, sous-estimé et relégué dans l’ombre de l’économie formelle. La décroissance propose la distribution égalitaire du care et le recentrement de la société autour de ce travail. Une économie du soin est intensive en termes de travail [labor-intensive] parce que c’est justement le travail humain qui lui fournit toute sa valeur. C’est pourquoi le care offre simultanément la possibilité de réduire le chômage et de produire une société plus humaine14 ».
Enfin, en ce qui concerne la dépense :
« La dépense se réfère à l’usage improductif des excédents produits par la societé. La manière dont les civilisations utilisent leurs excédents – soit les « dépenses » qui sont effectuées au-delà et en plus de ce qui est nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux – en définit les caractéristiques essentielles. Les Egyptiens de l’Antiquité utilisaient leurs excédents pour construire des pyramides, les Tibétains pour la classe non-productive des moines, les Européens du Moyen-Âge pour construire des églises (il s’agit là d’une observation analytique : je ne suggère bien évidemment pas que nous devrions reproduire ces modèles de dépenses). Dans la civilisation capitaliste actuelle, dans laquelle l’excédent est accumulé et investi pour produire une croissance ultérieure, la dépense est dirigée vers des pratiques privées de consommation exubérante. A partir du moment où une limitation de la consommation pourrait à elle seule accroître la propension à l’économie et à l’investissement, la décroissance porte le projet d’une réduction radicale des excédents et de la manière dont on les dépense, dans le cadre d’une société festive où les citoyens mettraient en œuvre des modalités d’usage nouvelles et non violentes, qui contribueraient à renforcer les liens communautaires et la production collective de sens15».
Je voudrais souligner trois aspects qui me paraissent pertinents dans ces extraits : les limites économiques ne constituent pas des données objectives, mais bien des éléments posés de manière politique face à la confrontation collective (soit le résultat toujours réversible de la lutte des classes) ; le conflit sur le terrain de la sphère reproductive est fondamental […] ; le renversement du point de vue est clair : le problème n’est pas la rareté, mais bien l’excédent (ce qui renforce la critique d’une logique de la valeur implicite dans le consumérisme contemporain, et rend désirable la mise en commun en tant qu’expression de la richesse, sur un terrain de nature exclusivement qualitative).
C’est sur ces bases que je propose de confronter à nouveau décroissance et marxisme – un certain marxisme, comme nous allons le voir bientôt. Il faut néanmoins signaler qu’en termes de propositions politiques concrètes, la Voie catalane marque une amélioration par rapport au passé – notamment parce que ces propositions se construisent en référence permanente à des luttes des mouvements sociaux contre les effets de la crise. Le collectif Research & Degrowth (basé à Barcelone) a, de fait, élaboré une liste de « réformes non réformistes » – l’expression est d’André Gorz – dans le but de sortir de la crise (objectif immédiat) et du capitalisme (objectif à long terme) :
- Audit de la dette (dans l’objectif de la restructuration et de l’abolition partielle de la dette) ;
- Réduction des heures travaillées (32 heures par semaines, tendant au partage des tâches)16 ;
- Revenu de base et plafond pour les plus hauts salaires ;
- Eco-taxes (en particulier la taxe carbone) ;
- Arrêt immédiat des aides publiques aux activités fortement polluantes ;
- Incitation à la production alternative (bénévolat, système coopératif, filières courtes, etc.) ;
- Modernisation écologique des bâtiments ;
- Réduction substantielle de l’espace dédié à la publicité ;
- Introduction de limites à la pollution environnementale ;
- Abolition du PIB comme indicateur de progrès économique17.
Comme souligné ci-dessous, l’objectif est de mettre côte à côte marxisme et décroissance à partir des liens convergents qu’ils établissent entre les termes de travail, de nature et de valeur […]. Cette tentative se réfère à une certaine acception de la décroissance (celle de la Voie catalane) et à une certaine acception du marxisme. L’analyse développée dans les chapitres précédents a montré que le courant théorique qui m’intéresse ici et que je voudrais discuter est l’opéraïsme italien – et en particulier les efforts actuels opérés par ce courant et destinés à actualiser la boîte à outils marxiste. Andrea Fumagalli propose de les définir comme un « néo-opéraïsme 18 ». Je rappellerai ici brièvement les principales caractéristiques de l’expérience opéraïste : d’un point de vue politique, la mise en place de l’opéraïsme est strictement liée au cycle révolutionnaire des années soixante et soixante-dix en Italie (et ailleurs)19 : il est nécessaire, à ce titre, de mentionner a minima les revues Quaderni Rossi (Cahiers rouges), Classe Operaia (Classe ouvrière) et Rosso (Rouge), ainsi que des formations politiques telles que Potere Operaio (Pouvoir ouvrier) et Autonomia Operaia (Autonomie ouvrière).

D’un point de vue méthodologique, l’option opéraïste se décline autour de quatre éléments, bien décrits par Michele Filippini et Federico Tomasello : le caractère partial du point de vue ; la réflexion et la lutte appréhendées en tant qu’unité consubstantielle ; l’ambivalence de la condition ouvrière (force de travail/travail abstrait à l’intérieur du capital, classe ouvrière/ travail réel contre le capital) ; la centralité de la composition de classe20. Enfin, du point de vue politique, les deux principales innovations de l’opéraïsme ont été, à mon sens : la pratique du refus du travail, et la « révolution copernicienne » selon laquelle le conflit de classes prime sur l’organisation du capital (procédant donc d’une articulation à la fois causale et incrémentale entre luttes ouvrières et développement capitaliste).
En ce qui concerne ce dernier élément, il faut souligner que la rupture de la logique de la valeur doit nécessairement advenir là où celle-ci est la plus puissante et la plus dynamique : le retard du capitalisme est un facteur limitant pour le conflit ouvrier également. Grosso modo, le schéma était le suivant : étant donné que le moteur du développement se trouve au sein de la lutte ouvrière, l’assaut doit porter au plus haut du développement capitaliste, car c’est seulement là qu’il sera possible de réorienter l’objectif de la coopération sans perdre de sa puissance, sans en disperser la force politique. L’exigence d’une bifurcation entre logique de la valeur et logique des richesses ne portait pas sur les racines21, mais bien – pour rester dans une métaphore arborée – au niveau du fruit. Je me réfère ici à deux passages d’un entretien effectué en 2001 par Sandro Mezzadra avec Guido Borio, Francesca Pozzi et Gigi Roggero – que je me dois de partager entièrement – et dans laquelle sont soulignées d’un côté la plus grande richesse de l’opéraïsme et de l’autre ses plus grandes limites22. Concernant la première :
« Je continue à voir de la richesse dans la tentative d’observer la réalité sociale et le développement à travers des catégories prises dans une forte tension subjective. Garder la porte ouverte à une réflexion sur le mode de production capitaliste, marquée par l’objet de la scission, soit la subjectivité prise comme moteur du processus de développement (entre autres moteurs, j’ajouterais), voilà ce qui me semble, en quelques mots, le principal élément qui vaille la peine d’être valorisé dans la leçon opéraïste ».
Concernant maintenant les secondes :
« Devoir parler des limites de l’opéraïsme est à la fois plus facile et plus difficile. C’est plus difficile parce qu’il est nécessaire de dire que la définition même de l’opéraïsme est discutable : c’est une définition très large, qui contient en son sein des moments historiques et différentes élaborations théoriques subjectives. Personnellement, je ressens du respect par rapport à l’expérience et au patrimoine théorique opéraïste qui continuent à circuler dans notre pays, dans les cercles engagés en particulier, et je déduis que la plus grande limite est d’accepter de temps en temps une sorte d’organicisme de fond, pour lequel le sujet militant que je mentionnais ci-dessus ne naît pas d’une impulsion personnelle mais constitue un sujet déjà formé, déjà entièrement prédisposé au communisme23. La seconde limite, et peut être que cela vaut encore davantage que la première concernant l’opéraïsme appréhendé dans sa complexité, est une sorte de progressisme implicite. Comme je disais, il prévaut certainement concernant l’opéraïsme considéré dans sa complexité, bien qu’il soit nécessaire d’établir de nombreuses distinctions : par progressisme implicite, j’entends bien évidemment la référence constante au point le plus haut du développement, en tant que point de rupture potentielle, fidèlement à la fameuse leçon de « Lenin in Inghilterra » [ndlr : Lénine en Angleterre] de Tronti. Ces deux limites ont été souvent entremêlées et continuent encore à s’entremêler, et c’est pour cela que la recherche du point le plus haut du développement débouche immédiatement sur la quête du militant déjà formé, autour duquel se construit la recomposition de classe, quel que soit le nom qu’on lui donne ; et tout cela, surtout dans les conditions actuelles, tend, selon moi, à revêtir des caractéristiques quelque peu mystiques ».
J’essayerais maintenant de définir l’enjeu pour la décroissance d’une confrontation entre néo-opéraïsme et Voie catalane. Cette tentative repose sur une analyse récente de Franco Berardi « Bifo », selon laquelle les mouvements sociaux devraient se libérer de deux fétiches, devenus au fil des ans plutôt encombrants : le travail salarié et la croissance économique :
« peut-être que la perspective de sortie de la dépression contemporaine coïncide avec cette émancipation par rapport à des attentes relatives au modèle de la croissance et du salariat24 ».
Je partage pleinement ces considérations et voudrais montrer d’une part comment ces deux fétiches entretiennent une affinité profonde et d’autre part comment le fait de s’en débarrasser conjointement représente, aujourd’hui, rien de moins qu’une nécessité stratégique. Dans cette perspective, le néo-opéraïsme pourrait trouver dans la Voie catalane les ressources nécessaires pour laisser derrière lui le progressisme implicite dont parlait Mezzadra ; de son côté, cette décroissance pourrait trouver dans l’analyse du « nouveau » lien entre travail-nature-valeur la tension subjective indispensable pour asseoir son projet de transition2. Comme l’a pertinemment souligné Stefania Barca, le changement social a besoin de personnes réelles, et les bons arguments ne suffisent pas à les atteindre : l’analyse du travail réel à travers lequel la valeur et la richesse sont créées reste fondamentale25. En documentant le rapport entre l’ancrage des chaînes de valeur (composante technique) et les intérêts/orientations concrets visant à multiplier les richesses (composante politique) la Voie catalane pourrait mettre au jour les femmes et les hommes – les travailleuses et les travailleurs – sur lesquels la société pourrait reposer.
Il faut maintenant revenir à une réflexion sur le rapport entre salaire et croissance. A ce propos, reprenons brièvement la thèse discutée dans le chapitre III : le salaire en tant qu’institution est au cœur du pacte fordiste – l’obéissance en échange de la sécurité – soit du dispositif entropique dont les conditions préalables sont la croissance économique quantitative et la subordination des personnes à la reproduction (garantie par un welfare state conçu en tant qu’entité périphérique et redistributive). En bref : le pacte ne tient que si le butin croît, pour les personnes internes à la production, au détriment de celles qui sont à l’extérieur.
Deux éclaircissements doivent être ajoutés à cette analyse : l’un renvoie au concept de croissance (et aux relations qu’il entretient avec celui d’accumulation du capital et l’augmentation du métabolisme social), l’autre concerne l’historicité du cadre théorique de référence26 […]. Concernant le premier point, il me semble que l’approche la plus prometteuse est celle qui dérive de Schumpeter27 : on peut penser l’accumulation comme le résultat de deux moments, l’un qualitatif – le développement, marqué par la destruction créatrice faisant émerger un paradigme techno-économique ouvrant un cycle d’accumulation28 – et un quantitatif – la croissance qui « sature » progressivement le cycle, dans l’attente d’une innovation remettant en marche le mécanisme sur un plan différent et supérieur. Deux mouvements, donc : un vertical, venant ouvrir un nouvel espace pour le mouvement d’auto-valorisation du capital ; l’autre horizontal, qui colonise peu à peu le nouvel espace et finit par « l’épuiser ». De ce point de vue, la croissance ne peut se vanter d’aucune primauté – logique, historique ou politique – par rapport à l’accumulation du capital, voire elle peut tranquillement être considérée de manière indépendante.
C’est dans ce contexte que la quasi totalité des adhérents au panorama marxiste a soutenu – et continue à soutenir – non seulement la possibilité, mais aussi le caractère socialement désirable d’une croissance différente, indépendante des impératifs capitalistes. Je rapporte ici les positions d’auteurs que j’admire et qui se situent différemment par rapport au mouvement opéraïste (rejet, perplexité ou adhésion). Je commencerai par Bruno Trentin :
« Je mets toujours l’accent sur l’exigence de partir d’un changement dans la forme du travail pour atteindre un développement différent en termes qualitatifs, plus compatible avec l’environnement. Afin d’interrompre le circuit désastreux d’une croissance sans qualité, qui multiplie les dégradations environnementales, il est nécessaire de réconcilier la personne qui travaille et cherche de nouveaux espaces de liberté dans le travail avec l’environnement, avec les questions de santé, qu’elles concernent l’espèce humaine ou la planète. Si elles continuent à être pensées de manière séparée voire parfois opposée, elles sont vouées l’une comme l’autre à l’échec29 ».
Je poursuis avec Riccardo Bellofiore et Emiliano Brancaccio, sollicités par Carla Ravioli pour exprimer un point de vue sur la croissance économique comme cause directe de la crise écologique :
« Le choix idéal qui se présente à nous […] est différent : au-delà du zéro croissance, d’une croissance négative, ou, de façon alternative […] il faudrait une mutation dans la qualité du développement, qui bien sûr aurait bien peu à voir avec le keynesianisme militaire et consumériste de l’âge d’or du capital, et serait par conséquent compatible avec la croissance de certains secteurs et le déclin d’autres […] La première voie paraît difficile à parcourir, que ce soit à échelle globale ou à échelle nationale, et elle est incompatible avec la démocratie. Il faut donc s’engager sur la seconde, celle d’un possible développement qualitatif, qui aille de pair avec une distribution différente du revenu et des richesses, dans un cadre national et international30 ».
Je conclus avec Alex Foti :
« Aujourd’hui nous avons besoin d’une révision simultanée de la régulation sociale et écologique du capitalisme […]. La croissance doit repartir de manière à ce que le taux de profit augmente, réduisant ainsi la disparité entre le capital et le travail. Toutefois, cet objectif « rouge » (social) tend à s’opposer à un objectif « vert » (écologique) dès lors qu’une croissance supplémentaire induirait une augmentation des émissions de CO2, et engagerait plus tard la planète dans le chaos environnemental. […] Toutefois, la croissance économique n’a de sens que si elle est mesurée en termes monétaires et non physiques. Donc, en principe, il est possible d’imaginer une régulation du capital évaluée non pas en termes monétaires (dépassant ainsi la crise économique), mais en termes écologiques (en redimensionnant la catastrophe climatique). Il s’agirait alors d’un stade de l’économie dans lequel la croissance immatérielle constituerait la norme et irait de pair avec la maximisation des connaissances collectives et du bien-être social – et non plus avec le profit des entreprises et de la richesse privée. Une économie dans laquelle les personnes échangeraient davantage de services immatériels que de biens matériels31 ».
Il me semble que le point commun entre ces trois visions repose sur l’idée que le problème du productivisme s’attache exclusivement au mode de production capitaliste et qu’au-delà de la valeur, il existe une richesse qui pourrait croître à l’infini. Dans une perspective néo-opéraïste, cet infini existe dans la mesure où il est fondé sur l’intelligence collective (general intellect) et, plus globalement, sur la reproduction devenue productive, et par conséquent détachée du principe de rareté. J’avoue qu’il s’agit d’un passage conceptuel spécifique, que je ne me sens pas le droit d’abandonner complètement. Cela ne retire rien au fait que la relation entre l’augmentation du métabolisme social et l’augmentation du taux de croissance peut être observé de façon empirique32. Même si la richesse intangible est conçue en tant que création d’un travail cognitif libéré du joug de l’exploitation, il serait néanmoins nécessaire de ne pas perdre de vue les exigences énergétiques (très importantes) de l’économie digitale ; le rêve accélérationiste de l’autonomisation de masse planifiée pourrait facilement se transformer en un cauchemar écologique dont le besoin ne se fait pas sentir33. En outre, il faut considérer que l’on ne part pas de zéro, mais bien d’une planète déjà fortement atteinte d’un point de vue écologique : pour prendre un exemple récent, la commission de Lancet sur la pollution et la santé a révélé qu’en 2015, la pollution atmosphérique a co-causé neuf millions de décès, soit un sixième du nombre total de décès.
Je trouve donc intéressant de partager l’analyse de Kallis, selon qui, historiquement, les indices de throughput [ndlr : débit] et de la décroissance démontrent une corrélation positive entre la croissance du PIB et la consommation de ressources et d’énergie et, à supposer que ce soit vrai – en théorie – qu’il est envisageable de les penser de manière indépendante et surtout nécessaire d’avancer avec beaucoup de prudence sur cette voie. A minima, pour quatre raisons : si l’objectif reste celui de croître le plus possible sur une période longue, alors cette séparation ne pourra être que relative et temporaire ; il ne faut pas oublier que la faisabilité pratique ne découle pas toujours des possibilités logiques ; le gigantisme énergétique – celui de l’industrie, par exemple – se prête mal au contrôle démocratique et tend à requérir une gestion technocratique34 ; si les exigences énergétiques devaient croître au rythme des dernières années pendant encore longtemps, même la substitution totale des ressources fossiles par les énergies renouvelables pourrait ne pas représenter une solution désirable, dans la mesure où des portions très importantes du sol devraient être dédiées à cette production (les énergies renouvelables ne sont préférables que si la substitution des fossiles s’accompagne d’une réduction des besoins)35.
En conclusion, l’auteur propose de dépasser la tension entre absence de croissance et croissance « alternative ». Pour lui, les deux moments peuvent coïncider, au sein d’une stratégie articulée qui tienne compte de la transformation des rapports entre la valeur et la nature au cours du développement capitaliste. Le problème politique soulevé ici est le suivant : comment produire un conflit qui viserait à la réduction de la pression sur la biosphère (par la diminution ou le revirement du métabolisme social) tout en allant, simultanément, vers l’augmentation des activités de soin et la production de connaissance (augmentation du travail reproductif/cognitif) ? Il conviendrait de travailler conjointement deux objectifs : la nécessité de réduire l’impact écologique néfaste des activités productives et la désirabilité quant à la sortie du marché de pratiques subjectives qui entrelacent la société et la nature sans pour autant les impacter. C’est sur ce type de travail libéré du marché (et non salarié), que Nina Power nomme le « dé-capitalisme36 », qu’il faudrait construire une stratégie de lutte opposée au capitalisme contemporain […].
Traduit de l’italien par Anahita Grisoni

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute.
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- NdT : Travail – Nature – Valeur, André Gorz entre marxisme et décroissance, Othotes, Naples-Salerne, 2018[↩]
- Au-delà d’une confirmation analytique, une analyse « écologique » des rapports de classe liant le désir d’une transition climatico-énergétique et la lutte contre la précarité, donnerait à la décroissance un instrument subjectif efficace pour revendiquer, par exemple, un droit universel à la santé.[↩][↩]
- NdT : La Degrowth Conference est organisée tous les deux ans par le réseau du même nom.[↩]
- Barbara Muraca et Mathias Schmelzer ont récemment démontré comment le débat sur la décroissance, initié dans le sud de l’Europe, s’est enrichi d’un courant anglophone et germanophone ; cf. B. Muraca, M. Schmelzer, « Sustainable Degrowth. Historical Roots of the Search for Alternatives to Growth in Three Regions », in I. Borowy M. Schmelzer (dir.), History of the Future of Economic Growth, Routledge, London 2017.[↩]
- Joan Martinez-Alier, L’écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Paris, Les Petits Matins, 2014[↩]
- G. D’Alisa, F. Demaria, G. Kalli, Degrowth, a vocabulary for a new era, Routledge, London, 2015.[↩]
- F. Schneider et al., « Crisis or Opportunity? Economic Degrowth for Social Equity and Ecological Sustainability », Journal of Cleaner Production, 18(6), 2010, pp. 511-518.[↩]
- G. D’Alisa, F. Demaria, G. Kallis (dir), Degrowth, op. cit., p. 1.[↩]
- On peut émettre l’hypothèse d’un effet rétroactif positif des positions de Serge Latouche, qui, dans un article datant de 2013, écrivait ce qui suit : « la croissance n’est que le terme « vulgaire » du phénomène analysé par Marx comme l’accumulation illimitée de capital, source de toutes les défaillances et injustices du capitalisme. Le profit est le but de l’accumulation du capital, tout comme l’accumulation du capital est le but du profit. Parler d’une croissance ou d’une accumulation du capital vertueuses, d’un développement vertueux, revient à dire qu’il existe un capitalisme vertueux (vert ou soutenable) et une exploitation vertueuse. Pour sortir d’une crise qui est, de manière inextricable, écologique et sociale, il faut sortir de la logique de l’accumulation infinie du capital et de la subordination de toutes les décisions essentielles à la logique du profit ». S. Latouche, Decrescita con Marx, « Comune-info » [2013].[↩]
- M. Schmelzer, A. Passadakis, Postwachstum, Verlag, Hamburg 2011.[↩]
- C. Garmann Johnsen et al. (dir.), Organizing for the Post-Growth Economy, Mayfly, London 2017.[↩]
- A ce sujet, il me paraît important de signaler l’existence d’un problème non résolu par l’écologie politique en général, soit la tension entre les différents champs sémantiques qu’elle met en lien : l’interdépendance (soit, l’apport spécifique de l’écologie) et l’autonomie (soit, dans ce cas, le but de l’action politique). Il s’agit d’un problème philosophique très complexe que je me limiterai ici à évoquer, tout en indiquant une piste de recherche qui, à mon sens, vaut la peine d’être parcourue afin de sortir de cette impasse : il s’agit de l’hypothèse proposée par Gilbert Simondon, selon laquelle « l’autonomie précède l’indépendance ». En élargissant le sens de cette proposition, la question de l’autolimitation (environnementale) apparaît comme l’issue de conflits spécifiques à l’autonomie politique, qui correspondent et rétroagissent sur une modalité (historique) donnée de l’interdépendance écologique. G. Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Jérôme Millon, Grenoble 2005, p. 195.[↩]
- G. Kallis, L’alternativa della decrescita, revue en ligne Effimera, 2017.[↩]
- G. Kallis, « L’alternativa della decrescita », revue en ligne Effimera, 2017.[↩]
- Ibidem. Le thème de la dépense est entré dans le débat sur la décroissance grâce aux travaux d’Onofrio Romano (O. Romano, « Bisogna distruggere la società », in O. Marzocca (dir.), Governare l’ambiente ? La crisi ecologica tra saperi, poteri e conflitti, Mimesis, Milano-Udine 2010).[↩]
- A ce propos, il faut mentionner la très bonne interprétation féministe du partage des tâches dans la perspective décroissante proposée par C. Dengler et B. Strunk, The Monetized Economy versus Care and the Environment : Degrowth Perspectives on Reconciling an Antagonism, « Feminist Economics » (en cours de publication).[↩]
- Voir G. Kallis [A. Vansintjan (dir.)], « In defense of degrowth »[↩]
- A. Fumagalli, « Operaismo, post-operaismo? Meglio neo-operaismo », Effimera [2017][↩]
- L’opéraïsme s’est rapidement diffusé en Allemagne à travers la revue « Autonomie » et le travail de Karl Heinz Roth ; en France, à travers les revues « Matériaux pour l’intervention », « Camarades » et les réflexions de Yann Moulier Boutang ; aux Etats-Unis, à travers la revue « Zerowork » et les analyses d’Harry Cleaver (cf. S. Mezzadra, Italy, « Operaism and Postoperaism », in I. Ness (dir.), International Encyclopedia of Revolution and Protest, Blackwell, Oxford 2009, 1841-1845).[↩]
- M. Filippini – F. Tomasello, « Il pensiero come arnese : note sul metodo operaista degli anni Sessanta », in A. Simoncini (dir.), Dal pensiero critico : filosofie e concetti per il tempo presente, Mimesis, Milano-Udine 2015.[↩]
- Baranzoni – P. Vignola, « Biforcare alla radice. Su alcuni disagi dell’accelerazione », « Effimera » [2016][↩]
- G. Borio – F. Pozzi – G. Roggero, Futuro anteriore, Derive Approdi, Roma 2002.[↩]
- Note de la Traductrice. L’auteur se réfère à un automatisme implicite, très présent dans l’opéraïsme classique, selon lequel une position donnée au sein du mécanisme d’exploitation induirait une disposition « naturelle » à la lutte des classes.[↩]
- F. Berardi « Bifo », « Il rifiuto del lavoro ai tempi della precarietà », in F. Coin (dir.), Salari rubati, ombre corte, Verona 2016, p. 129.[↩]
- S. Barca, « The Labor(s) of Degrowth », Capitalism Nature Socialism, Vol. 30 issue 2, 2019.[↩]
- M. Schmelzer, The Hegemony of Growth, Cambridge University Press, 2016.[↩]
- A. Zanini, J.A. Schumpeter. Teoria dello sviluppo e capitalismo, Bruno Mondadori, Milano 2000.[↩]
- Il faut néanmoins préciser que, pour Schumpeter, une croissance (proportionnelle) sans développement représente un simple expédient logico-analytique. La réalité se trouve dans le développement qui, toutefois, est toujours soutenu par l’attente de profits croissants.[↩]
- Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Carlota Perez. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar, 2002. Pp. xix, 198, in The Journal of Economic History, 63 (2), pp.615-616.[↩]
- R. Bellofiore, E. Brancaccio, « L’economia della natura », in C. Ravaioli (dir.), Lettera aperta agli economisti. Crescita e crisi ecologica, Manifesto libri, Roma 2001, pp. 60-61.[↩]
- Foti, General Theory of the Precariat, Theory on Demand, Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2017, pp. 40-148.[↩]
- N. Srnicek, A. Williams, Inventing the Future, Verso, London 2016.[↩]
- A. Roos, V. Kostakis, C. Giotitsas, « The Materiality of the Immaterial: ICTs and the Digitale Commons », Triple C, 14(1), 2016, pp. 48-162. A. Vansintjan, Accelerationsim and… Degrowth? The Left’s Strange Bedfellows, Institute for Social Ecology [2016][↩]
- Serge Latouche, Jacques Ellul contre le totalitarisme technicien, Neuvy-en-Champagne, Le Passager Clandestin, coll. « Les précurseurs de la décroissance », Lyon, 2013 ; T. Paquot, Ivan Illich et la société conviviale, Le Passager Clandestin, coll. « Les précurseurs de la décroissance », Lyon, 2020 ; D. Cérézuelle, Bernard Charbonneau ou la critique du développement exponentiel, Le Passager Clandestin, coll. « Les précurseurs de la décroissance », Lyon, 2018.[↩]
- G. Kallis, « Socialism Without Growth », Capitalism Nature Socialism, Vol. 30, issue 2, 2019, pp. 189-207.[↩]
- N. Power, Decapitalism, Left Scarcity and the State, « Fillip », 20: https://fillip.ca/content/decapitalism-left-scarcity-and-the-state. [2015[↩]








