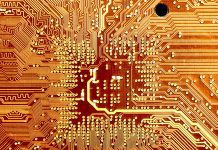Alors que les vents contraires soufflent de plus en plus fort sur l’écologie politique, aidez-nous à faire vivre cet espace éditorial et politique unique, où s’imaginent et s’organisent les écologies radicales.
Merci ! On compte sur vous !
Temps de lecture : 21 minutes
Façon puzzle
L’un de mes anciens professeurs m’avait un jour dit qu’une fois un livre paru, il ne nous appartient plus. Je m’aperçois aujourd’hui combien cette réflexion était exacte. En effet on ne peut pas totalement contrôler la forme des débats dans lesquels notre travail vient s’inscrire, on ne peut pas non plus anticiper la nature et l’intensité des affects que les lecteurs et les lectrices investissent lorsqu’ils s’en emparent. En lisant la recension qu’a fait paraître la revue Terrestres de mon livre Abondance et liberté, j’ai été confronté à ce problème de manière très directe. J’ai constaté que ce livre pouvait être lu d’une façon qui ne correspond pas tout à fait à l’intention que j’ai souhaité y mettre, selon des lignes de clivage qui ne sont pas les miennes, et que ce décalage suscitait des affects exacerbés au point de justifier un règlement de comptes assez brutal.
Tout cela ne veut pas dire que la lecture proposée par l’auteur est intégralement erronée, loin de là, mais qu’elle réagit en fonction de partages conceptuels et politiques qui me sont en partie étrangers : mon propre travail me revient donc sous des traits que je ne lui connaissais pas, remis en jeu par des attentes et des principes que je n’ai pas anticipés, mais avec lesquels je dois désormais composer. Et non seulement l’auteur de ce texte investit mon travail selon des lignes de clivage que je n’avais pas imaginées moi-même (ce qui est intéressant), mais ce décalage aboutit à une destruction en règle de l’ensemble de mon projet (ce qui est un peu plus gênant…).
Ce qui m’a d’abord surpris est le ton de mise en accusation polémique — au sens où ce qui nous oppose serait de l’ordre de la guerre. Mais en y réfléchissant j’ai compris que ce ton et le contenu théorique qui m’est opposé vont de pair dans l’esprit de l’auteur. Faute d’être agréable, la critique qui m’est faite est donc cohérente, et le texte n’est pas inutilement agressif — il l’est constitutivement. Car le clivage qu’il orchestre entre ma position et la sienne (car il en a une, affirmée de façon très nette) va bien au-delà des idées. Elle engage une position dans le monde, un rapport profond aux institutions, au savoir, à l’Etat, à l’idée de justice — autant de choses que l’on ne peut confiner dans le débat universitaire, et qui appellent à une catharsis intellectuelle dont je ne suis, me semble-t-il que l’occasion, ou le catalyseur (le prétexte ?). Ce que la recension de Berlan reproche à mon travail réactive au fond un partage entre deux écologies qu’il juge incompatibles, voire plus : un état de guerre latent qu’il fallait tôt ou tard déclarer.
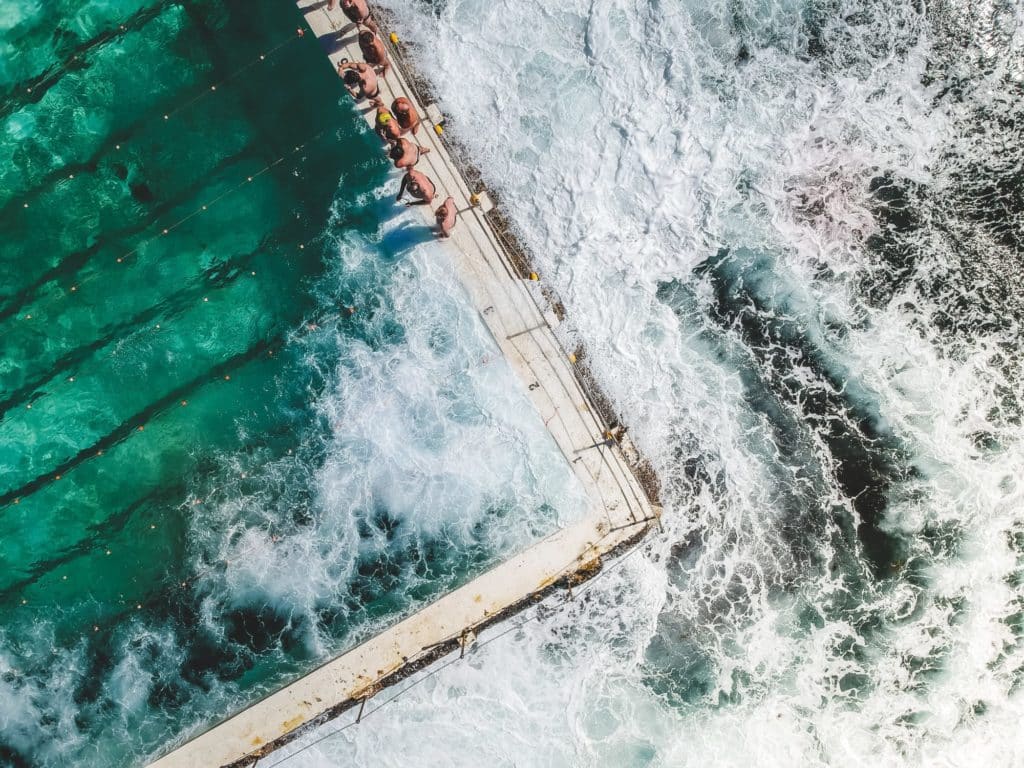
Je ne m’explique pas autrement le projet de Berlan, qui consiste à rédiger un texte extrêmement développé, précis et argumenté, sur un livre qu’il juge apparemment en dessous de tout standard intellectuel. Abondance et liberté est à ses yeux indigent et incohérent, mais semble-t-il représentatif de quelque chose qu’il fallait dénoncer de toutes ses forces. Il saisit mon livre comme l’occasion d’un « bilan » sur « l’héritage de la modernité » et la situation de l’écologie politique, ce qui n’est pas un petit honneur — même si celui-ci est pour le moins paradoxal. Clairement il ne s’agit pas d’une recension, car Abondance et liberté n’y est pas résumé (l’article ne dit rien des thèmes centraux du livre que sont l’histoire du socialisme et la question territoriale), mais d’une proposition alternative à la mienne, qu’il faut prendre comme telle.
Le « quelque chose » qui nous sépare, cette ligne de clivage, il faudra bien l’identifier et l’examiner (au-delà du manque de rigueur qui m’est opposé, et sur lequel je peux me défendre dans d’autres cadres), mais d’abord je veux clarifier mes intentions dans cette réponse. Autant le dire tout de suite, je ne partage pas du tout cette conception de ce qui nous oppose. Ou pourra me reprocher que cette position est stratégique, mais je la soutiens : le clivage qui existe entre ma proposition et celle qui sous-tend la lecture de Berlan n’est pas de l’ordre de la guerre. Ce qui nous oppose est à mon sens infiniment moins important que ce qui nous relie, si du moins on accepte de situer ce débat dans l’espace plus vaste des dangers et des opportunités qui se présentent à nous dans la situation politique globale.
Comme je n’accepte pas l’idée que nous soyons en guerre, et comme je pense plus généralement qu’il vaut mieux ne pas faire la guerre pour de mauvaises raisons, je propose de faire la paix. Non pas de nier nos oppositions, qui sont réelles, ou de définir de façon autoritaire les termes de cette paix, mais de qualifier de façon plus juste ce qui nous oppose pour saisir dans le même mouvement ce qui nous relie.
I know nothing
L’auteur déploie un argumentaire qui recourt à plusieurs registres, trois exactement, entre lesquels il glisse en permanence. Ce n’est pas lui qui organise ainsi son propos, mais moi.
Il passe d’abord par des éléments d’histoire des idées qui sont très riches et très convaincants, qui témoignent du fait que ce dont je parle dans mon livre, il le connaît très bien et a fréquenté aussi cette nébuleuse de questionnements. De ce point de vue, son argument peut se résumer ainsi : il est inexact d’affirmer, comme je le fais, que la conception moderne de l’émancipation s’est trouvée capturée par les structures matérielles de l’abondance, car il existe une tradition continue, qui irait des grecs à Rousseau et à Illich, pour laquelle la liberté se définit justement contre la quête de l’illimitation économique. Aussi la tension que je décris entre question sociale et question écologique sans lui donner de résolution dogmatique, si ce n’est l’invitation à concevoir et à mettre en pratique son dépassement, est à ses yeux entièrement factice, puisqu’elle m’a été imposée par mon incapacité à adhérer à la seule et unique conception juste de la liberté — celle que promeut cette tradition arcadienne anti-modernisatrice.
Il y aurait de nombreuses choses à répondre à cette critique, je me contente d’un élément. La recension de Berlan ne mentionne pas du tout le premier chapitre d’Abondance et liberté, qui se charge de répondre par anticipation à cette objection. J’ai décidé de me détourner de l’histoire des idées écologistes, ou environnementales, pour m’intéresser au contraire à ce qui cloche, à ce qui peut expliquer que nous tendions encore massivement (peut-être pas les quelques écolos véritables que l’on trouve çà et là, mais les milliards d’autres) à assimiler le développement techno-scientifique à une opportunité de libération, et que cette assimilation structure encore des architectures juridiques et politiques très difficiles à déloger et à délégitimer. De ce point de vue, mon livre ne peut pas être rangé aux côtés des « grands penseurs » de l’écologie que sont Gorz, Illich ou autres, car il suit une logique en quelque sorte inverse : non pas « voici le chemin pour vous délivrer de la surabondance », mais « voici le chemin qui vous y a conduit ». Et comme je pense qu’une bonne histoire des idées et une histoire des idées qui fait ressortir des contradictions, de choses que l’on n’accepterait pas a priori, j’ai tenté de montrer que ce qui nous a coincé dans cette confiscation de la liberté par l’abondance, c’étaient pour partie de bonnes raisons. Du moins, des mécanismes sociaux suffisamment puissant et littéralement captivants pour avoir suscité des formes d’adhésion et de loyauté que l’on ne peut se contenter de rejeter d’un revers de main en disant « il aurait mieux valu ne pas s’y prendre ainsi ». C’est vrai, il aurait mieux valu ne pas d’y prendre ainsi, mais c’est trop tard : l’univers techno-politique dans lequel nous évoluons s’accompagne d’attentes sur lesquelles il est difficile de revenir par une pure décision intellectuelle.

L’histoire est faite d’inerties. Et lorsqu’au tournant des 19e et 20e siècles, et plus encore au milieu du 20e, une bonne partie du problème que pose la légitimation démocratique de l’ordre politique et économique repose sur le partage des bénéfices, sur l’assimilation de la pénurie à un risque de dictature et sur l’assimilation complémentaire de l’essor de la production au socle de la démocratie sociale, alors les sortilèges du productivisme s’enracinent dans la conscience collective d’une façon absolument concrète. Qu’il faille aujourd’hui mener une critique du besoin ne fait aucun doute, car comme le rappelle Berlan les débouchés concrets de la productivité industrielle contemporaine sont largement décalés par rapport au problème de la satisfaction des attentes légitimes du corps social, mais comme on le sait aussi, le mort saisit le vif. Et en l’occurrence, le mort, c’est le credo des gains de productivité, pris dans la danse de l’Etat et du capital.
Donc l’autre autonomie, celle dont nous rêvons tous et toutes, elle n’est pas tout à fait derrière nous. On peut réactiver sans doute des lambeaux de pratiques et de pensées anciennes, celles d’avant la modernité, mais il faut bien la réinventer sur la base des attentes sociales entre temps produites par le moment industriel. Lorsqu’on dit qu’il faut « réinventer » le progrès, ou la solidarité, on dit bien autre chose que « inventer » : ces biens symboliques et politiques que sont la justice et l’égalité, nous les avons connus, même partiellement, mais nous les avons touchés du doigt dans un univers matériel qui nous est aujourd’hui inaccessible. Et bien malin qui saura faire passer le couteau de boucher entre ce qui relève d’une empreinte laissée par les faux espoirs de l’industrialisme, et ce qui relève d’un héritage à assumer — entre ce qu’il faut abandonner et ce qu’il faut garder. Moi, cette distinction, j’avoue que je ne sais pas la faire. Et j’avoue être surpris quand je lis Berlan affirmer que lui, il sait : il affirme qu’il sait car il a lu les bons livres, et (nous y reviendrons) parce que la vie l’a mis dans une situation qui lui donne accès à cette vérité, c’est-à-dire proche des luttes (mais des luttes, il y en a beaucoup en ce monde…).
Je ne sais pas car il y a en moi la trace d’attentes politiques absolument modernes (l’idée de vie privée par exemple, de liberté d’expression sur la place publique, l’idée d’une désolidarisation entre la vie sexuelle et les normes du cadre familial), d’autres qui sont totalement industrialistes (je pense que les formes d’association liées à un haut niveau de division du travail sont bénéfiques), ou liées au contexte industriel (je pense que nous nous devons une solidarité mutuelle qui tient compte du milieu technique avancé, comme la vaccination). Et au milieu de tout cela des attentes suscitées par l’horizon de la catastrophe écologique et matérielle, comme celle de l’auto-limitation. Donc ce qu’il prend pour une validation insidieuse de la logique modernisatrice et destructrice est en réalité une volonté d’assumer un héritage incontournable, un héritage qui d’ailleurs peut être identifié chez lui aussi (qui écrit pour un journal en ligne, et qui croit donc à la communication instantanée à distance), un héritage que l’on doit examiner car qu’on le veuille ou non il occupe nos esprits, et il s’est objectivé dans notre paysage matériel et idéel.
Je considère que l’édification de la justice politique est une série de réponses situées à des pathologies — certaines sont liées à la situation agraire et organique, d’autres sont liées à la situation industrielle, et d’autres, plus récentes, sont liées à la situation de catastrophe écologique globale. Je pense également qu’il n’y a pas d’harmonie absolument fondamentale entre ces différents régimes de justice et de solidarité, et que, encore une fois, bien malin qui saura les équilibrer. Je pense enfin que le corpus de l’écologie politique identifié comme tel par Berlan (Ellul, Gorz, Illich, Bookchin) ne donne pas à lui seul la clé de ces enjeux, et qu’il serait temps que les écologistes apprennent à prendre avec distance la critique que l’on peut adresser à ces références intellectuelles, car la plus grave de ces critiques n’est pas celle que je peux leur adresser, mais celle que leur adresse en quelque sorte l’histoire en refusant de leur accorder un rôle de prophètes qu’une toute petite minorité de militants leur attribue.

Les principes d’auto-limitation aujourd’hui débattus sont nombreux, ils vont de la critique classique du capitalisme prédateur à la planification centralisée de la production, du rationnement de la consommation à la compensation des dépossessions coloniales, de la lutte contre les énergies fossiles par le déploiement massif des énergies renouvelables au retour à une économie agro-écologique. Et on pourrait ajouter encore bien des exemples, bien des combinaisons de pratiques et d’autorités scientifiques, techniques, morales qui s’avancent pour nous sortir de l’impasse. Je ne conçois pas le travail de la philosophie comme un point final à ces différentes propositions, mais comme une proposition qui permet d’appréhender leur signification historique et politique, et de les prendre au sérieux contre la tendance adverse consistant à défendre le business as usual.
Le traître parmi nous
Le second registre discursif utilisé par l’auteur (le premier était celui de la disputatio théorique, classique) relève, je le crains, de l’accusation politique franche. On le décèle dans l’usage, à plusieurs reprises, du terme de « purge », et encore plus simplement de « police politique », puis de l’idée d’une « neutralisation préventive de la contestation écologiste » de ma part. Ce sont des termes forts, qui renvoient au domaine de la censure. Je suis donc un censeur. Encore une fois, si l’on admet qu’il ne s’agit pas d’une question de personnes, Berlan m’attribue ici une position de pouvoir telle que le choix des auteurs que je discute dans Abondance et liberté prend la signification d’une liste de références permises — les autres étant ipso facto interdites, ou comme il le dit plusieurs fois « occultées ». Derrière la critique acide, il y a donc une attribution d’autorité exacerbée.
C’est semble-t-il l’occultation de certains auteurs qui a touché chez Berlan le nerf le plus sensible, c’est ce qui me vaut les accusations les plus lourdes. Ceci je crois est compréhensible encore une fois dans une logique de conflit ouvert : la seule chose qui est pire qu’un ennemi, c’est un traître. Or en faisant mine d’endosser la cause écologique pour lui planter finalement un couteau dans le dos, je suis le traître absolu.
Evidemment, il y a une réponse brève à cette grave accusation : mon livre n’est pas encyclopédique, j’ai choisi des références qui expriment à mon sens au mieux les tensions historiques et philosophiques que je voulais mettre en exergue, et comme je préfère toujours discuter en profondeur une petite sélection de références plutôt que survoler une longue liste de noms, le tri a quelque chose d’arbitraire. En réalité, ce serait mon rêve de participer à un grand panorama historique des formes de réflexivité environnementale modernes (c’est même plus qu’un rêve, c’est un projet), mais ce ne sont pas des choses que l’on fait tout seul.

Une réponse plus longue consiste à prendre au sérieux l’accusation qui consiste à voir dans mon livre une opération de purification de l’histoire des idées au détriment des représentants de l’écologie politique consacrés comme tels. Encore une fois, les raisons de l’absence de ces auteurs sont longuement explicitées au premier chapitre du livre, dont le titre ne peut laisser de doute : « Critique de la raison écologique ». La recension parle dans son titre de « neutralisation » de l’écologie politique et semble le dire de manière critique. Or c’est bel et bien ce que j’ai voulu faire — sur un plan méthodologique évidemment, pas sur celui des luttes (qui de toute façon n’obéissent pas heureusement à des injonctions universitaires). Je voulais me délivrer de mes propres inclinations normatives, qui sont proches de Illich et Gorz, pour m’intéresser à autre chose, non pas à l’histoire de l’émergence lente et douloureuse de la vérité écologique, si tant est qu’elle existe, mais à l’histoire du problème qu’allait finir par devoir résoudre cette école de pensée. Donc les références favorites de mes camarades écologistes passent un peu par pertes et profits, mais d’autres lecteurs et lectrices ont vu dans cette mise entre parenthèses une invitation à les relire d’un œil neuf, sous des contraintes théoriques nouvelles. L’écologie politique panthéonisée comme telle n’est pas dans ce livre l’analyseur de l’histoire de la liberté moderne, mais elle peut, si on accepte de se livrer à cette tâche, être analysée à cette lumière. J’ajoute en passant que c’est ce que je fais en tant qu’enseignant : je dirige régulièrement des mémoires de Master sur ces auteurs (j’ai d’ailleurs récemment lu Bookchin, que je ne connaissais pas, grâce à un étudiant), et nous les examinons sans les sanctifier.
D’ailleurs cette logique est plus générale dans le livre : j’examine de façon aussi rigoureuse que possible d’autres formes d’écologie, celle que l’on trouve chez Marcuse, celle du rapport du Club de Rome et de la bioéconomie, celle de la sociologie des risques, ou des injonctions à l’adaptation. Ce n’est pas qu’aucune de ces formulations ne trouve grâce à mes yeux, car mon approche n’est pas guidée par un jugement. Mais chacune à sa manière véhicule une conception du monde social, dans son rapport au milieu matériel et écologique, qui ne va pas de soi. Au fond on en revient à cette question de la vérité, d’un savoir écologique sûr de lui et prêt à s’afficher de façon résolument normative. A mon sens, la question du réajustement des attentes de justice sociale dans un monde bouleversé par les retombées de l’histoire industrielle est fondamentalement disputée — c’est-à-dire encore ouverte, encore instable.
A cet égard, la formulation la plus révélatrice, celle qui me laisse aussi le plus circonspect dans cet article est la suivante : lorsqu’il discute ma réflexion sur la forme du collectif qui va prendre en charge la critique écologique et sociale du modèle de développement actuel, Berlan écrit que « la réponse à la question du « sujet collectif critique » va de soi ». Très simplement, je peux dire que non, elle ne va pas de soi, car si c’était le cas, elle se serait imposée depuis belle lurette — à moins que les gens ne soient majoritairement stupides ou bloqués dans un rôle de marionnettes téléguidées par le pouvoir, deux idées auxquelles je ne peux me résoudre.
Enfin un troisième ordre de raisons m’ont conduit à ne pas faire des références favorites de l’écologie politique mes héros théoriques. Disons le schématiquement. Je me suis surtout intéressé à l’histoire des mises en forme théoriques de la société, et à ce qu’elles doivent aux affordances du milieu. Simplement, je n’ai pas écrit un livre sur les idées qui font avancer la cause de l’industrie ou de l’écologie, mais à propos des idées sur ce qui fait tenir ensemble les humains dans des communautés aux prises avec une extériorité naturelle. Comment l’usage de la terre, des machines, des minéraux, de l’espace, configure différents paradigmes politiques des derniers siècles. J’ai essayé de mettre de l’ordre dans cette histoire, avec pour principale préoccupation la possibilité que prenne forme (pas sous ma plume, mais à l’échelle historique) un paradigme politique ajusté aux bouleversements géo-écologiques actuels. Je suis donc un traître à l’écologie dans le sens où je ne me fixe pas comme programme de la consolider ou de l’attaquer, mais d’examiner à quel genre de conception socio-politique elle peut s’adosser.
Ce travail n’est pas neuf, d’autres que moi ont dessiné cet horizon théorique bien avant. Mais il est important de rappeler que la réussite d’un tel programme ne peut pas obéir à des considérations purement militantes. Comme le sait Berlan, qui est l’auteur d’une monographie sur la sociologie allemande classique, la recherche en sciences sociales possède ses règles, ou du moins ses codes — et il le sait d’autant plus qu’il m’accuse de ne pas y obéir. La logique de mon livre est donc celle de l’enquête théorique et historique, pas celle de l’appui intellectuel aux luttes, et si les luttes peuvent in fine trouver intérêt à me lire, cela ne prendra jamais la forme d’une réappropriation directe (sur le mode des « armes » de la critique), mais d’un apport de réflexivité. Ce dernier point me conduit d’ailleurs au troisième aspect de la critique qui m’est faite.

Démasqué !
Le troisième registre discursif adopté par Berlan est celui de la sociologie du champ académique. Sociologie conjecturale, évidemment, car il ne connaît pas le détail des conditions dans lesquelles je travaille, donc disons plutôt prétention sociologique.
En résumé, l’argument procède ainsi : les positions politiques que l’auteur m’impute peuvent être déduites de l’univers institutionnel dans lequel j’évolue, elles en sont le calque et le relais sous forme rationalisée. Mon travail serait donc la légitimation « d’un écologisme d’Etat et d’entreprise », ce qui explique son succès médiatique réel ou présumé car il serait compatible avec les attentes mainstream préconstruites par les élites. Berlan s’applique d’ailleurs à lui-même ce cadre d’analyse sociologique, puisqu’il se prévaut pour sa part d’une relation harmonique aux luttes écologiques, qui lui donnent un accès sans biais et sans illusio à la véritable raison politique écologiste, celle qui « va de soi ».
En fonction des conditions sociales dans lesquelles on se trouve, le mouvement d’intellectualisation des pratiques tend donc vers la dépolitisation (Berlan parle à mon sujet « d’intellectualisation dépolitisante »), ou vers l’adéquation idéale avec la cause. Or ce qui provoque dans mon cas l’intellectualisme parasitaire, c’est mon appartenance au monde universitaire. Ce qui est tout à fait frappant, car Berlan me fait des reproches qui relèvent strictement du cadre académique en corrigeant ma copie sourde aux vérités de l’histoire. Donc la thèse de l’anti-académisme qu’il suggère ne tient pas : on a affaire à quelqu’un qui tient aux normes de production du savoir, qui les a apprises et appliquées dans son propre travail, et qui sait les utiliser contre leurs dépositaires légitimes.
Ma faute n’est donc pas d’être confit dans l’académisme, sans quoi il tomberait avec moi dans cette ornière, mais réside dans ma complicité avec l’Etat — que lui, on le devine, a lucidement abjuré. Ce qu’il appelle « l’aveuglement académique » est une fausse critique, car comme je viens de le signaler il raisonne de façon tout aussi académique que moi, mais lui prétend le faire hors de la super-structure institutionnelle qui régit de nos jours le monde académique, à savoir l’Etat. Il va de soi que pour ma part, cela m’est impossible : je suis fonctionnaire, chercheur dans une institution publique, et comme je le rappelle à la fin de mon livre, j’ai été au cours de sa rédaction entièrement tributaire d’institutions publiques comme la Bibliothèque Nationale de France, et plus encore la crèche où mon fils était gardé aux heures de travail. Ce que Berlan interprète comme un biais qui pervertit l’enquête est assurément un point de vue : sans doute mon attention au mouvement socialiste tient au fait que je considère l’Etat comme un champ de bataille, comme un réseau institutionnel où se jouent des rapports de forces — des rapports de forces en partie configurés par des relations matérielles et écologiques.
Donc oui, en effet, une partie essentielle de ma pensée est solidaire de l’Etat. Je le dirais en fait autrement : elle est solidaire du mouvement par lequel des collectifs critiques investissent la puissance publique, c’est-à-dire essentiellement le droit, dans sa capacité à modeler l’expérience collective dans le sens de la justice. Ce mouvement est par définition tributaire des institutions telles qu’elles existent, avec leurs imperfections et les intérêts qui s’y trouvent objectivés. Mais en toute honnêteté je peine à saisir comment un mouvement social peut prendre racine dans l’histoire sans en passer par cette dynamique.
Donc ce que l’auteur qualifie comme une position de surplomb désincarnée, « au-dessus de la mêlée », est en réalité une position d’implication directe dans les structures du commun institué, d’abord à travers l’enseignement et la recherche (c’est-à-dire que je rends des comptes à des personnes réelles, à des pairs, contrairement à ce qu’il imagine), et ensuite, dans un second temps, à travers la participation au débat sur les transformations sociales. Et je voudrais dire cela de façon très nette : il est absolument aberrant de dénoncer comme abstraite et déconnectée des pratiques une élaboration intellectuelle qui se fait en lien direct avec les normes de véridiction du monde universitaire et avec l’espace public institué. Car la vie dans les institutions universitaires, et plus largement dans les plis de l’Etat et des demandes de justice qu’il organise, ou refuse, n’est pas un point de vue de Sirius. C’est un point de vue, bien entendu, qui comme tel se discute et se critique, mais ce n’est pas une rêverie solitaire — c’est même, à mon sens, la garantie que les idées qui se développent sont tenues par une longue chaîne de dépendances, d’épreuves, de vérifications, et d’expériences partageables.

Je passe plus brièvement sur la rhétorique un peu usée de la « tour d’ivoire », d’autant plus usée que l’on connaît l’état de délabrement qu’est cette tour d’ivoire de l’université en France. Je travaille dans un laboratoire de l’EHESS avec une enveloppe de recherche de 1200 euros par an à peu près, je vis dans mon appartement de Seine-Saint-Denis avec mon épouse, elle aussi fonctionnaire, et mes enfants. En termes socio-économiques, nous sommes dans les 20% supérieurs des revenus français (d’après les données de l’INSEE), ce qui est en effet une situation extrêmement enviable, mais qui ne donne pas comme telle accès à un pouvoir réel sur la marche de l’économie et des institutions publiques. Disons qu’elle oblige à une certaine reconnaissance à l’égard du collectif qui rend possible ce genre de vie, et pour moi cette reconnaissance prend la forme d’une contribution qui potentiellement vaut pour tous et toutes, et pas pour une caste d’élus aux prises avec des luttes mystérieusement auto-désignées comme vraies.
Maintenant le problème posé par l’article de Berlan peut être posé en termes simples : ma situation socio-économique est-elle en elle-même un obstacle à ma participation à tout mouvement de reconstruction écologique, car elle serait déjà trop privilégiée pour avoir une vue saine et représentative des attentes sociales ? La petite bourgeoisie intellectuelle (car il s’agit de cela) dont je fais partie est-elle à jamais complice du ravage écologique, en raison de sa cooptation par un Etat complice de ce ravage ?
C’était pas ma guerre

Toutes ces questions méritent d’être posées. Elles méritent d’ailleurs de l’être frontalement, et à un niveau collectif, plutôt que sous la forme d’insinuations ad hominem. On peut en effet poser la question de la légitimité d’une classe d’intellectuels au service de l’Etat — et d’ailleurs la question est posée très concrètement par le gouvernement actuel qui semble faire son possible pour que cette classe disparaisse, ou pour qu’elle soit subordonnée à des principes autoritaires étrangers à l’enquête scientifique. Le problème est que si l’on suit cette pente, celle d’une confrontation entre être dans l’Etat et être hors de l’Etat, il faudra accuser de la même trahison les millions, dizaines de millions, de personnes insérées dans les mécanismes redistributifs qui assurent leur emploi, leur santé, leur retraite, les personnes encore plus nombreuses qui sont prises dans les infrastructures de transport et d’éducation, et pour lesquelles la question de la justice et de la solidarité se pose en lien avec l’Etat. L’hypothèse de la sortie de ce cadre institutionnel, pour séduisante qu’elle soit, demeure une hypothèse en partie idéaliste et, je me permets de le signaler, qui témoigne d’une autre forme de privilège. Celui que n’ont pas, par exemple, les personnes qui vivent dans le parc locatif public et réglementé, souvent les plus pauvres et les plus rançonnées par un système économique inefficace et destructeur : auront-elles droit à accéder à des infrastructures urbaines sobres et bon marché, à une alimentation de qualité, à des filières professionnelles en phase avec la réinvention de notre univers matériel, à du temps libre, ou doivent-elles simplement être dénoncées avec moi comme complices de l’Etat destructeur parce que leurs demandes ne peuvent se concrétiser hors de ce cadre ? Berlan m’oppose des expériences « d’en bas », mais à cela je réponds que ce qui vient « d’en bas » ne vient pas nécessairement (et pas majoritairement) d’espaces en rupture avec l’Etat.
La question se pose, car les attentes de ces groupes sociaux ne sont en réalité pas si différentes de celles que l’on peut trouver sur les ZAD ou dans les espaces d’autonomie productive locale. Elles consistent à élaborer une architecture juridique et technique radicalement divergente de la forme marchande universelle pour coordonner et mettre en œuvre une sortie du régime d’accumulation actuel. A moins de considérer les luttes menées dans les ZAD comme des entreprises marquées par une forme de dandysme romantique et sécessionniste, ce qui n’est pas le cas, il faut bien les envisager elles aussi comme des projets qui s’adressent à l’Etat. Ces entreprises n’ont pas vocation à rétablir la justice pour un petit nombre d’individus (leurs participants directs) au détriment des autres, mais d’expérimenter des modèles d’action collective généralisables, de dire à la puissance publique combien elle est irresponsable et inefficace lorsqu’elle souhaite neutraliser des terres de biodiversité et d’agriculture pour un grand projet obsolète.
C’était le sens du dernier chapitre d’Abondance et liberté, à côté duquel est passé Berlan. Contrairement au mouvement ouvrier qui comme son nom l’indique est porté par un groupe social identifiable, le mouvement écologique prend plutôt la forme d’une alliance de groupes sociaux hétérogènes, alliance irréductible à des critères de classe, de profession, de niveau d’éducation, ou de situation géographique, et que l’on ne peut donc pas adosser à un seul type de pratiques ou à un seul type de lexique théorico-militant. A moins de tomber dans une position paranoïaque qui verrait des ennemis et des traîtres partout, dans les ONG, dans les organismes publics, dans les syndicats, dans les entreprises (mêmes petites), dans les partis, dans les universités, chez les ingénieurs, cela au nom d’une vérité prédéfinie et fatalement réservée à une minorité, il faut inévitablement jouer le jeu de ces alliances sociales. Autrement dit, il faut faire passer le clivage essentiel ailleurs, surtout pas entre une volonté d’institution des contre-mouvements à une échelle étatique (voire supra-étatique, car Berlan ne se doute pas que je suis pire qu’un étatiste : je suis européiste !) et une volonté de réinitialisation totale des formes collectives dans le local. Il faut le faire passer à l’intérieur de chacun de ces organisations publiques et privées, à l’intérieur de chacun d’entre nous, même, pour le rendre effectif.
J’avais proposé dans un autre texte une esquisse de ces alliances, en prévoyant d’ailleurs le scénario avancé par Berlan, celui d’une guerre interne entre les différents segments de cette alliance en raison d’inimitiés culturelles. Je voudrais donc, pour conclure, inviter à la paix. Non pas une paix de façade où chacun tolère l’autre par mépris ou désintérêt, mais une paix dynamique, où chaque protagoniste identifie chez l’autre ce qui lui manque pour vaincre l’ennemi véritable — celui dont malheureusement ces débats nous détournent. Ce qui est désarmant dans cette lutte, c’est que l’absentéisme des puissants lorsqu’il est question de défi climatique, de préservation du vivant, d’élaboration d’un modèle économique qui rendrait compatibles les attentes de justice sociale et les limites planétaires, toutes ces défaillances ne les disqualifient pas mécaniquement. Dans le cadre des démocraties libérales de masse, le modèle de développement dont nous essayons de sortir semble perpétuellement consolidé, voire acclamé par une partie conséquente de la population qui pourtant est exposée à ses crises. Là où nous voyons une crise de légitimité totale et irréversible, bon nombre de citoyens voient des crises passagères, qui nécessitent des réaménagements marginaux, voire estiment qu’il y a plus à perdre qu’à gagner dans la bifurcation écologique. Là encore, à moins de n’avoir à leur adresser que notre mépris et à leur dire « bye bye, je reconstruis ailleurs », il faut bien trouver les mots pour les recruter. Et avant de trouver ces mots-là, qui ne relèvent pas du travail de la philosophie, peut-être n’est-il pas totalement inutile de reconstituer le champ de la théorie politique.