Un point de prudence avant de commencer…
La pandémie de Covid-19 et sa gestion, à la croisée des sciences et de la politique, ont suscité des débats nombreux, parfois violents. Nous connaissons tou·tes des groupes, des familles, des collectifs qui ont été déchirés par ces désaccords, aboutissant à une fragmentation toujours plus nette du tissu social en France. Tout cela est la conséquence directe de la politique d’un gouvernement qui fabrique le séparatisme comme l’envers stratégique du consentement, rendant encore plus difficile toute tentative de penser la situation autrement que sur le mode du clash.
Au sein du collectif de rédaction de Terrestres, ces désaccords existent aussi et ils ont donné lieu à des discussions parfois vives entre nous. Pour autant, nous avons toujours tenté de faire vivre ces dissensus, en les envisageant non pas comme des motifs de scission, mais plutôt comme les signes d’une vie intellectuelle et démocratique intense, dont nous essayons aussi de témoigner dans nos colonnes.
Revendiquer la fécondité de ces dissensus pour mieux faire émerger une description juste et plurielle de la situation contemporaine, voilà aussi le signe d’un attachement à ce qu’Isabelle Stengers appelle l’irréduction, c’est-à-dire la méfiance à l’égard de toutes les thèses qui impliquent, plus ou moins explicitement, « le passage de “ ceci est cela ” à “ ceci n’est que cela ” ou “ est seulement cela1 ” ».
Tenir ainsi à l’irréduction contre la réduction d’une situation à une explication définitive, c’est aussi résister à tout ce qui cherche à se draper dans la pureté de l’évidence, c’est-à-dire d’une vérité dévoilée. Ainsi, examiner la manière dont une thèse peut en faire balbutier une autre, la compléter, l’infléchir ou en renforcer la pertinence, voilà une toute autre affaire que de chercher une thèse officielle ou alternative qui révèlerait enfin le vrai d’une situation — et de préférence tout le vrai.
C’est pour ces raisons que nous avons collectivement décidé de continuer à publier une variété de textes sur la situation pandémique. Des textes qui ne reflètent pas forcément le point de vue de l’ensemble des membres du collectif de rédaction. Des textes avec lesquels certain·es d’entre nous sont même parfois en franc désaccord. Mais des textes qui nous semblent à même, par leur diversité et les rencontres qui en procèdent, d’esquisser ensemble un tableau analytique de la situation pandémique et politique.
La tâche n’est pas facile, mais nous essayons de faire de notre mieux, en respectant la temporalité qui est celle de la revue : celle du recul et de la réflexion, plutôt que celle de la réaction et de la polémique. Aussi, n’hésitez pas à nous suggérer des textes qui pourraient contribuer à ce travail lent et patient de description et d’éclairage du présent.
Bonnes lectures dans les méandres !
Le collectif de rédaction de Terrestres
Deux critiques
Les mesures prises par le gouvernement Macron ne suscitent pas l’unanimité. Le problème est que les critiques qui les visent semblent incompatibles entre elles. D’un côté, on constate avec effarement l’extraordinaire rétrécissement des libertés qui se produit au nom de la gestion de la crise. Se rassembler pour manifester, bien sûr, mais aussi prendre un café en ville, aller voir les amis ou même sortir de chez soi : autant de gestes désormais interdits (ou du moins soumis à l’approbation de la police), dont on n’aurait pu imaginer il y a tout juste huit mois qu’ils puissent l’être un jour dans nos « démocraties libérales ».
De l’autre côté, on insiste sur l’échec de la gestion de la crise sanitaire en tant que telle. Le risque d’un effondrement de l’hôpital est notamment souligné par le personnel soignant depuis plusieurs semaines, et pourtant aucune mesure permettant de contrer efficacement l’épidémie n’a été prise à temps – car c’est en septembre, lorsque l’épidémie reprenait à bas bruit, qu’il aurait fallu réagir. Les hésitations, atermoiements et incohérences des gouvernants mettent donc en danger la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Alors quelle est la position juste : s’agit-il de dire que le confinement est une mesure liberticide, que le port du masque devrait être laissé à la libre initiative de chacun et que l’attention dont chacun est capable pour ses proches et pour les autres doit suffire à éviter une catastrophe ? Ou bien au contraire faut-il dire que le confinement devrait être plus conséquent, qu’il faudrait stopper la majeure partie des activités sur les lieux de travail et dans les écoles, et prévoir plusieurs mois de consommation réduite au strict nécessaire ? Peut-être n’est-ce pas la bonne alternative. Du moins, peut-être que l’alternative, formulée ainsi, rate quelque chose d’essentiel.
Il faut peut-être repartir de ce qu’indiquent les critiques formulées à l’encontre du gouvernement. On peut considérer que chacune a sa pertinence : non seulement il y a une incohérence manifeste dans les choix du gouvernement, mais ceux-ci ne peuvent se défendre ni du point de vue d’une stricte logique sanitaire, ni du point de vue des conséquences sur la vie sociale et politique. Que des points de vue critiques apparemment contradictoires puissent être également pertinents, cela veut dire deux choses : premièrement, qu’ils cernent bien les contradictions dans lesquelles s’empêtrent les dirigeants ; deuxièmement, à l’inverse : ce qui semblait contradictoire du côté des critiques peut en réalité se révéler tout à fait cohérent. Comment dégager cette cohérence ? Avec les mesures adoptées récemment par l’État français, la réponse à cette question a sans doute été clarifiée.
L’économie et ses lois
On pourrait dire que le gouvernement a fait deux fois le choix du pire. D’une part en maintenant le fonctionnement de ce que Santé Publique France identifie depuis longtemps comme les deux principaux foyers de diffusion de l’épidémie, à savoir l’école et les lieux de travail. D’autre part en empêchant que les gens puissent faire autre chose que se rendre à leur lieu de travail ou rester chez eux. Le temps passé chez soi est d’ailleurs bien souvent lui-même voué au travail : on assiste bien aujourd’hui à la généralisation du « télétravail » qui nous était promise depuis longtemps, avec tous les effets pervers que l’on peut imaginer, notamment en termes d’allongement du temps de travail réel.
On pourrait se dire que les gouvernants font une double erreur, et s’étonner qu’ils persistent à ce point dans des gestes qui réussissent à être à la fois anti-démocratiques et inefficaces. Mais ce serait faire semblant de ne pas connaître la logique qu’ils défendent. L’important, pour le gouvernement, est de faire en sorte que l’économie ne s’effondre pas. Pour cela, on peut bien exposer des vies, en les entassant dans des transports bondés, ou dans des espaces dans lesquels les mesures sanitaires dites indispensables ne pourront pas être appliquées – pensons aussi aux espaces scolaires, qui ne sont ouverts que pour permettre aux parents de se rendre à leur travail. Mais on peut bien aussi sacrifier la liberté ; et par là il faut entendre bien sûr les libertés juridiques mais aussi la liberté politique de se regrouper, d’occuper la rue, et d’organiser des actions.
Bien des voix se sont élevées au début du premier confinement pour dire que la crise sanitaire actuelle entraînait la mise en question de notre modèle de société. Un modèle qui repose sur le caractère intangible, bien que profondément embrouillé, des « lois » de l’économie. Les économistes prendront sans doute un peu de temps pour nous expliquer à nouveau gentiment pourquoi les milliards de Jeff Bezos, de Steve Jobs ou de Bernard Arnault ne peuvent être utilisés pour empêcher un désastre social. Mais cette explication suppose elle-même que nous soyons internes à la logique économique, et qu’il ne soit pas question d’en sortir. Or tout le problème est là : ne s’agit-il pas de cesser de faire peser sur nous les lois de l’économie comme ont pu peser pendant des siècles des lois religieuses et morales que la plupart d’entre nous s’accordent aujourd’hui à juger arbitraires ? Peut-être que la crise que nous sommes en train de vivre ne peut être décemment surmontée qu’à la condition d’abandonner la logique que nos gouvernants continuent à défendre comme la seule voie qui puisse être suivie. Ou plus simplement : peut-être la crise ne peut-elle être surmontée qu’en abandonnant la logique qui l’a produite. Une logique qui est à la fois directement responsable de l’apparition du virus, par le biais de la réduction des territoires de la faune sauvage, et de l’impossibilité d’y faire face, en raison des transformations subies par les structures hospitalières sous les gouvernements acquis aux dogmes néolibéraux.
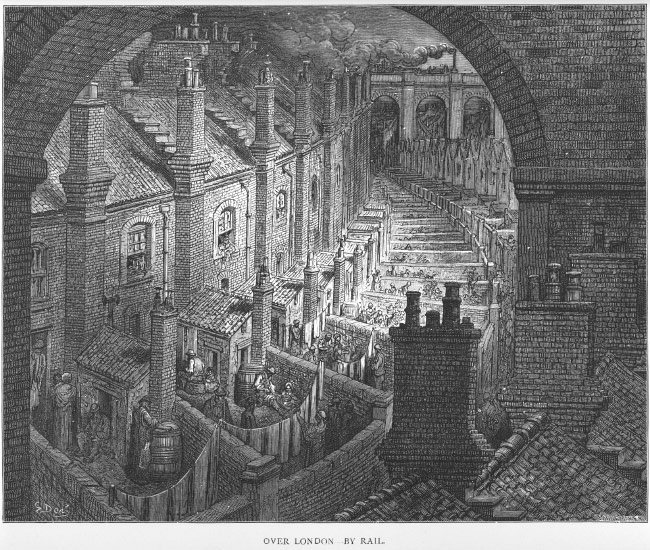
Le travail et sa valeur
Il ne suffit pas de dire que notre modèle de société repose sur la fausse nécessité des lois l’économie. Il faut préciser ce que ces fausses lois imposent avant tout, à savoir : la mise au travail de tous. Aujourd’hui, la nécessité portée par les membres du gouvernement Macron est avant tout celle-là : il faut renvoyer les gens au travail. Il ne faut pas qu’ils se déshabituent du travail ; il ne faut pas qu’ils mettent en question la valeur-travail, le seul ciment social qui soit parfaitement ajusté à la vision capitaliste du monde. La classe des capitalistes, dont les membres du gouvernement Macron sont des militants en tout point exemplaires, organise la mise au travail des autres – de tous les autres, y compris ceux qui ne sont pas humains, et même si leur activité n’est bien sûr pas reconnue comme travail. Elle organise le travail, là encore, selon une certaine logique, qui est celle l’intensification de sa productivité.
Cette obsession de la productivité du travail est notamment ce qui a conduit il y a quelques années Jean Castex, alors directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, à concevoir le plan hôpital 2007, par lequel la logique de la rentabilité s’est introduite dans les structures hospitalières. L’actuelle ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a pour sa part travaillé à entériner cet état de choses avec la Loi portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, du 21 juillet 2009. Les principaux responsables directs de l’état de délabrement dans lequel sont plongés les hôpitaux, qui sont donc aussi les responsables de la catastrophe sanitaire en cours, se trouvent donc aujourd’hui à la tête du gouvernement.
La bêtise et le cynisme d’un Macron, par ailleurs indubitables, ne suffisent pourtant pas à expliquer le geste de nommer ces personnes dans le nouveau gouvernement. Il faut voir dans cette nomination un geste politique. Un geste qui peut se traduire ainsi : « nous assumons pleinement la logique de rentabilité imposée dans les institutions de soin. Nous allons défendre cette logique quel qu’en soit le coût en termes politiques, et quel que soit le nombre de vies qu’il faudra sacrifier ». Nul étonnement dès lors à ce que la politique initiée par les membres du gouvernement Macron se soit poursuivie tout au long de l’été, alors même que le ministre de la santé promettait des milliers de lits de réanimation supplémentaires. À Besançon, à Rouen, à Lyon, à Nancy, à Nantes, les suppressions de places d’hospitalisation se sont poursuivies cet été, ou sont promises à se poursuivre dans les mois qui viennent.
Le caractère proprement criminel de cette politique devrait sauter aux yeux même de ceux qui ont la chance de ne pas être aujourd’hui les usagers des institutions de soin. Mais ce caractère criminel n’est pas attaché à la seule gestion de la crise. Il se révèle aussi lorsque les États se refusent à prendre des mesures à la hauteur des enjeux du changement climatique, et laissent aux pays les plus pauvres et aux générations futures le soin de prendre en charge les effets proprement meurtriers du désastre en cours, qui pourtant pourrait encore être combattu. Il se révèle encore lorsque la police humilie, mutile ou tue des manifestants, soutenus par les mafieux qui se succèdent au poste de ministre de l’intérieur.
Un article récent de Frédéric Lordon était intitulé « Ces criminels qui nous gouvernent ». On ne soulignera jamais assez le fait que la notion de « crime », ici, est aujourd’hui moins que jamais une métaphore. Elle indique de façon très exacte l’opération politique qui est en cours : pour sauver la logique de la rentabilité, la logique de la valorisation du capital, les gouvernants sacrifient à la fois les libertés et les vies. La mise au travail pour sauver l’économie est un crime politique, et un crime tout court. Elle est la raison de la catastrophe sanitaire, la raison du ravage écologique, et la raison qui permet de livrer chaque jour davantage la population au pouvoir policier. Les gouvernants qui en sont responsables devraient donc être considérés comme des criminels, et traités comme tels.
Qui pourrait encore s’étonner que les gens ordinaires – déchus de leurs droits, exposés à la mort par un virus (ou à se faire porteurs de maladies graves pour leurs proches), et plus largement par les effets de la dégradation des milieux naturels, exposés aussi à l’arbitraire policier – en viennent à haïr ces criminels ? Tout le problème est de savoir comment cette haine pourra trouver sa forme d’expression collective.
Peut-être quelques lycéens courageux, et ce ne serait pas la première fois, sont-ils en train de commencer à inventer cette forme. Il s’agirait pour tous les autres d’être capables de les suivre. Ce qui veut dire : se rendre capables de défendre à la fois la vie et la liberté politique, contre les impératifs de l’économie et sa morale du travail.








