Dans le contexte du post-confinement, les grandes entreprises, la finance, se posent des questions. Par exemple : « On nous a demandé d’assurer la performance financière, comment on fait maintenant pour assurer la performance écologique, économique, et sociale ? »
Isabelle Delannoy1
Quand on parle d’agir pour le vivant, on devrait commencer par prendre conscience de qui agit contre le vivant.
Une personne dans le public, le même jour2
Le jeudi 27 août, dans le cadre du festival « Agir pour le vivant » lancé à Arles par les éditions Actes Sud, différents théoricien·nes, acteurs et actrices économiques participaient à des débats sur le thème de la « régénération » de l’économie et des écosystèmes3. Outre des consultant·es et des essayistes, les invité·es comprenaient ce jour-là des cadres et dirigeant·es de grandes entreprises telles que RTE, la Compagnie du Rhône ou le groupe La Poste4. Nous voudrions donner ici un aperçu de ces échanges. Bien qu’étant concentré principalement (mais pas uniquement) sur une journée de tables-rondes, le compte-rendu suivant n’en souligne pas moins certaines façons significatives d’appréhender les problèmes écologiques, dans l’ensemble de ce festival et au-delà.
Voyons comment sont abordés ici les rapports entre économie et écologie (ou leur indistinction, que le mot-valise « écolonomie »5 suggère sans détour). Voyons aussi comment un panel de « solutions » est évoqué et laissé ouvert, qui satisfait l’ensemble des acteurs et actrices présent·es. On prêtera attention, en particulier, aux éléments de langage qui favorisent une dépolitisation et une transfiguration des enjeux écologiques : celles-ci aboutissent à un degré déconcertant de greenwashing, à la poursuite de la marche ordinaire du monde des affaires (ou business as usual), et enfin au contraire de l’objectif affiché, qui est de mettre un terme au ravage du vivant.
Un présupposé : une « économie globale », qui dépasse toutes les contradictions habituelles
La journée débute avec la lecture de l’« Appel d’Arles » par une de ses rédactrices. Ce manifeste, autrement nommé Appel des régénérateurs, commence par lister des dimensions de la crise écologique et de la « crise de sens » qui l’accompagnerait : extraction et épuisement des ressources, pollution, réchauffement climatique, explosion des inégalités, déshumanisation des rapports. Ces nuisances sont attribuées à l’économie dominante et à une « vision » bien emblématisée par le discours d’investiture du président Truman en janvier 1949, où il détaille son fameux programme du « développement ».
L’Appel d’Arles annonce la résolution possible de tous ces problèmes dans l’avènement d’une « nouvelle économie globale et complète » : c’est l’« économie régénérative » (qui donne son titre à la journée entière de discussions). Lorsque cette économie est évoquée, c’est avant tout par l’intermédiaire des vertus qu’on lui prête, dont celle de dépasser les contradictions ordinaires. Ainsi, elle permettrait l’avènement « [d’] un monde où parce que nous produisons, nous régénérons nos sols, nos paysages, nos économies et nos emplois ». Cette économie régénérative « concilie deux choses qui nous semblaient contradictoires : le respect et l’amour que nous portons au vivant et notre volonté d’avancer et de faire grandir ce monde pour le bien de tous »6.
Malgré ces propriétés peu banales, l’économie régénérative ne fait pas l’objet d’une définition précise. Le plus souvent, elle est juxtaposée à des notions aussi peu circonscrites : croissance verte, relance verte ou « transition » – un autre exemple de signifiant flottant. Au fil de la journée, l’économie régénérative est tour-à-tour associée à l’économie sociale et solidaire, à la finance verte, à la valorisation ou au ré-usage des déchets, à l’agriculture biologique artisanale et industrielle, aux entreprises « engagées dans la transition », à la production industrielle d’énergie éolienne et photovoltaïque, à des groupes comme Danone qui recourent à des labels pour conformer leur fonctionnement à des normes environnementales7, aux classes sociales « créatives »8… Ou encore, à un grand patron qui dit puiser de « l’énergie régénératrice » grâce à une démarche de transformation individuelle, et grâce à des méthodes de management inspirées du fonctionnement d’un peuple amérindien9. Si certain·es conférencier·es distinguent parfois l’économie régénérative de l’économie extractive dominante, ou du capitalisme financier, cela n’empêche pas un dirigeant de La Poste de s’en revendiquer à l’occasion, tout en assumant que son entreprise soit actionnaire du groupe Total. Au final, l’économie régénérative rassemblerait tantôt « des milliers », tantôt « des millions » d’acteurs disparates :
« ils sont agriculteurs, énergéticiens, fabricants de smartphones et d’ordinateurs, d’automobiles, ils sont commerçants, ils sont maires, ils sont publicitaires, ils sont financiers »10.
Parallèlement à ces définitions floues, certains exemples considérés comme représentatifs de l’économie régénérative bénéficient d’une exposition intense pendant le festival. Une entreprise de production d’enveloppes biodégradables, déjà présentée dans le film Demain et dans le livre du même nom paru aux éditions Actes Sud, envoie des représentant·es dans deux tables-rondes différentes, avec en prime un clip promotionnel. En plus d’avoir redressé leur activité tout en n’utilisant que des matériaux étiquetés renouvelables, les dirigeant·es de cette PME auraient créé un environnement de travail privilégié. La « responsable développement » de cette entreprise (Pocheco) témoigne ainsi :
« J’ai la chance de travailler aux côtés d’Emmanuel Druon, qui est le propriétaire de l’entreprise (…). Son rôle c’est (…) de nous aider à libérer la pensée, et à être bien ensemble (…). Si le travail est une source d’épanouissement, (…), permet d’avoir une action positive sur l’environnement (…), est-ce qu’il faut toujours continuer à scinder le temps passé au travail, l’emploi, et le temps personnel ? »11
De son côté, le dirigeant de l’entreprise affirme : « Si ça marche pour nous, ça peut marcher pour tous »12. Sans même examiner si ce raisonnement est valable, on peut remarquer ici que le flottement des définitions et des critères joue son rôle. Un cadre dirigeant de La Poste, tout en se réclamant des mêmes principes que Pocheco, affirmera quant à lui que c’est bien la disparition du courrier (et donc des enveloppes, biodégradables ou pas) que son entreprise doit chercher à accompagner : la transition numérique figurant ici une priorité, au même titre que les transitions « écologique » et « énergétique ».
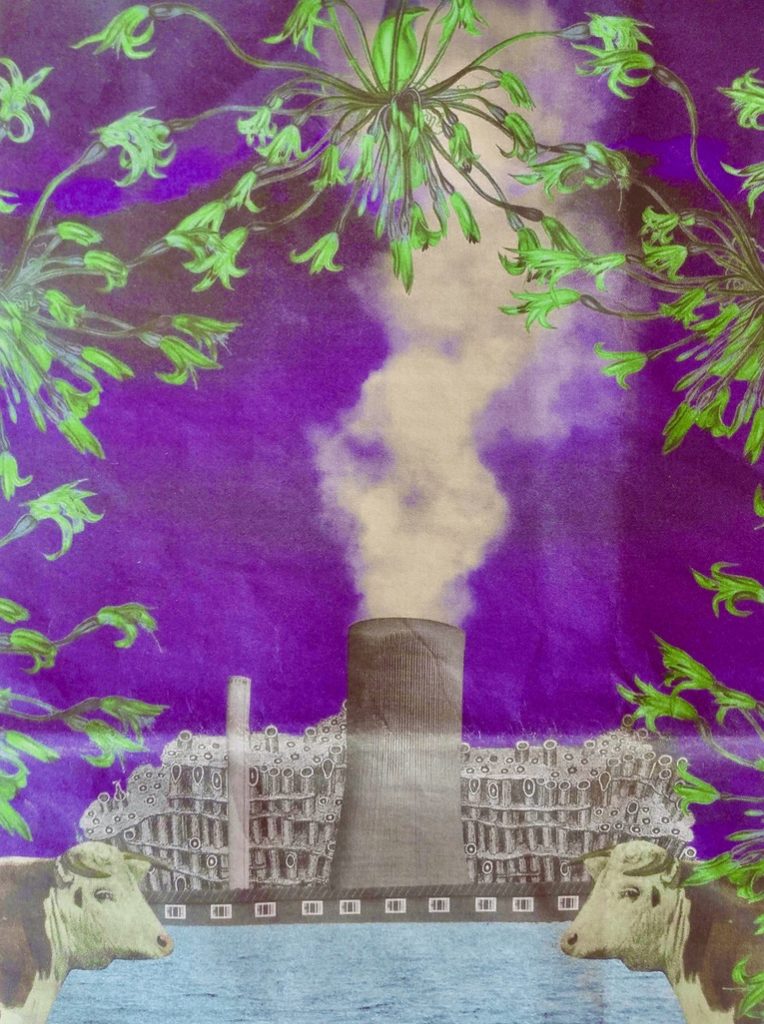
Un nouvel imaginaire, pour perpétuer la croissance économique
On peut se demander si, à un certain point, l’absence de toute définition concrète ou réaliste n’est pas en partie volontaire. Lorsque la journaliste chargée de la modération des débats demande à une promotrice de l’économie régénérative : « Aurélie Piet, faisons d’abord un petit retour dans le passé, comment sommes-nous arrivés à ce modèle économique qui ne prend pas en compte les limites planétaires ? », celle-ci esquive la demande :
« Peut-être, avant de répondre à ta question, redéfinir ce qu’on entend par économie régénérative. L’économie régénérative est celle qui met véritablement en avant l’homme et la nature… »13
Et elle ne donnera des éléments de réponse à la question de la journaliste que bien plus tard, en avançant quelques généralités sur le rôle de « la modernité » et de ses « valeurs ». L’important est bien pour elle de poser, en pétition de principe, la nouveauté de l’économie régénérative et ses vertus. D’ailleurs, elle précise juste après :
« Et j’ai envie de dire qu’au-delà d’être un nouveau modèle, [l’économie régénérative] est véritablement un nouveau paradigme. (…) Une nouvelle définition de l’économie. »
Un paradigme, donc – et non un modèle, d’après lequel il serait possible d’éprouver la réalité. S’il s’agit de retrouver du sens, de renouveler l’adhésion des acteurs économiques (les entrepreneur·es et les cadres en particulier) que l’« ancienne définition » de l’économie ne provoquait plus, il n’est guère utile en effet de cadrer davantage les débats.
D’autres caractéristiques des interventions permettent de résoudre à bon compte les contradictions que l’on repère habituellement entre les exigences de l’écologie et celles de l’économie. Ainsi, la propension à attribuer les dommages causés par le capitalisme à des dysfonctionnements ou à une dénaturation de celui-ci, par rapport à ce que serait sa « vraie » essence. C’est ce qu’on voit avec Guibert del Marmol, ancien dirigeant et cadre de différents groupes (Walibi, Sodexo…) qui est aujourd’hui consultant en « économie régénérative » auprès de grands patrons notamment14. Pendant une table-ronde de l’après-midi, il dénonce :
« il y a beaucoup de fausses croyances et de faux dogmes dans le monde de l’entreprise. La croissance en est un. (…) La vraie raison d’être de l’entreprise, c’est la création d’abondance partagée dans le respect de l’humain et de l’environnement. »15
Plutôt que d’analyser et éventuellement de mettre en cause le fonctionnement du système économique, il s’agirait ici de retrouver une vérité du capitalisme, au moyen de nouvelles idées et de nouveaux marchés. Dans son intervention, Guibert del Marmol fait la liste des ingrédients qui permettraient aux dirigeants d’entreprise de « contribuer au bien commun » en allant « bien au-delà de la croissance ». Florilège des mots d’ordre : « développer une vraie vision » ; « mettre en place des systèmes organisationnels symbiotiques qui s’inspirent du vivant » ; développer un comportement « holistique » (au motif qu’« on est tous managers de quelque chose ») ; compléter le quotient intellectuel « garanti par l’université » par le développement d’un « quotient émotionnel » (censé permettre « d’interagir ») et d’un « quotient systémique » (pour « comprendre la systémique »). Et, dernièrement, d’un « quotient spirituel » (précision : « ça n’a rien à voir avec la religion, c’est le sens et la valeur, c’est pourquoi on est ensemble, et à quoi on contribue »). Pour finir, il faudrait « changer les indicateurs de performance »16.
Cette intervention réunit certains des principaux leitmotivs de l’avant-garde patronale des dernières années : la représentation du dirigeant en performeur, une sorte de super-sportif aux capacités augmentées, et la légitimation du rôle de l’entreprise par des objectifs de « performance globale » ou de contribution au « bien commun »17. La présence de ces thématiques dans le festival d’Arles rappelle que la médiatisation de la crise écologique est aussi une opportunité, pour des membres du patronat rénovateur, de véhiculer des mots d’ordre mûris depuis des décennies. Le grand récit et les ambitions étaient déjà là – puisque l’intégration des critiques et le dépassement des antagonismes sociaux constituent des préoccupations constantes et anciennes des organisations patronales. L’innovation (relative) consiste à intégrer ici la variable « environnementale » à une rhétorique déjà largement en place.
Pour aller « bien au-delà de la croissance », ces entreprises sont invitées à recourir de façon accrue aux outils ordinaires de la quantification et de l’appropriation : « quotient émotionnel », « quotient spirituel » – ou ailleurs, « capital naturel »… Des mots qui traduisent la poursuite, tout à fait réelle, de la compétition capitaliste pour accumuler des profits. Laquelle reste associée in fine, d’une façon ou d’une autre, à la continuation des processus d’émission de CO², d’extraction de ressources et de privatisation de biens communs.

D’autres propos, puisés à différents moments de la journée, manifestent aussi bien ces objectifs de croissance et de puissance économiques :
« Nous devons devenir l’économie dominante » (L’Appel d’Arles).
« Cette économie se fonde sur la notion de croissance, qui n’est pas un gros mot ici. (…) Ce qu’on défend ici, ce n’est pas moins de croissance, mais c’est surtout une croissance qualitative » (Aurélie Piet)8.
« Il y a un problème culturel. Et là j’ai une question pour vous [la coopérative financière Nef] : c’est pourquoi vous n’êtes pas plus gros ? (…) Les fonds d’investissement, les sociétés de gestion gèrent des milliards, ou des millions ; et les économies régénérateurs [sic] ils ne sont pas à ces échelles. Donc on a une sorte de gros embout, comme un gros tuyau d’arrosage, alors que la plate-bande elle a plein de petites plantes – des grosses plantes, des petites – et qu’on a pas le pommeau d’arrosoir pour pouvoir irriguer correctement cet écosystème » (Isabelle Delannoy)18.
« L’investissement dans le capital naturel en est à ses balbutiements. Il faut accélérer, il faut passer à l’échelle. (…) Jusqu’au financement massif par le marché » (Philippe Zaouati)19.
Ces invitations constituent au final autant d’appels au « développement » – une « croyance occidentale » bel et bien maintenue ici20. Malgré la critique du discours de Truman sur le développement placée au début de l’Appel d’Arles, les régénérateurs proclameront à la fin de celui-ci :
« Dans cette époque si sombre, il y a un phare. Ce phare, c’est le monde des régénérateurs. Notre temps, le temps des régénérateurs, est venu »21.
Comme l’écrivent ailleurs les philosophes Isabelle Stengers et Philippe Pignarre :
« Nous avons (…) l’habitude de déplorer les méfaits de la colonisation, et les aveux de culpabilité sont devenus routiniers. Mais ils nous manque l’effroi devant cette idée que non seulement nous nous sommes pris pour la tête pensante de l’humanité, mais nous ne ne cessons de continuer à le faire. (…) L’effroi commence quand nous nous rendons compte que, malgré notre tolérance, notre culpabilité, nos remords, nous n’avons pas tellement changé »22.
Un coup de force : l’économie fondue dans l’écosystème
Certains éléments de langage récurrents au milieu des débats méritent ici un examen plus approfondi. La notion de « développement » est déjà en-elle même une métaphore biologique à visée normative, dont l’usage remonte loin dans la métaphysique occidentale23. C’est cette pensée développementaliste qui sous-tend les représentations des conférencier·es :
« Un vivant d’abord développe sa masse, c’est très énergivore, ça prend du temps. Un bourgeon vous le voyez pas, il développe tous ses organes (…). Et puis au bout d’un temps, il y a un signal hormornal, et flop ! (…) Je crois que notre économie c’est ce qu’elle a fait depuis 50 ans, l’économie des régénérateurs. (…) On s’est développés dans nos principes, on a occupé le terrain, et on attend la venue du printemps, le signal hormonal. Pour moi le Covid est un signal hormonal [rires]. Et si l’eau nous arrive, c’est-à-dire la finance – l’appel d’Arles est aussi signé d’experts de la finance (…) – là, ça compose une économie régénératrice du vivant, du social, des écosystèmes. (…) Maintenant, on doit faire écosystème. »24
Il n’est pas rare de voir des intervenant·s invoquer les « lois de la nature »25. L’économie régénérative serait ainsi « une économie qui s’inspire de la nature, qui est conforme aux lois de la nature »8. Le consultant Guibert del Marmol s’en réclame aussi, et voudrait appliquer la « permaculture » à l’économie :
« C’est de la perma-économie. C’est pas une vision idéologique, c’est simplement du bon sens, c’est l’observation des lois de la nature.»26
Dans le même ordre d’idées, on rencontrera « la philosophie de la permaculture appliquée à l’agriculture, appliquée à l’urbanisme. »27 Ou bien, la banque « éthique » comme activité consistant à « prendre soin de l’argent, comme l’agriculteur bio prend soin de ses légumes pour les donner à manger »28. Ou encore, le biomimétisme comme « méthode pour extraire l’information du monde vivant, s’en inspirer pour la sphère technologique, pour des sphères de production, d’organisation, la conception de politiques publiques »29. Un ensemble de discours et de pratiques se trouvent ainsi légitimées par la référence au vivant, au jardinage et aux sciences naturelles.
La « science » économique retrouve ici une vieille lubie : être fondée en nature. Il est vrai qu’Adam Smith ne promettait que La Richesse des nations, alors qu’on fait miroiter ici, en prime, la richesse des sols et l’abondance biologique. Mais c’est la même « soupe » qui est resservie. L’opportunité d’instaurer un encadrement marginal de l’activité économique par la puissance publique (comme certain·es intervenant·es se hasardent à le suggérer30) ne figure ici, comme il y a quelques siècles, qu’une variante minime par rapport à l’option libérale, dont elle est « consanguine »31.
On résumera la situation en disant que la « soupe primordiale » de la terre32, au capitalocène, est composée des êtres vivants suivants : des humains, des plantes, des bactéries, des espèces sauvages, des entreprises, des actifs financiers… Il s’agit de les préserver et de les faire croître, extinction oblige, dans leurs écosystèmes respectifs. Parmi ceux-ci, les « territoires » que régissent les pouvoirs publics… et même les places boursières (Philippe Zaouati se réfère par exemple à « l’écosystème » que constitue « la place financière de Paris »)33.
Une légitimation des acteurs et actrices en présence
C’est en tant que participant·es à des politiques en faveur du vivant que l’ensemble des acteurs et actrices présent·es se trouvent légitimé·es. La PDG d’un groupe énergétique pourra écrire ainsi, dans le fascicule du festival :
« L’entreprise est le corps social par lequel nous exprimons notre faculté à agir et à construire (…). La simple présence d’une entreprise sur un territoire suffit à le transformer, à lui donner vie. (…) Les entreprises sont la clef de la résolution des enjeux écologiques, sociaux et économiques »34.
Et comme dans les meilleurs discours du MEDEF, les différences sont gommées, les « gros » parlant ici au nom des « petits » (en l’occurrence, des « millions » de PME comptant souvent quelques salariés en France). Dans le même fascicule, c’est aussi le dirigeant d’un groupe financier qui défend sa place :
« La mobilisation du secteur financier est indispensable, autant pour réduire les atteintes à la nature que pour orienter le capital vers des solutions permettant de la préserver »35.
En particulier, le recours à la métaphore de l’écosystème favorise un glissement : celui qui fait passer de situations « de fait » (la présence d’une entreprise dans certains lieux, les activités auxquelles elle se livre) à des arguments fondés « en droit » (la même entreprise en tirerait une légitimité ou une compétence pour agir en faveur du vivant). Le dirigeant de l’entreprise Réseaux de Transport d’Électricité (RTE) déclare ainsi :
« À travers l’infrastructure qu’on opère, l’énergie, on est dans l’ensemble de l’environnement français. Et par conséquent, on a déjà cette forme de connexion avec la nature »36.
Cette position ferait de lui un acteur logique de l’action en faveur de la biodiversité. Un partenaire donc – et non un adversaire, comme inclineraient à le croire les paysan·nes et les écologistes expulsé·es de leurs terres agricoles et traduit·es en justice en Aveyron, qui dénoncent depuis plusieurs années les mensonges de l’énergie « verte », et qui s’opposent aux projets d’éoliennes industrielles, ainsi qu’au monde du « tout électrique », des « réseaux intelligents » et des « objets connectés » que cette entreprise défend. Des objections qui restent valables, sans doute, malgré la « transformation personnelle » que le patron de RTE dit avoir vécue (c’est-à-dire, sa conversion en « dirigeant-militant »)37.
De son côté, la PDG de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) explique son choix d’investir dans des installations photovoltaïques et éoliennes en bordure du fleuve, qui doivent permettre de maintenir un apport continu d’énergie malgré la baisse du débit du Rhône pendant ces dernières années. On peut remarquer que ces investissements ne vont pas dans le sens de la sobriété énergétique, qui aurait pu conduire à accepter une moindre production d’électricité (et à faire un tri entre des besoins prioritaires et d’autres qui le seraient moins, comme on avait sérieusement commencé à l’envisager pendant le confinement). Mais curieusement, pour la dirigeante de l’entreprise, le point de vue « holistique » ou « systémique » n’est plus celui qui compte ici :
« Le métier de la CNR n’est pas de travailler sur la sobriété mais de fournir de l’énergie verte, des entreprises qui travaillent sur la sobriété il y en a »16.
C’est ainsi que des entreprises, mises en cause sous certains rapports pour leur activité destructrice du vivant, peuvent s’attribuer sous un autre rapport une nouvelle mission : agir pour le vivant, gérer la biodiversité… Voire même, « apporter la vie »38. On voit ici combien la thématique de la « connexion » avec la nature, avec la logique du fait accompli qui l’accompagne (dans le genre : « nous y sommes, nous y restons »), constituent « une sorte de piège théorique, économique et politique », comme le fait remarquer le philosophe Frédéric Neyrat. En effet, explique-t-il, « puisque tout est en réseau, relié, interconnecté, alors plus aucune distance n’est possible par rapport au monde dans lequel nous vivons, donc acceptons le monde tel qu’il est »39.
Le monde tel qu’il est : c’est-à-dire, tel qu’il est géré notamment par des groupes comme RTE ou la CNE. Quoique leur place sur cette planète puisse être conquise et maintenue par la force, comme c’est le cas actuellement pour RTE en Aveyron, cette place ne sera pas mise en débat : elle fait partie des prémisses de la discussion. Tout comme l’ambition de ces différent·es acteurs et actrices de mieux connaître les paramètres de fonctionnement de ce « vaisseau spatial particulier »40 que serait la planète Terre, afin de continuer à le diriger.
Conjurer le trouble : une « méthode »
Prenons à présent un peu de recul, pour récapituler les étapes de l’espèce d’opération intellectuelle et politique accomplie durant cette journée de débats (et, plus généralement, dans l’ensemble du festival). Cette opération est bien résumée par l’économiste Aurélie Piet, lorsqu’elle affirme :
« Pour entrer dans ce nouveau paradigme, dans cette économie régénérative, si on veut un changement profond, il faut changer notre vision du monde, il faut changer de valeurs, il faut changer de récits, il nous faut une véritable révolution sociétale. La bonne nouvelle selon moi c’est qu’elle est déjà là. La mauvaise selon moi, c’est que ça met du temps avant de se diffuser. Y’a une véritable révolution, mais ça prend du temps. (…) Une révolution scientifique, technologique, sociétale et culturelle. »24
Face à la « mauvaise nouvelle » que représente la crise écologique, on aura donc, successivement :
- Un « diagnostic », qui porte principalement sur la nécessité de changer de « vision du monde ».
- Le repérage de solutions « déjà là », dont des innovations technologiques, et des valeurs ou des visions du monde en cours de transformation.
- Un appel à accompagner (patiemment, dans le temps) les « transitions » en cours.
1. Diagnostic : une « vision du monde »
À côté de quelques références à l’économie extractive dominante, la responsabilité des crises écologique et civilisationnelle est attribuée principalement à une « vision »41, à un « logiciel de pensée »42, à des éléments de « notre système de pensée »43, parfois à une « représentation de ce qu’est l’humain »44 : en tout état de cause, à une « vision du monde » avant tout. Celle-ci est parfois qualifiée – de « matérialiste, quantitative, scientifique, logique, hyper-rationnelle »8 – ou imputée à « la modernité », quand ce n’est pas à la « crise d’adolescence »45 que l’espèce humaine serait en train de traverser. Dans une version savante de ce diagnostic, on retrouve la priorité donnée à l’analyse philosophique des « structures métaphysiques invisibles »46, ainsi qu’à la résolution « diplomatique » des malentendus qui pourraient résulter des catégories modernes.
Comme un problème avant tout cognitif se règle par des moyens cognitifs, une place centrale est donnée à l’« éducation » : une table-ronde est dédiée par exemple au « rôle de l’école dans la transition ». L’hypothèse centrale d’un déficit de connaissances légitime une idéologie scientiste, qui place ses espoirs dans la diffusion des savoirs issus des sciences du vivant (un biologiste affirme par exemple : « Citoyens, votre société est ce cycliste, hésitant entre maintien et chute : exigez des connaissances pour choisir entre les deux »)47. Enfin, il s’agit bien sûr de construire les indicateurs susceptibles d’« aider » les décideurs politiques et financiers. Comme dit Isabelle Delannoy, au cours de la table-ronde intitulée « Pour une finance de la transition » :
« Le deuxième pilier des équilibres climatiques, qui fait le climat, c’est les écosystèmes vivants. Mais on sait pas bien mesurer et on n’y comprend rien – parce que finalement on commence à comprendre quelque chose à la biodiversité en Occident que depuis les années 70 ».
Heureusement, dans la foulée, le Directeur Général du cabinet de gestion financière Mirova affirme que des indicateurs de mesure de la biodiversité sont en cours de construction avec Axa, Sycomore et le groupe BNP Paribas48.
La compréhension dominante de la crise écologique est donc non matérialiste (les rapports de force réels sont évacués, au profit des rapports de sens), et elle engage une lecture foncièrement non conflictuelle des rapports sociaux. En témoigne également le vocabulaire de « l’exclusion »49, hérité d’une formulation de la question sociale et du « problème des banlieues » qui met au second plan les rapports de domination et d’exploitation50. Dans ces conditions, les « mouvements sociaux », dont celui des Gilets Jaunes, ne sont mentionnés qu’à titre de symptômes d’un mal à traiter51 – et jamais comme des événements historiques à partir desquels il est possible d’envisager des transformations du monde.
2. Solutions : « En fait on est des millions »
La deuxième étape consiste à mentionner des solutions, et à dresser un tableau nuancé de la situation. Comme dit le nouveau maire d’Arles Patrick de Carolis, dans son discours du samedi matin, « tous les outils sont là ». Il faudrait par ailleurs se rendre compte que « des bonnes choses ont été faites ». Comme « la Camargue » par exemple, dont l’Homme a enrichi la biodiversité à travers ses aménagements au fil des siècles.
Il s’agit donc ici, en premier lieu, de « prendre conscience de notre force »45 : nous « pourrions être une espèce régénérative »52. Et par ailleurs,
« en fait on est des millions, (…) dans tous les pays, pas seulement en Europe du Nord. (…) Essayez de mettre l’ensemble de ces régénérateurs dans une tour à la Défense… On tient pas ! »53
En plus de la force du nombre, il s’agirait de réaliser l’existence d’« outils » et de transformations déjà en cours : prise en compte croissante des exigences environnementales dans les institutions et dans les entreprises ; révolution des mentalités, en particulier chez les « décideurs », ainsi que dans une partie de la population (un éloge est rendu au passage au public qui compose la salle, et à un théoricien qui fait lui-même l’éloge des « créatifs culturels »)54 ; et enfin, bien entendu, innovations technologiques. La « révolution numérique » et les thèmes de la soi-disant « mobilité propre » tiennent ici une place importante – le cadre dirigeant de La Poste se vante par exemple que son groupe détient « la première flotte de véhicules électriques au monde »55 – sans que les nuisances écologiques considérables qu’elles engagent ne soient évoquées56.
3. Transitions : « Prendre conscience pour mieux accompagner »8
Cette formule d’une conférencière résume bien la représentation de l’action politique et du changement prévalant dans les débats. Il s’agit en effet d’identifier et d’accompagner des « révolutions » et des transformations « déjà » en cours. Cette représentation rencontre le thème de la « transition », entendue comme le passage linéaire d’un état à un autre. Le champ sémantique de la « symbiose », comprise comme une situation où les contradictions sont résolues et dépassées, peut également être invoqué57, tout comme le schème du « post- » (post-libéralisme, après-capitalisme, etc.), qui ne précise quelle sorte d’opération historique permet d’aboutir à un changement d’ère.
En proposant « une autre trajectoire pour l’humanité », l’Appel d’Arles prête à l’humanité la faculté de se mouvoir d’un seul tenant – étape après étape58. Il conforte ainsi la représentation d’un destin commun à la société ou à l’humanité. Celles-ci sont personnifiées et considérées en bloc, sur un « chemin », par-delà les conflits d’intérêts ou les clivages politiques et sociaux.
Une offensive idéologique
À la faveur des différents mouvements qui composent cette « méthode », une dépolitisation profonde des enjeux écologiques est accomplie. La gravité extrême des dévastations écologiques est minorée, au bénéfice de certains remèdes qui aggravent les problèmes, d’une poursuite de la routine du monde des affaires, et d’une re-légitimation d’acteurs et d’actrices largement responsables des désastres en question. La digestion et la neutralisation de la critique écologiste amoindrissent les chances d’initier les transformations radicales susceptibles de mettre un terme – sans transitions – aux ravages du vivant.
La formation d’un consensus, dans une ambiance d’auto-célébration, n’exclut pas ici l’existence de quelques « malentendus politiques »59 entre des participant·es. L’objectif d’un sociologue comme Alain Caillé, qui veut créer une coalition idéologique et politique « convivialiste » contre les excès du capitalisme financier (tout en faisant des références non critiques à la notion d’économie régénérative ou à l’Appel d’Arles), ne sont pas nécessairement les mêmes que celui d’un ex-dirigeant qui vend ses services de consulting à des patrons, afin de « régénérer » le management des grandes entreprises. Ces différents acteurs n’en sont pas moins juxtaposés, sans aucun dissensus apparent, dans un événement organisé autour d’un axiome : il est possible, et nécessaire, de concilier l’économie et l’écologie.
Il fallait sans doute la place et la trajectoire particulière des éditions Actes Sud60, ainsi que le carnet d’adresse de son ancienne dirigeante qui fut ministre de la culture, pour tenter de consacrer ainsi cette sorte d’« écologie » capitaliste et dépolitisée, en réunissant des botanistes, des patron·nes, des philosophes, des consultant·es ou encore des cadres d’administrations publiques.
Mais des questions restent en suspens : à qui s’adressent en priorité tous ces efforts pour réconcilier (symboliquement) l’écologie avec l’économie ? Et qui peut y croire ? Commençons par écarter un candidat improbable : sans doute pas les catégories les plus dominées de la société française et de son salariat. Elles ne sont pas ou peu représentées dans le public du festival, et leur expérience ordinaire du monde peut les prédisposer à savoir – comme des mouvements politiques récents l’ont somme toute exprimé – qu’il existe une racine commune aux dommages « sociaux » et « environnementaux ». Le soulèvement des Gilets Jaunes par exemple, fondé sur le rejet d’une taxe qui prétendait faire payer aux moins riches la responsabilité du réchauffement climatique, n’a pas adopté pour rien comme un de ses slogans : « Plus de banquise, moins de banquiers ».
L’offensive idéologique représentée par le festival d’Arles, et par la journée dédiée à l’économie régénérative en particulier, est dirigée en priorité vers d’autres catégories : entrepreneur·ses, cadres, professions intellectuelles en tous genres. Des catégories dont les certitudes, la loyauté, ou même simplement parfois la motivation pourraient commencer à vaciller, devant les manifestations des désastres écologiques et devant les critiques adressées à l’ordre politique et économique qui les produit.
Pour tous ces gens, le « trouble » né de la « mauvaise nouvelle » (la crise écologique) peut visiblement parvenir à une forme d’apaisement. Et ce n’est peut-être pas le moindre des effets produits. L’entrepreneur Emmanuel Druon écrit ainsi : « Nous voulons travailler sans porter la culpabilité de la destruction des ressources »61.
En des temps de détresse face aux bouleversements écologiques, ou de « solastalgie » qui n’épargne pas les entrepreneurs et les financiers62, un des enjeux est bien de gérer ce sentiment de culpabilité : Philippe Zaouati, qui dirige la société Mirova dont la spécialité est d’investir dans le « capital naturel », ne décrit pas autrement la genèse de la « finance verte ». À la fin de sa table-ronde, un membre du public rappelle des méfaits notoires et récents de la finance (perte de logements de millions d’Américains, crises alimentaires…) et conclut : « Est-ce qu’on devrait se réjouir maintenant que la finance s’occupe d’écologie ? » Visiblement déstabilisé, le D.G. de Mirova répond avec agacement :
« Je suis d’accord avec vous ! Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? (…) Moi j’ai pris conscience de ça il y a 10 ans au moment de la crise financière, ça faisait 20 ans que je travaillais dans la finance et que je ne m’étais pas posé du tout ces questions-là. (…) Je me suis dit, mais qu’est-ce que tu fais maintenant ? Tu peux faire de l’agriculture durable… – ben franchement je suis nul, je sais même pas arroser une plante. (…) Donc en gros je savais faire que de la finance. »63
Mais les souffrances engendrées par la conscience malheureuse, la compréhension exclusivement morale des problèmes politiques ou encore la difficulté à modifier ses habitudes ne constituent pas de très bonnes raisons pour fournir autant d’efforts volontaires visant à renouveler l’« esprit » du capitalisme, et son emprise sur le monde. Quant à la question de garder une activité professionnelle pour survivre, en envisageant éventuellement une reconversion, elle se poserait avec une urgence différente pour des ouvrier·es ou des employé·es réellement exposé·es à perdre toute source de subsistance en même temps que leur emploi.
En sorte que, si « la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité au vivant »64, comme l’affirme Baptiste Morizot dans son intervention, alors nous gagnons à nous rendre sensibles aux contrastes et à toute la gamme de rapports de force qui parcourent le monde vivant humain, et qui ont des effets certains sur le reste du vivant. Si quelque chose existe comme « la matrice de notre rapport au reste du vivant », on ne saurait la « transformer » sans prendre en compte le rôle qu’y joue le capitalisme, avec ses capacités d’adaptation et ses offensives, sa force de bouleversement du tissu de la vie.
Notes
- Ingénieur agronome, essayiste et consultante, spécialisée en « modèles économiques générateurs de fortes plus-values écologiques, économiques et sociales » (profil Linkedin). Propos tiré de la table-ronde « L’appel d’Arles – Symbiocène. Le temps des régénérateurs ». Merci à la Déli et au 26, à leurs habitantes et leurs hôtes, et au comité de rédaction de la revue Terrestres.[↩]
Table-ronde « Redéfinir l’imaginaire de la croissance.[↩]- L’ensemble de la journée, comme le reste de la semaine, sont visibles sur la chaîne Youtube du festival[↩]
- Réseaux de Transport d’Électricité (RTE), détenue à 51% par EDF, gère les infrastructure nécessaire à l’acheminement de l’électricité. La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) gère des barrages produisant de l’électricité.[↩]
- Voir l’article d’Emmanuel Druon dans le journal du festival : « Relançons l’économie en tenant compte de l’écologie. Faisons de l’écolonomie », Au nom de la terre, Agir pour le vivant, août 2020, p. 12.[↩]
- Isabelle Delannoy, « Si tu n’es pas toi [sic], qui ? Si pas maintenant, quand ? », Au nom de la terre, journal papier du festival Agir pour le vivant, août 2020, p. 8.[↩]
- Table-ronde « Redéfinir l’imaginaire de la croissance ».[↩]
- Aurélie Piet, table-ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative ».[↩][↩][↩][↩][↩]
- Olivier Grabette, dirigeant de RTE, pendant la table-ronde « L’entreprise engagée dans la transition ». Des membres du MEDEF se sont intéressé·es au même peuple amérindien, dans le but de « repositionner leurs stratégies marketing » et de revisiter leurs méthodes de management : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/retour-sur-les-grands-patrons-et-les-kogis-r[↩]
- Isabelle Delannoy, « Si tu n’es pas toi, qui ?… » (article cité), p. 8.[↩]
- Élodie Bia, table-ronde « Redéfinir l’imaginaire de la croissance ». À l’objection que cette remarque témoigne d’un « entre-soi difficile à entendre », cette cadre répondra : « Je témoigne de ce que je vis… (…) Tous les chefs d’entreprises ne sont pas des pourris ».[↩]
- Emmanuel Druon, « Relançons l’économie en tenant compte de l’écologie. Faisons de l’écolonomie », Au nom de la terre, festival Agir pour le vivant, août 2020, p. 12.[↩]
- Aurélie Piet, table-ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative »[↩]
- Voir sa présentation biographique sur le site des éditions Ker : « De San Francisco à Bombay en passant par les forêts amazoniennes et les campagnes européennes, Guibert del Marmol vit au contact des entrepreneurs qui changent le monde et réconcilient les mots économie, écologie et sens. Ancien dirigeant, il est aujourd’hui conseiller, auteur et conférencier spécialisé dans le domaine de l’économie »régénératrice ». Il forme également les dirigeants aux pratiques d’un leadership inspiré et inspirant en mariant sagesses anciennes et technologies modernes » (https://www.kerditions.eu/guibert-del-marmol/).[↩]
- Table-ronde « Redéfinir l’imaginaire de la croissance » (nous soulignons).[↩]
- Idem.[↩][↩]
- Ces thématiques sont présentes depuis des décennies au sein d’organisations patronales « avant-gardistes » (voir Thomas Clerget : « Les militants de la cause entrepreneuriale. Trajectoires sociales, transactions identitaires et formes de mobilisation des membres du Centre des Jeunes Dirigeants à Marseille », mémoire de master en Études Politiques, Université Aix-Marseille III – IEP, 2007). La notion de « bien commun », elle, a une longue histoire depuis le XIXe siècle, dans la doctrine sociale de l’Église et les organisations patronales d’influence chrétienne. Elle correspond à l’ambition de placer les entreprises au-dessus des intérêts particuliers et de la lutte des classes (voir Henry Weber, Le parti des patrons. Le CNPF 1946-1986, Seuil, 1987 : http://digamoo.free.fr/weber1986.pdf ; pp. 109 et 248 notamment).[↩]
- Table-ronde, « Pour une finance de la transition ».[↩]
- Article « La finance au service du vivant », Au nom du vivant, festival Agir pour le vivant, août 2020, p 9.[↩]
- Voir, Gilbert Rist, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale (Sciences Po, 2007). Voir https://www.cairn.info/le-developpement–9782724612790.htm. Sur le travail de l’auteur, on peut lire : https://www.terrestres.org/2020/06/26/la-tragedie-de-la-croissance-une-metaphysique-du-neo-liberalisme/.[↩]
- Derniers mots de « l’Appel d’Arles », table-ronde « L’appel d’Arles – Symbiocène. Le temps des régénérateurs ».[↩]
- La Sorcellerie capitaliste. Pratiques de désenvoûtement, (La Découverte, 2007), p. 88.[↩]
- Comme le rappelle le philosophe Cornelius Castoriadis : « Le développement est le procès moyennant lequel le germe, l’œuf, l’embryon se déploie, s’ouvre, s’étale – où le vivant en général parvient à son état de »maturité ». Parler de »développement », c’est se référer à la fois à un »potentiel » qui est déjà là et à un accomplissement, un achèvement, un acte, une energeia donnés, définis, déterminés ; c’est opposer une »matière » déjà riche de déterminations non explicitées à la forme qu’elle va devenir – est cette forme est une norme. C’est là le langage d’Aristote, de l’ontologie aristotélicienne, mais cette ontologie, sous une forme ou une autre, sous-tend toute la pensée occidentale. Ainsi, pour ce qui est du problème qui nous occupe : on parle de »développement » des pays du Tiers Monde en posant qu’il existe un état de maturité définissable qu’ils doivent atteindre. » Extrait tiré des « Réflexions sur le »développement » et la »rationalité » », Domaines de l’homme. Les carrefours du labyrinthe 2 (Le Seuil, 1999), p. 192.[↩]
- Table-ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative ».[↩][↩]
- L’usage d’images venues du vivant ou des sciences naturelles, afin de déterminer les bonnes « réformes » à initier à l’intérieur de la société humaine, ne constitue pas un phénomène nouveau. Comme l’écrit Christian Topalov à propos du 19e siècle, « les savoirs réformateurs empruntent aux sciences de la nature des modèles d’expérimentation, ils y puisent aussi des schèmes d’interprétation sous la forme d’inépuisables métaphores. La physiologie, surtout, est mise à contribution. Les métaphores du corps social (…) peuvent se décliner dans la médecine : diagnostic, nosologie, étiologie, prescription (…) », in Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914 (EHESS, 1999), p. 41.[↩]
- Table-ronde « Redéfnir l’imaginaire de la croissance ». Permaéconomie. Réconcilier économie et écologie est également le titre d’un essai d’Emmanuel Delannoy (Wildproject, 2016).[↩]
- Isabelle Delannoy, table-ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative ».[↩]
- Bernard Horenbeek (Président du directoire de la Nef, coopérative de « finances solidaires »), table-ronde « Pour une finance de la transition ».[↩]
- Karim Lapp, « Ingénieur principal spécialisé dans la transition écologique et chercheur indépendant en biomimétisme », table ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative ».[↩]
- Par exemple Alain Caillé, table-ronde « Quelle société pour l’après-capitalisme ? ».[↩]
- Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, XVIIe-XVIIIe (EHESS, 1992).[↩]
- Pour reprendre une expression appréciée par Emanuele Coccia (La Vie des plantes, Rivages, 2016), un autre intervenant du festival d’Arles.[↩]
- Philippe Zaouati, La Finance verte commence à Paris (Rue de l’échiquier, 2018), p. 39.[↩]
- Elisabeth Ayrault, PDG de la Compagnie nationale du Rhône, « Une relance verte », Au nom de la terre, festival Agir pour le vivant, août 2020, p. 8 (nous soulignons).[↩]
- Philippe Zaouati, « La finance au service du vivant », Au nom de la terre, festival Agir pour le vivant, août 2020, p. 9.[↩]
- Olivier Grabette, table-ronde « L’entreprise engagée dans la transition » (nous soulignons).[↩]
- Table-ronde, « L’entreprise engagée dans la transition »[↩]
- « En développant des énergies en-dehors du fleuve, (…) ça nous permet de continuer à gérer le fleuve, et à apporter au fleuve je dirais euh… la vie » (Élisabeth Ayrault, table-ronde, « L’entreprise engagée dans la transition).[↩]
- La Part inconstructible de la terre. Critique du géo-constructivisme, (Seuil, 2016) p. 29-30.[↩]
- Karim Lapp, table-ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative ».[↩]
- L’Appel d’Arles.[↩]
- Table-ronde « L’appel d’Arles – Symbiocène. Le temps des régénérateurs ».[↩]
- Gilles Boeuf, table-ronde « Redéfinir l’imaginaire de la croissance ».[↩]
- Alain Caillé, table-ronde « Quelle société pour l’après-capitalisme ? ».[↩]
- Idem.[↩][↩]
- Baptiste Morizot, Raviver les braises du vivant. Un front commun (Actes Sud/Wildproject, 2020), p. 96, n.1. Dans une recension d’un autre ouvrage de Baptiste Morizot, l’anthropologue Charles Stépanoff écrit : « Particulièrement séduisante pour les philosophes semble l’idée que les désastres moraux et écologiques (…) dériveraient moins de changements techniques et politiques de ces derniers siècles que du déploiement programmé d’une métaphysique ». Il note que ce biais intellectualiste « occulte les violences et les luttes, toujours actuelles », et minore en particulier le rôle des hiérarchies sociales, de l’État et du marché « qui fait du vivant une marchandise » (voir « Les hommes préhistoriques n’ont jamais été modernes », http://journals.openedition.org/lhomme/32370, p. 135 et 146 notamment).[↩]
- Marc-André Selosse, « De la société au monde vivant : vers une double alliance ? » Au nom de la terre, festival Agir pour le vivant, août 2020, p. 7.[↩]
- La banque BNP Paribas est absente de la table-ronde, suite à la discussion politique et stratégique ouverte par Isabelle Fremeaux et John Jordan dans une lettre publiée sur le site de la revue Terrestres. En introduction de cette ultime table-ronde de la journée, la journaliste Aude Massiot indique qu’elle regrette cette absence, qui ne permet pas de « parler avec tout le monde ». Ce sera là l’unique mention de la controverse de toute la journée.[↩]
- Comme le fait Isabelle Delannoy, table-ronde « L’appel d’Arles – Symbiocène. Le temps des régénérateurs ».[↩]
- Sur ce thème, voir l’article de Sylvie Tissot : https://www.cairn.info/revue-geneses-2005-3-page-57.htm[↩]
- Le biologiste Gilles Bœuf, ancien président du Muséum d’histoire naturelle, attribue ainsi l’existence des mouvements sociaux à une « souffrance » sociale, qu’il relie elle-même à la surpopulation humaine sur le globe terrestre (table-ronde « Redéfinir l’imaginaire de la croissance »).
[↩] - Karim Lapp, table-ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative ».[↩]
- Isabelle Delannoy, table-ronde « L’appel d’Arles – Symbiocène. Le temps des régénérateurs ».[↩]
- Il s’agit de Paul Ray (Aurélie Piet, table-ronde « L’économie de la surabondance : devenir une espèce régénérative »).[↩]
- Yannick Imbert, table-ronde « L’entreprise engagée dans la transition ».[↩]
- Le journal en ligne Reporterre a consacré une série d’articles au cas de la voiture électrique, « promue sans la moindre réserve par la classe dirigeante », dont il explore les liens avec les émissions de gaz à effet de serre, l’extraction minière ou encore l’intelligence artificielle et les GAFAM : https://reporterre.net/Non-la-voiture-electrique-n-est-pas-ecologique.[↩]
- Présent dans les débats de la journée de tables-rondes, et dans le livre d’Isabelle Delannoy L’Économie symbiotique. Régénérer la planète, l’économie et la société (Actes Sud, 2016).[↩]
- Comme l’insinuent aussi la métaphore du véhicule (le vaisseau spatial Terre…) ou l’infinitif « bifurquer », qui donne son titre à un ouvrage collectif commenté en fin de journée : table-ronde « Épistémologie de la catastrophe – une initiative de Bernard Stiegler » (Bifurquer, sous la direction de Bernard Stiegler, Les Liens qui libèrent, 2020).[↩]
- Pour reprendre une expression de l’historien Christian Topalov, dans une étude sur le monde des « réformateurs » de la fin du XIXe siècle. L’auteur avance que « sens commun réformateur et malentendu politique » peuvent aller de pair (« Langage de la réforme et déni du politique », 2020 [1996] https://www.cairn.info/revue-geneses-2020-1-page-5.htm, p. 20).[↩]
- On en trouvera quelques éléments dans l’article suivant : https://blog.agone.org/post/2011/10/20/Concentration-capitalistique-dans-l-%C3%A9dition-la-methode-Actes-Sud[↩]
- « Relançons l’économie en tenant compte de l’écologie. Faisons de l’écolonomie », (article cité), p. 12. Il insistera sur ce thème pendant une table-ronde : « Il y a une culpabilité à sentir, »j’ai du travail et je ramène du salaire, et en même temps, je massacre ce qui m’entoure. » C’est pas gérable. C’est pas responsable. C’est pas vivable. Et ça mène au burn-out et compagnie » (table-ronde « Le vivant en commun », le mardi 25/08).[↩]
- Voir, sur le site dirigeant.fr, la reprise de la définition de la solastalgie par Glenn Albrecht : « La solastalgie désigne une émotion chronique éprouvée face à un changement environnemental négativement perçu, une sorte de détresse. » http://www.dirigeant.fr/planete/lere-actuelle-lanthropocene-doit-ceder-la-place-a-lere-du-symbiocene/[↩]
- Table-ronde « Pour une finance de la transition ».[↩]
- Table-ronde « Ranimer les braises du vivant », samedi 29/08.[↩]







