Nous reproduisons ici la préface à la réédition de L’utopie ou la mort (Points Seuil, 2020), de René Dumont, paru initialement en 19731. Ce texte est le premier d’une série d’autres contributions, qui reviendront dans les prochains mois sur la vigueur des luttes, alertes et pensées écologiques dans les années 1970 et sur l’analyse des contre-feux et stratégies mises en œuvre par les élites économico-politiques, en vue de tirer quelques enseignements d’un demi-siècle de défaites (non sans nombres de victoires locales) des mouvements écologiques qui, activement combattus marginalisés déviés ou cooptés, n’ont pu infléchir notre trajectoire de déréglement planétaire ni parvenir à destituer les forces de mise au travail et de saccage des vivants.
« Tous ceux qui s’accrochent aux privilèges de la société de consommation, proférait-il en 1973, qui refusent les réformes […] indispensables à la justice sociale à l’échelle mondiale et à la survie, peuvent désormais être considérés comme les assassins des plus démunis. Voulez-vous risquer d’être traités d’assassins par vos enfants […]? »2
Expert du développement puis militant écologiste, ayant parcouru la planète en tous sens, René Dumont (1904-2001) est l’un des grands témoins du XXe siècle. Agronome colonial devenu anticolonialiste, abondanciste et productiviste devenu critique de la croissance illimitée, pourfendeur du malthusianisme devenu malthusien, modernisateur devenu écologiste, René Dumont a su réviser ses analyses aux évolutions du siècle et des connaissances. Sa pensée provocante, son exigence de sobriété et de solidarité mondiale nous accompagnent aujourd’hui plus que jamais.
Écoutons-le : « Le feu est à la maison» ; « La course à la mort est engagée » ;, « Nous fonçons dans le brouillard à toute allure vers un mur de ciment3 ». Cette alerte à l’ « effondrement total de notre civilisation » (p. 44) vient-elle d’un collapsologue d’aujourd’hui ? Non ! Elle émane du tout premier candidat écologiste à l’élection présidentielle française de 19744. Cet appel à « une mobilisation générale de survie, un état d’urgence » (p. 46), cette exigence de justice générationnelle sous peine « d’être traités d’assassins par nos enfants », est-elle un cri des récentes mobilisations de la jeunesse en faveur du climat et de la sauvegarde de la planète, une nouvelle prise de conscience au XXIe siècle ? Non. C’est l’implacable bilan du XXe siècle productiviste5, dressé dès 1973 par un homme de 70 ans, qui en avait pourtant été un acteur et un apôtre.
Des savoirs et des contestations écologistes déjà considérables autour de 1972
À l’heure où les rapports des instances internationales d’expertises
scientifiques se font chaque année plus sombres, où les effets des dérèglements
planétaires sont sensiblement éprouvés par un nombre croissant d’êtres
terrestres – humains et autres qu’humains – L’Utopie ou la Mort
de René Dumont, parue en 1973, saisit par son actualité visionnaire,
tant par l’analyse des impasses écologiques d’un modèle de civilisation
industrielle que par l’appel à la responsabilité envers les générations futures
et à la justice sociale. Assurément, les consciences et les savoirs ont évolué
depuis un demi siècle : certaines craintes émises par Dumont, en écho
à celles d’autres scientifiques et experts, tels ceux du Club de Rome, et de
militants écologistes du début des années 1970, concernant l’épuisement de
plusieurs ressources dans les années 2020 se sont depuis avérées exagérées ou
prématurées, tandis que, inversement, certaines autres dimensions des
dérèglements de notre terre n’étaient pas encore entrevues. Mais L’Utopie ou
la Mort nous force à reconnaître l’existence, dès le début des années
1970, de débats intenses et de multiples alertes scientifiques sur les
dérèglements planétaires causés par ce que les scientifiques et historiens de
l’Anthropocène nomment désormais la « grande accélération6»
d’après 1945, produit d’une course effrénée entre le capitalisme fordiste et
néocolonial (à l’Ouest), le socialisme réel (à l’Est), et le développementisme
extractiviste (aux Suds).

Alors qu’un discours paresseux, doublé d’une rhétorique récurrente de la « nouveauté », soutient trop souvent qu’« avant, on ne savait pas », que la « prise de conscience » relative aux dérèglements anthropiques de l’état de la planète ne serait que peu à peu advenue ces derniers temps7, les travaux d’histoire environnementale ont mis au jour l’ancienneté séculaire des savoirs et de la réflexivité des sociétés quant à leur incidence sur les équilibres et fonctionnements terrestres. Sans remonter si loin, L’Utopie ou la Mort vient nous rappeler l’étendue des alertes scientifiques et la force des questionnements écologiques il y a déjà un demi-siècle8.
La poussée d’un mouvement écologique dans les années 1968
Les années 1968-1974 qui voient émerger l’écologie politique se situent en effet à une apogée de la contestation du capitalisme fordiste comme du soviétisme productiviste : aspirations anti-autoritaires et en faveur de l’autogestion, mouvement antinucléaire obtenant des victoires dans plusieurs pays industriels, luttes des droits civiques et anticoloniales en pleine guerre du Vietnam, grèves et résistances ouvrières pesant sur le taux de profit, contestations étudiantes et féministes, etc.
Aux États-Unis, le Committee for Environmental Information de Barry Commoner mène depuis 1958 campagne contre le nucléaire, les pollutions et les produits toxiques en lien avec des groupes féministes et de justice environnementale9. Silent Spring, l’ouvrage sur les dégâts des pesticides et autres pollutions chimiques, publié en 1962 par Rachel Carson devient un best-seller et stimule la naissance de l’environnementalisme comme nouveau mouvement social : lors du premier jour de la Terre, le 22 avril 1970 se sont 20 millions d’Américains qui agissent et manifestent dans les rues, et un an plus tard un projet d’aéroport en Floride doit être abandonné en 1971 face aux intenses mobilisations qu’il avait suscité. Un laboratoire de recherche estime alors à 5 à 10 millions (sur 200) le nombre d’États-uniens engagés dans une des associations environnementales10. L’évolution de l’opinion est telle qu’un président conservateur comme Nixon se voit contraint de passer une série de réformes environnementales significatives11. Dans ce sillage, tous les pays industriels se dotent d’un ministère de l’Environnement, à l’instar de la France en 1971, année où s’affirment la lutte du Larzac, le mouvement antinucléaire métropolitain, ou encore la contestation indépendantiste des essais nucléaires en Polynésie française12.
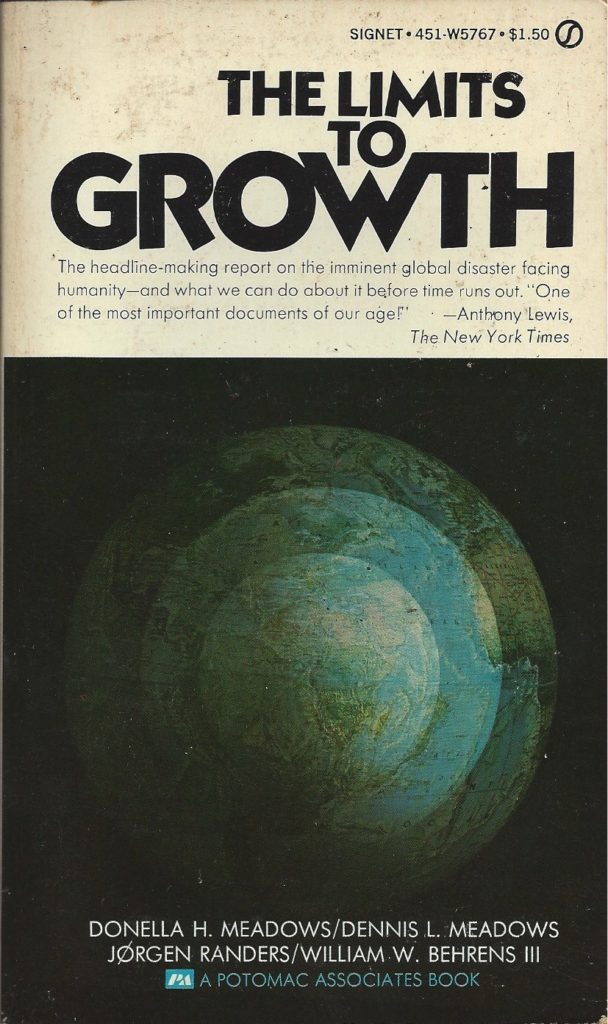
L’avenir de la planète en débat au plan international
Au plan international, on assiste à une mise à l’agenda des enjeux écologiques. En 1972, la conférence des Nations unies sur l’environnement humain de Stockholm, placée sous le slogan « Nous n’avons qu’une seule Terre », institue le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE/UNEP). La diffusion des images de la Terre prises par Apollo 8 en décembre 1968, puis de la fameuse « bille bleue » en 1972, renforce la métaphore d’un fragile « vaisseau spatial terre » et le sentiment d’un devenir commun de l’humanité et de la planète13. Même l’OCDE, institution gardienne des politiques de croissance de l’Occident capitaliste, laisse émerger en son sein – de 1968 jusqu’à leur mise à l’écart en 1972 – une équipe d’experts autour d’Alexander King qui mène l’analyse critique de certaines conséquences sociales et environnementales de la croissance. Ils réfléchissent alors à l’hypothèse d’une « croissance zéro », à contre-courant du modèle d’une croissance économique infinie14. King est aussi, en 1968, le co-fondateur du Club de Rome, sponsorisé par l’industriel Aurelio Peccei, de Fiat. Associant des dirigeants patronaux et des scientifiques, tels Jay Forrester (pionnier de l’informatique au MIT), Dennis Gabor (inventeur de l’holographie) et René Dubos (biologiste), ce groupe prône une planification mondiale à long terme, à la fois économique, démographique et environnementale. Il commande un rapport au MIT, basé sur un modèle informatique de dynamique des systèmes (« World 3 »), l’un des tout premiers visant à modéliser le futur démographique, industriel et écologique de la planète entière15. Intitulé The Limits to Growth, ce rapport, dit rapport Meadows paraît au printemps 1972 et pronostique un effondrement du système économique industriel au plan mondial au xxie siècle, du fait des pollutions, des déchets, de l’épuisement des ressources et des écosystèmes.
C’est à la lecture de ce rapport que René Dumont, « saisi à la gorge par [s]es données16», se lance dès l’été 1972 dans la rédaction de L’Utopie ou la Mort. L’ouvrage de René Dumont intervient donc en un temps de fortes mobilisations socio-écologiques au Nord comme au Sud de la planète, de débats publics très intenses y compris dans les arènes internationales (dans lesquelles l’agronome évolue), dont les medias se font largement l’écho17.
L’accumulation des alertes et travaux scientifiques
L’Utopie ou la Mort s’appuie sur une masse déjà considérable de travaux scientifiques et de rapports sur les questions environnementales : avec l’essor, après la Seconde Guerre mondiale, des communautés scientifiques étudiant l’environnement physique et biologique à l’échelle planétaire ; avec la prise en charge de la question de la protection de la nature par l’Unesco dès sa création en 1945 ; avec la conférence de l’Unesco à Paris, en 1968, sur « les bases scientifiques de l’utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère » ; puis le programme SCOPE (Scientific Committee of Problems of the Environment), créé en 1969, par le Conseil international des unions scientifiques (ICSU)18.
Ces préoccupations environnementales planétaires font l’objet de trois synthèses majeures, au début des années 1970, qui ont profondément marqué Dumont : le rapport Meadows (The Limits to Growth), bien sûr, mais aussi le rapport Ward-Dubos Only one Earth remis en 1972 en vue du sommet des Nations unies sur l’environnement humain, à Stockholm19 ,et le rapport Man’s Impact on the Global Environment, remis, en 1970, à la Maison-Blanche20.
Des changements irréversibles du climat
Certains s’étonneront que Dumont mentionne, dès 1973, les « changements irréversibles de climat » causés par les émissions de gaz à effet de serre et une montée des océans de plusieurs dizaines de mètres à long terme (p. 78). Si la question climatique n’occupe pas encore la place qu’elle tient aujourd’hui dans l’espace public, l’alerte climatique de René Dumont s’appuie en réalité sur un corpus de connaissances déjà considérable et grandissant : l’effet de serre est connu depuis le XIXe siècle ; la mesure précise de l’augmentation continue du taux atmosphérique de dioxyde de carbone est enregistrée à l’observatoire de Mauna Loa par Charles Keeling depuis 1958 ; le rapport Man’s Impact on the Global Environment est communiqué à la Maison-Blanche en 1970, suivi l’année suivante par la parution du livre Inadvertent Climate Modification. Report of the Study of Man’s Impact on Climate. Fondé sur le meilleur des observations et des modélisations d’alors, encore prudent et reconnaissant l’existence d’incertitudes, ces deux derniers rapports prédisent un réchauffement climatique de plusieurs degrés au xxie siècle21.
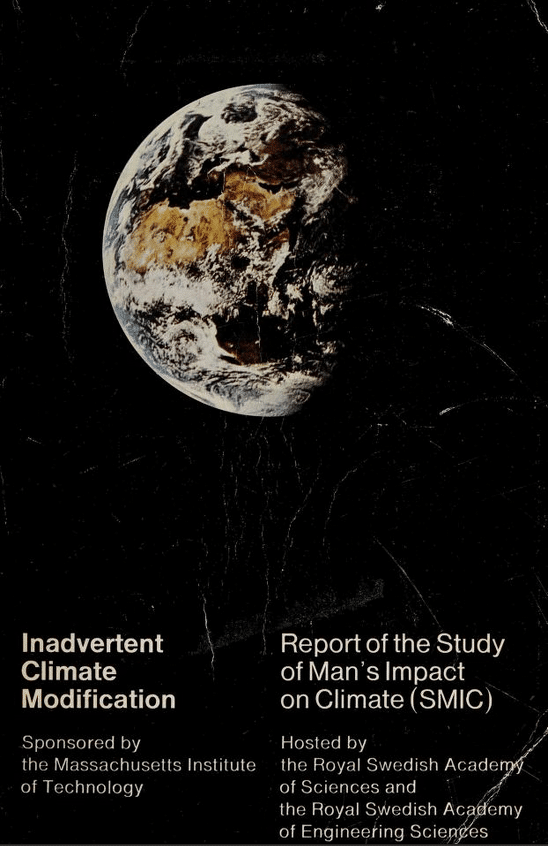
Ces perspectives de réchauffement du climat global entrent alors dans l’espace public, elles sont discutées et reprises dans des communications aussi bien internes qu’externes des grandes compagnies pétrolières alors parfaitement conscientes du problème. Celles-ci, n’ayant pas encore choisi la stratégie du déni, ont financé, dès les années 1955-1968, des recherches confirmant un futur réchauffement climatique, dont certaines publiées dans les plus grandes revues scientifiques22.
En France, la revue de la société pétrolière Total reconnaît ainsi dès 1971 les dangers de « modifications du climat par la pollution ». L’article annonce que l’émission de « quantités énormes de gaz carbonique », qui « pourrait atteindre 400 parties par million vers 2010 » (contre 326 en 1971) et modifier « les grands équilibres mondiaux », avec une hausse de la température mondiale « de 1 à 1,5° centigrade » et « une montée sensible du niveau marin. Ses conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer23. »Un nombre croissant d’historiens et de juristes estiment qu’à partir de ces travaux, produits ou relayés par les compagnies énergétiques elles-mêmes dès les années 1970 et 1980, on ne peut plus dire qu’ « on ne savait pas ».
En 1972, le rapport préparatoire à la Conférence de Stockholm, mentionne dans deux de ses 109 recommandations finales la possibilité d’un changement climatique24. Si la modélisation précise du climat et de ses changements est évidemment dans son enfance, Dumont peut donc s’appuyer sur des indices scientifiques solides et des recommandations internationales qui appellent à un changement de cap sous peine de dérèglement climatique.
La biodiversité en danger
Des connaissances alarmantes sur les atteintes aux vivants, à la biodiversité, aux écosystèmes, aux poissons et aux sols se sont également accumulées dans le quart de siècle précédent L’Utopie ou la Mort. Et Dumont s’en fait l’écho lorsqu’il note « une réduction des stocks existants » de poissons, « le recul de la forêt » ou l’épuisement des sols de 15 % des terres labourées, qui ont perdu perdu leur humus (p. 185, 63 et 65).. Dès la conférence de l’UNESCO et de l’Union internationale pour la protection de la nature, en 1949, d’importants impacts négatifs du DDT et d’autres pesticides sur la faune et la flore avaient été mis en évidence. L’ouvrage décisif de Rachel Carson, Silent spring (1962), mentionné par Dumont (p. 70), est traduit en français dès 1963 avec une préface du directeur du Muséum national d’histoire naturelle dénonçant « l’industrialisation aveugle » et « les empoisonneurs publics25». Au plan international, la collecte systématique sur les espèces menacées (Red data book) débute dès 1958, tandis que le concept scientifique d’« extinction de masse » prend forme dans les années 196026. Au même moment, le constat de la concordance entre expansion des humains et extinction des grands mammifères à la fin du Pléistocène conduit à la thèse d’une extermination humaine de ces derniers (théorie de l’overkill)27. Les éléments sont donc en place pour rendre bientôt pensable l’idée d’une nouvelle extinction de masse en cours à l’âge industriel28. En mai 1971, le « message » de 2 200 scientifiques, incluant quatre Prix Nobel de biologie29, avait sonné l’alarme :
[…] nous sommes tous liés aujourd’hui par un danger collectif sans précédents dans l’histoire […] [qui] représente non seulement la probabilité d’un immense accroissement de souffrance humaine dans un proche avenir, mais la possibilité même de l’extinction, ou d’extinction virtuelle de la vie sur la planète. Il nous faut voir désormais la Terre, qui nous semblait immense, dans son exiguïté. Nous vivons en système clos, totalement dépendants de la Terre et dépendants les uns des autres, et pour notre vie et pour la vie des générations à venir30.

« Il m’a fallu longtemps… »
Rien ne prédisposait René Dumont, qui professait des années 1930 aux années 1960 des positions vigoureusement abondancistes, anti-malthusiennes et productivistes, à critiquer la croissance et à alerter sur les limites de la planète. Il reconnaît volontiers, en 1977, que s’il fut très tôt partisan des décolonisations – il signe ainsi, en 1960, le manifeste des 121 contre la guerre d’Algérie – et d’une justice sociale mondiale :
« Il m’a fallu plus longtemps pour comprendre le drame écologique, l’épuisement des ressources rares de la planète, eau incluse, le danger de toutes les formes de pollutions qui peuvent compromettre, avec nos écosystèmes, nos climats eux-mêmes31.».
Dans L’Utopie ou la Mort, il s’étonne « qu’il ait fallu attendre jusqu’à ces dernières années pour qu’une telle évidence [celle de la finitude des ressources et des dérèglements planétaires] dépasse un petit cercle d’initiés ». Et il avoue que ce constat « ne [l]’avait pas tellement frappé32 ! » Un quart de siècle plus tôt, pourtant, Dumont avait eu connaissance des alertes environnementales lancées par les best-sellers des biologistes Fairfield Osborn (Our Plundered Planet, 1948; The Limits of the Earth, 1953) et William Vogt (Road to Survival, 1948)33. Mais, croyant alors à la possibilité de tirer bien plus de la terre par des méthodes plus rayionnelles, il combattait les thèses de ces livres comme malthusiennes. Ainsi, pour William Vogt, l’avenir de l’humanité se joue entre deux courbes : « L’une est la courbe de population humaine […], l’autre courbe est celle de nos ressources. Elle représente l’extension et l’épaisseur de notre sol, l’abondance de nos forêts, l’eau disponible, les prairies sources de vie et le réseau biophysique qui les relient tous ensemble34» : une thèse que Dumont ne pouvait alors accepter en 194835, mais qu’il fera sienne pourtant dans L’Utopie ou la Mort.
La population mondiale, une question d’avenir ?
Avant de remettre en question la course en avant d’une économie productiviste, Dumont commença d’abord à réviser ses position anti-malthisiennesà propos de l’accroissement démographique. A partir de son expérience de terrain, il avait observé les liens entre misère paysanne et surpopulation rurale au Vietnam et en Chine dès les années 1930. Et c’est dès les années 1950 que Dumont se convertit à l’idée de politiques visant à infléchir ou contrôler la courbe de la population mondiale. Il préconise le contrôle des naissances, dès 1954, dans Économie agricole dans le monde36. Tandis que la population mondiale double entre 1930 et 1974 (de 2 à 4 milliards), il estime, en 1966, que « l’homme doit se rendre maître de l’expansion numérique de l’humanité ». Il propose de « substituer à la brutalité inacceptable des « régulateurs naturels » de la population (famine, épidémie, guerre) des régulateurs qui restituent à l’homme sa liberté de choix et engagent sa responsabilité37.»
Dumont rejoint ici le néo-malthusianisme qui s’affirmait dès 1945 dans les arènes onusiennes38, mouvement porté par de nombreux agronomes ou biologistes de sa génération tels Julian Huxley (1er directeur de l’Unesco-, John Boyd Orr (directeur de la FAO), le Suédois Georg Borgström, ou l’Etats-Unien Paul Ehrlich39. Mais Dumont aborde cette question démographique à partir de son expérience d’agronome et d’économiste de terrain. Après-guerre, Dumont est persuadé qu’une utilisation plus rationnelle et intensive du sol à l’échelle planétaire produirait une abondance nouvelle en faveur de l’essor de la population mondiale, thèse à contrario des sombres prédictions d’un Vogt ou d’un Osborne. Il est alors l’un des chantres de la « révolution verte ». Mais dès la fin des années 1960, Dumont constate, de manière toute pragmatique, que, en dépit d’énormes gains de rendements agricoles suite à l’intensification agricole, la croissance de la production alimentaire reste inférieure à celle de la population. Son adhésion à un contrôle des naissances s’en trouve renforcée40, ce qui le conduira à endosser les thèses démographiques du Club de Rome. Ce moment signe une rupture avec son ami et compère modernisateur le démographe Alfred Sauvy, critique de l’agréger de situations nationales différenciées dans un discours démographique global, qui pointe les dangers à venir pour la croissance économique et la redistribution sociale du fait d’un vieillissement des populations41.
Une trajectoire personnelle pour renoncer au credo productiviste
Si la position de Dumont sur la démographie est somme toute conforme à celle de bien des biologistes, agronomes et décideurs internationaux de son temps – son choix au crépuscule des dites « Trente Glorieuses » de critiquer le productivisme, de prendre au sérieux les dérèglements environnementaux et climatiques, de rappeler les limites de la croissance sur une planète limitée, est plus exceptionnel et remarquable. L’Utopie ou la Mort est le premier livre de René Dumont où s’exprime cette conversion du socialisme productiviste qui était le sien depuis les années 1930 vers une nouvelle civilisation de « croissance zéro de notre consommation globale de produits industriels » (p. 156). Cette évolution est largement due à l’électrochoc provoqué en lui par sa lecture du rapport Meadows sur les limites de la croissance42. On doit saluer ici la capacité de René Dumont, à changer de position lorsque les observations et les faits l’en convainquent, et noter son énergie missionnaire à transmettre ses nouvelles convictions. Dumont devient alors, avec André Gorz, Françoise d’Eaubonne ou Cornélius Castoriadis, l’un des intellectuels qui surent sortir la gauche de la matrice productiviste qui la domina tout au long du XXe siècle43.
Rappelons-le, Dumont fut sous la IVe République un ardent promoteur de l’intensification agricole et au début de la Ve République l’un des douze scientifiques du Comité consultatif de la recherche conseillant l’effort de modernisation techno-scientifique. Au cabinet de Jean Monnet en 1937, il devient sur recommandation de Sauvy, en décembre 1945, conseiller agricole au commissariat général au Plan de modernisation et d’équipement. Dumont dirige ainsi les travaux de la section agricole du plan Monnet. Érigeant en modèle la productivité de l’agriculture américaine, il défend un exode rural massif pour diminuer par deux le nombre d’exploitations44, une motorisation soutenue par un remembrement rapide et massif, l’adoption généralisée des engrais et biocides, ainsi que le défoncement de millions d’hectares de prairies, à transformer en champs labourés, à vider de leur capital « humus » pour produire au plus vite45. Dans Le Problème agricole français (1946), à partir du cas d’une loi japonaise qui impose l’usage des engrais, Dumont se demande dans quelle mesure « le progrès doit-il être obligatoire », et s’il ne serait pas nécessaire de « faire intervenir la législation pour la généralisation de quelques progrès techniques incontestables, dont la vulgarisation par persuasion s’avère d’une lenteur dangereuse pour la survivance de notre agriculture ». Notre modernisateur planiste conclue toutefois sa réflexion en jugeant préférable « d’obtenir la collaboration active des élites rurales, de la représentation professionnelle agricole, pour éveiller au sein de notre paysannat la mystique du progrès technique46 ». Animé par ce credo de l’industrialisation de l’agriculture, Dumont est alors un fervent partisan de la « révolution verte » combinant la sélection génétique de variétés, l’usage intensif d’engrais et de pesticides, la motorisation et l’irrigation artificielle. Il consacre deux décennies à promouvoir cette intensification agricole et à conseiller de nombreux gouvernements du tiers-monde (Afrique, Cuba, Chine…) sur les moyens d’adapter cette « révolution verte » à la situation de chaque territoire agricole. Il publie ainsi Les Leçons de l’agriculture américaine (1949), Voyages en France d’un agronome (1951), Économie agricole dans le monde (1954), Révolutions dans les campagnes chinoises (1957), Évolution des campagnes malgaches (1957), L’Afrique noire est mal partie (1962), Cuba, socialisme et développement (1964), Développement et socialismes (1969, avec Marcel Mazoyer). Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que Dumont infléchit sa vision de la « révolution verte », prenant en considération ses incidences sociales et environnementales. Bien que dénonçant dans L’Utopie ou la Mort les dégâts environnementaux du DDT (dont des dérivés sont utilisés comme herbicides) et des engrais (p. 59), il se refuse à « condamner tout emploi d’engrais chimique » et il estime encore que « l’agriculture biologique ne pourrait nourrir l’humanité » (p. 73).
Si, en 1973, Dumont n’a pas entièrement renoncé, à une agriculture intensive en intrants industriels, il est convaincu de la perspective d’un effondrement économique et social annoncé du fait des limites des ressources comme des capacités de la Terre à encaisser les dérèglements que lui infligent la course à la croissance et à l’accumulation. Alors que, dans les années 1950, pour écarter toute crainte « malthusienne » de surproduction future, il prônait l’adoption en France d’un régime carné à la néo-zélandaise (10 400 calories végétales directes et indirectes par jour et par personne, soit 50 % de plus que la moyenne française d’alors47), le voilà, en 1973, qui dénonce la surconsommation carnée des pays riches comme non généralisable aux « 7 milliards d’habitants de l’an 2000 », mettant sur une même balance les « 7 calories végétales [nécessaires] pour produire 1 calorie animale » et rappelant que les hectares labourables sont comptés, limités (p. 72). Présent, en 1949, à la conférence de la FAO sur les ressources, Dumont n’avait pas accepté les thèse portées par Vogt, Osborn et bien des savants naturalistes sur la finitude et de la fragilité de la Terre, persuadé que la planète était encore loin de fournir la totalité de son potentiel productif permis par l’usage des techniques les plus « rationnelles » et avancées. Or, un quart de siècle plus tard, Dumont ne croit plus aux sirènes techno-cornucopiennes qui feraient de la Terre une source d’abondance infinie grâce à la technique. Il fustige la généralisation de la voiture individuelle, s’oppose à l’énergie nucléaire et dénonce le mythe de technologies pouvant « sauver la planète » et assurer l’abondance de tous jusqu’au xxie siècle, mythe colporté face aux alertes écologiques par les Dr. Folamour de la guerre froide, tels Herman Kahn, l’un des précurseurs du négationnisme écologique et climatique48. Ayant constaté les limites de l’innovation technique comme solution suffisante aux problèmes planétaires, Dumont réfléchit à « un projet global de civilisation à basse consommation d’énergie et de minerais, vivant en harmonie avec la nature, donc capable de longue survie » (p. 228).
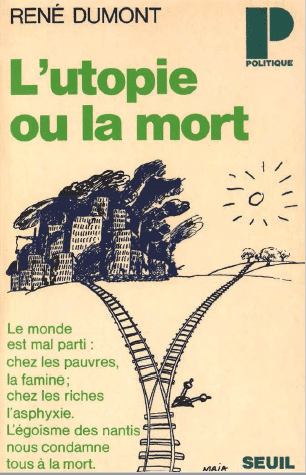
Un projet d’« écologie socialiste »
Bien que la connaissance des modèles et des résultats scientifiques du rapport Meadows a joué un rôle déclencheur dans la prise de conscience de René Dumont, ce dernier s’écarte cependant nettement du discours politiquement conservateur du club de Rome, du rapport Only one Earth comme du malthusianisme néocolonial alors en vogue aux États-Unis et dans les arènes internationales. À une défense technocratique et conservatrice des équilibres de la Terre, il oppose un projet socialiste de civilisation, une exigence radicale de « rapide réduction des injustices à l’échelle mondiale » (p. 214). À la posture scientiste prétendant modéliser la Terre et diriger « scientifiquement » son bon usage soutenable, il oppose « une transformation révolutionnaire » (p. 260), une planification démocratique et écologique. Aussi est-il très critique envers le rapport Meadows, « émanant de dirigeants de l’économie capitaliste » (p. 44), qui prétend prédire « un avenir prédéterminé » (p. 222) et qui « n’a pas voulu condamner » « notre capitalisme déclinant » (p. 213). Il invite à conclure de ce rapport que, vu « l’incapacité du capitalisme à prolonger “notre” civilisation, […] nous sommes “acculés” au socialisme » (p. 210).
Pour Dumont, le rapport Meadows marque un seuil clé en tant qu’acte de décès de la promesse développementiste selon laquelle les pays pauvres rejoindraient un jour le mode de vie des pays riches (p. 45). À partir de ce point de prise de conscience des limites, ceux qui en appellent encore à la poursuite de la croissance et de la consommation comme solution au rattrapage des inégalités entre territoires ou entre groupes sociaux– promesse pour laquelle il n’existe pas de Terre aux ressources suffisantes –, doivent être combattus pour ce qu’ils sont : des stratèges d’un sécessionnisme des riches vouant sciemment les plus pauvres des pays dominés à la catastrophe. Il est intéressant de noter que Dumont formule, dès 1973, le constat d’une sécession écologique des riches ayant parfaitement compris que leur mode de vie ne pouvait être partagé sur une Terre finie – sécession récemment popularisée par Bruno Latour, et dont Trump et Bolsonaro constituent l’expression politique contemporaine49. Si Dumont endosse ce constat majeur du Club de Rome quant aux limites terrestres et à l’impératif d’un « état d’urgence » écologique planétaire (p. 46), il estime que les responsabilités de la crise écologique sont différenciées selon les groupes sociaux et que les conséquences de celle-ci ont et auront des effets plus dramatiques sur la vie des populations pauvres des pays pauvres que sur celle des bénéficiaires de la société de consommation. De cette expérience des limites de la planète, Dumont déduit donc un projet socialiste, un socialisme de « disciplines matérielles » (p. 49), incluant une « discipline démographique » s’appliquant d’abord au Nord (p. 87) et une « discipline de consommation [qui] permettra l’aisance chez les plus démunis » (p. 210)50.
Dumont ne manque pas de propositions concrètes pour donner corps à son projet de civilisation : la taxation des familles nombreuses par l’impôt (p. 89); l’interdiction des automobiles privées (p. 119) en centre-ville (p. 116); la priorité du rail sur le trafic routier51 et le rationnement des voyages en avion (p. 170) ; l’égalisation des revenus et une fiscalité plus lourde sur les riches (p. 160) en vue de réduire leur consommation (p. 121) ; la croissance zéro de la consommation industrielle mondiale (la décroissance dans les pays riches pour permettre un certain accroissement au Sud) (p. 156) ; l’armement zéro (p. 158) ; le compostage pour l’agriculture des excréments (p. 183) et le retour des bouteilles consignées (p. 106) ; l’annulation de la dette du tiers-monde (p. 144) ; la réduction du temps de travail (p. 162)…
Dumont a également conservé sa conviction planiste des années 1930 et 1940, et promeut l’« allocation centralisée » et le « rationnement mondial des ressources rares [qui] se baserait sur la population de chaque pays en 1985» (p. 89) à travers des offices internationaux de vente des matières premières (p. 141 et 148) ; la taxation mondiale des produits pétroliers et autres ressources rares alimentant un fond mondial de développement (p. 147). Selon lui, « la protection nécessaire des climats […] et surtout des océans et de l’atmosphère postulera également une organisation planétaire dotée de réels pouvoirs, donc supranationale» (p. 148). Il tempère toutefois son dirigisme mondial par une dose de décentralisation et d’autogestion (p. 149) et un « socialisme libertaire, anarcho-syndicaliste, autogestionnaire » (p. 217).
À l’heure où des milliers de migrants sombrent chaque année au fond de la Méditerranée, où les désastres climatiques menacent massivement et en premier lieu les plus pauvres des pays dominés52 et où 1 % des humains s’approprient 82 % des richesses annuellement produites53, c’est moins par le constat des limites de la planète et des impasses du productivisme que par son analyse géopolitiquement différenciée des effondrements et par sa proposition d’une écologie socialiste anti-impériale que l’agronome au pull-over rouge aura fait œuvre de visionnaire.
La réception des thèses de Dumont dans la France des années 1970 et 1980
Si Dumont reprend sans hésiter le constat de l’impossibilité d’une
croissance indéfinie dans une planète finie du rapport Meadows, il n’adopte
nullement à un malthusianisme conservateur ou un catastrophisme
cynique où les famines et les épidémies feraient office de
« régulation » chez les pauvres. Il reconceptualise un mode de vie,
en voie de généralisation dans les pays riches depuis la Seconde Guerre
mondiale, comme injustice sociale envers les habitants des pays dominés,
puisque non partageable universellement. Sur une planète limitée, seul un
« socialisme de semi-austérité »(p. 118) réduisant le niveau de
« gaspillage » des riches, mais aussi des classes moyennes
occidentales, peut constituer une « option socialiste universaliste »
(p. 97). Le projet internationaliste se retrouve ainsi redéfini, écologisé.
Prolongeant les analyses du groupe Socialisme ou Barbarie, d’Herbert Marcuse ou d’André Gorz sur l’apprivoisement de la classe ouvrière par le consumérisme54, Dumont dénonce le modèle consumériste, et notamment « l’automobile privée pour tous », car, « une fois que l’on s’est bien embourgeoisé, il est difficile de retrouver de la solidarité internationale vraie »(p. 211). En résonance avec des théoriciens économistes, avec un anticolonialisme des « damnés de la Terre », avec l’ascension géopolitique des pays anciennement colonisés et avec un « tiers-mondisme » qui s’affirme en France55, Dumont affirme ainsi que la contradiction dans le capitalisme mondialisé s’est déplacée : les prolétaires d’aujourd’hui ne sont plus tant les ouvriers des pays riches que « les masses rurales, les habitants des bidonvilles et autres chômeurs et sous-employés miséreux des pays dominés » (p. 192). Ceux qui les exploitent sont bien sûr les entreprises capitalistes du Nord et les élites dirigeantes extraverties du Sud, mais aussi les classes aisées des pays riches, vivant dans le « gaspillage, devenu fonction essentielle, moteur indispensable de l’économie de profit » (p. 109).
On l’aura deviné, la gauche classique française se démarquera nettement des propositions et analyses de Dumont. Ses dirigeants, du PS à l’extrême gauche en passant par le PCF, ne veulent voir dans le rapport Meadows qu’un complot austéritaire des dirigeants capitalistes56. Appelant à voter « non » au référendum d’avril 1972 sur l’adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark, de l’Irlande et de la Norvège, Georges Marchais instrumentalise la lettre de Sicco Mansholt comme preuve d’un plan secret de « stopper la croissance économique – abaisser le niveau de vie –, enchaîner la souveraineté nationale57 ». Toute critique d’un modèle de consommation en passe de devenir insoutenable, tout essai de déterminer d’éventuelles limites aux capacités de la planète est sévèrement attaqué en France, non seulement du côté des milieux patronaux (le président du Conseil national du patronat français défend, en 1972, la poursuite de la croissance économique, pour « améliorer le niveau de vie des plus défavorisés »), par une intelligentsia dénonçant un retour d’un malthusianisme tant de fois démenti par les avancées de la raison et des techniques, mais aussi et surtout par la gauche du programme commun publié en juin 1972, qui ne comporte qu’un squelettique paragraphe sur les enjeux écologiques.

Dans ce paysage intellectuel et politique, on comprend que de jeunes militants et groupes écologistes aient été séduits par une personnalité de la stature de René Dumont pour porter leurs idées dans l’arène politique. Du fait de la notoriété de Dumont, dont L’Afrique noire est mal partie (1962) avait été un succès, de l’audience des débats ouverts par le rapport au Club de Rome et de la nouveauté du projet d’écologie socialiste qu’il esquisse, la publication de L’Utopie ou la Mort connaît un véritable succès éditorial. L’édition de 1973 se vend à 50 000 exemplaires, l’édition de poche parue dès 1974 atteint vite 90 000 ventes et l’ouvrage est traduit et publié en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en grec et en turc. Lorsque Georges Pompidou décède, de jeunes activistes écologistes (groupes de défense de l’environnement, antinucléaires, Amis de la Terre, etc.) se tournent vers Dumont pour représenter l’écologie à l’élection présidentielle d’avril 1974. Son identité passée d’expert productiviste incomplètement converti vaut à René Dumont les réserves de certains mouvements naturalistes ou d’agriculture biologique lors du processus de choix du candidat. Mais sa personnalité iconoclaste et tiers-mondiste comme son rejet du nucléaire et de l’automobile individuelle correspondent bien aux aspirations des courants de l’écologie passés par Mai 196858. Qui plus est, Dumont obtient le soutien de personnalités féministes et son programme présidentiel revendique la légalisation de l’IVG et une « égalité de droits et de pouvoirs pour les femmes, leur permettant de n’être plus cantonnées dans le rôle de mère59». L’Utopie ou la Mort inspire d’ailleurs Françoise d’Eaubonne, pionnière de l’écoféminisme, qui publie, début 1974, Le Féminisme ou la Mort, reliant enjeux démographiques, écologiques et refus d’une « gestion de nos corps confiée au Système mâle » :
Quand on sait […] qu’un petit Américain ou Suisse va détruire davantage que dix Boliviens, on mesure avec précision l’urgence d’un contrôle démographique mondial par les femmes de tous les pays […]. La seule solution à l’inflation démographique, c’est la libération des femmes, partout à la fois60.
Le manifeste électoral de 1974 s’intitule « Pour une autre civilisation61» et reprend les analyses et propositions de L’Utopie ou la Mort ainsi que d’autres éléments venant de l’équipe de campagne. Les passages à la télévision de cet homme sans cravate, au pull-over rouge, font sensation, mais son score (1,32 %) restera modeste dans un contexte dominé par le ralentissement de l’économie suite au premier choc pétrolier et aux espoirs d’une arrivée de la gauche au pouvoir (Mitterrand obtient 49 % au 2e tour face à Giscard d’Estaing). Reste que l’écologie politique est lancée sur la scène politique française, et Dumont en sera un parrain incontournable jusqu’à sa mort en 2001. En 1986, la liste qu’il dirige aux élections législatives (proportionnelle) à Paris obtient moins de 2 % des voix, du fait d’un décalage entre l’électorat parisien et son discours opposant « les riches des villes et les pauvres des campagnes62 » dans le tiers-monde. Ne peut-on y voir un symptôme de la difficulté, toujours actuelle, à faire émerger les plus affectés par les dérèglements environnementaux comme sujets politiques dans nos démocraties des pays riches ? La proposition politique la plus radicale de Dumont, celle de réinventer l’internationalisme sur une planète limitée, reste en tout cas inachevée et son assise socio-politique à construire.
Selon Dumont, dans le capitalisme contemporain, « le rôle des ouvriers, des paysans, des intellectuels » et des classes moyennes des pays riches doit être de se désolidariser de l’échange inégal et de la spoliation des communs planétaires, de refuser d’« accéde[r] à certains privilèges, que nous savons désormais impossibles à généraliser à l’échelle planétaire » (p. 119) sans dérèglements majeurs. Faute de ce choix décisif, poursuit-il, la situation d’effondrement pourrait conduire à « une vaste entreprise de génocide à l’échelle mondiale de l’ensemble du Quart-Monde, que l’on va “laisser crever”» (p. 120). Un demi siècle après cette mise en garde, alors que les dérèglements planétaires s’accélèrent, que l’individualisme numérique a accentué la domestication consumériste des classes moyennes globales par le techno-capitalisme, et que l’absence de tout début de réponse adéquate des élites économiques et politiques à l’enjeu existentiel de la catastrophe écologique et climatique en cours laisse pantois, on aimerait que Dumont se soit trompé au moins sur ce dernier point, et qu’une écologie de solidarité internationale pèse enfin sur l’évolution du monde.
Une écologie de solidarité internationale : vers la notion d’échange écologiquement inégal
Proche de Samir Amin et lecteur d’autres théoriciens marxistes tels André Gunder Frank ou Arghiri Emmanuel63, Dumont s’appuie dans L’Utopie ou la Mort sur leurs thèses pour rappeler que « l’accumulation à l’échelle mondiale a pu se faire au “centre” du système capitaliste mondial, en pays développés » (p. 124) via l’échange inégal avec les « pays dominés ». On sait que la théorie de la dépendance (puis celle des systèmes-monde d’Immanuel Wallerstein) a été développée pour saisir le double mouvement historique de globalisation de l’économie (convergence des territoires) et la perpétuation d’inégalités économiques entre régions du monde (asymétries entre territoires). Lors de chaque phase de l’histoire du capitalisme, un groupe de nations (au centre du système-monde) accumulent du capital, garantissent à leurs populations un niveau de vie supérieur à celui des autres régions du monde, maintiennent ce faisant l’ordre social sur leur territoire métropolitain et y financent leurs infrastructures, l’éducation, la santé, la mobilité et l’innovation. Ces États et les entreprises qu’ils protègent (des compagnies des Indes du xviie siècle aux GAFA d’aujourd’hui) ont le pouvoir économique et la force militaire pour prélever à bon prix dans les pays périphériques des matières premières, y exploiter une main-d’œuvre peu coûteuse, y écouler des marchandises et y valoriser des capitaux.
Dans les années 1970, la thèse d’un échange inégal entre territoires du « centre » et territoires des « périphéries » s’appuyait sur le calcul économétrique d’une dégradation des termes de l’échange Nord-Sud et sur le constat que, à valeur d’échange égale sur le marché mondial, un produit du centre contient moins d’heures de travail qu’un produit de la périphérie, conduisant cette dernière à devoir payer une heure des travailleurs du « centre » avec plusieurs heures de ses travailleurs.
Mais depuis les années 1990, d’autres unités de compte que le temps de travail sont venues enrichir la notion d’échange inégal : biologistes, chercheurs en économie écologique et historiens se sont mis à compter les « hectares fantômes » (empreinte écologique), la teneur en énergie, l’empreinte carbone, la quantité de matière ou d’eau, ou encore de produits toxiques et de déchets qui sont associés aux échanges commerciaux mondiaux. On a ainsi pu montrer que, pendant lesdites « Trente Glorieuses », une grande partie de la croissance des pays de l’OCDE fut le simple produit d’un influx accru d’énergie fossile ; que ces pays drainaient alors pour leur usage exclusif des milliards de tonnes de matières provenant du reste du monde, lui renvoyant en retour des nuisances écologiques (déchets, gaz à effets de serre dans l’atmosphère, dégradation des sols surexploités, etc.). Ces nouvelles données et méthodes ont fait évoluer certains théoriciens du marxisme vers un nouvel éco-marxisme64, elles ont mis au jour la dette écologique contractée par les pays dominants envers les pays dominés du fait d’échanges écologiquement inégaux, soulevant d’importantes questions (géo)politiques. Du constat de formes écologiquement inégales d’échange et de dette écologique entre territoires naît alors un renouvellement de l’idéal égalitaire, non plus seulement sous la forme de juste distribution des richesses économiques, mais aussi d’un accès égal de chaque habitant de la planète aux bienfaits (« ressources » ou « services ») des fonctionnements terrestres et d’une équité dans la distribution des nuisances (pollutions, conséquences du changement climatique, etc.). Cet enrichissement matériel et écologique du projet émancipateur et égalitaire est aujourd’hui au cœur d’une écologie politique de transformation sociale : justice environnementale, écologie décoloniale, approches égalitaires et internationalistes de la décroissance, écologie sociale, éco-marxismes et éco-socialismes…
Bien avant ces travaux de l’économie écologique et de l’éco-marxisme, dès 1973, Dumont conçoit non seulement le pillage des ressources, mais aussi l’altération de l’état écologique et climatique de la Terre comme une injustice sociale et une dimension majeure de l’échange inégal :
Ce qui reste sûr, c’est que nous déséquilibrons systématiquement un système fragile […]. Cette dégradation du patrimoine commun de l’humanité constitue une véritable spoliation par les entreprises ou les particuliers [notamment des pays riches et surconsommateurs] de la richesse collective. Spoliation qui peut parfois dépasser la plus-value prélevée sur l’ouvrier, ou même sur le consommateur : notion qu’il est urgent de réviser, amis marxistes. (p. 79)
L’échange écologiquement inégal et la déstabilisation de la Terre pour le bénéfice des plus riches, avec de graves conséquences frappant plus durement les plus pauvres, se voient donc reconnaître par Dumont autant d’importance que l’exploitation du marxisme orthodoxe. On retrouve là une thèse clé de l’éco-marxisme contemporain, formulée notamment par Jason Moore, qui ôte à l’exploitation le privilège de la création de plus-value : l’appropriation de l’activité des êtres (humain.e.s et non humains) et des processus terrestres est une dimension essentielle (non une simple condition de possibilité de l’exploitation du travail salarié) de la dynamique d’accumulation capitaliste65.
S’il ne s’est jamais considéré comme un théoricien de l’économie ou de l’écologie – il se voyait plutôt comme un homme de terrain, d’enquête et de conviction –, l’agronome aura pourtant apporté une contribution majeure aux théories de l’échange inégal, en faisant évoluer l’approche standard marxiste par l’ajout d’une composante écologique. René Dumont est donc l’un des pionniers de l’intégration de la valeur d’usage écologique dans l’édifice théorique de la critique de l’échange inégal. Il nous laisse en héritage à réinventer le projet égalitaire sur une Terre finie et sur les ruines des promesses industrialistes.
Notes
- Christophe Bonneuil, Préface à la réédition de René Dumont, L’utopie ou la mort, Points Seuil, 2020, p. 9-42[↩]
- Dumont, L’utopie ou la mort, op. cit., p.223[↩]
- p. 193, 221, 151.[↩]
- Le terme d’« effondrement » est employé 4 fois par René Dumont dans son ouvrage, celui de « survie » 91 fois. Avant que son éditeur, Jean Lacouture ne lui propose le titre L’Utopie ou la Mort, Dumont envisageait d’intituler son livre Fin d’une civilisation, cf. René Dumont, Agronome de la faim, Paris, Robert Laffont, 1977, p. 317.[↩]
- Serge Audier, L’Âge du productivisme. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques, Paris, La Découverte, 2019.[↩]
- John R. McNeill et Peter Engelke, The Great Acceleration : An Environmental History of the Anthropocene since 1945, Cambridge, Harvard University Press, 2014.[↩]
- Que ce soit grâce au GIEC, aux satellites, à la modélisation et au monitoring du système Terre, ou grâce à l’affirmation de l’anthropocène comme nouvelle époque géologique.[↩]
- Yannick Mahrane et al., « De la nature à la biosphère : la construction de l’environnement comme problème politique mondial, 1945-1972 », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2012/1, n° 113, p. 127-141 ; Yannick Mahrane et Christophe Bonneuil, « Gouverner la biosphère. De l’environnement de la guerre froide à l’environnement néolibéral, 1945-2013 », in Dominique Pestre (dir.), Le Gouvernement des technosciences. Gouverner le progrès et ses dégâts depuis 1945, Paris, La Découverte, 2014, p. 133-169.[↩]
- Michael Egan, Barry Commoner and the Science of Survival – The Remaking of American Environmentalism, Cambridge, The MIT Press, 2007.[↩]
- Élodie Vieille-Blanchard, Les Limites à la croissance dans un monde global. Modélisations, prospectives, réfutations, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2011, p. 244.[↩]
- National Environmental Policy Act en 1970, Clean Air Act en 1970, suivi du Clean Water Act en 1972 et de l’Endangered Species Act en 1973.[↩]
- Céline Pessis, Survivre et vivre. Critique de la science, naissance de l’écologie, Montreuil, L’Échappée, 2014.[↩]
- Sebastian V. Grevsmühl, La Terre vue d’en haut. L’invention de l’environnement global, Paris, Seuil, 2014.[↩]
- Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth : The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 239-286.[↩]
- Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers et William W. Behrens III, The Limits to Growth, New York, Universe Book, 1972. Traduction française complétée : Halte à la croissance ?, Paris, Fayard, 1972 (préface de Robert Lattès). Pour une confrontation aux trajectoires réelles et une mise à jour récente, voir Dennis Meadows, Donella Meadows et Jørgen Randers, Les Limites à la croissance (dans un monde fini) : Le rapport Meadows, 30 ans après, Paris, Rue de l’Échiquier, 2012. Pour une analyse du modèle et de sa réception, voir Élodie Vieille-Blanchard, Les Limites à la croissance dans un monde global, op. cit.[↩]
- René Dumont, Agronome de la faim, op. cit., p. 315.[↩]
- Cf. à l’occasion de la Conférence de Stockholm, le hors-série « Écologie » du Nouvel Observateur de juin-juillet 1972 intitulé « La dernière heure de la Terre ». Cf. aussi Christian Delporte, « “N’abîmons pas la France !”. L’environnement à la télévision dans les années 1970 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2012/1, n° 113, p. 55-66 ; Guillaume Sainteny, « Les médias français face à l’écologisme », Réseaux, n° 65, 1994, p. 87-105.[↩]
- Sur l’essor des recherches scientifiques environnementales après 1945, voir Yannick Mahrane et al., « De la nature à la biosphère », art. cit. ; Ronald Doel, « Quelle place pour les sciences de l’environnement physique dans l’histoire environnementale ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 56-4, 2010, p. 137-163 ; Paul N. Edwards, A Vast Machine. Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming, Cambridge, MA, MIT Press, 2010 ; Sebastian Grevsmühl, La Terre vue d’en haut. L’invention de l’environnement global, Paris, Seuil, 2014 ; Jacob D. Hamblin, Arming Mother Nature : The Birth of Catastrophic Environmentalism, Oxford University Press, 2013 ; Sabine Höhler, Spaceship Earth in the Environmental Age, 1960-1990, Londres, Pickering & Chatto Publishers, 2015.[↩]
- Barbara Ward et René Dubos, Only One Earth. The Care and Maintenance of a Small Planet, Londres, Penguin Books, 1972.[↩]
- Man’s Impact on the Global Environment. Assessment and Recommandations for Action – Report of the Study of Critical Environmental Problems (SCEP), Cambridge MA, MIT Press, 1970.[↩]
- Man’s Impact on the Global Environment, op. cit., voir notamment le rapport du groupe « Climatic effects of Man’s Activities », p. 46-55 et 82-88, ainsi que le résumé p. 11-12. Cf. aussi, Inadvertent Climate Modification. Report of the Study of Man’s Impact on Climate (SMIC). MIT Press, Cambridge, Mass., 1971. Pour un rapport plus ancien et ayant été discuté au sein des milieux pétroliers, voir President’s Science Advisory Committee, Environmental Pollution Panel Restoring the Quality of Our Environment : Report. Washington, DC, Executive Office of the President, 1965, p. 111-133.[↩]
- Ben Franta, « Early oil industry knowledge of CO2 and global warming », Nature Climate Change, n° 8, 2018, p. 1024.[↩]
- François Durand-Dastès, « La pollution atmosphérique et le climat », Total Information, n°47, 1971, 12-19, p. 18.[↩]
- Barbara Ward et René Dubos, Only One Earth, op. cit., p. 192-195 ; Cf. aussi les recommandations n° 70 et 79 de la déclaration finale de la conférence de Stockholm.[↩]
- Préface de Roger Heim, in Rachel Carson, Printemps silencieux, Paris, Plon, 1963, p. 12.[↩]
- S’éloignant de l’idée d’évolution lente qui dominait depuis Lyell et Darwin, des paléontologues et évolutionnistes élaborent l’idée d’extinction de masse à différents moments de l’histoire de la Terre : cf. Norman D. Newell, « Crises in the History of Life », Scientific American, 208 (2), fév. 1963, p. 76-92 ; Norman D. Newell., « Mass Extinctions at the End of the Cretaceous Period », Science, 27 août 1965, 149(3687), p. 922-924 ; Mikhail I. Budyko, « The causes of the extinction of some animals at the end of the Pleistocene », Soviet geography, 1967, p. 783-793.[↩]
- Paul S. Martin, « Africa and Pleistocene overkill », Nature, n° 212, 1966, p. 339-342 ; Paul S. Martin, « The Discovery of America », Science, 179(4077), 9 mars 1973, p. 969-974.[↩]
- L’expression de « sixième extinction » apparaîtra plus tard, suite à la publication des ouvrages de Norman Myers, The Sinking Ark : A new look at the problem of disappearing species, New York, Pergamon Press, 1979 ; Paul R. Ehrlich et Anne H. Ehrlich, Extinction : The Causes and Consequences of the Disappearance of Specie, New York, Random House, 1981.[↩]
- Parmi ces quatre Prix Nobel, il est significatif de trouver le biologiste moléculaire Jacques Monod, pourtant peu sensible aux problèmes écologiques.[↩]
- « SOS environnement. 2 200 savants s’adressent aux trois milliards et demi de Terriens », Le Courrier de l’Unesco, 7 juillet 1971, p. 4-5. Le secrétaire général de l’ONU accueille cet appel en déclarant : « Il existe sur (et autour de) la Terre un équilibre délicat entre les phénomènes physiques et biologiques, qui ne saurait être bouleversé étourdiment par notre ruée vers le développement […], ce grave danger général, qui porte en lui les prémices d’une extinction de l’espèce humaine. »[↩]
- René Dumont, Seule une écologie socialiste, Paris, Robert Laffont, 1977, p. 10.[↩]
- Dumont, L’utopie ou la mort, op. cit., p. 54.[↩]
- Vendus à plus de 20 millions d’exemplaires en plusieurs langues, les deux ouvrages de 1948 furent rapidement publiés en français : Fairfield Osborn, La Planète au pillage, Paris, Payot, 1949 ; William Vogt, La Faim du monde, Paris, Hachette, 1950. Voir Anna Trespeuch-Berthelot, « La réception des ouvrages d’alerte environnementale dans les médias français (1948-1973) », Le Temps des médias 2015/2, n° 25, p. 104-119.[↩]
- William Vogt, Road to Survival, op. cit., 1948, p. 287.[↩]
- Dumont préface ainsi élogieusement l’ouvrage d’un de ses amis abondancistes qui croise le fer Vogt et Osborn : Henri Jouis, Richesses insoupçonnées. Réponses à « La faim du monde » par William Vogt, Paris, Ledis, 1951.[↩]
- Bruno Villalba, « La conversion de l’écologie scientifique à l’écologie politique : retour sur la trajectoire de René Dumont », in Cécile Blatrix et Laurent Gervereau (dir.), Tout vert ! Le grand tournant de l’écologie. 1969-1975, Paris, Musée du Vivant-AgroParisTech, 2016, p. 59-70, ici p. 66.[↩]
- René Dumont et Bernard Rosier, Nous allons à la famine, Paris, Seuil, 1966.[↩]
- Cf. Les conférences mondiales sur la population de 1954 à Rome, 1965 à Belgrade et 1974 à Bucarest.[↩]
- Nations unies, The Determinants and Consequences of Population Trends : A Summary of Findings on Interaction of Demographic, Economic and Social Factors Population Studies, n° 50, New York, 1953 [suivi d’une mise à jour en 1973] ; Georg Borgström, The Hungry Planet : The Modern World at the Edge of Famine, New York, Macmillan, 1965 ; Paul Ehrlich, La Bombe P, Paris, Fayard, 1972 [1968, en anglais]. Pour des études historiques de ce malthusianisme d’après 1945 voir Alison Bashford, Global population. History, Geopolitics, and Life on Earth, New York, Columbia University Press, 2014 ; Björn-Ola Linner, The Return of Malthus. Environmentalism and Post-War Population-Resource Crises, The White Horse Press, Harris, 2003 ; Matthew Connelly, Fatal Misconception : The Struggle to Control World Population, MA, Cambridge, Harvard University Press, 2008.[↩]
- Dumont, L’utopie ou la mort, op. cit., p. 86, 88, 156, 170. Comme nombre d’intellectuels de gauche après 1968, Dumont, s’il rejette le modèle soviétique, n’est pas sans admiration pour le modèle chinois, dont il souligne l’efficacité en matière de contrôle des naissances.[↩]
- Sauvy partage avec son ami Dumont une même expérience dans les cabinets ministériels du Front populaire, puis dans les réseaux technocratiques du gouvernement de vichy, enfin dans les milieux planistes et modernisateurs autour de Jean Monnet à la Libération. Contrairement à Dumont, Sauvy intervient dans un sens nataliste au colloque « Population et développement » du Caire en 1973. Cf. René Dumont, Agronome de la faim, Paris, Robert Laffont, 1974, p. 328 ; Alfred Sauvy, Croissance zéro ?, Paris, Calmann-Lévy, 1973.[↩]
- Sur la base du rapport du Club de Rome, un autre socialiste planiste européen opère une conversion similaire à celle de Dumont (les deux hommes se connaissent) : il s’agit du Hollandais Sicco Mansholt, commissaire européen, qui écrit, en février 1972, au président de la Commission européenne pour proposer, outre une politique de contrôle démographique dans le monde, « une forte réduction [en Europe] de la consommation des biens matériels par habitant, compensée par l’extension des biens corporels (prévoyance sociale, épanouissement intellectuel, organisation des loisirs et des activités récréatives, etc.) ». Cette lettre est reproduite sur le site <http://ecorev.org/spip.php?article803>.[↩]
- Serge Audier, L’Âge du productivisme. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques, Paris, La Découverte, 2019.[↩]
- René Dumont, Voyages en France d’un agronome, Paris, Éditions M.-Th. Génin, 1951, p. 460. En 1973, Dumont défend une position inverse de « création d’emplois à la campagne » et de limitation de la croissance des grandes agglomérations (p. 173).[↩]
- Sylvain Brunier, « Faire du foin. Reconfiguration des savoirs agronomiques et expérimentation d’un nouveau régime de conseil agricole lors de la “révolution fourragère” (1945-1960) », in Margot Lyautey, Léna Humbert et Christophe Bonneuil (dir.), Histoire des modernisations agricoles au xxe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021 ; Wilfrid Séjeau, « René Dumont agronome », Ruralia, n° 15, 2004.[↩]
- René Dumont, Le problème agricole français, Paris, 1946, p. 215-217.[↩]
- René Dumont, « Le “prolétariat oublié” par l’expansion agricole », Esprit, vol. 23 , n° 227, juin 1955, p. 897-916, ici voir p. 912.[↩]
- Naomi Oreskes et Erik M. Conway, Les marchands de doute, Paris, Le Pommier, 2010, chap. 2. Kahn est la figure de scientifique “fou” qui a inspiré le personnage du Dr Folamour du film de S Kubrik.[↩]
- Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017.[↩]
- Sur le socialisme écologique de Dumont, voir notamment Alexis Vrignon, « René Dumont ou le socialisme “de l’arbre et du jardin” », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 130, 2016, http://chrhc.revues.org/4938 (consulté le 27 juillet 2017).[↩]
- On apprend p. 166 que, en 1972, le trafic routier a dépassé en France le trafic ferroviaire. Aujourd’hui, le rapport est de 88 % contre 12 %. Voir Alexandre Moatti, « René Dumont : les quarante ans d’une Utopie », 11 juillet 2014, https://laviedesidees.fr/Rene-Dumont-les-quarante-ans-d-une.html.[↩]
- Même si les pays riches en auront aussi leur part.[↩]
- Ces chiffres d’inégalités sont ceux d’Oxfam pour 2018.[↩]
- Paul Cardan [Cornelius Castoriadis], « Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne », Socialisme ou Barbarie, n° 31, décembre 1960- février 1961, p. 51-81, n° 32, avril-juin 1961, p. 84-111, et n° 33, décembre 1961-février 1962, p. 60-85 ; André Gorz, Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Paris, Seuil, 1964.[↩]
- Christoph Kalter, The Discovery of the Third World : Decolonization and the Rise of the New Left in France, c. 1950-1976, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.[↩]
- Timothée Duverger, « Le Parti socialiste et l’écologie, 1968-2011 », Paris, Éditions de la Fondation Jean Jaurès, 2011, p. 29-42 ; Philippe Buton, « L’extrême gauche française et l’écologie. Une rencontre difficile (1968-1978) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2012/1, n° 113, p. 191-203 ; Philippe Buton, « La gauche et la question écologique », Revue française d’histoire des idées politiques, 2016/2, n° 44, p. 63-92.[↩]
- Cité par Élodie Vieille-Blanchard, Les Limites à la croissance dans un monde global, op. cit., p. 435.[↩]
- Alexis Vrignon, La Naissance de l’écologie politique en France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 116.[↩]
- La campagne de René Dumont et ses prolongements. Objectifs de l’écologie politique, Paris, J.-J. Pauvert, 1974, p. 52.[↩]
- Françoise d’Eaubonne, Le Féminisme ou la Mort, Paris, Femmes en mouvement-P. Horay, 1974, p. 10 et p. 52-53. Voir l’importante étude d’Isabelle Cambourakis, « Un écoféminisme à la française ? Les liens entre mouvements féministe et écologiste dans les années 1970 en France », Genre & Histoire, n° 22, automne 2018.[↩]
- À vous de choisir l’écologie ou la mort, op. cit.[↩]
- Jean-Paul Besset, René Dumont. Une vie saisie par l’écologie, Pocket, 1994, p. 141.[↩]
- Samir Amin, L’Échange inégal et la Loi de la valeur, Paris, Anthropos, 1973 ; André Gunder Frank, Le Développement du sous-développement. L’Amérique latine, Paris, François Maspero, 1970 ; Arghiri Emmanuel, L’Échange inégal. Essai sur les antagonismes dans les échanges internationaux, Paris, François Maspero, 1969.[↩]
- On se réfère ici aux travaux de l’Institute of Social Ecology de Vienne, de Alf Hornborg ou encore de Jason Moore. Pour une bibliographie et une synthèse des notions de système-monde, d’échange inégal, d’échange écologiquement inégal et d’écologie-monde, voir Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, « Capitalocène. Une histoire conjointe du système Terre et des systèmes-mondes », in L’Événement Anthropocène. L’histoire, la Terre et nous, Paris, Seuil, « Points Histoire », 2016, p. 247-279.[↩]
- Jason Moore, Capitalism in the Web of Life, Londres, Verso, 2015[↩]





