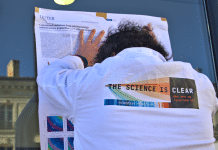Un point de prudence avant de commencer…
La pandémie de Covid-19 et sa gestion, à la croisée des sciences et de la politique, ont suscité des débats nombreux, parfois violents. Nous connaissons tou·tes des groupes, des familles, des collectifs qui ont été déchirés par ces désaccords, aboutissant à une fragmentation toujours plus nette du tissu social en France. Tout cela est la conséquence directe de la politique d’un gouvernement qui fabrique le séparatisme comme l’envers stratégique du consentement, rendant encore plus difficile toute tentative de penser la situation autrement que sur le mode du clash.
Au sein du collectif de rédaction de Terrestres, ces désaccords existent aussi et ils ont donné lieu à des discussions parfois vives entre nous. Pour autant, nous avons toujours tenté de faire vivre ces dissensus, en les envisageant non pas comme des motifs de scission, mais plutôt comme les signes d’une vie intellectuelle et démocratique intense, dont nous essayons aussi de témoigner dans nos colonnes.
Revendiquer la fécondité de ces dissensus pour mieux faire émerger une description juste et plurielle de la situation contemporaine, voilà aussi le signe d’un attachement à ce qu’Isabelle Stengers appelle l’irréduction, c’est-à-dire la méfiance à l’égard de toutes les thèses qui impliquent, plus ou moins explicitement, « le passage de “ ceci est cela ” à “ ceci n’est que cela ” ou “ est seulement cela1 ” ».
Tenir ainsi à l’irréduction contre la réduction d’une situation à une explication définitive, c’est aussi résister à tout ce qui cherche à se draper dans la pureté de l’évidence, c’est-à-dire d’une vérité dévoilée. Ainsi, examiner la manière dont une thèse peut en faire balbutier une autre, la compléter, l’infléchir ou en renforcer la pertinence, voilà une toute autre affaire que de chercher une thèse officielle ou alternative qui révèlerait enfin le vrai d’une situation — et de préférence tout le vrai.
C’est pour ces raisons que nous avons collectivement décidé de continuer à publier une variété de textes sur la situation pandémique. Des textes qui ne reflètent pas forcément le point de vue de l’ensemble des membres du collectif de rédaction. Des textes avec lesquels certain·es d’entre nous sont même parfois en franc désaccord. Mais des textes qui nous semblent à même, par leur diversité et les rencontres qui en procèdent, d’esquisser ensemble un tableau analytique de la situation pandémique et politique.
La tâche n’est pas facile, mais nous essayons de faire de notre mieux, en respectant la temporalité qui est celle de la revue : celle du recul et de la réflexion, plutôt que celle de la réaction et de la polémique. Aussi, n’hésitez pas à nous suggérer des textes qui pourraient contribuer à ce travail lent et patient de description et d’éclairage du présent.
Bonnes lectures dans les méandres !
Le collectif de rédaction de Terrestres
Entretien réalisé le 21 juin 2020 par Aurélien Gabriel Cohen.
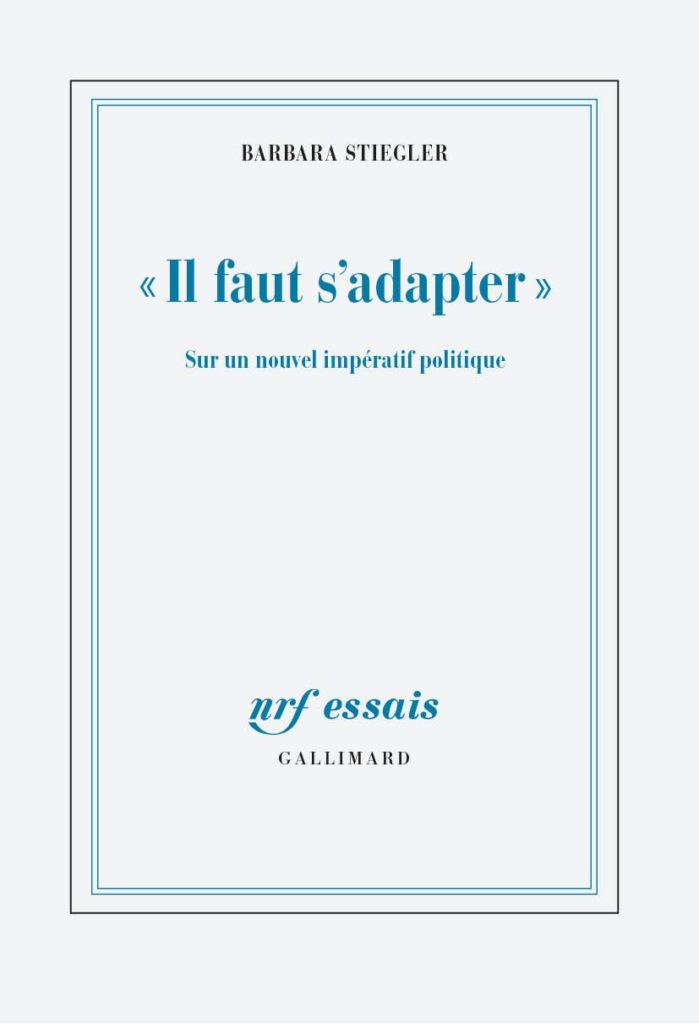
Dans un débat philosophique célèbre du début du 20e siècle, que vous étudiez en détails dans votre ouvrage « Il faut s’adapter1 », les penseurs américains Walter Lippmann et John Dewey s’opposent sur les formes et les conditions du gouvernement en démocratie. À un Lippmann néolibéral, persuadé de l’apathie intrinsèque des masses et qui en appelle à un gouvernement des experts, répond Dewey et sa démocratie radicale, dans laquelle le rôle principal du gouvernement est de faciliter l’appropriation par les collectifs des problèmes qu’ils rencontrent : ce qu’il appelle la formation de « publics ». En quoi ce débat et les concepts de ces auteurs vous semblent-ils importants pour penser les modalités du gouvernement de la pandémie en France ?
Ce que l’on a retrouvé, lors de cette crise sanitaire, comme composante essentielle du néolibéralisme, c’est la conviction du caractère irrationnel des populations, et l’idée que seuls les experts, conseillant les gouvernants, étaient à même de nous mener dans la bonne direction. L’idée qui a prévalu, c’est que la science était du côté des élites et que toutes les décisions devaient être prises en haut lieu et dans le secret des cabinets. A quoi s’est ajoutée une deuxième idée, typique du dispositif néolibéral : celle d’une nécessaire fabrication ou « manufacture » (pour parler comme Walter Lippmann) du consentement des populations aux décisions de santé publique : la fameuse « acceptabilité sociale » des mesures gouvernementales, qui était déjà au cœur du discours dominant dans le monde de la recherche depuis au moins deux décennies. Dans la plupart des programmes de recherche en effet, les sciences humaines et sociales sont désormais convoquées pour fabriquer « l’acceptabilité sociétale » des innovations, elles-mêmes coproduites par les sciences dites dures et les sciences appliquées. La dimension critique des sciences sociales est niée au profit de leur instrumentalisation par l’agenda économique et technologique des forces dominantes. La thèse qui sous-tend cette conception dominante de la recherche, c’est que les populations sont toujours en retard sur le progrès et qu’il faut les réadapter sans cesse au flux incessant des innovations grâce à une ingénierie sociale qui corrige ses biais, pour certains hérités de la longue histoire évolutive de l’espèce humaine. C’est la théorie actuelle du nudge2, de l’incitation douce au changement de comportement, qui prolonge les analyses de Lippmann sur le retard des masses et sur leur nécessaire prise en main par les experts. Dans le contexte de la crise sanitaire, cette doxa des élites dirigeantes a conduit à toute une série de manipulation de l’opinion, à laquelle on a délivré des informations au compte-goutte pour conjurer son irrationalité prétendue et sa tendance supposée à la panique et à l’affolement. Pensons notamment à la folle semaine qui a précédé le confinement et pendant laquelle il est clair que le pouvoir nous a caché l’essentiel. Or, il est intéressant de voir à quel point ce dispositif a en partie échoué. Si une partie de la population a visiblement jubilé d’assister à la reprise en main de nos vies par le pouvoir, avec son inflation de règlements et de décrets autoritaires, si certains ont versé dans l’excès de zèle et la délation, nous rappelant les pires heures de notre histoire, beaucoup d’entre nous se sont sentis manipulés et infantilisés par les discours des autorités, ce qui a conduit à aggraver la défiance du pays, déjà très profonde, contre le pouvoir en place. A côté de cette conception autoritaire du pouvoir et du gouvernement des experts, beaucoup aspirent à un autre rapport à la démocratie, tout à fait conforme à ce que défend le philosophie pragmatiste John Dewey, et dans lequel on fasse enfin confiance à l’intelligence collective des publics concernés. Ce qui suppose que le savoir scientifique sorte du secret des cabinets, des commissions et des hauts conseils, pour être mis au centre de la Cité, et qu’il devienne l’enjeu d’une véritable enquête collective. Telle devrait être précisément la mission de l’école, des laboratoires et de l’Université, qui subissent aujourd’hui des attaques incessantes du pouvoir, avec la réforme Blanquer du bac et du lycée et avec la LPPR, Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche, aggravant la compétition et la précarité qui détruit déjà nos métiers. On le voit, la recherche et l’éducation sont à la croisée des chemins : elles sont désormais l’enjeu d’une véritable bataille politique entre ceux qui souhaitent l’asservir aux besoins de l’innovation, de l’adaptation et de la capitalisation individuelles des compétences, et ceux qui veulent la mettre au service de la pensée critique, de l’intelligence collective et de la démocratie.
On a souvent tendance à confondre l’ultralibéralisme, qui serait essentiellement une économie politique du laisser-faire absolu, et le néolibéralisme, dont vous expliquez dans votre livre qu’il est davantage une théorie anthropologique et politique de l’adaptation au marché mondialisé qu’une doctrine économique stricto sensu3. Comment analysez-vous les hybridations et les distinctions entre ces deux formes théoriquement contradictoires de libéralisme dans les politiques actuelles, et en particulier dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 ?
La gestion de la crise par le pouvoir a très bien montré tout ce qui séparait le néolibéralisme du libéralisme classique et du laisser-faire. Tandis que les véritables libéraux ont toujours été très réticents face aux mesures contraignantes de santé publique, et tandis que les ultra-libéraux n’ont pas hésité à laisser mourir les plus fragiles plutôt que de contraindre les agents économiques, les néolibéraux qui gouvernent actuellement la France ont retrouvé, avec les mesures sanitaires, le moyen de restaurer leur pouvoir. Le contrôle de la population et de ses comportements, par principe inadaptés, par des règles de droit, la prise de pouvoir par l’éducation et par une certaine organisation du travail, pensée par les managers, l’adaptation à marche forcée au numérique et à ses innovations, la conduite du troupeau par le savoir des experts, le guidage disciplinaire des pulsions : tout ceci compose en effet, comme je le rappelais pour commencer, les ingrédients fondamentaux de la manière néolibérale de gouverner. Certes, les mesures de confinement sont allées dans un premier temps à contre-sens de l’agenda néolibéral, tourné au contraire vers la mondialisation, vers l’accélération des rythmes et des mobilités et vers la destruction de toutes les frontières. Et c’est ce qui explique probablement le retard pris par le pouvoir pour accepter à son tour de telles mesures. Rappelons l’attitude d’Emmanuel Macron qui, dix jours avant le confinement, se mettait en scène allant au théâtre et déclarait qu’il ne fallait rien changer à nos attitudes de vie. Mais après un moment de doute et de vacillement, le retour des mêmes manières de gouverner à travers le numérique a produit une sorte de compensation et a laissé penser au pouvoir qu’il disposait là d’une voie fondamentale pour avancer ses propres projets. C’est ainsi par exemple que je comprends la fermeture autoritaire des universités françaises. Alors que tous les établissements publics rouvrent à nouveau, les universités sont en effet condamnées au « numérique » et au « distanciel » car le pouvoir en place voit là une opportunité inédite d’avancer ses plans : ceux d’un enseignement stéréotypé et automatisé, entièrement soumis aux diktats des forces économiques dominantes, et qui n’auraient plus à redouter, ni la résistance des étudiants, tous atomisés devant leurs écran, ni celle des enseignants-chercheurs, progressivement remplacés par des capsules vidéos et des moocs duplicables à l’infini. C’est ce qui s’est majoritairement passé dans l’enseignement de la médecine et des professions de santé, produisant une destruction méthodique de la pensée critique et une tendance à automatiser les décisions, sous la pression des guidelines, des algorithmes et des arbres de décision. Et c’est aussi ce que prévoit les fameux « plans de continuité des activités » (PCA), traduction française pour les « business continuity plans ». Théorisé depuis les années 1990 par le management du risque, à travers notamment le Business Continuity Institute qui délivre des formations suivies par les dirigeants du monde entier, l’idée s’est imposée que nous étions en train d’entrer dans une période de catastrophes incessantes (écologiques, industrielles, terroristes) qui risquait de conduire les populations à la défiance et au questionnement. Face à ce risque, le but avoué de ces « plans » est d’utiliser les catastrophes et leur effet de sidération sur les esprits pour reprendre les populations en main, à partir de directives qui partent des instances dirigeantes et qui se diffusent dans tous les organes de directions publics et privés, et qui permettent de poursuivre la transformation des sociétés au service de l’innovation. Rien d’étonnant dès lors à ce que le pouvoir en place instrumentalise la crise pour déployer ses vastes projets de numérisation des services publics, tant dans l’administration que dans la santé ou l’éducation.
On entend de plus en plus, dans la bouche des gouvernants, une sorte d’injonction rampante selon laquelle « il va falloir vivre avec le virus ». Si tout cela part du constat évident que nous ne disposons ni de vaccin, ni de traitement, il me semble que quelque chose d’autre se joue à cet endroit, a fortiori si l’on considère l’importance des théories néolibérales dans l’idéologie gouvernementale dominante et dans ses techniques de gouvernement. L’entrée en scène du virus produirait ainsi une complexification soudaine et brutale de l’environnement mondialisé, quelque chose comme une nouvelle version de cette « Grande Société » globale, à laquelle Lippmann nous pensait collectivement inadaptés. Et là-aussi, on commence à entendre dans les discours politiques la rengaine habituelle qui veut que toute crise, y compris une pandémie, soit aussi un défi à relever, une chance à saisir et une opportunité pour innover4. En quoi la théorie néolibérale de l’adaptation joue-t-elle à votre avis un rôle dans les actualisations de ces impératifs ?
C’est très juste. Il y a quelque chose de suspect dans ce discours selon lequel nous allons devoir apprendre à vivre autrement, c’est-à-dire à distance les uns des autres et rivés devant nos écrans. Au fond, tous ces discours malsains sur la « nouvelle culture » que les Français devraient adopter, et que les Asiatiques, eux, auraient déjà incorporée dans leur manière de vivre, dénote une volonté des élites dirigeantes de détruire la société comme corps collectif susceptible de conflit et de résistance. En lieu et place des phénomènes sociaux, qui portent toujours avec eux la possibilité du mouvement social, de la mobilisation et de la contestation, mais aussi d’une intelligence collective inventive qui résiste à la concentration du pouvoir dans les mains des seuls dirigeants, les adorateurs de cette nouvelle culture du masque et de la distanciation rêvent d’une société dans laquelle ne prévaudrait que la compétition entre individus ou entre foyers privés, tous bien séparés les uns des autres. Ainsi de l’École, qui devient l’outil virtuel d’une capitalisation de compétences pour les descendants de chaque famille, mais qui perd toute dimension sociale et politique : celle d’une formation à la citoyenneté, dans sa dimension nécessairement collective. Il est assez cocasse de se souvenir que les mêmes prônaient, au lendemain des attentats de 2015, l’éternité prétendue de la culture française : celle des terrasses de café, où tout le monde s’assemble et s’affiche à visage découvert. C’était une autre époque, celle où il s’agissait d’abord d’affirmer notre identité occidentale contre celle, menaçante, venue de l’Islam et de l’Orient. Dix-huit mois de mobilisation sociale hors du commun ont imposé aux mêmes chroniqueurs une nouvelle urgence : celle de disqualifier la culture française elle-même, dans sa dimension contestataire, politique et révolutionnaire. De là, sûrement, cette adoration béate et pour le moins surprenante d’un espace public où chacun se tiendrait masqué et à distance des autres. Renforcé par l’idée que puisque nous ne devons surtout rien changer à la conduite des affaires, nous allons nécessairement entrer dans un monde de catastrophes écologiques et sanitaires auquel nous devons apprendre à nous adapter grâce, en effet, à l’adoption de nouveaux comportements, entièrement soumis aux consignes des experts, et au pouvoir de résilience prêté à l’innovation.
Tout un courant de l’écologie politique, en envisageant notamment le problème de la cohabitation avec les autres vivants et de la capacité des sociétés thermo-industrielles à se transformer pour composer avec des formes complexes d’altérité non-humaine, pose aussi la question d’une certaine adaptation des collectifs humains face à la catastrophe écologique systémique. S’agissant du virus, l’une des hypothèses avancée sur son surgissement propose d’ailleurs de l’interpréter comme une alerte face à la catastrophe en cours, une idée encore renforcée si l’on considère que son émergence s’inscrit clairement dans les structures d’exploitation industrielle et capitaliste du monde5. Dans cette perspective, ce nouveau virus agirait en quelque sorte comme un appel à nous adapter, ou plutôt à composer autrement avec un milieu-monde qui nous signalerait de plus en plus explicitement la toxicité et l’inadéquation de nos manières de l’habiter. En quoi ces propositions et leurs conséquences politiques vous semblent-elles différentes de l’injonction néolibérale à l’adaptation des masses dont nous venons de parler ?
C’est en effet une direction complètement inverse et c’est assurément celle qu’aurait choisi Dewey. Tandis que Lippmann attend des populations qu’elles s’adaptent à la révolution industrielle et à ses conséquences, Dewey comprend l’adaptation en un sens rigoureusement inverse. La révolution industrielle réclame que nos intelligences collectives se saisissent du savoir scientifique pour mener ce qu’il appelle des « enquêtes » et déterminer ensemble les fins que nous souhaitons poursuivre. Dans un tel processus expérimental, qui suppose que les laboratoires se mettent au service des publics (et non l’inverse, comme le préconise la fameuse « acceptabilité sociétale des innovations »), les publics ont pour mission de transformer l’environnement en luttant contre les effets délétères de l’industrialisation. Au lieu de s’adapter à un monde de catastrophes incessantes, il s’agit de reprendre en main le cours des choses pour refuser cet état de fait. Or un tel virage suppose de sortir la science, les laboratoires et les universités de la mainmise qu’exercent actuellement conjointement les agences gouvernementales et le monde économique. Pour Dewey, experts et scientifiques doivent au contraire se mettre au service des publics et de leurs problèmes. L’idée n’est pas de réagir au coup par coup aux urgences médiatiques, mais de se nourrir des questions conflictuelles qui traversent en profondeur le corps social. Tel devrait être, pour Dewey, la véritable racine du savoir scientifique et le sens profond de toute expérimentation collective.
Vous menez également depuis plusieurs années des recherches autour de la question du soin. Or, on voit de nombreux témoignages de soignants6 qui, bien qu’épuisés par le pic épidémique, disent paradoxalement craindre la fin de l’état d’exception dans les hôpitaux et en particulier le retour à un management administratif du soin, ce qui était la norme avant la crise du Covid-197, après une phase épidémique qui se serait finalement caractérisée par une plus grande liberté dans l’organisation pratique et clinique, et par une priorité donnée au soin au détriment des logiques gestionnaires. Comment continuer à résister à ce retour d’un management vertical, en poursuivant ce qui peut ressembler à une forme d’expérience autogestionnaire ? Et comment profiter de l’occasion paradoxale que constitue l’épidémie pour repenser l’organisation et les modalités du soin, pour les soignants comme pour les patients ?
Cette crise a en effet contribué au discrédit du pouvoir des managers, même si ces derniers ont bien souvent profité de la catastrophe pour déployer leur énergie gestionnaire et réglementaire. Cette situation fait dire à certains que la Covid-19 pourrait contribuer à restituer l’hôpital aux soignants. Mais le risque ici, c’est le retour des mandarins et d’une hiérarchie hospitalière dans laquelle l’immense majorité des soignants resteraient exclus des processus de décision. La seule solution à mes yeux, c’est que des publics se constituent au sens de Dewey, c’est-à-dire des instances clairement politiques alliant soignants, chercheurs, patients et citoyens qui se battent, dans l’arène sociale et politique, pour imposer un autre rapport à la recherche et à la santé. Tout ceci milite pour un rapprochement urgent entre les secteurs en lutte. Il est temps que l’hôpital, l’université et l’école sortent de leurs revendications sectorielles et « apolitiques » pour mener un conflit résolument politique autour des questions de recherche, d’éducation et de santé. Il est temps aussi et surtout de se souvenir que la politique est l’une des activités les plus nobles qui soit donnée de vivre à un être humain et que nous sommes tous appelés à prendre notre part dans les conflits qui traversent la Cité. De ce point de vue, je retiendrai une seule grande leçon positive de cette pandémie : elle a contribué à faire de la santé publique, et je l’espère aussi de la recherche, une question résolument politique, n’intéressant plus seulement les experts et les spécialistes, mais l’ensemble des citoyens. Au lieu de le déplorer et de renvoyer les citoyens à leurs préoccupations privées, nous devrions tous nous réjouir que la santé et le savoir scientifique aient désormais, aux yeux de tous, le statut de choses publiques.
Barbara Stiegler publiera le 20 août 2020, aux éditions Verdier, un nouveau livre, Du cap aux grèves. Comment sortir d’un demi-siècle de dépolitisation et d’atomisation pour faire naître des collectifs réels et vivants, où chacun se risque en chair et en os ? Comment faire basculer la mobilisation toute virtuelle de nos écrans dans la réalité physique des temps et des lieux ? Comment débloquer l’imaginaire, et parvenir à articuler les vieux concepts aux nouveaux affects qui nous envahissent ? Comment se débarrasser, enfin, de l’obsession du programme, du plan ou de l’agenda mondial, qui ne nous conduit qu’à l’impuissance ? Autant de questions auquel ce livre tente de répondre avec les armes de la philosophie politique.
Illustration principale — Walter Lippmann Symposium, Août 1938
Notes
- Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter » Sur un nouvel impératif politique, Gallimard, 2019.[↩]
- Aussi appelée « théorie du paternalisme libéral », elle a été définie en ces termes par l’économiste Richard Thaler et le juriste Cass Sunstein : « Le nudge, le terme que nous utiliserons, est un aspect de l’architecture du choix qui modifie le comportement des gens d’une manière prévisible sans leur interdire aucune option ou modifier de manière significative leurs motivations économiques. Pour ressembler à un simple « coup de pouce », l’intervention doit être simple et facile à esquiver. Les « coups de pouce » ne sont pas des règles à appliquer. Mettre l’évidence directement sous les yeux est considéré comme un coup de pouce. Interdire uniquement ce qu’il ne faut pas faire ou choisir ne fonctionne pas. » Thaler et Cass, Nudge – La méthode douce pour inspirer la bonne décision, Vuibert, 2010. (N.D.L.R.) [↩]
- On trouve également une clarification efficace de cette confusion sous la plume de Pierre Dardot et Christian Laval, notamment dans ce court texte : https://blogs.mediapart.fr/christian-laval/blog/120414/ultraliberalisme-liberalisme-et-neoliberalisme (N.D.L.R.) [↩]
- Voir par exemple la tribune du ministre de la Santé allemand, et notamment le dernier paragraphe : « Comme la plupart des crises, celle-ci offre une chance à saisir. Dans de nombreux domaines, elle nous a révélés au meilleur de nous-mêmes : un sens nouveau de la communauté, un plus grand désir d’aider les autres, des capacités d’adaptation et de créativité renouvelées. Il ne fait aucun doute que les conséquences à moyen terme de la pandémie seront rudes. Mais malgré toutes les difficultés et toutes les incertitudes qui nous attendent, je demeure optimiste. En Allemagne et ailleurs, nous sommes les témoins de ce dont nos démocraties libérales sont capables. » (N.D.L.R.) [↩]
- Sur les liens entre la pandémie et les circulations des capitaux au profit de la déforestation et de l’agro-industrie, voir Wallace & al., « Le Covid-19 et les circuits du Capital », https://www.terrestres.org/2020/04/30/le-covid-19-et-les-circuits-du-capital (N.D.L.R.) [↩]
- Voir par exemple : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/04/a-l-hopital-la-crainte-d-un-retour-au-fonctionnement-d-avant_6038586_3244.html (N.D.L.R.) [↩]
- Comme en témoigne ce documentaire : https://www.lemediatv.fr/emissions/les-documentaires/le-prix-de-la-vie-plongee-dans-lhopital-public-gLYfccULSMWQOamq6oApcA (N.D.L.R.) [↩]