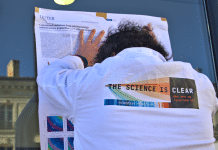Un point de prudence avant de commencer…
La pandémie de Covid-19 et sa gestion, à la croisée des sciences et de la politique, ont suscité des débats nombreux, parfois violents. Nous connaissons tou·tes des groupes, des familles, des collectifs qui ont été déchirés par ces désaccords, aboutissant à une fragmentation toujours plus nette du tissu social en France. Tout cela est la conséquence directe de la politique d’un gouvernement qui fabrique le séparatisme comme l’envers stratégique du consentement, rendant encore plus difficile toute tentative de penser la situation autrement que sur le mode du clash.
Au sein du collectif de rédaction de Terrestres, ces désaccords existent aussi et ils ont donné lieu à des discussions parfois vives entre nous. Pour autant, nous avons toujours tenté de faire vivre ces dissensus, en les envisageant non pas comme des motifs de scission, mais plutôt comme les signes d’une vie intellectuelle et démocratique intense, dont nous essayons aussi de témoigner dans nos colonnes.
Revendiquer la fécondité de ces dissensus pour mieux faire émerger une description juste et plurielle de la situation contemporaine, voilà aussi le signe d’un attachement à ce qu’Isabelle Stengers appelle l’irréduction, c’est-à-dire la méfiance à l’égard de toutes les thèses qui impliquent, plus ou moins explicitement, « le passage de “ ceci est cela ” à “ ceci n’est que cela ” ou “ est seulement cela1 ” ».
Tenir ainsi à l’irréduction contre la réduction d’une situation à une explication définitive, c’est aussi résister à tout ce qui cherche à se draper dans la pureté de l’évidence, c’est-à-dire d’une vérité dévoilée. Ainsi, examiner la manière dont une thèse peut en faire balbutier une autre, la compléter, l’infléchir ou en renforcer la pertinence, voilà une toute autre affaire que de chercher une thèse officielle ou alternative qui révèlerait enfin le vrai d’une situation — et de préférence tout le vrai.
C’est pour ces raisons que nous avons collectivement décidé de continuer à publier une variété de textes sur la situation pandémique. Des textes qui ne reflètent pas forcément le point de vue de l’ensemble des membres du collectif de rédaction. Des textes avec lesquels certain·es d’entre nous sont même parfois en franc désaccord. Mais des textes qui nous semblent à même, par leur diversité et les rencontres qui en procèdent, d’esquisser ensemble un tableau analytique de la situation pandémique et politique.
La tâche n’est pas facile, mais nous essayons de faire de notre mieux, en respectant la temporalité qui est celle de la revue : celle du recul et de la réflexion, plutôt que celle de la réaction et de la polémique. Aussi, n’hésitez pas à nous suggérer des textes qui pourraient contribuer à ce travail lent et patient de description et d’éclairage du présent.
Bonnes lectures dans les méandres !
Le collectif de rédaction de Terrestres
Une ritournelle se fait entendre depuis quelques semaines : « Il ne faut pas imaginer que nous retournerons à nos vies d’avant le Covid-19 ». Non, c’est certain. Cette expérience est indubitablement transformatrice. Les récits qui nous sont le plus souvent imposés empêchent cependant de saisir la profondeur de certaines de ces transformations, en ne permettant pas, par exemple, de reconnaître la pluralité des formes de rencontres entre des humains et des virus.
Les récits épidémiques reposent de bien des façons sur un Grand Partage entre les sociétés humaines et une nature qui leur serait extérieure et profondément hostile. Ils reconduisent ainsi les idées d’une exceptionnalité humaine et d’une commune humanité éprouvée par l’intrusion d’une altérité radicale : des frontières semblent délimiter strictement ce qui est soi et ce qui est autre, ce qui est humain et ce qui ne l’est pas. Tout paraît clairement défini, borné, délimité dans cet ordre des choses – et tout doit être fait pour le maintenir ou le restaurer dans la stabilité qu’on lui suppose. Nous ne retournerons pas à nos vies d’avant, mais un peu quand même.
Dans les sciences – dans les théories, les hypothèses et les pratiques développées par les chercheurs1 –, mais aussi dans les sphères politique et médiatique, l’usage des métaphores façonne les différentes manières d’appréhender le vivant2 D’un côté, cependant, les expériences différenciées que font les humains de l’épidémie de Covid-19, en fonction de la classe sociale, du genre, du lieu de vie, de la situation familiale et professionnelle, de la nationalité, de l’état des systèmes de soins ou encore des mesures choisies par chaque pays ne permettent guère l’uniformisation de leurs vécus dans leurs relations aux virus. D’un autre côté, les « microbes » continuent d’être réunis dans une catégorie qui est pourtant loin d’être cohérente, homogène et invariable. Et les récits en termes de guerre ou de paix, d’ennemi à abattre ou, dans une version plus romantique, d’amis dont il faudrait prendre soin, se déploient le long d’un spectre supposant de prêter à la catégorie des microbes des objectifs et des finalités qui échappent pourtant aux humains.
Avec l’apparente unité de la catégorie de « microbes », fondée sur une caractéristique unique (l’invisibilité ou la quasi invisibilité des microorganismes à l’œil nu), des millions d’entités biologiques se trouvent assignés à un mode d’existence qui leur serait commun. Cette catégorie regroupe des organismes aussi divers que les bactéries, les protistes, certains champignons microscopiques, des algues, les planaires, les amibes, certains constituants du plancton, et les virus. Ces derniers sont ce que les scientifiques appellent des parasites stricts, des entités qui ne peuvent survivre sans un organisme hôte. De façon schématique, un virus pénètre dans une cellule spécifique d’un organisme lui-même spécifique et utilise la machinerie métabolique de ce dernier pour se reproduire. Pour certains virologues ou philosophes de la biologie, cette dépendance des virus envers leurs hôtes rend impropre leur classification dans le monde vivant : incapables de survivre seuls, ils seraient « à la marge ». Non vivants, mais pas inorganiques. Ce débat risque de ne pouvoir être tranché avant longtemps, car le développement des connaissances vient régulièrement ajouter des données difficiles à conceptualiser. L’existence de virophages, de petits virus qui infectent des virus plus gros, fait par exemple tomber le dogme selon lequel un virus ne pourrait être qu’un parasite et non un hôte : les virus peuvent à leur tour être infectés.
Il est pourtant possible de conceptualiser le problème autrement : un parasite strict ne peut être pensé sans son hôte, dans la mesure où son existence est rendue possible par les relations qu’il instaure avec lui. Ce que les virus nous obligent donc à penser, c’est moins la frontière entre le vivant et l’inerte que la nature fondamentalement relationnelle des entités biologiques. Si le séquençage des virus permet de rendre compte de leur incroyable diversité génétique3, la majeure partie des caractéristiques, capacités et compétences d’un virus donné ne peut être étudiée expérimentalement, comprise et assimilée que dans le cadre des interactions instaurées par celui-ci avec la ou les espèces (animale, végétale ou bactérienne par exemple) qu’il infecte, et avec lesquelles il évolue. Ces devenirs dans et par les relations rendent particulièrement difficiles les tentatives de systématisation. Ce sont bien eux qu’il s’agit de penser. Et l’on peut espérer, ce faisant, mieux porter le regard sur les devenirs que les humains partagent avec les virus.
De l’amphibiose à la pluribiose
Dans les années 1960, le microbiologiste Theodor Rosebury a introduit la notion d’amphibiose pour décrire les relations, dynamiques et changeantes en fonction du temps et de l’espace, qui s’établissent entre des entités biologiques différentes. Le microbiologiste Martin Blaser en propose une définition dans Missing Microbes : « L’amphibiose est la condition dans laquelle deux formes de vie créent des relations qui sont soit symbiotiques soit parasitaires, selon le contexte (…). Elle est au cœur de la biologie, dans laquelle la constance de la sélection naturelle force une myriade d’interactions nuancées. »4. Prenons deux exemples. Le staphylocoque doré est une bactérie qui colonise le nez d’environ 30% des humains analysés, sans causer de symptômes particuliers. A l’occasion d’une opération chirurgicale, ce staphylocoque peut cependant passer du nez à la hanche ou au genou, et causer une infection. La bactérie helicobacter pylori, quant à elle, provoque des ulcères à l’estomac, mais à certains moments seulement (les crises apparaissant par intermittence, en moyenne entre 30 et 60 ans). Les porteurs n’en souffrent donc pas en permanence. Selon les conditions, les relations entre un humain et ces deux types d’entités microbiennes peuvent donc varier du tout au tout.
La notion d’amphibiose permet d’opérer un premier déplacement : elle ne décrit pas des entités, mais les relations qu’établissent ces entités entre elles, relations dépendantes d’un contexte. Essentialiser ces dernières, les figer dans le temps ou dans l’espace, pour parler de « guerre » ou de « paix », d’ « amis » ou d’ « ennemis », constitue ainsi une première erreur, et une première violence faite aux relations entre les vivants.
Cette notion est cependant réductrice à deux titres. En premier lieu, elle réduit le champ des relations à une opposition binaire : les vivants interagiraient selon deux modes, symbiotique ou parasitaire. En second lieu, elle repose sur une conception relativement fixe des entités en relation, et empêche ainsi de penser comment leurs relations, d’une façon ou d’une autre, les transforment. Les savoirs acquis sur les virus apportent sur ce point de précieuses leçons. Les virus bactériophages (littéralement : mangeurs de bactéries), ont pour hôtes des bactéries. L’une et l’autre de ces deux formes de vie coévoluent depuis plus de 3,5 milliards d’années, selon des modalités dynamiques et complexes. Les bactériophages (dits aussi simplement phages) sont les entités biologiques les plus nombreuses sur Terre. On estime qu’à un temps t, 40% des bactéries de la planète sont infectées par un virus. Les relations entre phages et bactéries, cependant, sont hautement spécifiques : un virus donné ne peut généralement infecter qu’une espèce bactérienne, voire, pour certains, qu’un des variants génétiques de cette espèce. Qui plus est, lorsqu’un bactériophage donné entre en relation avec une population de bactéries clonales (c’est-à-dire identiques génétiquement), les conséquences ne sont pas uniformes. Des bactéries mourront, détruites par le virus qui se sera servi d’elles pour se multiplier5. D’autres apprendront à vivre avec lui, en ayant acquis, par mutation et sélection, la faculté de se préserver de l’infection. D’autres enfin développeront une relation profondément intime avec le virus : ce dernier intégrera son matériel génétique à celui de son hôte, de façon transitoire ou définitive. S’ils se séparent de nouveau, le virus pourra laisser une partie de son matériel génétique, et/ou emporter avec lui une partie de celui de la bactérie, les deux entités s’en trouvant transformées.

Les compétences relationnelles des phages et des bactéries sont observées et utilisées dans les laboratoires depuis des décennies. Les scientifiques leur doivent le développement de la biologie moléculaire6, avec toutes ses possibilités tant en recherche fondamentale qu’appliquée (par exemple la capacité à produire des organismes génétiquement modifiés, des molécules thérapeutiques, des biocarburants, etc.). Beaucoup de scientifiques ne pensent pas ces formes de vie comme telles. Elles sont devenues de simples outils au service de certains humains. C’est d’ailleurs à cette manipulation d’un vivant désincarné et désanimé que puisent de nombreux récits de science-fiction ou d’anticipation pour, le plus souvent, dénoncer la propension des humains à réifier et réduire à l’état de marchandise une Nature qui leur resterait désespérément extérieure. Pour d’autres en revanche, ces compétences sont source de questionnements sans cesse renouvelés sur le continuum du vivant, la coopération, l’évolution ou l’écologie. L’étude des virus et des bactéries révèle en effet bien plus qu’un spectre de modalités relationnelles : elle met en jeu la plasticité même des entités, leur devenir commun dans et par les relations qu’ils instaurent. Avec la fusion des matériels génétiques, le mode d’existence du virus change radicalement : il fait partie intégrante de la bactérie. On dit parfois qu’il est dormant, ce qui, dans des sociétés qui renvoient dos à dos le réel et l’imaginaire de la rêverie, conduit à penser qu’il ne fait rien. Pourtant, la bactérie dans laquelle il « dort » développe de nouvelles compétences. Les siennes propres ? Celles du virus ? Les deux entités peuvent-elles encore être dissociées ou forment-elles une chimère, une nouvelle entité ? Questions d’autant plus complexes que l’entité ainsi formée peut tout à fait être transitoire. Sous certaines conditions, le matériel génétique viral peut se dissocier de celui de la bactérie, se répliquer par centaines pour former de nouvelles particules virales, puis se libérer en tuant la bactérie.
Les métaphores jouent ici encore un rôle capital. On peine à exprimer, à formuler les comportements « viro-bactériens » hors des champs lexicaux usuels de la reproduction sexuée et de l’immunologie, dont l’anthropologue Emily Martin a montré à quel point l’une et l’autre étaient genrées7. On dit des phages qu’ils « injectent » leur ADN, « pénètrent » la cellule hôte, se « tapissent » ou « se cachent », agents dormants, dans l’ADN bactérien. Il est donc question de transgression, de viol, de guerre larvée, de destruction, quand il est pourtant possible de discerner tout autre chose : des puissances créatrices échappant, précisément, aux dogmes de la reproduction sexuée ou d’une immunologie encore pensée sur le mode du soi et du non soi ; des intimités organiques qui révèlent la porosité des catégories avec lesquelles la modernité occidentale pense et agit sur le monde. Certains virologues, grâce à une familiarité de longue date avec les phages et les bactéries, hésitent d’ailleurs à dire que le phage « tue » son hôte : dans bien des cas, la bactérie meurt d’elle-même, toutes ses ressources finissant par être épuisées par le virus. Derrière cette reformulation à première vue anodine, ce qui se joue est pourtant un autre récit, où le virus ne détruirait pas intentionnellement la bactérie, mais y trouverait une matrice pour sa réplication/création, intégrant ce faisant des fragments de cette même bactérie. Un spectre subtil de relations se dessine alors entre des entités qu’il devient de plus en plus difficile d’essentialiser. Pour compliquer encore les choses il faut aussi rappeler que ces relations dépendent en outre des milieux plus larges dans lesquels elles se déroulent et qu’elles façonnent et composent… parfois de façon spectaculaire.
Chaque année, le lac Nakuru, au Kenya, accueille d’immenses colonies de Flamants Nains. Par centaines de milliers, ces oiseaux viennent s’y repaître d’Arthrospira platensis, des cyanobactéries particulièrement abondantes dans ces eaux salines et alcalines. En 2009 cependant, la population de flamants a brutalement chuté, passant de plus d’un million à un peu plus d’un millier entre les mois de juin et d’octobre. Cette diminution inhabituelle était corrélée à la disparition des Arthrospira, leur principale source de nourriture. Les échantillons régulièrement collectés dans le lac ont révélé la présence du plus grand nombre de virus jamais signalé dans un environnement aquatique naturel. Ces derniers s’y reproduisaient, raréfiant dans le même mouvement les populations de cyanobactéries. Les flamants, privés de nourriture, se sont envolés vers des lieux plus propices. Il s’agit du premier exemple documenté de l’influence des virus sur une chaîne trophique8.
Ce virus n’est cependant pas venu d’ailleurs. Il fait partie de l’écosystème du lac, où il entretient avec les cyanobactéries des relations plurielles et dynamiques. Certains représentants infectent des cellules bactériennes pour se reproduire. D’autres se lovent au cœur du matériel génétique de leurs hôtes. Quelque chose s’est modifié dans le lac Nakuru (salinité ? pH ? exposition aux UV ?), induisant un changement dans ces modes de relations. La plupart des virus s’est alors désolidarisée des bactéries qui les portaient en leur sein, et s’est mise à se répliquer activement, épuisant les cellules dont se nourrissaient les flamants. Et le lac Nakuru a été déserté. Superposition de spectres relationnels, donc, enchevêtrement de formes de vie qui entrent en résonance et modifient en retour leur milieu.
Ces modes d’interaction ne sont pas propres aux virus et aux bactéries. 5 à 8% de l’ADN humain est en effet d’origine virale, c’est-à-dire issu de la fusion, à un moment donné ou à un autre de l’histoire évolutive des espèces, du matériel génétique d’un virus avec une cellule hôte « infectée ». L’exemple le plus connu dans le règne animal est celui des syncytines, des protéines nécessaires à la formation du placenta, une compétence propre aux mammifères, mais qui – ce n’est paradoxal que si l’on cherche à maintenir coûte que coûte des cloisons protectrices et des frontières pour séparer une « essence » de quelque chose qui viendrait la souiller – a en fait été rendue possible par l’interaction avec des virus9. Cet ADN d’origine virale, dont une large part est considérée comme du « junk DNA », de l’ADN « poubelle » en raison de sa supposée inutilité (actuelle, immédiate), peut être envisagé comme la lente sédimentation d’expériences relationnelles, la précieuse archive d’événements qui ont conduit les mammifères là où ils sont aujourd’hui.
L’essentialisation des entités et des relations n’est en effet possible que si on arrête le mouvement, ou si on le ralentit suffisamment. C’est ici que le monde microbien est précieux. Sans présumer de ou réduire l’ensemble des différences existant entre ces formes de vie, on peut souligner que les temporalités qui les animent sont clairement distinctes : dans le temps d’une vie humaine, ce sont des milliers de générations de bactéries qui se succèdent, des milliards de cellules qui vivent et échangent avec des bactériophages, procèdent à des transformations mutuelles et agissent sur les milieux qu’elles peuplent. Les bactéries vont donc beaucoup plus vite, et ce faisant donnent à voir ce que les scientifiques ne peuvent que patiemment reconstruire et supposer pour le règne animal ou végétal.
La restauration du mouvement, la prise de conscience de l’impossibilité de penser efficacement sans lui, voilà à quoi oblige la compréhension des virus et bactéries. C’est uniquement par un effet de distorsion dû au ralentissement que nous sommes portés à penser des relations univoques entre des entités dont l’essence serait figée et à considérer les milieux dans lesquels elles se déroulent (et qu’elles contribuent pourtant à transformer) comme de simples scènes, des arrière-plans immuables.
L’observation des virus et des bactéries nous offre ainsi la possibilité d’appréhender la pluribiose, c’est-à-dire des spectres de relations plurielles entre des entités toujours en devenir, travaillées, transformées par leurs rencontres avec d’autres vivants. Entités, relations et milieux sont foncièrement fluents, et profondément relationnels.
La différence radicale des temporalités rend plus difficile, on l’a vu, de percevoir la sédimentation des effets de relations tissées avec d’autres formes de vie dans l’ADN des organismes complexes au cours de leur longue et lente histoire évolutive. Cette sédimentation, cependant, n’est qu’un aspect parmi d’autres de la pluribiose.
Devenir avec les virus
L’histoire humaine est riche d’observations et de vécus des relations toujours mouvantes entretenues avec les virus et leurs potentialités transformatrices, et ce même si on choisit de ne s’intéresser qu’à la pathogénicité, qui ne représente qu’un aspect parmi beaucoup d’autres.
Les humains ont appris à vivre et à devenir avec certains virus pathogènes. Un apprentissage malheureusement imposé par des situations de crise sanitaire (du moins aux 20ème et 21ème siècles), à des époques où les possibilités de développer des formes de vécus alternatifs étaient déjà conditionnées et sévèrement restreintes par des infrastructures matérielles propres à des systèmes politiques et économiques fondés principalement sur le déplacement des vivants – humains et non-humains – hors de leurs milieux à des fins d’exploitation intensive des ressources.
Dans son livre Aux origines du sida, Jacques Pépin retrace l’histoire complexe du VIH10. Les données phylogénétiques permettent d’estimer que l’ancêtre commun des souches de ce virus (il en existe plusieurs, réparties en neuf groupes) date de 1921. C’est à ce moment-là qu’aurait donc eu lieu la transmission inter-espèces à l’origine de la pandémie. Présent depuis plusieurs centaines d’années chez le chimpanzé Pan troglodytes troglodytes, sa transmission à l’humain a pu se produire à plusieurs reprises, notamment lors de la chasse de cet animal, ou de sa préparation dans le but d’être ingéré. Par exemple, un chasseur et sa femme ont pu s’infecter mutuellement et périr quelques années plus tard dans leur village, sans avoir eu l’occasion de transmettre le virus hors du cercle familial. Au début des années 1920 cependant, à la suite de différentes vagues de colonisation, l’Afrique avait subi de profondes transformations environnementales, sociales, politiques mais aussi médicales, permettant la dissémination du virus. Deux voies distinctes de transmission semblent avoir été nécessaires pour générer l’épidémie : une première phase, par transmission parentérale, c’est-à-dire par des aiguilles et des seringues souillées et mal stérilisées, lors de campagnes de vaccination ou de prévention, notamment contre la maladie du sommeil et/ou lors des campagnes de traitement de la lèpre qui se déroulaient au même moment. L’augmentation du nombre d’individus infectés par cette voie dans leurs propres villages rend ensuite plus probable une transmission et une amplification par voie sexuelle. Les mutations engendrées par l’arrivée des colons, incluant la migration des hommes vers les villes ou les mines pour trouver du travail et le développement massif du travail du sexe dans les décennies suivantes, ont ouvert une seconde phase d’amplification par voie sexuelle. Les propriétés des différentes souches virales ainsi que les données socio-politiques à disposition ont permis de reconstituer les différentes trajectoires des virus et des humains dans le monde, lesquelles laissent entrevoir autant de « biologies situées11 », d’agencements multispécifiques12 et socio-politiques singuliers.
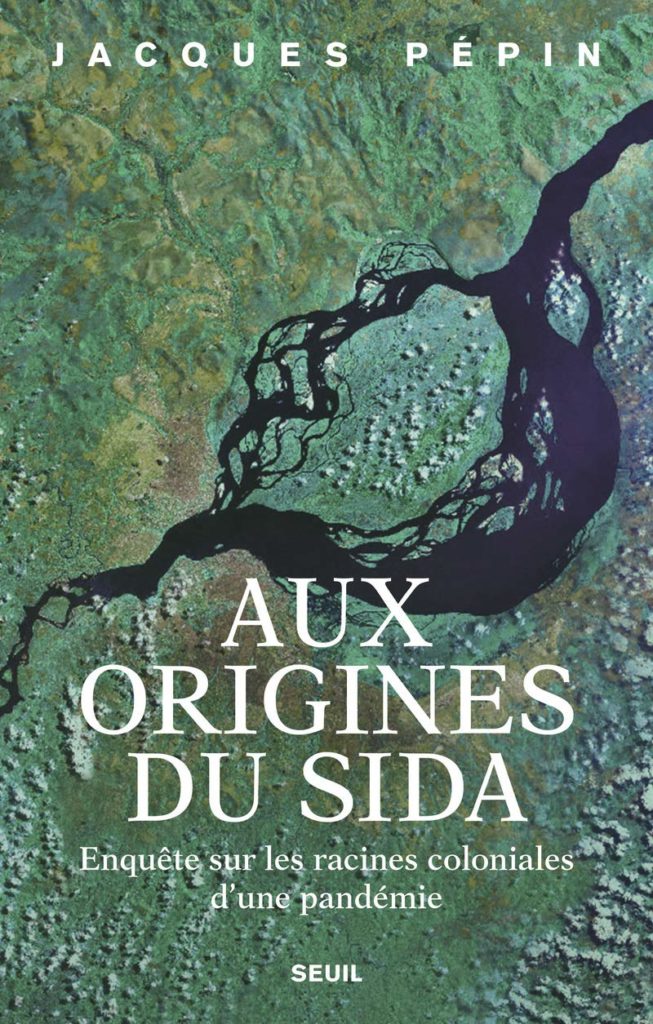
Loin de l’histoire simpliste d’un virus tapi au cœur de la jungle, attendant opportunément l’arrivée d’un humain aux mœurs légères pour se propager et coloniser le monde, la pandémie de VIH est la résultante de plusieurs événements combinés : la colonisation, le développement d’un capitalisme d’extraction et celui de formes spécifiques de globalisation, chacun de ces aspects jouant sur les spectres de relations instaurées entre les êtres et sur leurs devenirs.
Ce que les vécus de millions de personnes séropositives incitent à penser, ce sont les devenir communs aux humains et au VIH – alors même que l’objectif de l’Organisation Mondiale de la Santé reste une éradication pure et simple du virus. La dénomination « PvVIH », « Personnes vivants avec le VIH », participe en partie de cette approche en termes de vécu. Par l’ingestion de molécules antirétrovirales spécifiques, ciblées, il est devenu possible de modifier les types de relations entretenues entre les virus et le corps humain, de les domestiquer, si l’on entend la domestication comme le contrôle (toujours imparfait) de la reproduction, mais aussi, d’un point de vue comportemental, comme l’atténuation des effets délétères des interactions entre ces formes de vie. Ces changements dans les modes de relations grâce aux traitements, qui induisent des transformations tant des virus que des humains, ont été rendus possibles par d’autres transformations : activisme et militantisme, réorganisation des projets et des politiques de recherche et de développement, des modes de financement, etc.
La disponibilité des traitements et l’organisation de la prise en charge dépend en effet de choix politiques et sociaux, de l’état des systèmes de santé, des modes de production, de distribution et de consommation. L’ingestion du traitement par les personnes infectées repose sur des dynamiques complexes, contraintes par des impératifs de tous ordres : socio-économiques, culturels, politiques ou religieux. La prise du traitement, et donc la modulation des relations entre VIH et humains, ne peut donc être comprise qu’en replaçant l’individu infecté dans l’espace domestique, dans ses interactions quotidiennes avec son entourage, familial ou professionnel, et dans l’ensemble de la société dont il fait partie. Moduler ces interactions implique de comprendre que ce qui contient et contraint ce virus particulier contraint également les humains. Les virus et les humains forment de ce point de vue une communauté hybride dont l’existence nécessite le respect de règles précises qui portent entre autres sur l’ingestion régulière et contrôlée des antirétroviraux, rendue possible et acceptable (ou non) par des choix politiques et socio-économiques. Cette vie en commun repose également sur des méthodes visant à réduire les taux de transmission : port du préservatif, prophylaxie pré-exposition (PREP), traitement comme prévention (TasP), circoncision masculine, sécurisation des dons de sang, adaptation des gestuelles dans l’administration des soins, etc.
Si les relations entre virus et humains s’incarnent entre autres dans des corps particuliers, il serait donc erroné d’en faire pour autant une lecture individualiste. L’histoire de l’épidémie de VIH, de la rencontre entre ce virus et les populations humaines, est faite d’apprentissages, de rapports de forces, de luttes collectives, contre les effets mortifères du virus et pour le droit à la dignité, à la reconnaissance, aux savoirs et aux traitements. L’implication des personnes infectées a été cruciale à tous les niveaux, depuis la formation de groupes de parole pour le soutien entre malades, dont le statut est loin d’être systématiquement connu de l’entourage, jusqu’au partage et à la production des connaissances, avec au passage le déploiement de nouveaux récits. L’impératif de survie suscité par l’épidémie de VIH s’est traduit par une politisation des malades et de leur entourage, renforcée par la production des antirétroviraux et la revendication de pouvoir participer à leur élaboration pour mieux accéder aux promesses qu’ils offraient.
Parler d’un « vivre avec les virus » n’implique en rien de négliger ou de nier les souffrances infligées par certains d’entre eux, de façon fortement différenciée, à certains des humains, pas plus que celles infligées par les communautés humaines à certaines de leurs composantes les plus vulnérables. C’est plutôt une façon de rappeler que les virus révèlent les inégalités, les situations de domination et les violences, plus qu’ils ne les créent ; qu’ils activent aussi les puissances créatrices de collectifs capables d’imaginer d’autres façons de vivre, ou plutôt de devenir, avec eux. C’est aussi mettre à jour les manières dont virus et humains en sont transformés.

« Nous allons devoir vivre, durant de longs mois, avec le virus » : c’est aussi ce que nous dit la ritournelle du moment. Mais ce « vivre avec » sonne creux, voire comme une injure aux humains placés dans des situations de grande vulnérabilité, auxquels les efforts les plus colossaux sont demandés. D’autant plus que ce qui est supposé n’est finalement qu’une adaptation a minima : ce « vivre avec » n’est en fait qu’un « vivre malgré ». Il est le constat d’un échec à gérer, loin de la force de transformation de ceux qui ont dû, malgré les souffrances, inventer, avec le VIH qui les habitait, de nouvelles façons d’être au monde. Ce « vivre avec » n’est pas celui de la pluribiose, de la reconnaissance du caractère fondamentalement relationnel des formes de vie.
Des politiques de la pluribiose, en revanche, impliquent de toutes autres exigences. Elles obligent à rendre compte, à être comptable de tous les déplacements que le virus fait opérer aux humains et au reste du vivant, et de la façon dont toutes les formes de vie s’en trouvent transformées : avec les effets du confinement, des hardes de cervidés se promènent dans les villages ; des tortues reviennent pondre sur des plages qu’elles avaient depuis longtemps désertées ; des satellites nous informent de l’amélioration sensible de la qualité de l’air ; des chaînes d’approvisionnement, rompues, deviennent visibles par les pénuries engendrées ; le ciel n’est plus strié de lignées blanches laissées par des avions désormais cloués au sol ; des femmes et des enfants se trouvent confinés avec leurs bourreaux ; des personnes meurent de n’avoir pas eu les moyens matériels de se protéger ; des soignants, applaudis à 20h tous les soirs, qui n’obtenaient pour leurs efforts que gaz lacrymogène et coups de matraque il y a quelques mois seulement, sont ostracisés par des voisins dont il est trop facile de considérer qu’ils seraient seulement bêtes et méchants ; des réseaux d’entraide se constituent ; des circuits courts se multiplient ; partout des expérimentations sont en cours. Et le virus, de façon discrète, évolue au gré des rencontres, entamant chaque jour un peu plus les certitudes des scientifiques : pour combien de temps encore sera-t-il pertinent et efficace de considérer ces variations comme un seul et même virus13 ?
Autant de transformations qui ne peuvent être appréhendées par les catégories de la modernité occidentale qu’en en brouillant le sens et la portée. Vivre avec, oui. Mais donc vivre autrement, devenir, et devenir plastiques. Non pas de la plasticité du néo-libéralisme, vouée à contraindre les humains à entrer dans un cadre uniforme et étriqué jusqu’au terme de l’auto-destruction en cours. La plasticité de la pluribiose, des savoirs et des biologies situés implique d’observer et apprendre des relations pluribiotiques, de dégenrer et décoloniser les savoirs et les comportements, de nous demander à quoi nous tenons et ce que nous sommes prêts à sacrifier, ce pour quoi nous sommes prêts à nous battre et contre qui, de poser aussi la question de savoir qui souffrira des conséquences des choix effectués. Il s’agit de penser une écologie politique à la hauteur, qui passe par l’abandon des prétentions au contrôle, pour reconnaître que la standardisation et la réification du vivant, humain et non-humain, auront toujours des conséquences inattendues. Il s’agit d’être attentifs aux façons de vivre dans les milieux capitalo-anthropisés oui, mais pour mieux reconfigurer les rapports de force. En prenant au sérieux la précarité du vivant et ses puissances créatrices.
Illustration principale – Image au microscope électronique à balayage : des virus bactériophages (en vert) attaquent des bactéries (en violet). Au centre, l’une d’entre elle est déjà détruite. Ce type de processus a lieu en permanence.
Crédit / Helmholtz Center for Infection Research, Braunschweig, Allemagne / Colorisation Dwayne Roach (Institut Pasteur)
Notes
- Evelyn Fox Keller, 2003, Le siècle du gène, Paris: Gallimard.[↩]
- Larson et al.,2005, « Metaphors and Biorisks: The War on Infectious Diseases and Invasive Species », Science Communication, 26(3): 243-268.[↩]
- Voir la carte phylogénétique disponible ici[↩]
- Martin Blaser, Missing microbes, New-York : Picador, p. 105 (ma traduction).[↩]
- Et qui y trouve là l’origine de son appellation.[↩]
- Lily Kay L, 1993, The molecular vision of life. Oxford University Press, Oxford. Michel Morange, 1994, Histoire de la biologie moléculaire, Paris : La Découverte.[↩]
- Emily Martin, 1991, « The egg and the sperm : how science has constructed a romance based on stereotypical male-female roles », Journal of Women in Culture and Society, 16(3): 485-501 ; Emily Martin, 1995, Flexible bodies, Beacon Press.[↩]
- Peduzzi et al., 2014, « The virus’s tooth : cyanophages affect an African flamingo population in a bottom-up cascade », ISME 8(6): 1346–1351.[↩]
- Anne Dupressoir et Thierry Heidmann, 2011, « Les syncytines, des protéines d’enveloppe rétrovirales capturées au profit du développement placentaire », Médecine/Sciences 27(2) : 163-169.[↩]
- Jacques Pépin, 2019, Aux origines du sida, Paris : Éditions du Seuil.[↩]
- Niewöhner, Lock, 2018. Situating local biologies: Anthropological perspectives on environment/human entanglements. BioSocieties DOI: 10.1057/s41292-017-0089-5[↩]
- Anna Tsing, 2017, Le champignon de la fin du monde, Paris: La Découverte.[↩]
- Corum and Zimmer, « How Coronavirus mutates and spreads« , New York Times, 30 april 2020[↩]