À propos des ouvrages de Serge Audier, La société écologique et ses ennemis (2017) et L’âge productiviste (2019), Paris, La Découverte.
L’écologie est-elle de gauche ? Cette question peut paraître futile, voire obscène à l’heure où les désastres écologiques incitent à jeter les vieux modes de pensée. C’est entendu, l’URSS socialiste et la Chine communiste ont saccagé la nature au moins autant que l’Occident capitaliste ; la gauche, dans sa grande majorité, n’a pas su se détacher du scientisme et du productivisme. Selon d’influents penseurs comme Moishe Postone, André Gorz, John Holloway ou le courant critique de la valeur, le salariat, en tant que rouage intégré à l’engrenage capitaliste, est incapable de s’évader du travail abstrait dont la valorisation conditionne son devenir. De fait, peu de penseurs de l’écologie accordent une quelconque importance à la question du travail.
Pourtant, la crise écologique s’enracine bel et bien dans le travail : les pollutions résultent d’une logique de production exclusivement finalisée par le profit et le pouvoir de la classe dominante1. C’est l’activité quotidienne de travail de 3 milliards de travailleurs enrôlés dans les chaînes de la valeur capitaliste qui détruit la nature. Voilà une évidence trop souvent impensée : la nécessaire modification radicale des finalités et des modalités de l’engrenage de la production ne pourra se faire sans la participation active des travailleurs, et encore moins contre eux.
De ce point de vue, l’histoire du mouvement ouvrier n’incite certes pas à l’optimisme. S’appuyant sur les nombreux traits positivistes de la pensée de Marx, la vulgate marxiste – socialiste et communiste – a fait bloc avec le productivisme. La croissance des forces productives devait aboutir à la société d’abondance où l’homme jouirait de la liberté en laissant le travail nécessaire aux machines. La fragilité de la nature était négligée. Même si la Confédération syndicale internationale proclame aujourd’hui qu’« il n’y aura pas d’emplois sur une planète morte », en pratique, dans les secteurs polluants, les syndicats défendent encore trop souvent l’emploi contre la vie.
Serge Audier, dans son travail monumental sur l’histoire de la pensée écologique2, prouve brillamment que ce choix productiviste de la gauche n’a été ni unanime, ni inéluctable. Avec une méthode d’exposition alliant paradoxalement érudition, rigueur et ferveur, il éclaire les sources d’une pensée émancipatrice pleinement écologique. Il démontre non seulement que la pensée socialiste n’a pas été uniformément productiviste, mais qu’elle seule – surtout dans sa veine libertaire – a su formuler une perspective authentiquement écologique au sens où elle tire toutes les conséquences d’une affirmation décisive : la prédation de la nature par l’homme a partie liée avec l’oppression d’humains par d’autres humains. Et donc, « la création d’une nouvelle société de libres et égaux, c’est-à-dire d’une société ouverte, passe ipso facto par une relation harmonieuse avec la nature – et réciproquement » (Audier, I, p. 331). Les fleurs de l’écologie sociale et de l’écoféminisme3 qui s’épanouissent aujourd’hui ont leurs racines dans un terreau dont Audier nous restitue toute la richesse.
Naturellement, la question du travail n’est pas au centre de son propos : le féminisme, le colonialisme, la cause animale, l’urbanisme, la protection de l’environnement, la croissance économique, l’éducation, la science, l’esthétique… aucun domaine ou presque n’échappe à son impressionnante enquête sur la généalogie de la pensée écologique et de ses ennemis. Et si la destruction écologique est liée aux oppressions sociales, celles-ci ne se limitent pas à l’antagonisme capital- travail. Je me focaliserai pourtant ici sur ce lien, trop peu exploré, entre politique du travail et visée écologique.
Le marxisme : productiviste ou éco-socialiste ?
Audier rappelle l’adhésion majoritaire du mouvement ouvrier au productivisme, je serai bref sur ce point bien connu. Il ne nie pas la « dimension éco-socialiste » (Audier, II, p.174) de la pensée de Marx, inspirée par sa lecture du chimiste Liebig, et cite le célèbre passage du Capital selon lequel le capitalisme « épuise en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur » (Marx, 1867, II, p.156). Mais à l’évidence « la dimension productiviste et prométhéenne de sa pensée a infiniment plus frappé les esprits du mouvement ouvrier et de ses dirigeants » (Audier, II, p.174). Marx n’a cessé de proclamer son admiration pour le rôle historique de la bourgeoisie, destructrice des liens sociaux traditionnels et créatrice de la grande industrie fondée sur la science qui pavait ainsi la voie du communisme. Jules Guesde le répétera à sa manière: « le socialisme sort tout armé du capitalisme, dont il est à la fois l’aboutissement et le correctif. Nous sommes, pour employer l’expression pittoresque d’un des nôtres, les fils du cheval-vapeur » (Guesde, 1904, 1II., p. 198). Cette vision techniciste et productiviste était partagée par des penseurs aussi profonds que Lénine (appelant les ouvriers à se soumettre « sans réserve à la volonté du dirigeant soviétique, du dictateur, durant le travail » pour mettre en œuvre « les conquêtes scientifiques les plus précieuses » du système Taylor4) ; ou Gramsci (« le prolétaire (…) sent la nécessité que le monde entier soit comme une seule et immense usine, organisée avec la même précision, la même méthode, le même ordre dont il constate qu’il est vital dans l’usine où il travaille »5). Le productivisme n’épargnait pas non plus les milieux anarcho-syndicalistes : ainsi George Sorel visait-il « la création d’un monde technicisé sous la direction des producteurs associés » (Audier, II, p. 205). Mais nombre de penseurs anarchistes/libertaires ont eu des visions autrement plus fécondes en la matière, à commencer par Charles Fourier.
Fourier et le « territoire végétal du socialisme »
Même si sa théorie cosmogonique n’était pas exempte de penchants prométhéens quelque peu délirants6, Fourier peut être qualifié de « prophète de la destruction de la planète » : face aux ravages de « l’esprit rapace toujours porté en agriculture comme en finance à dévorer l’avenir, tuer la poule pour avoir les oeufs » (Fourier, 1847, I, p. 118), il proclame « l’urgence à sortir enfin de cet état ‘civilisé, barbare et sauvage’ pour remédier à la fois aux ‘souffrances matérielles de la planète’ et aux ‘misères humaines’, les deux tenant ensemble tant par leurs causes que par leurs solutions » (Audier, I, p. 1147). L’organisation fouriériste du « travail attractif » repose sur la loi des « séries passionnées » : « comme ils aiment beaucoup la variété, ils passent fréquemment d’un objet à l’autre et goûtent successivement toutes les jouissances physiques, morales et intellectuelles que la Providence a réservées à la nature humaine » (Considérant, 1846, I, p. 509). L’agriculture est au coeur du système de travail fouriériste qui voit « le jardinage comme paradigme de la réconciliation créatrice entre l’homme et une nature partiellement humanisée » (Audier, I, p. 362).
Se fondant sur ce diagnostic du lien intrinsèque entre oppression des hommes et dégradation de la nature, le grand géographe anarchiste Elisée Reclus prolonge Fourier, la rigueur scientifique en plus. Il montre comment les excès de l’industrie et du profit font oublier aux hommes que « la liberté, dans notre rapport avec la Terre, consiste à en reconnaître les lois pour y conformer notre existence » (Reclus, 1864, I, p. 189) : « face à tous ses maîtres qui voulaient asservir les hommes par la terreur (…), la Terre, par la magnificence des ses horizons, la fraîcheur de ses bois, la limpidité de ses sources, est restée la grande éducatrice, et n’a cessé de rappeler les Nations à l’harmonie et à la recherche de la liberté » (Reclus, 1869, I, p. 406).
Autre fouriériste moins connu, l’ouvrier teinturier Mathieu Briancourt apporte une idée nouvelle – et fort actuelle – à la critique du maltravail industriel, en accordant une grande importance aux pathologies mentales qui lui sont associées : « déplorant après Fourier le règne d’une compétition effrénée et malhonnête, Briancourt évoque le ‘souvenir de vingt maisons respectables’ qui ont été ruinées pour avoir refusé de falsifier leurs produits, alors même que leurs confrères moins scrupuleux offraient à des prix inférieurs leurs ‘denrées frelatées’ » (Audier, I, p. 273). Avec le socialiste associationniste Philippe Buchez et bien d’autres, Audier rappelle comment la lutte contre les pollutions industrielles mêle indissociablement la défense de la santé des travailleurs et de la nature.
Des pensées pré-écologiques du travail
Entre la mi-XIXème et le début du XXème, Audier restitue avec bonheur toute une diversité d’écosystèmes de pensée et de pratiques alternatives du travail, « socialiste romantique » (George Sand, Marie D’Agoult, Pierre Leroux…), « naturien libertaire » (Emille Gravelle, Henri Zisly…) ou anarcho-écoféministe avant l’heure (Emma Goldman et sa revue Mother Earth, la syndicaliste suisse Margarethe Faas et son journal L’exploitée…8 Mais c’est sans doute le britannique William Morris, avec son « socialisme esthétique », qui pousse le plus loin les intuitions écosocialistes (et les réalisations pratiques) issues du fouriérisme. Partant du même diagnostic – « le développement du système commercial couronné par la révolution des grandes industries des machines nous a privés de l’attractivité du travail et autant qu’il le peut de la beauté de la Terre » (Morris, 1885, I, p. 520), il prône une réorganisation complète du travail par les travailleurs « pour que les marchandises qu’ils produisent soient aussi belles que les œuvres de la nature, (…) pour que leur fabrication même soit agréable, tout comme la nature rend agréable l’exercice des fonctions nécessaires aux êtres sensibles » (Morris, I., p. 522).
Morris définit « l’attractivité du travail » de façon bien plus précise et rigoureuse (au regard-même des développements ultérieurs de l’ergonomie, de la psychologie et de la psychodynamique du travail) que Fourier : ses dimensions principales sont « « la diversité », « l’espoir qui accompagne la création », « l’amour-propre qui provient d’un sentiment d’utilité » et « ce mystérieux plaisir corporel qui va avec l’exercice habile des facultés physiques » (Morris, I, p. 521). Sans récuser le progrès technique, il lui laisse une place subordonnée : « tout ouvrage qu’il serait fastidieux de faire à la main est exécuté par des machines extrêmement perfectionnées, et pour tout ouvrage qu’il est agréable de faire à la main, on se passe des machines » (Morris, 1890, I, p. 524). Il refuse clairement le consumérisme : « nous nous sommes rendus compte de nos besoins, et notre production se réduit ainsi à ces besoins ; et comme rien ne nous oblige à fabriquer d’immenses quantités de choses inutiles, nous disposons du temps et des ressources qui nous permettent de prendre en considération le plaisir que nous procure la fabrication » (Morris, 1890, I, p. 523).
Morris est sans aucun doute un pionnier majeur de la pensée écosocialiste9): « par socialisme j’entends un état de société où il n’y aurait ni riches ni pauvres, ni patrons ni esclaves, ni oisiveté ni surmenage, ni travailleurs intellectuels malades de l’intellect ni travailleurs manuels atteints d’écœurement, bref une société dont tous les membres jouiraient d’une égalité de conditions et éviteraient tout gaspillage dans la conduite de leurs affaires ». L’anarchiste George Renard, émule de Morris, s’exclame : « Qui donc a dit le premier que dans la cité future, il doit y avoir pour tous du pain et des roses ? Si ce n’est pas un socialiste, c’est quelqu’un qui a heureusement exprimé l’idée du socialisme » (Renard, 1907, I, p. 32610).
Percées naturalistes en pédagogie
Audier ressuscite l’extraordinaire figure de Paul Robin, ami de Bakounine et pédagogue libertaire. A l’orphelinat de Cempuis (Oise), Robin met en pratique de 1880 à 189411 « l’éducation intégrale » pour faire accéder les enfants des classes défavorisées au savoir et à l’émancipation : « dans ce projet éducatif, intellectuel, moral et physique, qui voulait promouvoir inséparablement l’épanouissement individuel et le sens social de la coopération, de la réciprocité et de la solidarité, un nouveau rapport à la nature prenait une place essentielle, comme si la réconciliation de l’homme avec l’homme passait par une réconciliation de l’homme avec la nature, et ce dès les plus jeunes âges de formation où se joue l’avenir de l’individu et de la société » (Audier, I, p. 539). Comme souvent chez les libertaires, le féminisme côtoie le souci de la nature : Robin refuse la ségrégation sexuée et pratique la « coéducation des sexes ». A la suite de Robin, les grands pédagogues du début du XXème siècle (Decroly, Ferrer, Freinet) incarnent des « percées naturalistes de la pensée libertaire en matière éducative » (Audier, I., p. 542). Decroly ne désignait-il pas sa conception comme celle de « l’école pour la vie, par la vie » ?
C’est le moment de regretter une absence dans la fresque d’Audier, celle de John Dewey, le grand théoricien de l’éducation et de la démocratie et inspirateur de Freinet. Dewey ne se disait certes pas libertaire12 – il se définissait comme « socialiste démocrate » – mais il poussait le libéralisme politique jusqu’à des conséquences radicalement démocratiques. Certes Dewey n’a guère parlé de la crise écologique, mais l’interaction entre l’humain et son environnement – social et biologique – est au coeur de sa pensée. Contre les conceptions philosophiques classiques qui opposent culture et nature, corps et esprit, pratique et théorie, Dewey (à la suite de Darwin) affirme que « l’évolution d’un organisme dépend de circonstances environnementales particulières et réciproquement, le développement de ses pouvoirs vitaux modifie ses conditions de vie »13. Son « expérimentalisme » est au coeur des réflexions actuelles sur l’éthique de l’environnement14. Au titre des regrets signalons aussi l’absence quasi totale de référence à Simone Weil15, dont on a pu montrer à quel point elle avait produit une analyse quasiment prophétique des ravages du capitalisme sur le travail et la nature16.
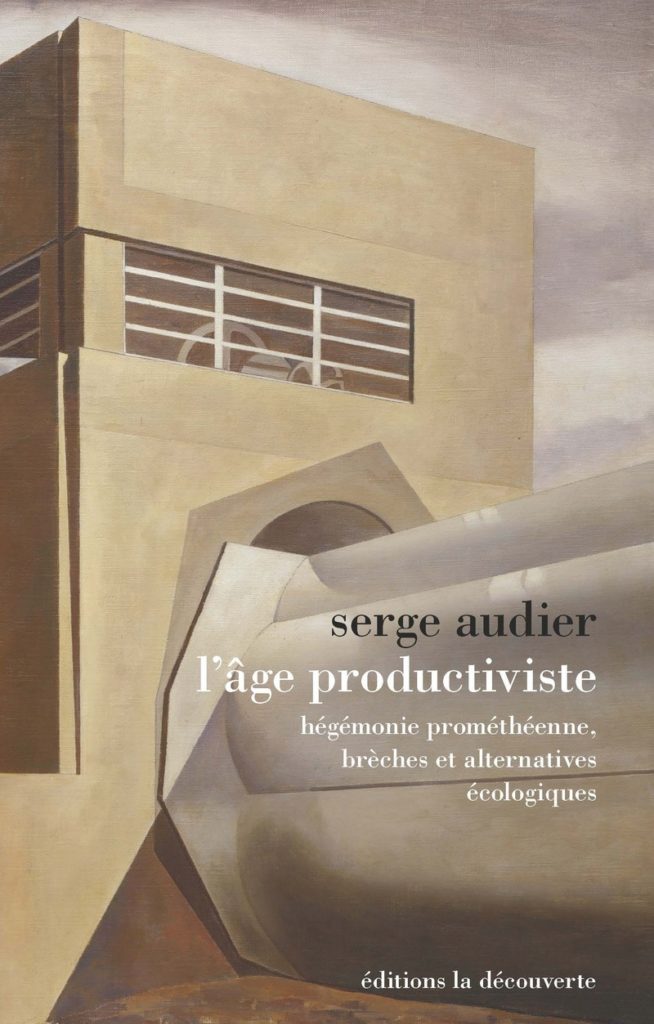
La filière italienne
Même s’il cite beaucoup d’auteurs français, Audier adopte un point de vue résolument international (plus précisément : occidental), avec – pour le XXème siècle – un tropisme italien particulièrement intéressant. Dans la suite de son travail sur le « socialisme libéral »17, il met en lumière des précurseurs oubliés de l’écologie sociale au Xxème siècle. Ainsi Gina Lombroso-Ferrero, auteure féministe et antiproductiviste avant la lettre, développe une critique du fordisme, ce système qui exalte « sur tous les tons les plaisirs que l’on peut industrialiser, fabriquer et vendre, les plaisirs qui poussent au travail et à la consommation » (Lombroso-Ferrero, 1933, II, p. 343). « Sous cet angle aussi le taylorisme était une catastrophe : asservissant l’homme à la machine, il détruisait ‘le besoin physiologique fondamental de variété’ [encore Fourier, TC] et brimait ‘ le besoin d’originalité’ par sa production aliénante en grande série » (Audier, II, p. 343).
De même, Camillo Berneri, philosophe libertaire, était hostile au « communisme de Gramsci, auquel il reprochait précisément un alignement sur le paradigme productiviste et avant-gardiste léniniste » (Audier, II, p. 374) : « contre cet élitisme ouvriériste et industrialiste, Berneri invitait la gauche à suivre plutôt l’idéal du ‘travail attrayant’[toujours Fourier, TC] (…) et la réduction du temps de travail » (Audier, II, p. 377). Parmi les critiques du taylorisme et du fordisme issues des milieux libertaires ou ‘socialiste libéraux’ antifascistes, « l’une des plus remarquables fut celle du socialiste fédéraliste Silvio Trentin, militant du groupe Giustizia e Liberta de Carlo Rosselli », qui « dénonçait l’américanisme et la rationalisation fordiste comme des moyens impitoyables de détruire la personnalité des travailleurs » (Audier, II, p. 380). Son fils Bruno, dirigeant et intellectuel de la CGIL des années 1970-1990, retint la leçon, renforcée par « l’expérience ouvrière italienne » de l’automne chaud18.
Car c’est au tournant des années 1968 que la gauche italienne réalise une percée écologique, malheureusement éphémère : « Giovanni Berlinguer, spécialiste de la médecine du travail, contribue à mettre au premier plan de l’agenda des communistes les questions de santé au travail et d’environnement, dans le souci d’articuler toujours mieux l’écologique et le social » (Audier, II., p. 647). Aux antipodes de leurs camarades du PCF, « les intellectuels communistes qui esquissaient cette rénovation voulaient démontrer que l’écologie, loin de se réduire à un point mineur relevant de soucis ‘bourgeois’, s’avérait un thème clé élucidable dans un horizon marxiste ». Il s’agit de « tirer toutes les leçons des luttes prometteuses de la société civile et du mouvement ouvrier sur les enjeux sanitaires sur le lieu de travail, qui avaient commencé dans les années 1960 (…) Des luttes comme celles de la région des Pouilles pour l’eau et la terre, ou celles de Gênes contre les mauvaises installations post-alluvions, ont pu être définies comme les ‘premières grèves écologiques’ de la Péninsule » (Audier, II. p. 648).
En novembre 1971, lors de l’important colloque de l’institut Gramsci, « Homme, nature, société. Écologie et rapports sociaux », un intervenant communiste, Franco Busetto, conclut à la nécessité de travailler sur « les liens qui circulent entre la lutte conduite sur les lieux de production pour procéder à de nouvelles formes d’organisation du travail et l’action qu’il faut conduire à différents niveaux du territoire pour la défense de l’environnement naturel, (…) pour élever les conditions de vie, de santé et de participation politique des masses populaires » (Busetto, 1971, II, p. 649). En 1977, dans son « projet à moyen terme », le PCI affirme que « la crise économique est strictement liée à la crise énergétique mais aussi à la crise écologique, et on ne sortira de la première qu’en affrontant en même temps les deux autres » (II, p. 650). Ces idées, qui irriguent alors la gauche autogestionnaire européenne, sont portées avec une vigueur sans égale par les communistes et syndicalistes italiens.
La crise économique et la contre-offensive patronale eurent raison de ces audaces. Enrico Berlinguer19, le dirigeant du PCI, se prononça dès 1977 en faveur de « l’austérité juste », nécessaire pour dépasser « un système qui est entré dans une crise structurelle, (…) et dont les caractères distinctifs sont le gâchis et le gaspillage, l’exaltation des particularismes et de l’individualisme les plus effrénés, du consumérisme le plus irresponsable20 » (Berlinguer, 1977, II., p. 651). Comme le note Audier, cette orientation visant un « compromis sans rapport de forces – donc sans une certaine imposition aux couches dominantes – conduit à une défaite ou à une compromission assurées » (II, p. 690), dont le prix pour le PCI fut sa disparition. Une leçon qui vaut aujourd’hui pour ceux qui croient que les élites capitalistes et scientistes pourraient volontiers réorganiser le travail et réduire drastiquement son empreinte écologique, voire partager le pouvoir et les richesses pour préserver la biosphère.
Un « éco-républicanisme conflictuel » ?
Ce n’est certainement pas le cas de Serge Audier, qui souligne à plusieurs reprises le « conflit irréductible » entre les « logiques de domination, d’exploitation, d’appropriation et de profit » et celles de « liberté, d’égalité et d’intérêt général de long terme » (II, p. 818). On ne peut que s’étonner, néanmoins, à le voir prôner un « éco-républicanisme conflictuel » plutôt qu’un écosocialisme libertaire, au motif selon lequel la bataille pour réhabiliter le mot « socialisme » serait « perdue d’avance » (II, p. 800). S’il faut se ranger derrière un mot en « isme », le républicanisme n’est-il pas autrement discrédité par ses versions « nationalistes et stato-centrées » (dixit Audier), ultra-majoritaires chez les républicains réellement existants partout dans le monde et notamment en France ? Et le républicanisme « civique et cosmopolite » d’un Benjamin Barber ou d’un Claude Lefort, dont se réclame Audier, n’est-il pas encore bien plus marginal et invisible dans la tradition républicaine que le courant libertaire dans la tradition socialiste ? Pourquoi inventer une bannière aussi improbable alors que la tradition écosocialiste retracée par Audier a tant de lettres de noblesse à faire valoir ?
Sur les alternatives au capitalisme en matière de propriété, Audier vante l’absence de « dogmatisme » du républicanisme – qui saurait « reconnaître les vertus possibles d’une gestion par les intéressés eux-mêmes, mais aussi, selon les situations, les avantages d’une prise en charge par la puissance publique, pourvu qu’elle demeure sous la tutelle du droit et la surveillance des citoyens » (II, p.813). Mais l’écrasante majorité des “républicains” ne s’inquiète guère de la concentration de plus en plus inouïe des grands moyens de production et de communication. Et doit-on postuler le caractère indépassable de la coupure entre société et État ? Une « puissance publique » réellement placée sous le contrôle (et pas seulement la « surveillance ») des citoyens, via la démocratie directe et délibérative, serait-elle encore un État ?
Pire encore, on ne voit absolument pas l’apport du républicanisme, fût-il civique ou cosmopolite, à la compréhension des enjeux actuels des luttes sociales, en particulier ceux de l’articulation (« intersectionnelle ») entre les résistances aux différentes dominations sociales et au productivisme. Alors que l’écosocialisme libertaire, comme le montrent abondamment les ouvrages de Serge Audier, n’a cessé depuis ses origines de porter en théorie et en pratique une visée de fécondation mutuelle des aspirations sociales, féministes, écologiques et démocratiques21. Mais n’est-ce justement pas la marque d’un livre important que de nous donner les outils pour penser contre lui ?
Notes
- Allan Schnaiberg, David Naguib Pellow, Treadmill of Production: Injustice and Unsustainability in the Global Economy, Routledge, 2015.[↩]
- La société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, La Découverte, 2017 ; L’Âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques, La Découverte, 2019. Ces deux livres sont en fait indissociables, le premier traitant du XIXème siècle et le second du XXème, avec une méthode et une ambition très proches ; on les inclura ensemble dans cette revue en les désignant par (I) et (II[↩]
- Par exemple, Murray Bookchin, Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté, Éditions Écosociété, 2011; Emilie Hache (dir.), Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Cambourakis, 2016.[↩]
- Dans « Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets » (1918), cité par Bruno Trentin dans La cité du travail. La gauche et le fordisme, Fayard, 2012.[↩]
- « L’operaio di fabbrica », La settimana politica, février 1920.[↩]
- « Un cosmogone, s’il est versé dans la science, doit se charger d’opérer à jour fixe le dégagement de l’un des pôles sous cinq ans, et plus tard celui du pôle sud, et de faire croître à cette époque l’oranger au Spitzberg aussi bien qu’à Lisbonne » ; Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Prospectus et annonce de la découverte, Leipzig, 1808.[↩]
- La citation est tirée de (Audier, I), les passages entre ‘ ’ étant de Fourier (cité par Audier). Par la suite, quand je citerai Audier citant un autre auteur, je ne donnerai pas les références de ses citations, les lecteurs intéressés pourront se reporter à la page indiquée de l’ouvrage d’Audier (I ou II). [↩]
- Dans lequel Faas écrivait en 1907 : « prolétaires ! La nature ne vous a pas créés esclaves. Ses prés, ses fleurs, ses moissons, ses richesses vous appartiennent ; la nature c’est la vie, et pour vivre il faut être libre. Devenez donc des fils de la nature ! Devenez libres ! » (Margarethe Faas, I, p. 433).[↩]
- La revue en ligne Contretemps a publié en 2003 Art et Socialisme de William Morris avec en sous-titre « Un manifeste écosocialiste de la fin du XIXe siècle » (https://www.contretemps.eu/art-socialisme-manifeste-ecosocialiste-fin-xixe-siecle/[↩]
- La question de Renard (« qui le premier ? ») semble encore actuelle : Wikipedia attribue l’expression « Bread and Roses » à Helen Todd, une suffragette états-unienne, qui l’aurait employé pour la première fois en 1910, alors que Renard la cite dans « Le socialisme à l’œuvre » paru en 1907.[↩]
- Date à laquelle il est contraint à partir sous la pression d’une campagne de la presse d’extrême-droite, comme Freinet 40 ans plus tard.[↩]
- Pas plus que Freinet, officiellement communiste, mais en réalité proche de la pensée libertaire.[↩]
- Joëlle Zask, Introduction à John Dewey, Repères, La Découverte, 2016, p.43.[↩]
- « L’évolutionnisme adopté clairement par Dewey replace tout à fait, et peut-être pour la première fois aussi nettement dans l’histoire de la pensée, l’homo sapiens dans l’ensemble des vivants et dans l’univers bio-géo-physique auquel il appartient de manière continue », Alain Létourneau, « Pour une éthique de l’environnement inspirée par le pragmatisme : l’exemple du développement durable », Vertigo, Volume 10 Numéro 1, avril 2010.[↩]
- Laquelle écrit d’ailleurs en 1933 un article dans la revue Libres Propos pour défendre Freinet.[↩]
- Geneviève Azam et Françoise Valon, Simone Weil ou L’expérience de la nécessité, le Passager clandestin, collection Les précurseurs de la décroissance, 2016.[↩]
- Serge Audier, Le socialisme libéral, Repères, La Découverte, 2014.[↩]
- Laurent Vogel, “L’actualité du modèle ouvrier italien dans les luttes pour la santé au travail », in Lucie Goussard, Guillaume Tiffon, Syndicalisme et santé au travail, Le Croquant, 2017[↩]
- Sans lien familial direct avec Giovanni Berlinguer, le médecin du travail cité ci-dessus.[↩]
- Discours de 1977 repris dans la revue « Faire », de la 2è gauche rocardienne, animée notamment par Pierre Rosanvallon et Patrick Viveret.[↩]
- Et aussi anticoloniales et antiracistes même si de façon moins unanime et moins centrales.[↩]







