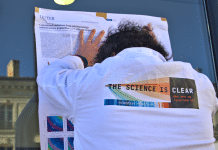Cet entretien de Marin Schaffner avec Isabelle Stengers est extrait du recueil de textes Un sol commun, qui paraîtra le 10 mai 2019 pour les dix ans des éditions Wild Project.
À quel moment vous êtes-vous véritablement plongée dans cette vision écologique ?
L’auteur qui m’a vraiment encouragée – il n’a pas tant été une inspiration qu’un compagnon de pensée –, c’est Félix Guattari et ses Trois écologies, publié en 1989. La manière dont il y a corrélé les ravages de l’écologie mentale, l’écologie sociale et l’écologie environnementale, a été une proposition politique puissante pour dépasser l’opposition désastreuse entre « Rouges » et « Verts ». Depuis, je pense le présent à partir de ce triple ravage écologique.
Par ailleurs, je trouve que l’écologie scientifique s’est progressivement remplie de récits de plus en plus intéressants. Progressivement, sont apparues toutes ces histoires de modèles chaotiques, de cascades, de rapports symbiotiques… Tout à coup, il y avait là une science naturelle aventureuse, ou en tout cas plus à la hauteur de la dimension aventureuse et événementielle de la vie. Je me suis donc avant tout abreuvée de ces histoires-là. Des histoires avec lesquelles, a priori, on ne sait pas ce qui compte et ce qui ne compte pas. Des histoires très différentes d’une espèce de théorie des systèmes où chacun a un rôle bien déterminé.
Et puis, à côté de cela, il y a aussi eu ce mouvement écologiste qui me paraissait intéressant parce qu’il apportait un souffle à la politique et des préoccupations qui, jusque-là, étaient considérées comme infra-politiques. Un tournant qui trouve aujourd’hui une vraie mesure avec la nouvelle génération des activistes, parfaitement anticapitaliste, ou plus précisément, parfaitement au courant que le capitalisme est ce à quoi il faut apprendre à résister si l’on veut que le monde ait une chance. Donc l’idée de la crise inséparablement écologique et sociale, au sens usuel, maintenant il n’y a plus besoin de lutter pour la faire reconnaître. C’est une chose qui est sue.
Sauriez-vous dater l’arrivée de cette nouvelle génération ?
Je dirais que ça a commencé aux États-Unis, il y a une vingtaine d’années, avec les alliances entre activistes et populations indigènes dans les mouvements altermondialistes. Et je crois d’ailleurs que des propositions comme celles des zapatistes y ont été pour beaucoup. Parce que les zapatistes pensent dans leur milieu et pas au nom de l’universel. Donc je pense qu’effectivement dans toute cette culture altermondialiste, il y avait cette nécessité d’hybrider les histoires de luttes sociales et les histoires de luttes contre la dévastation écologique. Quand on dit « Un autre monde est possible », alors le monde n’est plus seulement humain. Il implique aussi d’autres rapports avec tous les êtres vivants.
De plus, ces relations nouvelles entre activistes et peuples traditionnels fabriquent des modes de résurgence, des manières de faire et d’exister qui s’appuient avant tout sur ce qui a été détruit. Et ça, c’est pour moi l’un des grands changements de perspective qui vient après la domination par le mythe du progrès. C’est cette idée que nous sommes toutes et tous issu.e.s de désastres coloniaux, et ici en Europe aussi. Parce que la colonisation a commencé en s’en prenant aux mêmes choses ici et ailleurs : faire régner un droit de propriété qui est avant tout un droit d’exploiter, d’extraire, d’abuser et de détruire. Et pour moi, l’écologie, par conséquent, a toujours été une étho-écologie. C’est-à-dire que les êtres vivants qui composent un milieu sont issus de ce milieu, et donc des problèmes, des risques et des opportunités proposées par ce même milieu. De fait, on ne doit pas considérer que leur comportement, leur ethos, est déterminé par leur milieu, mais bien qu’ils se déterminent par rapport à leur milieu. Nous, vivants, ne sommes pas déterminés : on se détermine par rapport à ce à quoi on à affaire. Et donc, l’ethos, la manière de se comporter, est une des composantes intrinsèques de l’écologie. Avec l’écologie, on ne peut pas parler des espèces en général. Notre propos doit toujours être situé.
De ce fait, l’écologie apparaît comme une discipline d’observation, d’attention et d’acceptation de la surprise, qui vient créer de la transversalité un peu partout. Avec l’écologie, on parle d’événement, on parle de processus, de métamorphose, de résurgence… Il y a toute une série de termes qui peuvent voyager en produisant des intérêts nouveaux, et sans recréer le moindre surplomb scientifique. Donc, le sens que l’on donne à « intelligibilité » a muté. Il ne s’agit plus désormais de comprendre des lois. Les sciences réductionnistes – celles à craindre – étaient des sciences de la dépendance, qui cherchaient à comprendre de quoi dépendait un comportement. Mais, dès lors que l’on va vers l’interdépendance – de quoi un comportement a besoin, par quoi est-il mis en risque, etc. –, on change le sens du mot « intelligibilité » et donc, par extension, le sens de la position même de celui ou celle qui décrit. C’est difficile à dater, mais il y a des glissements en cours qui sont des modifications d’une culture du savoir.
Parlons un peu de nature : qu’est-ce que c’est pour vous ? Et comment vous positionnez-vous par rapport à ce concept ?
J’ai écrit il y a déjà très longtemps sur cette idée de nature. Le terme « nature » est tellement composite… Au fond, c’est une idée assez vide, sauf que ça reste l’idéal de quelque chose qui existerait indépendamment de l’humain. Je crois dès lors que dire qu’il y a de multiples natures – et de garder ce signifiant « nature » – n’est pas inutile. Car ce concept de nature nous permet d’affirmer que, si nous y prêtons l’attention qui convient, nous en apprendrons plus qu’au premier coup d’œil, et nous n’accepterons pas d’en apprendre moins. Donc ladite nature est une chose par rapport à laquelle c’est avant tout apprendre qui compte. Ce n’est pas une représentation, ce n’est pas un décor. Ça a de la densité, ça a des plis. C’est donc cette idée que la nature est quelque chose qui fait monde, et que, en dépliant, on en trouvera plus. Et puis la nature, ça tient. Et c’est donc en comprenant comment ça tient qu’on comprendra à quoi on a affaire. Et ça, j’aime beaucoup. La nature, en somme, est une matière à apprentissage, parce que d’une manière ou d’une autre on fait face à des choses qui tiennent par elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu’elles existent par elles-mêmes, mais en tout cas elles tiennent par elles-mêmes avec d’autres et grâce aux autres. La nature, alors, c’est ce à quoi nous demandons : comment tu consistes ?
Et donc ça, vous continuez à l’appeler « nature » ?
C’est comme on veut. Mon choix prend en compte le fait que ce mot a un passé lourd, qu’on ne peut annuler mais dont on peut hériter un peu autrement. En tout cas, une chose est sûre, ce que nous avons appris, ce à propos de quoi nous trouvons toujours plus, c’est que la nature, cela se détruit. Cela n’obéit pas à des lois, ce sont, à toutes les échelles, des modes d’interdépendance qui peuvent être détruits. Aujourd’hui, nous fabriquons des monocultures qui ne tiennent plus que par nous, nos pesticides et nos engrais. Ça, c’est un ravage de la nature, quand quelque chose ne tient plus que par nous.
Mais la pensée écologique n’invite-t-elle pas à redéfinir et à complexifier cette notion de « nature » ? À la réactualiser ? À dire qu’elle ne fait sens qu’avec l’humain dedans – bien qu’elle nous dépasse toujours autant ?
Oui, bien sûr. Mais elle fait sens aussi pour elle-même, et des sens multiples. Ce n’est pas l’humain qui donne sens, il essaie de le déchiffrer, de le faire signifier. En fait il n’y a pas de bonne définition de ce mot, nature, il faut toujours dire ce qu’on entend par là. Ce à quoi l’écologie s’adresse, c’est à des milieux, et cela à différentes échelles. Des milieux que nous partageons toujours avec d’autres, des milieux auxquels nous appartenons, etc. Terrain de vie ou milieu, peu importe. Et c’est ce que Deleuze et Guattari disent très bien dans Qu’est-ce que la philosophie ? : « Penser par le milieu. » Ça ne veut pas dire que les êtres sont fonction des milieux, mais ils demandent à être
pensés avec leur milieu.
Et l’intelligence écologique, c’est quoi ? C’est ça ?
Oui, l’intelligence écologique, c’est une intelligence de la différence entre interdépendance et dépendance. C’est une intelligence de ce que demandent les interdépendances, de ce dont elles rendent capables ceux qui y participent. À ce titre, on ne devrait pas opposer le naturel et le social. Si on peut les séparer, c’est parce que notre société nous demande de les séparer. Or, c’est l’intelligence des rapports que l’on peut nouer avec et dans tel ou tel milieu qui compte – et non la question de qui crée le sens. Le sens, ça se crée.
Donc les humains sont de la nature, et comme tous les autres participants, nous avons des moyens propres d’entrer en rapport, de transformer, de faire sens, mais les effets de ce que nous faisons sont également de la nature. Et ce que nous faisons, écologiquement mais aussi socialement, ce sont des milieux souvent appauvris, ravagés, etc. Mais même les OGM, c’est de la nature. On peut prendre au sérieux le paysan argentin qui dit que le soja génétiquement modifié est « méchant », car le mode d’existence de ce soja implique et exige une destruction généralisée. On n’a pas besoin de lui donner de dimension morale, mais c’est un jugement parfaitement acceptable, puisque ce soja est le produit de dynamiques intrinsèquement destructives. Donc dire qu’il est « méchant », on peut l’entendre sérieusement. Cela veut dire que nous avons mis au monde des êtres vivants qui n’ont pas besoin d’être pris dans des systèmes d’interdépendances. Les nurseries de plantes qui ont été sélectionnées pour survivre dans des environnements abstraits, sans requérir d’interdépendance avec d’autres, sont des choses dangereuses. Des choses mauvaises. Des choses « méchantes ». Et c’est pareil avec l’extraction minière : l’idée que l’on pourrait creuser impunément dans les entrailles de la Terre-Mère est une idée qui implique une anesthésie, une désensibilisation par rapport à des choses auxquelles d’autres peuples sont sensibles. Nous avons grandement besoin d’opérations de re-sensibilisation,
de ré-imagination, de repeuplement de l’imagination.
Comment l’écologie, science des relations, se définit-elle par rapport aux autres sciences ?
Maintenant, on parle tout à la fois d’écologie moléculaire, d’écologie sociale, d’écologie disons naturaliste, mais aussi d’écologie de la perception, etc. Donc les sciences découvrent de plus en plus qu’elles ne peuvent isoler pour définir. Ce qui m’intéresse, c’est la possibilité de notions transversales, de ce qui peut voyager à travers les situations écologiques que déchiffrent les sciences. Pour moi, cela pourrait signifier un renouvellement du rapport entre sciences et préoccupations communes. L’idéal de monoculture et de scalabilité – qui trouve une de ses origines dans la plantation coloniale et exige des définitions et des modes de gestion indépendantes de l’échelle, des circonstances et des histoires – ne sévit pas seulement dans les champs, mais à l’école par exemple. L’exigence que les savoirs soient formatés de manière telle que leur acquisition puisse être évaluée « objectivement » indépendamment des histoires et des rapports qui peuvent se tisser avec eux et entre les élèves, cela ressemble très fort à ces autres milieux « disciplinés » que sont les monocultures. La sensibilité à ces questions d’échelles et de localités propre à l’écologie – « ici ça se passe comme ça, et il faut être prêt à ce que ça se passe autrement ailleurs » – est aussi une sensibilité à l’historicité des milieux et aux pratiques qui les ont composés. Une sensibilité profondément située, pourrait-on dire. Avec l’écologie, il n’y a donc pas de vision en surplomb, mais plutôt un intérêt à suivre des trajets singuliers et leurs évolutions. L’écologie est une science de la rencontre, de la connaissance sensible – au sens fort du mot « sensible », pas seulement celui de la perception mais aussi de l’appréciation. Une science de savoirs qui se cultivent. Ce qui signifie également que la préoccupation écologique n’est jamais uniquement scientifique.
Est-ce que l’écologie, dans toute sa multiplicité, n’est pas en train de transformer nos représentations du monde ?
Si, et je pense qu’on le voit. On assiste à une écologisation générale des problèmes. Quand on a affaire au microbiome, et qu’on se rend compte que ce microbiome joue des tas de rôles dans le corps, eh bien, toute perspective exigeant une réponse à la question « qui est responsable ? » sont ébranlées. Plus moyen d’évoquer, en dernière instance comme on dit, « notre » ADN. Les responsables en dernière instance ont fait leur temps. Les questions deviennent aventureuses, les réponses deviennent typiquement écologiques : ça tient, non pas à partir d’une raison qui mettrait tout en ordre, mais de tas de manières qui se sont créées et de mises en rapport qui se sont plus ou moins stabilisées. Donc ça tient de manière précaire, presque merveilleusement. Nos définitions stables, par exemple celle qui séparait organisme et environnement, se défont. On ne sait plus précisément de qui et de quoi on parle : il n’y a plus qu’une multiplicité de modes d’existences, biologiques et non biologiques, qui ont besoin de milieux d’entrelacement qui leur donnent sens et où ils prennent sens. Et c’est là que la question des ravages écologiques se met à retentir à tous les niveaux, comme Félix Guattari l’avait déjà très bien entremêlé avec ses Trois écologies.