Avec L’Âge productiviste : hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques (La Découverte, février 2019), le philosophe Serge Audier poursuit son travail méticuleux de recherche des pensées écologistes dans les souterrains des deux derniers siècles de la modernité. Alors que La Société écologique et ses ennemis ; pour une histoire alternative de l’émancipation (La Découverte, 2017) s’était longuement arrêtée sur la diversité foisonnante d’auteurs du XIXe siècle, le dernier livre propose un panorama traversant tout le XXe siècle.
Dans les pages qui précèdent l’extrait ci-dessous, Audier revient sur les nombreuses alertes et diagnostics formulés au début du XXe siècle par le géographe français Franz Scharder (1844-1924). Ce dernier est alors tout le contraire d’un rêveur isolé : il bénéficie d’une grande renommée scientifique et de nombreuses responsabilités et récompenses institutionnelles.
Dans plusieurs textes, il décrit et analyse toute une série de périls écologiques qui font notre quotidien : désordres écologiques globaux, destructions des terres arables, « ruine de la planète elle-même », conception anthropologique erronée de notre rapport à la nature, etc. En 1904, il expliquait : « Déjà bien des fractions de l’humanité ont disparu, n’ayant pas pu se plier assez vite au gré de nos impatiences. Et quant à la terre, ces mêmes impatiences caractéristiques de l’évolution de plus en plus rapide où nous engageons le monde et nous-mêmes, quant à la terre, dis-je, nous avons déjà eu le temps de voir que la « mise en valeur » s’est résumée sur bien des points dans la destruction pure et simple de richesses latentes, qui, après leur transformation en monnaie, ont laissé la planète et l’humanité plus pauvres qu’auparavant : destruction des forêts, dessèchement de vastes régions, grandes cultures appauvrissantes, peuples supprimés, guerres destinées à faire vivre artificiellement telles industries. »
Serge Audier, L’Âge productiviste : hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques, Paris, La Découverte, 2019, pp. 20-25.
Comment expliquer que ses [il est ici question de Franz Scharder] inquiétudes et ses visions d’une solidarité planétaire aient trouvé un écho somme toute modeste, même si son combat sera repris tout au long du xxe siècle ? Comment comprendre que l’idée d’une « société écologique » ait si difficilement percé le mur de l’indifférence et du rejet ? Bien peu d’amis, beaucoup d’ennemis extrêmement puissants : si une « société écologique » n’est jamais parvenue à émerger, c’est bien parce que des forces considérables se sont opposées à sa conception et à sa réalisation.
Parmi ces forces, la première qui vient à l’esprit n’est autre que le « capitalisme ». Sans employer le terme, Schrader lui-même orientait le diagnostic de ce côté-là. De nombreux analystes ont, depuis, mis en avant cette responsabilité majeure et même centrale dans la crise écologique. Durant les années 1940, un des plus grands critiques du capitalisme et de l’idée de marché autorégulé, Karl Polanyi, pointait dans quelques passages de La Grande Transformation les dégâts naturels dont le capitalisme était le foyer. Sans affronter directement l’enjeu écologique, il l’évoquait dès la présentation de son livre : « Notre thèse est que l’idée d’un marché s’ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l’homme et sans transformer son milieu en désert. » On reviendra sur ses analyses, comme sur celles, bien antérieures, de Karl Marx, qui dans Le Capital soulignait l’impact désastreux de la logique du profit sur la terre et l’agriculture. Dans les dernières décennies du xxe siècle, des penseurs « éco-marxistes » et « éco-socialistes » comme James O’Connor devaient mobiliser ce double legs de Marx et Polanyi pour souligner la responsabilité centrale du capitalisme – et son insoutenabilité à tous égards – dans la crise écologique. Plus récemment, un théoricien d’une autre version de l’éco-socialisme, John Bellamy Foster, a lui aussi désigné, avec son coauteur Fred Magdof, le seul grand coupable : le « capitalisme ». À juste titre, ce penseur d’obédience marxiste souligne que trop de citoyens et d’intellectuels s’en tiennent à des généralités sur les maux infligés par l’activité humaine à l’environnement, sans aller aux causes réelles, à savoir le système économique et culturel hégémonique sur toute la planète qu’est le capitalisme. Il cite ainsi l’économiste marxiste américain Paul M. Sweezy, affirmant que « pour ce qui concerne l’environnement naturel, le capitalisme le perçoit non pas comme quelque chose à chérir et à apprécier, mais comme un moyen pour atteindre le but primaire de réaliser des profits et d’accumuler encore plus de capital ». L’éco-marxiste Bellamy Foster cite aussi Marx rappelant que l’impératif catégorique du capitalisme est clair : « Accumulez ! Accumulez ! C’est la loi et les prophètes. » Si l’on entend par capitalisme « un système économique et social dans lequel les propriétaires du capital (ou capitalistes) s’approprient le surplus de produit créé par les producteurs directs (ou travailleurs) », ce qui conduit à l’« accumulation de richesse (investissement et amas de richesse) par les propriétaires », alors tout indique que le capitalisme est structurellement destructeur de l’environnement, comme de la société. Il suppose en effet « une “externalisation” de coûts énormes sur la société et l’environnement », et il ne saurait en aller autrement dans une logique où, quelles que soient ses modalités et ses transformations, le profit commande tout. En ce sens, à la question de savoir qui sont les ennemis de la « société écologique », la réponse est claire : le capitalisme et ceux qui en détiennent le commandement.
Nous souscrivons à l’idée que le « capitalisme », par-delà ses innombrables transformations et la multiplicité de ses acteurs, n’a cessé, en tant que modèle économique dominant, d’être l’une des causes principales de la crise écologique contemporaine. La hausse vertigineuse des émissions de carbone et l’expansion accélérée de la déforestation trouvent comme explication majeure la révolution industrielle, dans ses différentes étapes, et l’usage exponentiel des énergies fossiles. On ne dira donc jamais assez à quel point le « capitalisme » – même si, il faut y insister, ce mot recouvre une grande diversité d’expériences historiques – a détruit, et continue de détruire, la planète. C’est pourquoi il nous paraît légitime de parler non pas seulement d’« anthropocène », de « technocène » ou de « thermocène » pour désigner la phase nouvelle et sans précédent de destruction des ressources et du milieu naturels par l’humanité, mais bien de « capitalocène », dont on peut repérer les étapes dans l’essor d’un « capitalisme houiller » dès le xvie-xviie siècle, puis d’un capitalisme industriel au xviiie-xixe siècle, en insistant sur le rôle crucial de l’invention de la machine à vapeur. Ces généalogies – qui situent d’ailleurs la naissance du capitalisme à des moments différents – sont en partie convaincantes, même s’il faut insister sur des causes beaucoup plus lointaines de la crise écologique, qui exigeraient une recherche spécifique, mais qui en tout cas ne suffisent pas à expliquer l’extrême gravité de la crise de notre temps.
Néanmoins, à s’en tenir là, on en resterait à une réponse convenue et faible. D’abord parce qu’il y a plusieurs formes de capitalisme, elles-mêmes liées à différentes formes de société. Et, contrairement à ce que suggère Bellamy Foster, le capitalisme n’est pas nécessairement anarchique et inorganisé. Opposer le capitalisme à la « planification », comme il le fait, c’est oublier bien vite que, sous des formes plus ou moins importantes, le capitalisme a été, dès les années 1930 et surtout dans l’après-1945, fortement organisé et planifié. Cette planification souple, sous l’influence de penseurs et d’expériences venus de la gauche – du New Deal de Franklin D. Roosevelt à l’école de John Maynard Keynes, en passant par le « planisme » du socialiste Henri de Man –, a été parfaitement compatible avec un nouveau cours du capitalisme, mais aussi avec un nouveau cycle de pollution et de destruction de l’environnement. Nombre de sociétés, durant le compromis économique et social de l’après-1945, ont bridé les logiques de profit, mais pas les logiques destructrices de la nature – elles les ont même nettement aggravées. En outre, à pointer du doigt le seul capitalisme, fût-il organisé, on en finirait par oublier qu’une bonne partie de la planète après 1917, et surtout après 1945, a été sous l’emprise des régimes communistes ou socialistes, dont l’impact environnemental a été le plus souvent catastrophique. De plus, nombre de ces pays, de la Russie à la Chine en passant par les pays de l’Est, se sont convertis au capitalisme et à l’économie de marché sans nécessairement rompre entièrement avec leurs objectifs passés – en particulier la croissance industrielle. Bref, ne viser que le « capitalisme sauvage », c’est passer largement à côté des causes de la crise écologique.
De surcroît se pose la question de la responsabilité du mouvement progressiste dans son ensemble, et notamment du socialisme, même quand il ne fut pas au pouvoir. Pourquoi n’a-t‑il pas su mettre en œuvre, ou en tout cas proposer, des alternatives écologiques ? Pourquoi ce thème fut-il si peu prégnant dans le mouvement ouvrier, censé être l’avant-garde ou le groupe central de la libération de l’humanité ? C’est là que la stratégie intellectuelle de Bellamy Foster et d’autres « éco-socialistes » révèle également ses grandes limites.
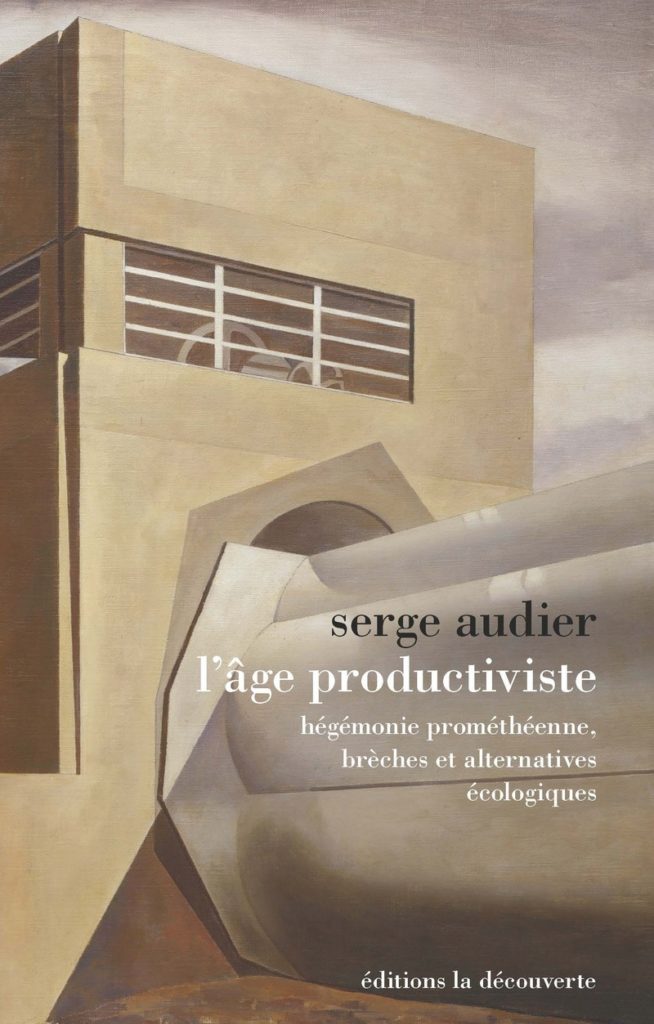
Et ce d’autant plus que Bellamy Foster se veut de longue date le porteur de la thèse selon laquelle Marx était un penseur totalement « écologique », tout comme, imagine-t‑il, une partie importante de ses successeurs marxistes et communistes. Or, est-ce si sûr ? Croit-on vraiment que le socialisme, en particulier dans sa mouture marxiste, ne porte pas lui aussi une grande part de responsabilité dans la crise écologique contemporaine ? Pourquoi ne pas explorer cette dimension, dans les textes et les pratiques, au motif que le seul vrai coupable est le capitalisme ? Les positions éco-marxistes dans la version de Bellamy Foster peuvent laisser d’autant plus perplexe que ce professeur de sociologie fait l’apologie des positions dites « socialistes » de l’ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, qui aurait trouvé la voie d’un socialisme écologique par la promotion de la « propriété sociale », de la production sociale par les ouvriers, et de la satisfaction des besoins de la communauté. À observer les destinées du Venezuela dans les années 2010, tant du point de vue démocratique qu’économique et social – sans oublier non plus que cette économie a pour moteur l’exploitation du pétrole –, on peut être perplexe. D’autres cas pourraient être mentionnés dans le même sens : si une critique du capitalisme reste indispensable, il se pourrait qu’une autocritique de la gauche, et particulièrement du socialisme marxiste, s’impose comme une étape nécessaire de tout questionnement sur les sources du problème environnemental contemporain – et donc sur ses possibles solutions.
La question est politique, elle est aussi philosophique. L’une des figures intellectuelles les plus éminentes de la gauche française et mondiale du xxe siècle, Simone de Beauvoir, disséquant la « pensée de droite », assenait le diagnostic suivant, en mentionnant Charles Ferdinand Ramuz, un écrivain suisse apologiste de la nature et du terroir dont il sera question dans ce livre : « “La Nature est à droite”, disait Ramuz. Ce qui est vrai c’est que la Nature est une des grandes idoles de la droite : elle apparaît comme l’antithèse à la fois de l’Histoire et de la praxis. Contre l’Histoire, la Nature nous donne du temps une image cyclique ; on a vu que le symbole de la roue ruine l’idée de progrès et favorise les sagesses quiétistes : dans le recommencement indéfini des saisons, des jours et des nuits s’incarne concrètement la grande ronde cosmique. L’évidente répétition des hivers et des étés rend dérisoire l’idée de révolution et manifeste l’éternel. » La grande pionnière du féminisme français, qui incarnait aux yeux du monde le meilleur de l’intelligentsia de gauche, pouvait se sentir d’autant plus autorisée à situer la droite du côté de la « nature » – et réciproquement – que, durant les années 1940, autour du régime de Vichy, toute une littérature et une idéologie du terroir avaient exalté la nature et la terre contre la grande ville et les idéaux de la Révolution française. Dans l’antinaturalisme radical de la grande théoricienne du féminisme se combinaient le rationalisme cartésien, une certaine lecture du progressisme marxiste et l’existentialisme de Jean-Paul Sartre et d’elle-même. Cependant, au-delà de son cas, comment ne pas voir que cette manière de rabattre le naturalisme du côté de la droite a constitué un geste répété de la gauche, c’est-à-dire de cette mouvance qui, par-delà son extrême diversité, a eu pour boussole l’égalité de tous et leur non-assignation à des rôles sociaux et biologiques prédéterminés par la nature, la hiérarchie ou la tradition ? C’est pourquoi le philosophe italien Norberto Bobbio, dans un essai des années 1990 devenu classique, pouvait affirmer que la gauche, par son attachement à l’égalité, était nécessairement du côté de l’artificialisme, et donc la droite du côté de la nature. La conviction de cet homme de gauche venu de l’antifascisme et du socialisme démocratique était largement partagée – et elle le reste souvent aujourd’hui. Or les implications écologiques d’une telle grille de lecture furent considérables. Même si cela coûte à le reconnaître, y compris pour l’auteur de ces lignes, il faut y insister, en un geste autocritique : tant au plan philosophique que programmatique, la gauche, héritière des idéaux de liberté, d’égalité et de progrès, a majoritairement rencontré des problèmes structurels avec la question écologique. En ce sens, ses noces le plus souvent manquées avec l’écologie scellent aussi tragiquement sa responsabilité historique dans la crise actuelle.
La réaction « néolibérale », entre déni et adaptation
Dans ce début du xxie siècle, s’interroger sur les responsabilités passées du socialisme et de la gauche peut paraître dérisoire au regard de tendances mondiales qui ont quasiment broyé leur existence même, et qui sont massivement responsables de l’aggravation de la crise écologique en cours. Pourtant, une renaissance écologique de la gauche – ou, disons, des mouvements en faveur de l’émancipation de tous – suppose selon nous un tel travail historique et philosophique autocritique, pour contribuer à une reconstruction qui reste presque entièrement à accomplir. Et ce d’autant plus que la grande offensive du capitalisme dit néolibéral, à partir des années 1970, a profité des échecs et des faillites de la gauche, au point de l’acculer à disparaître, ou à s’adapter à la nouvelle donne, ou bien encore à camper sur des positions minoritaires. L’un des objets de ce livre sera aussi de cerner le sens de ce moment des années 1970‑1980, qui conditionne encore la situation du début du xxie siècle.







