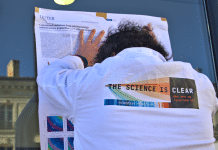A propos de Gaultier Bès, Radicalisons-nous. La politique par la racine, Editions Première Partie, Paris, 2017 et de Alain Policar, Comment peut-on être cosmopolite ?, Le bord de l’eau, Paris, 2018.
A l’heure où la politique migratoire devient un des premiers axes de clivage politique en Europe, la publication récente de deux ouvrages nous fournit l’occasion de faire le point sur le rapport entre écologie et cosmopolitisme. Il s’agit d’une part du livre de Gaultier Bès, Radicalisons-nous. La politique par la racine1 ; et d’autre part, de celui d’Alain Policar, Comment peut-on être cosmopolite ?2.
Des racines en mouvement ?
La thèse de Gautier Bès peut être résumée comme suit : la notion de « racine » est féconde en ce qu’elle rend compte d’une commune « condition » des végétaux et des sociétés humaines, qui se rapportent à un sol sur lequel les uns comme les autres déploient leurs architectures. Bès se défend de tout réductionnisme : la métaphore ne prétend pas dire le tout de l’expérience humaine. Il la revendique cependant dans un contexte de « liquéfaction » 3, encouragé par la marchandisation des rapports sociaux, qui leur dénie toute inscription dans un lieu. La mondialisation contemporaine déteste les lieux, les territoires, comme le pâtissier les grumeaux. Au contraire, Bès s’oppose au hors-sol et à l’hydroponie, en agriculture comme en politique. A ceux qui lui reprocheraient une lecture passéiste ou réactionnaire de l’identité, voire une apologie de l’immobilisme (une « politique d’éternité », pour reprendre les termes du politologue Timothy Snyder), il oppose une conception volontiers dynamique, vitaliste, qui fait du végétal enraciné un être « en mouvement » et, à ce titre, faiseur d’histoire
« Dire d’un pays ou d’un individu qu’il a ses racines, ce n’est pas le naturaliser, c’est-à-dire l’amalgamer au règne végétal en niant ses spécificités, mais bien plutôt l’historiciser, c’est-à-dire en reconnaître la part évolutive, la dimension circonstancielle. Comme tout ce qui est vivant, le végétal, aussi, a une histoire » (Bès, p.29)
Bès va puiser chez Simone Weil les sources de sa philosophie politique. Il lui emprunte, plutôt qu’à Barrès (qui est à peine évoqué dans le livre, et toujours comme figure repoussoir) sa thèse de l’enracinement, qu’il définit comme la « coopération entre les individus et les milieux avec lesquels ils interagissent ». Mais là où la philosophe parle de racines multiples, et insiste surtout sur la nécessaire congruence entre ses appartenances diverses (le sociologue allemand Hartmut Rosa parlerait ici de mise en « résonnance », pour désigner ce poly-enracinement porteur de sens et d’un sentiment d’accomplissement), Gaultier Bès s’attache à la notion de racine comme à une sorte de totalité, certes mouvante, dynamique, dont nous sommes les héritiers. Il ne discrimine pas suivant ses composantes. C’est ce qui l’autorise à parler d’identité (ce que Weil ne fait pas), qu’il définit comme un « style » : « S’il est absurde de parler de France éternelle, si elle n’est pas une essence immuable, qui ferait des Français d’aujourd’hui les descendants directs de « nos ancêtres les gaulois », elle a au moins un style ».
Observer et reconnaître ce style, c’est assurément éprouver une forme de paix, comme celle que procure la contemplation d’un vieux chêne. Bès voit dans ce sentiment un antidote aux entreprises belliqueuses, et récuse toute amalgame entre guerre et nationalisme : « la guerre est la plupart du temps affaire de conquête et de rivalité, de désir de puissance et de vanité, tentations qu’au fond celui qui est bien chez lui n’a guère de raison d’éprouver. […] Ce n’est pas l’enracinement qui menace la paix, mais le déracinement ». Ces passages ne sont pas sans rappeler le pacifisme d’un Jean Giono, ou, plus lointainement, d’un Joachim du Bellay.
Un « cosmopolitisme enraciné » ?
C’est à une autre source que puise Alain Policar lorsqu’il entreprend de fonder son projet de « cosmopolitisme enraciné ». Pour lui, tout cosmopolitisme repose avant tout sur une injonction morale : celle qui nous amène à reconnaître en tout homme un semblable. Le cosmopolitisme (le mot remonte aux philosophes stoïciens, le « cosmopolites » est « citoyen du monde », et à ce titre se sent partout chez lui, précisément parce qu’il est étranger à toute chose) se fonde sur la considération que nous ne sommes porteurs de droits qu’en vertu de notre humaine « nature », et indépendamment de notre appartenance à une communauté politique quelconque. A l’inverse d’Arendt qui voit en cette communauté la puissance instituante, celle qui accorde « le droit d’avoir des droits », et prévoit les conditions leur exercice effectif, Policar rattache les droits à la seule « nature humaine ». Tout comme Bès à propos du terme « racine » et « enracinement », mais de manière symétrique, Policar réfute l’accusation qui consisterait à imputer à la notion de « nature humaine » un caractère totalitaire, irrespectueux de différences. La notion de « nature » humaine est certes substantielle en ceci qu’elle est porteuse d’un contenu positif et permet de fonder une éthique. Le naturalisme de Policar est aussi, selon le mot de Dworkin, un « perfectionnisme » : « ce libéralisme substantiel, lequel comporte nécessairement une dimension perfectionniste (comment pourrions-nous légitimer la promotion d’une conception de la vie bonne sans cette dimension) entretient un lien consistant avec mon engagement cosmopolitique » (Policar, p. 34). Ce perfectionnisme cependant n’a pas de traduction univoque sur le plan des productions culturelles de l’être humain. Il n’est pas une seule manière d’être pleinement « Homme », mais toutes doivent, pour être également reconnues comme fécondes, encourager chez chacun ces vertus qui nous conduisent à voir en l’autre un semblable, et « postposer », comme nous y invite Montaigne, ses particularismes culturels à l’évidence première, et immédiate, de notre commune humanité : « j’estime tous les hommes mes compatriotes et embrasse un polonais comme un français, postposant cette liaison nationale à l’universelle et commune ». Policar fait sienne, en somme, la devise de Térence (« homo sum et nihil humanum a me alienum puto » : je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger) et y voit, avec Kwame Appiah, la règle d’or du cosmopolitisme. Cet éloge de la diversité ne se réduit pas une curiosité de « naturaliste » : elle nous encourage à modifier le cours de nos vies, à les rendre poreuses à l’altérité, toutes les fois que de ce surcroît de substance nous pourrions tirer la matière d’une vie meilleure : c’est en ce sens que l’on peut parler avec Appiah de « cosmopolitisme enraciné »… Lévinas ne disait-il pas : « un être capable d’un autre destin que le sien est un être fécond » ?4
Policar aborde donc le cosmopolitisme par le versant individuel, « situé » : « la thèse ici défendue fait du cosmopolitisme avant tout une relation entre des individus singulièrement et non collectivement considérés » (Policar p. 34). Il revendique un cosmopolitisme « itératif », de situation, à l’encontre d’un cosmopolitisme institutionnel qui se soucierait avant tout d’agencements juridiques :
« […] Si le cosmopolitisme est bien évidemment, un universalisme, il rejette ses incarnations dites abstraites, ce que l’on pourrait nommer, après Michaël Walzer, l’ « universalisme de surplomb » (lequel se fonde sur une loi unique valable universellement), pour défendre un « universalisme réitératif », qui exprime, par exemple dans le cas de la libération à l’oppression, le caractère particulier de toute expérience en même temps que sa répétition pour chaque peuple opprimé, dégageant ainsi l’universalité de la détestation de l’oppression ». (Policar p. 208)
Le cosmopolitisme de Policar est une expérience, une épreuve, par laquelle je me reconnais citoyen précisément en vertu du fait que je suis, par nature, un étranger, tout comme l’est cet « autre » que j’accueille : « de deux grandes orientations possibles de l’engagement cosmopolite, celle selon laquelle, étant tous citoyens du monde, il n’existe pas d’étrangers, et celle qui au contraire, considère que nous sommes tous des étrangers, nous choisirons délibérément la seconde » (Policar p. 8). L’accueil du migrant est le creuset d’une révélation intime, qui me restitue la pleine conscience de ma liberté, et me rattache à la communauté politique en tant que pure singularité, une tête d’épingle qui contient à elle seule l’universel tout entier.
Ainsi, sans nier la réalité et la vigueur du sentiment d’appartenance à une communauté particulière, Policar entend le projet cosmopolite comme une transgression, qui permettrait en définitive de dépasser le cadre national et d’orienter, à la manière d’une idée régulatrice, la démocratie vers sa pleine réalisation à l’échelon planétaire. Le cosmopolitisme est porteur d’un authentique programme politique :
« Se donner les moyens d’inscrire le cosmopolitisme à l’agenda politique, c’est insister sur l’absence de rupture entre ce dernier et l’idéal républicain. Si la démocratie se réalise historiquement dans l’Etat-nation, loin de discréditer celui-ci, « le cosmopolitisme n’est rien d’autre qu’une articulation explicite des fins normatives dont l’Etat-nation représente, pour le moment, la meilleure réalisation historique ». […] Le cosmopolitisme peut être ainsi compris comme un principe de désappropriation par rapport aux communautés effectives » (Policar p. 126)5.
Une double-impasse : le rapport à l’histoire coloniale et à la politique migratoire
Les deux auteurs s’opposent donc radicalement, en ceci qu’ils assignent à la politique des fins opposées. Tandis que Bès propose d’approfondir l’enracinement, quitte à admettre la possibilité d’incorporer dans la communauté nationale des allochtones (à condition toutefois que ceux-ci se prêtent à une politique d’enracinement6), Policar au contraire récuse tout discours, « aussi modéré soit-il, sur les identités particulières » (Policar p.147). Son cosmopolitisme est en ce sens tout aussi « radical » que la politique d’enracinement promue par Gaultier Bès.
Nous voici donc aux prises avec deux radicalités symétriques, et qui semblent avoir conquis leur pureté axiomatique au prix de deux impasses : l’une concerne le rapport à l’histoire coloniale, la seconde le rapport à la politique migratoire.
De la première, on pourra dire qu’elle se traduit, chez les deux auteurs, par une véritable occultation de ce qui caractérise la figure de l’ « étranger » en France, savoir son appartenance, le plus souvent, à une histoire coloniale dont nous ne finissons pas de tirer les leçons, et que nous refusons d’incorporer pleinement à notre « roman national », autrement que sous la forme d’un récit glorieux et pour tout dire apologétique. Sans doute Gaultier Bès partage-t-il in petto ce sentiment, lui qui invoque volontiers, à l’abri de la métaphore de l’« arbre-France », une sorte de totalité organique dont la splendide harmonie saute aux yeux , dès lors que l’on adopte une vue d’ensemble : « Comme toute histoire humaine, la nôtre comporte bien des pages épouvantables. Mais il est aussi déraisonnable de les nier que de les ressasser. […] tout n’y est certes pas sublime, mais tout n’y est pas sordide » (Bès p. 63). Or, cette occultation est problématique, dans la mesure où elle qualifie l’étranger comme pure extériorité. Ce geste simplificateur, et en somme fallacieux (car il occulte la dimension factuelle de la question) encourage le passage à l’abstraction ou à la métaphore. Il nous faut au contraire soutenir que l’étranger est déjà, bien souvent, un acteur du roman national, et que ce roman ne s’écrit qu’au prix de luttes sociales dont l’objet n’est autre que le droit à participer à la fabrique des imaginaires. L’étranger est déjà là, et c’est de nous qu’il s’agit lorsque nous lui faisons une place à notre table. Mais il ne s’assied pas de bonne grâce à la place que nous lui assignons : il en revendique une autre, et invoque sa propre mémoire, son propre rapport à l’histoire, pour justifier de son bon droit. La « composition des mondes » à laquelle le cosmopolitisme nous invite est donc par essence conflictuelle : rien n’est dit de ce conflit, et de la manière, sinon de le surmonter, du moins de le contenir dans les bornes de la raison démocratique. L’étranger n’a pas de corps, il est une pure figure rhétorique, alors même que notre propre rapport à la communauté politique s’est construit, historiquement, sur le lit de l’expérience coloniale, et notamment de la guerre d’Algérie. Que l’on songe ici, par exemple, aux pages admirables qu’Alexis Jenni a consacrées à l’Art français de la guerre. Si jamais il devait y avoir à nouveau une identité nationale (voire une « nation » dans le sens de Renan), ce ne sera qu’au prix d’une lecture partagée de notre histoire nationale, et d’une recomposition de nos imaginaires politiques où les victoires seront commémorées de part et d’autre, avec une égale ferveur, comme autant d’épisodes d’un parcours de reconnaissance que nous avons tous en partage, quelle que soit la part que nous, ou nos ancêtres, y auront prise.
La politique de la racine nous entraîne sur la voie d’un « organicisme » généralisé dont les origines philosophiques sont par trop évidentes, puisqu’il est commun à tous les auteurs contre-révolutionnaires, de Joseph de Maistre jusqu’à Patrick Buisson. Quant au cosmopolitisme, aussi enraciné soit-il, nous ne pouvons en respecter les injonctions qu’à la condition de refuser de déduire de l’accueil, de ses formes concrètes, une quelconque politique, si ce n’est d’un point de vue purement général et abstrait (à savoir, l’établissement d’une communauté humaine universelle).
La cécité à l’égard de la politique migratoire procède, pour une bonne part, de ces considérations. Ni Bès ni Policar ne prennent ici soin de dire ce que serait, en la matière, une « juste politique ». Nous en sommes réduits aux conjectures, et il nous est permis de supposer que le premier soutiendra l’idée d’un contrôle des flux frontaliers, tandis que le second s’y opposera, dans la mesure où la frontière n’est raisonnable qu’à la condition de garantir à tout Homme la pleine reconnaissance de ses droits naturels, au sein de la communauté politique à laquelle sa naissance l’a assigné7. Sitôt que l’on refuse d’accorder ces droits, ne fût-ce qu’à un seul homme, toute frontière est illégitime.
L’angle-mort : la notion de « seuil »
Les deux impasses dont nous avons fait mention prennent en réalité leur source dans un rapport également simpliste à la notion de culture, qui ne saurait être réduite, ni à un terreau, ni non plus à un ensemble d’ « artefacts » (Policar p. 110) parmi lesquels nous serions libre de choisir, au gré des circonstances. Il convient ici d’invoquer un texte décisif de Claude Lévi-Strauss, qui me semble apporter la dose de complexité dont manquent cruellement les analyses de Bès et de Policar. Ce texte est d’autant plus essentiel qu’il établit une analogie entre la culture et la génétique, afin de justifier, au nom de la préservation de la diversité culturelle et biologique, des politiques de fermeture.
De la culture, Claude Lévi-Strauss écrivait en 1971 qu’il nous est tout autant impossible de nous en extraire que le voyageur de sauter d’un train lancé à vive allure :
« Or, tout membre d’une culture en est aussi étroitement solidaire que [le] voyageur […] l’est de son train. Dès notre naissance, l’entourage fait pénétrer en nous, par mille démarches conscientes et inconscientes, un système complexe de références consistant en jugements de valeur, motivations, centres d’intérêt, y compris la vue réflexive que l’éducation nous impose du devenir historique de notre civilisation […]. Nous nous déplaçons littéralement avec ce système de références, et les réalités culturelles du dehors ne sont observables qu’à travers les déformations qu’il leur impose, quand il ne va pas jusqu’à nous mettre dans l’impossibilité d’en apercevoir quoi que ce soit. »8
Lévi-Strauss n’a jamais cédé à une définition organiciste de la culture, et il me semble qu’il faut le suivre lorsqu’il la définit comme un ensemble d’écart différentiels, plus ou moins saillants, plus ou moins stabilisés permettant d’identifier, afin de mieux les étudier, des entités discrètes. Tout dépend donc du point de vue de l’observateur, et l’on pourra parler de la « culture marseillaise » (pour la distinguer de la parisienne, par exemple), tout autant que de la culture « française » ou « allemande », selon le point de vue que l’on a décidé d’adopter. La culture est donc tout à la fois constituée d’un ensemble hétéroclite, et parfois même hétéronome, de traits spécifiques, sans pour autant se réduire à un répertoire. Elle ne constitue pas nécessairement une totalité « structurale » cohérente (c’est en ceci qu’elle est complexe), mais n’en fait pas moins système.
Or cet ensemble d’écart différentiels ne peut se perpétuer dans le temps qu’à la condition d’un certaine « surdité » à l’égard des cultures voisines :
« Sans doute nous berçons-nous du rêve que l’égalité et la fraternité règneront un jour entre les hommes sans que soient compromise leur diversité. Mais […] l’humanité […] devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l’appel d’autres valeurs, pouvant aller jusqu’à leur refus sinon même à leur négation. Car on ne peut, à la fois, se fondre dans la jouissance de l’autre ; s’identifier à lui, et se maintenir différent. Pleinement réussie, la communication intégrale avec l’autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l’originalité de sa et de ma création. Les grandes époques créatrices furent celles où la communication était devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans être cependant assez fréquente et rapide pour que les obstacles indispensables entre les individus comme entre les groupes s’amenuisent au point que de échanges trop faciles égalisent et confondent leur diversité. »9
En la matière, tout est donc affaire de seuils :
« Pour développer des différences, pour que les seuils permettant de distinguer une culture de ses voisines deviennent suffisamment tranchés, les conditions sont grosso modo les mêmes que celles qui favorisent la différenciation biologique entre les populations : isolement relatif pendant un temps prolongé, échanges limités, qu’ils soient d’ordre culturel ou génétique. »10
Ainsi, pour Lévi-Strauss, les cultures disparaissent lorsque le rythme des échanges, ou leur volume, rendent impossible la préservation de traits distinctifs. L’écart est perdu, l’uniforme se substitue à l’universel, le « commun » même est impossible puisqu’il ne s’établit qu’entre individus porteurs de spécificités culturelles. Paradoxalement, il faut au cosmopolitisme de la différence… Et celle-ci cependant fait obstacle (de manière définitive) au projet cosmopolite d’une « transgression » itérative, selon l’expression d’Alain Policar.
La « nature » ne discrimine pas, mais elle borne
On a reproché à l’auteur de Race et Culture sa trop grande proximité avec les thèses de la nouvelle droite réactionnaire11. Je n’entrerai pas dans ce débat. Le point qui m’intéresse ici, c’est le parallèle établi entre nature et culture, entre écologie (via l’usage que fait Lévi-Strauss de la génétique des populations) et cosmopolitique.
L’écologie a-t-elle quelque chose à objecter au projet cosmopolitique ? Peut-on le récuser au nom de la préservation des écosystèmes ? À cette question, la land ethic (éthique de la Terre), autrement dit la branche de la philosophie morale et politique qui s’évertue à dégager les principes philosophiques d’une éthique conforme à l’impératif écologique, et qui représente un des champs intellectuels les plus controversés de l’écologie politique, ne semble apporter aucune réponse. La nature ne discrimine pas, parmi les habitants d’un territoire donné, selon qu’ils sont autochtones ou allochtones. Tout au plus pourrait-on reconnaître aux premiers le bénéfice de l’antériorité et d’une meilleure connaissance de ce qu’Aldo Leopold appelait le « point de vue de la montagne », autrement dit celui de l’écosystème dont les hommes doivent préserver les équilibres, et accroître la résilience, s’ils veulent satisfaire à la maxime fondamentale de l’éthique de la Terre : « une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste si ce n’est pas le cas »12.
L’écologie semble muette à l’endroit de la question cosmopolitique, mais l’écologie politique ne saurait se soustraire à la question de savoir ce que doit être, de son point de vue, une politique migratoire « juste », adéquate à ses objectifs. Or, sur ce plan, l’écologie politique, en tant que politique d’émancipation (et comme tous les courants qui se réclament de ce principe) se trouve confrontée au dilemme suivant : comment concilier solidarité nationale et solidarité universelle ? Jusqu’où doit s’étendre la première, jusqu’où la seconde ? Ni Bès ni Policar ne répondent à cette question de manière décisive, et aucune de leurs analyses ne permettent de l’évacuer.
Si la nature (ou plus précisément, l’écologie politique) ne discrimine pas, elle borne, au sens où elle admet l’existence de seuils au-delà desquels les capacités de régénération des écosystèmes ne sont pas assurées. S’accorder sur de tel seuils implique-t-il de réduire la part de l’étranger à la portion congrue, à la variable résiduelle ? Faudrait-il, après avoir exploité au maximum les capacités de régénérescence des écosystèmes, accrocher à la porte de notre compartiment un tableau portant la mention « complet », et refouler le trop-plein de voyageurs ?
L’effondrement qui vient nous donnera sans doute l’occasion de mettre à l’épreuve des flux migratoires de telles dispositions d’esprit. On sait que, par le passé, les quelques rares sociétés étant parvenues à échapper au risque d’effondrement ne se sont pas embarrassées de règles d’hospitalité, allant même jusqu’à pratiquer un contrôle des naissances qui transformait certains de leurs membres en parias13. Encore ce risque était-il à l’époque circonscrit à tel ou tel territoire particulier. Il en va tout autrement cette fois-ci. Les bouleversements à venir seront d’une telle ampleur que les refoulés n’auront guère où se rendre, et que seules les zones tempérées seront susceptibles de fournir un refuge sûr aux réfugiés climatiques des régions intertropicales dont les écosystèmes, usés jusqu’à la corde, auront franchi le seuil critique de non-renouvellement. Sans attendre cette échéance (sans doute proche), l’écologie politique nous enjoint de tout mettre en œuvre pour accorder les sociétés à leur milieu, et faire ainsi coïncider géographie humaine et naturelle, en restituant au « territoire » (peuplé d’espèces vivantes humaines et non-humaines, dont les « puissances d’agir » sont également convoquées) sa valeur ordonnatrice. Dans ces territoires nouvellement constitués, quelle place pour le dernier arrivé, pour l’étranger ?
Si la morale nous enjoint d’accueillir jusqu’au dernier réfugié, y compris au risque de voir notre train dérailler sous le poids de ses occupants (ou notre esquif sombrer), ce sera donc, non pas au nom, mais en dépit de l’injonction morale de l’éthique de la Terre. Nos devoirs envers l’espèce se seront dans ce cas, comme toujours en Occident (seulement ?), surimposés à ceux qui nous arriment à notre communauté biotique.
Notes
- Editions Première Partie, Paris, 2017[↩]
- Le bord de l’eau, Paris, 2018.[↩]
- Cf . Zygmunt Bauman, La vie liquide.[↩]
- Cité par Policar, ibid, p. 98.[↩]
- Policar cite ici un extrait d’un texte de François Cheneval, La cité des peuples. Mémoides de cosmopolitismes, Pari, Le Cerf, 2005, 263. [↩]
- On notera que cette condition avait déjà formulée par Maurras lui-même (Cf Policar, Ibid, p. 139.[↩]
- Cette exigence ne se limite pas aux droits formels, mais porte aussi sur leur exercice effectif. Policar se fait ici l’écho des thèses de la Yaël Tamir qui parle d’un nationalisme libéral : « restreindre l’immigration en vue de conserver le caractère national d’un certain territoire n’est justifié que si toutes les nations ont une chance égale de créer une entité nationale dont les membres auront une chance équitable de poursuivre leurs buts individuels et collectifs. Le droit de préserver l’homogénéité culturelle dépend donc de la richesse des autres nations. Le nationalisme libéral implique qu’il est justifié pour une nation de viser l’homogénéité en contrôlant l’immigration seulement si cette nation a satisfait à l’obligation globale qui lui incombe d’assurer l’égalité entre toutes les nations » (Yaël Tamir, Liberal nationalism, Princeton, Princeton university press, 1992, p. 161, cité par Policar, op. cit. ; p. 119). Tamir ne précise pas si cette obligation porte sur les moyens ou sur les résultats, mais la logique cosmopolitique plaide en faveur des seconds. Par quoi Policar est amené à reconnaître qu’il s’agit là d’un « idéal régulateur ». [↩]
- Claude Lévi-Strauss, conférence intitulée « Race et culture » donnée à l’UNESCO, célébrant l’« Année internationale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale », 22 mars 1971 [↩]
- ibid. Ces réflexions recoupent étonnamment celles que Simone Weil consacrait à l’amour, qui n’est possible qu’à la condition de conserver à l’être aimé sa radicale étrangeté, alors même que cette étrangeté nous le rend nécessaire et nous enjoint de le consommer, de le réduire à une part essentielle de nous-mêmes.[↩]
- Ibid.[↩]
- Sur le point de savoir quelle philosophie politique se déduit des écrits de Lévi-Strauss, on pourra lire Wiktor Stockzkowski, « L’anthropologie rédemptrice de Claude Lévi-Srauss », in Etudes, 2010/4 (tome 412), p. 485-495.[↩]
- Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables, trad. Anna Gibson, Flammarion, 2000, p 283.[↩]
- Jared Diamond, Effondrement. Paris : Gallimard, 2009. Je pense en particulier à son analyse du système de contrôle des naissances de l’île de Tikopia, particulièrement sévère.[↩]