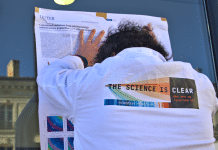A propos de Mark Hunyadi, La tyrannie des modes de vie, Bordeaux, Éditions Le Bord de l’eau, « Documents », 2015, 120 p.
« Tant de liberté, pour si peu de bonheur », chantait France Gall dans l’un de ses plus grands succès, Résiste. Le constat est juste, mais le remède proposé par le refrain laisse perplexe : « Prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste… Suis ton cœur qui insiste… Bats-toi, signe et persiste… » Comme on voit, le refus du monde égoïste s’exprime sur un mode extrêmement individualiste. Comment surmonter l’hiatus, entre l’étendue de la liberté d’un côté, l’étroitesse du bonheur de l’autre ? Réponse de la chanson : en renchérissant dans l’exercice de la liberté individuelle. Malheureusement, non seulement le remède n’est pas à la hauteur du problème mais, comme nous allons voir, il en est dans une certaine mesure l’aliment.
« Tant de liberté, pour si peu de bonheur… » Mais d’abord, de quelle liberté s’agit-il ? On connaît le contraste souligné par Benjamin Constant, entre liberté des anciens et liberté des modernes : « Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d’une même patrie : c’était là ce qu’ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées ; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances1. » Des libertés aussi différentes sont exposées à des maux eux-mêmes différents : « Le danger de la liberté antique était qu’attentifs uniquement à s’assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles. Le danger de la liberté moderne, c’est qu’absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique2. » Constant mettait donc en garde ses contemporains contre le retour d’une tyrannie à l’ancienne qui, en échange de la liberté accordée et de la sécurité garantie aux citoyens dans leurs affaires privées, les déposséderait de leurs droits politiques. La tyrannie, cependant, peut revêtir de multiples formes, et c’en est une autre que Mark Hunyadi voit régner de nos jours : la tyrannie des modes de vie.
Par « mode de vie », Hunyadi entend « l’ensemble des pratiques concrètes qui façonnent effectivement les comportements de chacun, en produisant des attentes auxquelles, pour se socialiser, les individus se conforment. […] Ainsi, on attend d’eux qu’ils travaillent, qu’ils consomment, qu’ils sachent s’orienter dans un univers technologique, qu’ils utilisent les moyens de télécommunication ; dans le milieu professionnel, on attend qu’ils soient performants, productifs, disciplinés, mais aussi évalués, comparés et, de plus en plus, autoévalués ; notre existence prend toujours davantage la forme d’un curriculum vitae, et il est attendu que notre commerce avec autrui se déroule dans le cadre du politiquement correct. Tout cela, et mille autres choses encore, visibles ou insidieuses, caractérisent notre mode de vie » (p. 44-45). De ce fait, « le petit espace privé sur lequel règne [l’individu] […] est un espace hautement contraint dans les choix qu’il laisse subsister : à l’image du salarié qui peut certes choisir d’avoir un compte dans la banque de son choix, mais qui ne peut pas choisir de ne pas avoir de compte » (p. 74).
La tyrannie des modes de vie n’est pas décrétée : elle est une conséquence de l’application consciencieuse des préceptes du libéralisme, selon lequel la société sera d’autant meilleure que les autorités s’abstiendront de délibérer sur la vie bonne, et se contenteront de promouvoir et garantir les libertés individuelles. Mais quand chacun revendique pour lui-même la plus grande des libertés, des millions de ces libertés juxtaposées composent un monde qui s’impose à chaque individu et sur lequel ce dernier n’a pratiquement aucune prise, réduit qu’il est à n’être qu’un parmi la foule. En son temps, Tocqueville avait remarqué, parlant de l’homme américain, que « cette même égalité qui le rend indépendant de chacun de ses concitoyens en particulier, le livre isolé et sans défense à l’action du plus grand nombre3 ». Hunyadi prolonge le constat, en explicitant la façon dont cette action s’exerce : « L’accomplissement des libertés individuelles conduit à la tyrannie des modes de vie » (p. 104). Tyrannie diffuse, mais d’autant plus prégnante – et que, au point où nous en sommes, chaque nouveau droit accordé à l’individu ne fait que renforcer : « La victoire de l’individu, consacrée par le triomphe du modèle des libertés individuelles, c’est la victoire du système » (p. 52). Libéré des anciennes tutelles, l’individu voit les contraintes revenir sur lui sous la forme des modes de vie imposés, qui pèsent sur lui comme un nouveau destin.
Que dit l’éthique en pareille conjoncture ? Aujourd’hui, à peu près rien. En grec ancien, ethos signifiait habitude, coutume, usage, mœurs – de même que mos en latin, mot d’où est issu notre morale. Mais de nos jours, l’éthique a déserté le terrain des modes de vie : en conformité avec l’idéologie libérale, elle est devenu ce que Hunyadi appelle une éthique restreinte, ou « Petite éthique », aussi obnubilée par les principes auxquels toute action devrait se conformer, qu’insoucieuse du monde qui résulte concrètement de ces actions. « En partant de l’idée que chaque initiative prise individuellement est bonne parce que respectueuse des principes de la Petite éthique, [on] conclut mécaniquement que le résultat final, issu d’une addition de telles initiatives individuelles, sera lui-même bon. Bon par simple transitivité, en quelque sorte : non pas bon parce que conforme à ce que l’on souhaite explicitement, mais bon parce que résultant mécaniquement de facteurs qui, pris chacun individuellement, sont bons » (p. 102-103). Pourtant, le fait que le résultat global serait juste et bon dès lors que les actions qui y contribuent, prises individuellement, respecteraient certains principes, n’a rien d’assuré : en fait « nous pourrions aboutir à une situation qui serait parfaitement juste du point de vue de la Petite éthique […] et néanmoins parfaitement pathologique du point de vue des conditions sociales d’existence » (p. 104). Mais rien n’y fait : ce que Hunyadi nomme « l’idolâtrie des libertés individuelles » rend la réflexion éthique incapable de prendre en compte les effets néfastes que ces libertés, laissées à elles-mêmes, exercent sur le monde commun – y compris quand, au nombre de ces effets, il faut compter une restriction du champ réellement ouvert aux individus, enserrés qu’ils sont dans les modes de vie comme le cardinal La Balue dans sa cage. « Que la vénération des libertés individuelles conduise à cela même qui les nie, en imposant également à tous des modes de vie non choisis, […] voilà ce que refuse de voir la Petite éthique dont l’éthique minimale4 est le superlatif » (p. 101).
Hunyadi relève ce paradoxe : d’un côté l’éthique est partout (pas un domaine d’activité qui n’ait son éthique dédiée), de l’autre les modes de vie, qui façonnent nos vies au premier chef, échappent à toute évaluation éthique (car une telle évaluation, en prétendant imposer dans l’espace public une certaine conception du bien, porterait atteinte à l’égale considération dont tous les points de vue doivent bénéficier). En fait, le paradoxe n’en est pas un, dans la mesure où l’éthique qu’on met partout, censée protéger l’individu des empiètements du système, est précisément celle qui entretient le système général et le met à l’abri de toute remise en cause : « L’éthique, à chaque fois comprise comme un système de quelques règles à respecter, avalise le système dans son ensemble » (p. 24). Il est vrai que « par la promotion libérale des droits individuels, chacun d’entre nous se trouve aujourd’hui garanti et protégé dans son statut comme jamais auparavant dans notre civilisation ». Mais la médaille a son revers : « L’avènement de l’individu est simultanément la meilleure garantie pour les systèmes instrumentaux – économiques, financiers, technoscientifiques – désormais mondialisés de pouvoir déployer à leur guise des réseaux complexes face auxquels les individus, mais aussi les communautés ou les États, se trouvent politiquement et éthiquement démunis. C’est de cela que se rend objectivement complice l’éthique des principes, véritable opérateur paradoxal : favorisant l’accès de chacun à tout un ensemble de droits devant nous permettre d’habiter le monde selon nos préférences respectives, elle nous rend simultanément étrangers au monde que nous devons habiter. […] À l’universalité proclamée des droits humains correspond la globalisation effective des systèmes inhumains » (p. 35-36).
Si une démocratie authentique se doit de défendre les droits de chacun de ses membres, il revient également au demos de délibérer sur la forme de vie générale qu’il entend se donner. Pourquoi les démocraties modernes renoncent-elles à cette tâche ? Il faut, bien entendu, compter avec l’influence des détenteurs du capital, qui ont tout intérêt à avoir les mains parfaitement libres au moment d’investir dans les activités qu’ils jugent les plus rentables – quand bien même ces activités laisseraient le monde et les hommes exsangues. Il faut aussi reconnaître que les démocraties modernes se ressentent du climat protestataire dans lequel elles sont nées, qui les a menées à davantage se soucier des formes à combattre que de celles qu’il convenait d’adopter. Comme l’a écrit Bergson, « chacune des phrases de la Déclaration des droits de l’homme est un défi jeté à un abus. […] Les formules démocratiques, énoncées d’abord dans une pensée de protestation, se sont ressenties de leur origine. On les trouve commodes pour empêcher, pour rejeter, pour renverser ; il est moins facile d’en tirer l’indication positive de ce qu’il faut faire5 ». Autant l’oubli des droits individuels est désastreux, autant leur règne exclusif est la ruine de toute politique. Jean-Claude Michéa n’a, cessé, au fil de son œuvre, d’attirer l’attention sur ce point, encore souligné dans son dernier ouvrage en date : « Bien entendu, un débat de type philosophique – prenant donc en compte les effets politiques, économiques, psychologiques ou moraux de telle ou telle revendication sur la vie commune – pourrait permettre dans la plupart des cas (à condition, du moins, d’être organisé démocratiquement) de s’accorder sur une distinction raisonnable entre ce qui constitue clairement un véritable progrès social et humain et ce qui ne représente, au contraire, qu’une expression de la décomposition marchande du lien social (voire, dans certains cas, un pur et simple délire idéologique). Mais c’est justement un tel type de débat qu’une approche exclusivement juridique de ces “problèmes de société” – la seule qui soit conforme au principe libéral de “neutralité axiologique” – exclut d’avance et par principe6. »
Cette incapacité à se prononcer sur ce qui est souhaitable pour la communauté politique dans son ensemble, au-delà de l’extension des droits reconnus à chaque citoyen, est particulièrement criante en ce qui concerne les innovations techniques. Prenons, par contraste, le cas des Amish. Ceux-ci ne sont pas hostiles à la technique. Ils osent simplement se demander si un dispositif mérite ou non d’être adopté en regard du bien commun qu’ils poursuivent. Ainsi, « toutes les nouvelles techniques sont soumises à la question de base : “Est-ce que cela renforcera le tissu de notre communauté, ou au contraire le desservira ?” Ils ont estimé que l’automobile et l’électricité seraient nuisibles (tandis que les appareils utilisant le propane ont été approuvés)7. » Si les Amish peuvent ici être donnés en exemple, ce n’est pas en tant qu’ils faudrait souscrire à leurs jugements sur les techniques, c’est en tant qu’ils se permettent d’exercer leur jugement à propos des techniques, au lieu de les accepter indistinctement, quelles que soient leurs conséquences sur le corps social. De quoi disposons-nous, face au déferlement technologique ? Du seul « principe de précaution ». Principe bon en lui-même, certes, mais qui, en l’état actuel des choses, a aussi un grave défaut : « Il invite à n’appréhender les actions techniques qu’à travers les seules lunettes du risque. Ce sont assurément des lunettes indispensables […]. Mais tout se passe comme si, une fois chaussées, ces lunettes délivraient ensuite de la responsabilité d’évaluer les techniques et les modes de vie qu’elles entraînent à un autre critère qu’à celui des risques » (p. 23). Critère manifestement insuffisant, lorsqu’on mesure qu’au cours des dernières décennies les changements les plus considérables dans la vie humaine ont été induits par des innovations technologiques, dont l’opportunité n’a jamais été discutée. Pour certains, prohiber telle ou telle technique au nom des effets, jugés funestes, que son déploiement aurait sur les modes de vie, serait attentatoire aux libertés (en vertu de l’identification déjà signalée entre liberté et libertés individuelles), contraire à la démocratie (quand bien même une démocratie des seuls droits individuels réduit le corps social en tant que tel à l’impuissance). En vérité, loin que le souci des modes de vie contredise la démocratie, « c’est au contraire si elle persistait à rester muette face à ce qui nous touche le plus directement qu’elle s’étiolerait et deviendrait une coquille vide » (p. 94). Hunyadi le dit clairement : « Il faut briser la neutralité éthique de notre éthique publique. Cette neutralité, mise en place pour protéger les individus, protège en fait le système » (p. 99-100). Et encore : « Il faut rétablir la primauté du commun, quitte à demander aux libertés individuelles de s’ajuster à cette nouvelle hiérarchie des valeurs. Mais elles s’ajusteront en conscience à ce qui aura été publiquement exposé plutôt que de devoir subir le joug anonyme de modes de vie que personne n’a choisi, comme elle y est contrainte aujourd’hui » (p. 105).
Afin que la forme générale que prend le monde humain soit l’objet d’une réflexion et d’une délibération publiques, au lieu d’être reçue comme une fatalité à laquelle il ne reste qu’à s’adapter, Hunyadi préconise la mise en place d’un « Parlement des modes de vie ». Cette nouvelle instance se préoccuperait de ce qui devrait être au cœur de la politique, et qui en a été évacué : le monde commun. L’idée est séduisante. Sa mise en œuvre, en revanche, paraît problématique. L’échelle proposée est européenne. On comprend ce qui conduit à viser d’emblée une telle extension : dans un monde aussi interconnecté que le nôtre, les petites entités sont dans une situation comparable à celle des individus : elles ne disposent pas de l’autonomie suffisante pour choisir librement leurs modes de vie. Mais d’un autre côté, plus l’échelle augmente, plus la conscience communautaire nécessaire pour s’accorder sur des modes de vie souhaitables vient à manquer. Le fait que la question des modes de vie soit absente du champ politique est, pour une large part, le résultat d’une taille déjà excessive des nations modernes : en passant à l’échelle continentale, on gagne théoriquement en puissance d’agir, mais, en pratique, on réduit le pouvoir politique à presque rien, simplement parce que la population devient trop vaste pour pouvoir encore constituer, autrement que nominalement, un corps politique. Par ailleurs, Hunyadi imagine que c’est par l’intermédiaire d’internet que les citoyens seraient conviés à faire entendre leur voix au sein du Parlement des modes de vie. Mais de ce fait, la discussion se trouverait d’emblée extrêmement contrainte, puisque serait par principe admise l’existence d’internet, qui exerce des effets immenses sur les modes de vie et présuppose pour fonctionner à peu près toute l’infrastructure industrielle.
Le grand mérite du livre de Hunyadi est de nous faire comprendre la nature du piège dans lequel nous sommes pris : c’est l’absence, au nom de la liberté individuelle, de toute définition collectivement assumée de la vie bonne qui induit la tyrannie des modes de vie, et la réduction drastique du champ d’expression de la liberté individuelle qui en résulte. La compréhension du piège ne suffit malheureusement pas à nous en extraire. Pour autant, le propos de Hunyadi est tout sauf vain. Dans une lettre à Friedrich Immanuel Niethammer, Hegel écrivait : « Le travail théorique, j’en suis chaque jour plus convaincu, réussit mieux dans le monde que le travail pratique ; dès qu’une révolution se produit dans le royaume de la représentation, la réalité effective ne tient plus en place8. » Sans souscrire à pareil idéalisme, on peut convenir qu’agir sur la réalité passe aussi par l’élaboration de représentations adéquates. C’est à cette tâche que l’ouvrage de Hunyadi participe.
1 « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », discours prononcé à l’Athénée royal de Paris en 1819, in Benjamin Constant, Écrits politiques, éd. Marcel Gauchet, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1997, p. 603.
2 Id., p. 616.
3 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835-1840), 2 vol., Paris, Flammarion, coll. « GF », 1981, t. 2, p. 17 (II, 1ère partie, chap. II).
4 En référence aux positions défendues par Ruwen Ogien, notamment dans La Panique morale (Paris, Grasset, 2004) et L’Éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes (Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2007). L’éthique minimale veut assumer pleinement l’individualisme libéral, en recommandant, entre autres, une stricte neutralité à l’égard des conceptions du bien personnel.
5 Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932), Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2005, p. 301. Sur ce sujet on peut lire l’ouvrage de Marcel Gauchet, La Démocratie contre elle-même (Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2002). Gauchet écrit dans son avant propos : « Nous nous trouvons désormais devant une entente majoritaire de la démocratie qui sacralise à ce point les droits des individus où elle se fonde qu’elle sape la possibilité de leur conversion en puissance collective. Une démocratie qui joue donc […] une partie d’elle-même contre l’autre, ses bases juridiques contre leur expression politique, son principe générateur contre le gouvernement effectif d’elle-même » (p. XXVII).
6 Le Loup dans la bergerie. Droit, libéralisme et vie commune, Paris, Climats, 2018, p. 32-33.
7 Patrick Deneen, Why Liberalism Failed, New Haven/Londres, Yale University Press, 2018, p. 106.
8 Lettre du 28-29 octobre 1808 (Briefe von und an Hegel, éd. Johannes Hoffmeister, 4 vol., Hambourg, Felix Meiner Verlag, 1952-1954, t. I, p. 253).